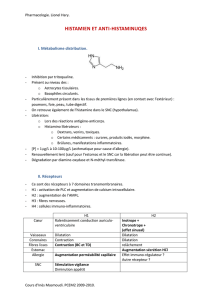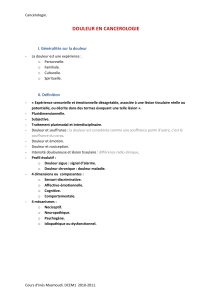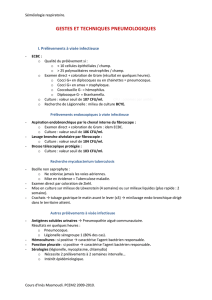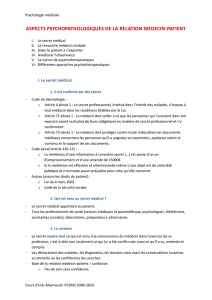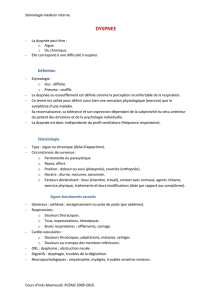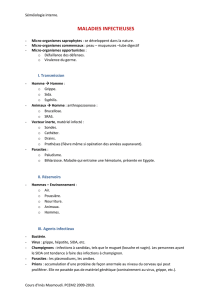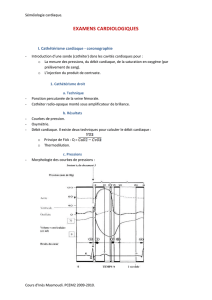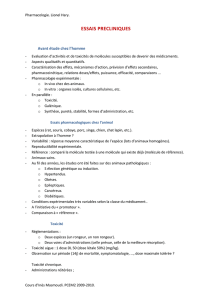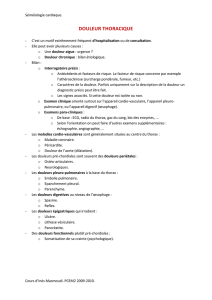V. Les afférences du SNA - Cours de PCEM2 2009/2010 à Amiens

Neurophysiologie.
Cours d’Inès Masmoudi. PCEM2 2009-2010.
ORGANISATION ANATOMO-FONCTIONNELLE DU SYSTEME NERVEUX
AUTONOME
I. Définition et généralités
- Le système nerveux autonome (SNA) est également appelé SN viscéral ou SN végétatif ou SN
involontaire.
- Le système nerveux somatique (SNS) tient sous sa dépendance les fonctions de la vie de
relation, c'est-à-dire :
o Les fonctions motrices.
o Les fonctions sensorielles.
Il est susceptible de fournir des réponses volontaires de l’organisme face au milieu extérieur.
Les effecteurs du SN somatiques pour les fonctions motrices sont les muscles squelettiques.
- Le SNA module et régule les fonctions végétatives : ce sont les fonctions commune au règne
végétal et animal. Elles permettent de maintenir la stabilité intérieure adaptée au milieu
extérieure : c’est l’homéostasie. La notion d’homéostasie a était introduite au début du XXème
siècle par Claude Bernard.
- Les différentes fonctions homéostatiques sont :
o L’équilibre électrolytique.
o Le métabolisme.
o Le volume.
o Le pH.
o La composition sanguine.
o La température.
o La pression artérielle.
Ces fonctions vont faire intervenir entre autre le système cardiovasculaire et le système
respiratoire.
- Le système endocrinien (SE) régule également des fonctions homéostatiques (le SNA n’est donc
pas le seul).
- Le SNA, pour réguler les fonctions homéostatiques, utilise les effecteurs suivant :
o Les muscles lisses (des viscères creux et des vaisseaux).
o Le myocarde.
o Les glandes et les cellules sécrétrices.
- Le SNA fonctionne surtout de façon autonome, reflexe, inconsciente mais il est sous la
dépendance d’une partie du système nerveux (incluse dans le SNC).
- Il peut solliciter certaines fonctions végétatives pouvant être sous le contrôle de la volonté (telles
que la miction et la défécation). D’autres fonctions (telles que la respiration) fonctionnent de
manière reflexe mais peuvent être contrôlés (on peut prendre des inspirations plus fortes).
- Par contre certaines fonctions (telles que le système cardiovasculaire) ne peuvent absolument
pas être sous contrôle.

Neurophysiologie.
Cours d’Inès Masmoudi. PCEM2 2009-2010.
- Le SNA fournit des réponses rapides (ordre de la seconde) mais de courte durée.
Les réponses du SNS sont plus rapides (ordre de la milliseconde).
Les réponses du SE sont moins rapides (ordre de l’heure) mais plus durable dans le temps.
- En cas d’atteinte du SNA, il n’y a pas un arrêt de l’organe innervé mais un dysfonctionnement.
Au contraire, en cas d’atteinte du SNS il y a une perte de fonction de l’organe innervé.
II. Organisation générale du SNA
- Le SNA se divise en deux sous-systèmes :
o Le SN orthosympathique.
o Le SN parasympathique.
- Le SN parasympathique assure le contrôle et la modulation des fonctions végétatives dans les
conditions habituelles de fonctionnement de l’organisme. On dit qu’il travaille pour la trophicité
de l’organisme (maintient de l’intégralité des tissus), il est trophotrope.
Il prédomine pour le métabolisme et la constitution des réserves dans les conditions ordinaires.
- Le SN sympathique travaille aussi pour la trophicité de l’organisme mais sa spécificité est qu’il
travaille également en urgence en cas de stress, les réactions qu’il engendre consomment alors
de l’énergie. On dit qu’il est ergotrope.
- La majorité des organes sont doublement innervés : ils reçoivent une innervation par
l’orthosympathique et une innervation par le parasympathique qui ont un effet opposé.
- Du point de vue anatomique, puisque le système travaille de manière reflexe, il y a des
afférences (qui apportent l’information sur l’état d’un système régulé). On ne distingue pas
d’afférences spécifiques des SN orthosympathique ou parasympathique.
- Il y a également des efférences qui seront incluses soit dans le SN orthosympathique soit dans le
SN parasympathique.
La particularité du SNA par rapport au SNS est sur les efférences :
o L’efférence du SNS se fait grâce à un seul motoneurone α (dont le corps cellulaire est
dans la corne antérieure de la moelle épinière), il n’y a pas de relais.
o La voie de sortie du SNA comporte elle deux neurones :
o Un neurone connecteur (ou pré-ganglionnaire) dont le corps cellulaire est situé
dans le SNC.
o Un neurone effecteur (ou post-ganglionnaire) en dehors du SNC. Sont corps
cellulaire est appelé ganglion.
III. Le système sympathique efférent
1. Les centres
- Les centres des neurones connecteurs (=corps cellulaires des neurones pré-ganglionnaires) sont
dans la moelle épinière (entre Th1 et L3), plus précisément dans la partie inter-médio-latérale de
la substance grise.
- Ils sont nombreux, il y en a environ 5000 par segment.

Neurophysiologie.
Cours d’Inès Masmoudi. PCEM2 2009-2010.

Neurophysiologie.
Cours d’Inès Masmoudi. PCEM2 2009-2010.
2. Les ganglions
- Les ganglions (= les corps cellulaires des neurones effecteurs) sont situés :
o Soit dans la chaîne latéro-vertébrale.
o Soit dans les ganglions pré-vertébraux.
- Les chaînes latéro-vertébrale est segmentaire :
o 3 ganglions cervicaux :
o Un ganglion cervical supérieur (très volumineux) à hauteur de C2, correspond à
la fusion des ganglions C1 à C4.
o Un ganglion cervical moyen, correspondant à la fusion des ganglions C5 et C6.
o Un ganglion cervical inférieur appelé également ganglion stellaire,
correspondant à la fusion des ganglions C7 à Th1.
o 12 ganglions thoraciques.
o 5 ganglions lombaires.
o 3 ganglions sacrés.
- Les neurones effecteurs qui ont un relais dans la chaîne latéro-vertébrale innervent :
o Les glandes sudoripares.
o Les vaisseaux.
o Les muscles pilo-constricteurs.

Neurophysiologie.
Cours d’Inès Masmoudi. PCEM2 2009-2010.
- Jusqu’en Th5, il y a un relais dans la chaîne latéro-vertébrale également pour l’innervation
orthosympathique de :
o L’œil.
o Les glandes lacrymales, nasales et salivaires.
o Le cœur.
o L’arbre trachéo-bronchique.
- En dessous de Th5, il n’y a plus de relais ganglionnaire dans la chaine orthosympathique latéro-
vertébrale, les neurones connecteurs ne font que passer par la chaîne latéro-vertébrale.
- Les relais sont ensuite pris au niveau des plexus pré-vertébraux correspondant aux:
o Ganglion cœliaque.
o Ganglion mésentérique supérieur.
o Ganglion mésentérique inférieur.
- Les neurones effecteurs y naissant innervent ensuite :
o Les muscles lisses du tube digestif (ganglion cœliaque).
o Les reins, la vessie (ganglion mésentérique supérieur).
o Les organes génitaux externes (ganglion mésentérique inférieur).
- Les médullosurrénales sont la partie centrale des glandes surrénales (situées au dessus des
reins). Ce sont glandes endocrines qui secrètent l’adrénaline et la noradrénaline et qui
reçoivent une innervation orthosympathique.
- La sécrétion peut être activée par la mise en jeu du SN orthosympathique, les hormones ont ainsi
pour rôle de répandre dans le sang un effet diffus qui atteint tous les récepteur du SN
orthosympathique.
- Le médullosurrénal est donc une sorte de ganglion orthosympathique avec des cellules
sécrétrices d’hormones à la place de neurones.
3. Les axones pré-ganglionnaires et post-ganglionnaires
- Les neurones pré-ganglionnaires ont leur corps cellulaire naissant dans la partie inter-médio-
latérale de la substance grise. L’axone passe ensuite dans la branche antérieure du N. rachidien
puis dans le N. rachidien. Enfin ils rejoignent la chaine latéro-vertébrale.
- Dans certains cas la synapse avec le neurone post-ganglionnaire ne se fait pas au même niveau
métamérique d’où il est sorti mais il remonte ou il descend à un autre niveau.
- Dans d’autres cas, l’axone pré-ganglionnaire peut ne faire que passer dans le ganglion pré-
vertébral.
- Les axones pré-ganglionnaires sont majoritairement myélinisés. Ce sont eux qui donnent sa
teinte au rameau communiquant blanc (RCB).
- A l’inverse le rameau communicant gris (RCG) contient des axones post-ganglionnaires (jamais
myélinisés).
- Ces neurones sont divergent : un neurone pré-ganglionnaire contact plusieurs neurone post-
ganglionnaires pour une réponse plus diffuse.
- Dans le SN orthosympathique, le relais se fait près des centres (inverse du SN parasympathique
où le relais se fait près des organes effecteurs), on retrouve donc :
o Des neurones pré-ganglionnaires avec des axones courts.
o Des neurones post-ganglionnaires avec des axones longs.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%