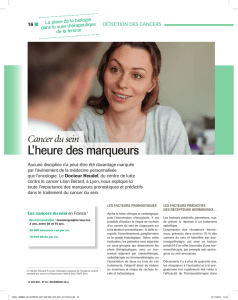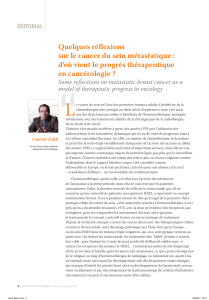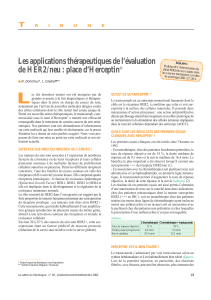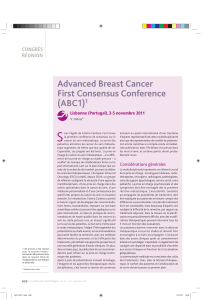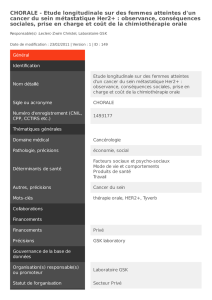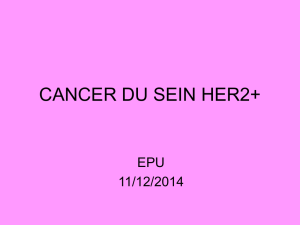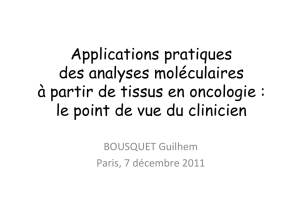Compte rendu des Premières Universités d’été des thérapies ciblées R

La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 8 - octobre 2007
Réunion
Réunion
373
Compte rendu des Premières Universités d’été
des thérapies ciblées
Montpellier, 6 et 7 juillet 2007
●● Organisateur local : David Azria
D’après les présentations de C. Sotiriou, H. Roché, J. Gligorov, W. Jacot, X. Pivot, A. Pèlegrin, M.C. Étienne, J.Y. Blay, J.P. Spano, L. Zelek,
F. Bibeau, B. Coudert, C. Hennequin, C. Lafont, P. Goss
recueillies par le Dr N. Charbonnier
SOUSTYPES MOLÉCULAIRES DES CANCERS
DU SEIN : LES FONDAMENTAUX
C. Sotiriou Bruxelles
La génomique et le développement des technologies de
microarrays, méthodes d’expression des gènes, permettent au
fi l du temps de mieux comprendre les mécanismes biologiques
impliqués à l’échelle moléculaire dans le cancer du sein.
Nouvelle classifi cation moléculaire du cancer du sein
À partir des résultats d’études menées avec les technologies de
microarrays, quatre grands sous-types moléculaires de cancer du
sein ont été identifi és : les basal-like et les HER2+, caractérisés
par un faible niveau ou une absence d’expression des récepteurs
des estrogènes, et les luminaux A et B, tumeurs exprimant des
récepteurs des estrogènes. Cette classifi cation est intéressante
sur le plan pronostique, avec des taux de survie à 6 ans supé-
rieurs à 80 % et 50 % respectivement pour les lumimaux A et B,
et des taux de survie à 3 ans pour les basal-like et les HER2+
inférieurs à 40 %.
Identifi cation croissante
de signatures moléculaires pronostiques
Deux grandes études ont recherché la valeur pronostique de
signatures moléculaires (signature d’Amsterdam avec 70 gènes et
signature de Rotterdam avec 76 gènes) chez des patientes N-. Une
corrélation signifi cative a été mise en évidence entre l’expression
de ces gènes, la survenue de métastases dans les 5 ans et la survie,
permettant de diff érencier deux types de populations en fonction
du pronostic. Récemment, le travail du TRANSBIG (réseau de
recherche translationnelle multidisciplinaire européen), mené chez
302 patientes N- non traitées et suivies durant 13,6 ans (médiane),
a permis la validation de ces deux signatures pronostiques (délai
d’apparition de métastases à distance et survie globale). Au vu de
ces données, deux études prospectives portant sur des patientes
atteintes d’un cancer du sein N-, l’étude TAILORx, initiée par le
National Cancer Institute (NCI), et l’étude MINDACT, coor-
donnée par la European Organisation for Research and Treatment
of Cancer (EORTC), ont été mises en place.
Quatre grands sous-types pronostiques
Une méta-analyse incluant toutes les données existantes en
matière de profil génétique du cancer du sein a été menée
(18 études, 2 865 patientes atteintes d’un cancer du sein). L’ana-
lyse des gènes impliqués dans cinq grands modules (récepteur
des estrogènes, HER2, prolifération, invasion tumorale, réponse
immunitaire) a permis d’identifier 4 sous-types différents :
ER-/HER2-, HER2+, ER+ et indice bas de prolifération, ER+
et indice élevé de prolifération). Le module ER+/indice bas
de prolifération représente le meilleur pronostic en termes de
survie, suivi du module ER+/indice élevé de prolifération, du
module ER-/HER2- et du module HER2+.
La prolifération, un facteur pronostique majeur
Parmi les 524 gènes récemment identifi és comme étant corrélés
à la survie, 65 % paraissent impliqués dans la prolifération cellu-
laire. L’expression de gènes de prolifération constitue donc un
facteur clé sur le plan pronostique dans le cancer du sein.
L’avenir, c’est aussi la prédiction
Des gènes impliqués dans la réponse au traitement de la sensi-
bilité thérapeutique hormonale, au trastuzumab et à la chimio-
thérapie (docétaxel, paclitaxel- FAC [5-FU, cyclophosphamide
et doxorubicine] ou CMF [cyclophosphamide, méthotrexate
et 5-FU] dans les tumeurs RE+) ont été identifiés. L’avenir
consistera à identifi er précisément des signatures prédictives
qui permettront le choix éclairé d’une stratégie thérapeutique
en fonction du profi l moléculaire de la tumeur. Le futur, c’est
aussi le micro-environnement tumoral, dont on commence
à cerner le rôle dans la réponse en situation néoadjuvante et
métastatique.
Les progrès des connaissances en biologie moléculaire dans
le cancer du sein devraient permettre dans le futur de savoir à
quelles patientes proposer un traitement adjuvant et, lorsque
ce traitement est indiqué, de proposer une véritable stratégie
personnalisée.
SOUSTYPES MOLÉCULAIRES DES CANCERS
DU SEIN : IMPLICATIONS EN PRATIQUE
H. Roché Toulouse
Le typage moléculaire, s’il constitue un apport supplémentaire,
ne bouleverse pas pour l’instant l’approche anatomoclinique. Il
s’agit encore d’une classifi cation expérimentale dont l’étalonnage,
la reproductibilité et les modalités devront être précisés.
Comme pour tous les sous-groupes,
les luminaux A et les lumi-
naux B
nécessitent des critères d’identifi cation applicables à la

▸▸▸/▸▸▸
La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 8 - octobre 2007
Réunion
Réunion
374
clinique. Leurs caractéristiques, leur évolution, leur sensibilité
aux traitements, les rechutes, etc., aujourd’hui mal cernées,
devront faire l’objet d’études spécifi ques.
Malgré les multiples travaux menés sur le
cancer du sein HER2+
,
nombre de questions restent en suspens : l’identifi cation IHC
et/ou FISH est-elle suffi sante ? Comment prédire un échec au
trastuzumab ? Quels critères de choix en faveur du trastuzumab
ou du lapatinib ? Faut-il eff ectuer la recherche d’expression de
topo-isomérase II ? Le bénéfi ce des anti-HER2 est-il limité aux
tumeurs HER2+ ?, etc.
Les cancers de type triple négatif
doivent être diff érenciés des
basal-like. T.O. Nielsen et al. ont montré que l’étude de l’expres-
sion de RE, HER1, HER2, CK5/6 pourrait suffi re pour défi nir
ce sous-groupe des basal-like. De moins bon pronostic que les
autres tumeurs, les tumeurs de type triple négatif semblent
bénéfi cier plus particulièrement d’une chimiothérapie adjuvante
par 3 FEC (5-FU, cyclophosphamide et épirubicine), suivie de
3 cures de docétaxel ou d’une chimiothérapie à fortes doses
(Rodenhuis S et al., 2006).
En l’état actuel des connaissances, la présence de récepteurs
hormonaux, la surexpression de HER2 et un grade histologique
de niveau 3 restent des facteurs prédictifs de choix. Sur le plan
pronostique, l’étude de E. Mamounas et al. (SABCS, 2005) a
montré l’existence d’une corrélation signifi cative entre le score
de récidive défi ni à partir du système Oncotype DX™ chez des
patientes N-/RE+ et le risque de rechute locorégionale ; l’associa-
tion d’une hormonothérapie et d’une chimiothérapie permet de
réduire signifi cativement les scores de rechute, et ce dans tous
les cas, quel que soit le niveau initial de score de récidive.
En pratique, la classifi cation moléculaire sera à l’avenir proba-
blement très utile pour identifi er des sous-groupes particuliers,
en complément des facteurs classiques, et orientera les choix
thérapeutiques.
ANTIHER : ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES
DE DÉVELOPPEMENT
J. Gligorov (Paris)
Thérapeutiques anti-HER2 (trastuzumab)
en situation métastatique
Dans la revue récente réalisée par C.A. Hudis (NEJM, 2007),
les données de trois essais thérapeutiques menés avec le
trastu-
zumab en monothérapie
chez des patientes présentant un
cancer du sein métastatique prétraité et HER2+ (évaluation
par immunohistochimie [IHC] simplement) indiquent des taux
de réponse variant de 11 à 26 % (doses et durée du traitement
diff érentes d’une étude à l’autre). Les résultats des deux études
pivots, menées par D.J. Slamon et al. et par M. Marty et al. avec
l’asso ciation
chimiothérapie-trastuzumab
en traitement de
première ligne chez des patientes HER2+ jusqu’à progression de
la maladie, ont constitué une vraie révolution, démontrant pour
la première fois en situation métastatique un allongement signi-
fi catif de la survie globale, et la possibilité de modifi er l’histoire
naturelle de la maladie (tableau).
Tableau.
E cacité de l’association chimiothérapie-trastuzumab :
résultats des deux études pivots.
Étude
et résultats
nals
Chimiothérapie Chimiothérapie
et trastuzumab p
D.J. Slamon et al.
Nombre
de patients
234 (doxorubicine
et cyclophosphamide
ou paclitaxel)
235 (doxorubicine
et cyclophosphamide
ou paclitaxel)
Temps jusqu’à
progression
(mois)
4,6 7,4 < 0,001
Taux de réponse
(%) 32 50 < 0,001
Médiane
de survie
globale (mois)
20 25 0,046
M. Marty et al.
Nombre
de patients 94 (docétaxel) 92 (docétaxel)
Temps jusqu’à
progression
(mois)
6,1 10,7 0,001
Taux de réponse
(%) 34 61 0,001
Médiane
de survie
globale (mois)
23 31 0,032
Un grand nombre d’études de phase II menées avec le trastu-
zumab associé à différentes chimiothérapies montre qu’il
existe des associations synergiques et peu toxiques comme,
par exemple, les associations au docétaxel, à la vinorelbine ou
encore à la capécitabine. Mais aucune comparaison directe n’a
été réalisée à ce jour, de sorte qu’aucune association ne peut
être considérée comme supérieure à une autre. L’association
au trastuzumab d’une chimiothérapie comprenant des sels de
platine et du paclitaxel est aussi probablement intéressante.
Pour la pratique, on retiendra les recommandations de Saint-
Paul-de-Vence (Oncologie, 2005).
Dans l’étude TANDEM, qui a comparé l’anastrozole seul à
l’asso-
ciation anastrozole-trastuzumab
, un allongement de la survie
sans progression (p = 0,0016) et de meilleurs taux de réponse
objective (6,8 % versus 20,3 % ; p = 0,018) ont été obtenus avec le
traitement combiné. Ces résultats ont permis l’obtention d’une
nouvelle AMM en traitement de première ligne métastatique.
Faut-il maintenir la pression sur les récepteurs HER2 après
progression ?
L’ensemble des données rétrospectives relatives au
trastuzumab sont en faveur de la poursuite du traitement au-delà
de la progression de la maladie, faisant apparaître dans ce cadre
un bénéfi ce en termes de survie. Le blocage en deuxième ligne
des récepteurs HER2 par le lapatinib, qui permet une augmen-
tation du taux de réponse et un allongement de la survie sans
progression, confi rme l’importance du maintien de la pression
sur les récepteurs HER2.

100
80
60
Survie sans progression
0
HR = 0,48 ; p < 0,0001
Paclitaxel (n = 354)
Bévacizumab + paclitaxel (n = 368)
10 20
6,7 13,3
30
Mois 40
40
02
0
Figure 1.
Paclitaxel-bévacizumab : temps jusqu’à progression
(étude E2100).
▸▸▸/▸▸▸
La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 8 - octobre 2007
Réunion
Réunion
377
Dans le cancer du sein métastatique, le trastuzumab reste le
traitement de référence pour bloquer les récepteurs HER2 quelle
que soit la ligne de traitement, aucune étude clinique évaluant
diff érentes stratégies anti-HER2 n’ayant mis en évidence à ce
jour de résultats équivalents.
Thérapeutiques anti-HER2
en situation non métastatique
Comme l’ont montré B. Coudert et al. dans leur récente publica-
tion (JCO, 2006), des taux élevés de réponse objective, supérieurs
à 20 % et avoisinant même parfois les 40 %, ont été rapportés avec
le
trastuzumab en néoadjuvant
chez des patientes HER2+.
L’actualisation des données provenant des cinq grands essais
randomisés de phase III menés avec le
trastuzumab en situa-
tion adjuvante
, quels que soient la chimiothérapie associée, les
schémas utilisés et la durée du traitement, confi rme son effi cacité
à ce stade de la maladie, avec une amélioration signifi cative
tant de la survie sans récidive (environ 50 %) que de la survie
globale. En ce qui concerne le profi l de tolérance cardiaque,
l’incidence d’une insuffi sance cardiaque reste stable au cours
du temps, de 1 à 3 %. La tolérance cardiaque du trastuzumab
est diff érente de celle observée avec les anthracyclines : absence
de toxicité cardiaque cumulative ou dose-dépendante, absence
de toxicité au niveau du cardiomyocyte et toxicité réversible.
De nouvelles recommandations viennent d’être publiées par
l’American Society of Clinical Oncology (ASCO).
Thérapeutiques anti-HER dans le cancer du sein :
réalité clinique et perspectives de développement
Des résultats décevants ont été obtenus avec l’utilisation
d’anti-HER1/epidermal growth factor receptor (EGFR) [erlo-
tinib, gefi tinib] dans le cancer du sein. La voie actuellement
explorée est celle du blocage de l’hétérodimérisation de HER2
avec le pertuzumab, effi cace même en l’absence de surexpres-
sion de HER2 et agissant en synergie avec un traitement par
trastu zumab.
THÉRAPEUTIQUES CIBLANT LE COUPLE VEGF/
VEGFR EN ONCOLOGIE MAMMAIRE
W. Jacot (Montpellier)
Ciblage du VEGF
Le bévacizumab (Avastin
®
), dont l’effi cacité a déjà été mise en
évidence dans diff érentes indications, fait l’objet d’un développe-
ment de très grande envergure. Plusieurs travaux menés afi n de
mieux comprendre son mécanisme d’action ont permis d’iden-
tifi er trois grandes étapes : à une phase précoce du traitement,
régression des néovaisseaux tumoraux et normalisation de la
vascularisation tumorale, puis, ultérieurement, inhibition de
la croissance tumorale et de la néovascularisation.
Une première étude de phase III a été initiée afi n de comparer
l’effi cacité et la tolérance de l’association bévacizumab-capécita-
bine versus capécitabine seule chez des 462 patientes présentant
un
cancer du sein métastatique déjà prétraité
. Des taux de
réponse objective importants, respectivement de 19,8 % et 30,2 %
(selon l’évaluation par le comité de relecture et par l’investiga-
teur), ont été obtenus avec le traitement combiné, supérieurs
à ceux obtenus avec la capécitabine seule, mais il n’a pas été
retrouvé de diff érence entre les deux bras concernant la survie
sans progression et la survie globale. La toxicité du bévacizumab
dans cette étude a été minime, principalement représentée par
une hypertension artérielle (15 à 20 %, grade 3). Le VEGF étant
l’un des facteurs les plus précoces impliqué dans l’angiogenèse,
des essais avec le bévacizumab ont été depuis mis en place à
des stades moins avancés, en première ligne métastatique et en
situation néo adjuvante.
Les résultats de l’étude E2100, menée en
traitement de première
ligne métastatique
dans le cancer du sein chez 715 patientes, ont
montré une augmentation du taux de réponse objective (36,2 %
versus 16,4 %) et un allongement très important de la survie sans
progression de 6,6 mois (13,3 mois versus 6,7 mois ; p < 0,0001)
dans le groupe traité par l’association paclitaxel- bévacizumab
(versus paclitaxel), et ce dans tous les sous-groupes étudiés
(fi gures 1 et 2). Un allongement de la survie médiane, bien que
non signifi catif, était également observé (p = 0,08).
Au cours d’une étude pilote menée en néoadjuvant auprès de
21 patientes présentant un cancer du sein invasif ou localement
avancé, l’association chimiothérapie-bévacizumab s’est révélée
intéressante : malgré un suivi médian bref de 26,9 mois, une
réponse complète a été observée dans 5 % des cas (une patiente),
et une réponse partielle dans 67 % des cas.
Ciblage du site tyrosine kinase du VEGFR
Les premières données relatives à l’effi cacité des inhibiteurs de
tyrosine kinase du VEGFR ne sont pas encore très convaincantes :
un bénéfi ce clinique de 16 % a été observé avec le sunitinib
(ASCO 2005) chez des patientes prétraitées pour un cancer

Paclitaxel (E2100)
Bévacizumab + paclitaxel hebdomadaire (E2100)
Docétaxel + doxorubicine (Nabholtz)
Doxorubicine + cyclophosphamide (Nabholtz)
Doxorubicine (Chan)
Docétaxel (Chan)
5-FU + doxorubicine + cyclophosphamide (Jassem)
Paclitaxel + doxorubicine (Jassem)
Docétaxel (Shaughnessy)
Docétaxel + capécitabine (Shaughnessy)
Paclitaxel toutes les 3 semaines (Albain)
Gemcitabine + paclitaxel (Albain)
TTP/PFS (mois)
Augmentation du TTP/PFS (mois)
TTP : temps médian jusqu’à progression ;
PFS : survie sans progression.
6,6
1,2
1,9
2,1
1,9
1,9
13,3
8,6
6,7
6,7
7,4
4,8
6,2
4,2
3,5
8,3
6,1
5,4
Comparaison des temps médians jusqu’à progression/survies sans progression
Étude pivots des protocoles ayant l’AMM dans le cancer du sein métastatique
Figure 2.
Temps sans progression : résultats des principaux protocoles dans le cancer du sein métastatique.
La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 8 - octobre 2007
Réunion
Réunion
378
du sein métastatique, associé à une toxicité hématologique
non négligeable (39 % de neutropénies de grade 3 et 15 % de
thrombocytopénie de grade 3).
Avec la découverte de ces nouveaux traitements antiangiogé-
niques, de nombreuses études de phase III ont été mises en
place en situation métastatique et adjuvante, dont les résultats
seront très attendus au cours de ces prochaines années. Les
tumeurs de type triple négatif et les tumeurs HER2+ pour-
raient bénéfi cier particulièrement de ces nouvelles approches
antiangiogéniques.
ANTIVEGF : PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
X. Pivot (Besançon)
De nombreux inhibiteurs de tyrosine kinase (TKi) ciblant spécifi -
quement le site tyrosine kinase du VEGFR sont en cours de déve-
loppement dans le cancer du sein, comme par exemple le sunitinib.
Les premières données obtenues chez 64 patientes atteintes d’un
cancer du sein, faisant état d’une réponse objective chez 6 des
7 patientes présentant une tumeur basale, constituent un rationnel
intéressant pour la poursuite de son développement dans les
cancers du sein de type triple négatif. L’utilisation des TKi reste
malgré tout limitée par leur profi l de tolérance, qui rend délicate
leur association à la chimiothérapie. Les résultats du sorafénib et
du vandetanib dans le cancer du sein sont décevants. Les premiers
eff ets d’une nouvelle molécule, l’axitinib, moins toxique sur le
plan hématologique que le sunitinib, se sont révélés modestes et
associés à un risque d’interactions médicamenteuses.
Un grand nombre d’études sont actuellement en cours avec le
bévacizumab, anticorps anti-VEGF, afi n d’évaluer, d’une part, au
stade métastatique, l’effi cacité de son association au docétaxel, à
la chimiothérapie et à l’hormonothérapie, et, d’autre part, à des
stades plus précoces, en néoadjuvant et en adjuvant, l’intérêt
d’associer le bévacizumab à la chimiothérapie. Des essais sont
aussi en cours avec l’association bévacizumab-chimiothérapie
dans les tumeurs basales triple négatif. Des résultats specta-
culaires obtenus avec l’association bévacizumab-trastuzumab
(sans chimiothérapie), dans des tumeurs métastatiques surexpri-
mant HER2, faisant apparaître plus de 50 % de taux de réponse
(3 patientes étant en outre toujours en réponse depuis plus de
2 ans), ont conduit à la mise en place de l’étude AVEREL.
Alors que l’ensemble des résultats obtenus avec l’association
chimiothérapie-bévacizumab, premier antiangiogénique anti-

Partenaire
de liaison
Interaction antigène-anticorps
Glycosylation
Antigène
Antigène
Antigène
Fab
Bisecting
N-acétylglucosamine
Acide sialique
Galactose
N-acétylglucosamine
Mannose
Fucose
Core
Variable
Asn297
Fab
région
VL
VL
VH
VH
CH1
CL
CH2
CH3
Modication de l’anité
ou de la spécicité
FcγR
Complément
Diminution ou augmentation
de l’activité ADCC ou CDC
FcRn Modication
de la pharmacocinétique
Impact potentiel d’actions
modiant les interactions
d’un anticorps monoclonal
Figure 3.
Structure et mécanisme d’action des anticorps monoclonaux (Carter PJ. Potent antibody therapeutics by design. Nat Rev
Immunol 2006;6:343-57).
La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 8 - octobre 2007
Réunion
Réunion
379
VEGF, montre une effi cacité très signifi cative dans diff érents
types de tumeurs, dont le cancer du sein, la place des TKi multi-
cibles anti-VEGFR reste à défi nir.
ANTICORPS MONOCLONAUX
A. Pèlegrin (Montpellier)
Glycoprotéines de grande taille, les anticorps monoclonaux
(Acm) sont caractérisés par leur reconnaissance très précise de
l’antigène et leur grande spécifi cité. Sur le plan moléculaire, les
Acm présentent deux fragments Fab, dont une partie interagit
avec l’antigène, et un fragment Fc responsable de la médiation
avec le système immunitaire (fi gure 3).
Le trastuzumab est le premier Acm ayant montré une effi cacité
signifi cative en oncologie dans le cancer du sein. Le pertuzumab,
en cours de développement, est un autre Acm qui cible aussi
HER2 mais qui, se fi xant sur un site diff érent, pourrait être
associé au trastuzumab.
L’interaction du fragment Fc des Acm avec le système immuni-
taire est à l’origine du phénomène d’antibody-dependent cellular
cytoxicity (ADCC). Les cellules immunitaires présentent à leur
surface des récepteurs spécifi ques, FcγRIIIa et FcγRIIb, qui se
lient avec les fractions Fc des Acm. L’interaction déclenche
une série de réactions immunitaires conduisant à la mort des
cellules tumorales. L’une des voies de développement des anti-
corps monoclonaux consiste à modifi er les fragments Fc (acides
aminés et/ou glycosilation) afi n de renforcer le phénomène
d’ADCC.
Les premiers essais menés en associant un Acm anti-HER2
(trastuzumab) à un Acm anti-HER1/EGFR, en particulier dans
un contexte de tumeurs exprimant faiblement le récepteur HER2,
montrent un eff et antitumoral important.
Les Acm, dont l’effi cacité a été déjà largement prouvée dans
diff érents types de cancer, constituent aujourd’hui l’une des
voies d’avenir majeures pour les traitements antitumoraux en
raison d’un grand nombre d’avantages : spécifi cité stricte, cible
membranaire, le plus souvent un récepteur ou son ligand, et
double, voire triple, mécanisme d’action : une action cible-
dépendante (par exemple entre trastuzumab et HER2) et un
mécanisme de type ADCC qu’il sera probablement possible de
renforcer (radioactivité, toxine) dans l’avenir.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%