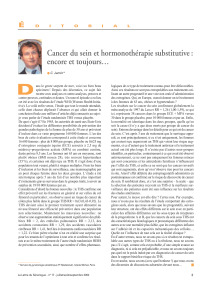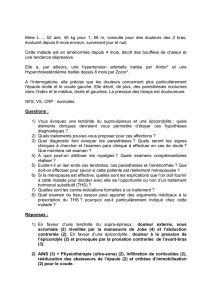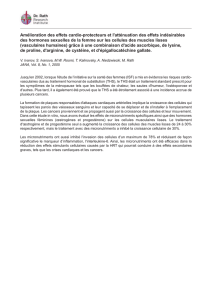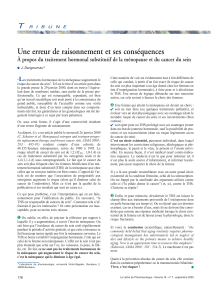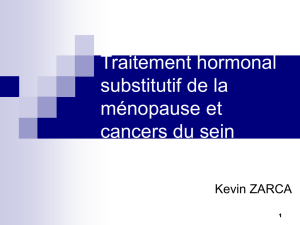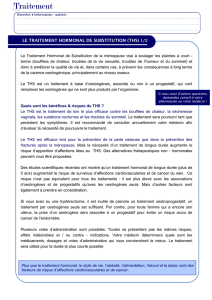es effets bénéfiques du traitement hormonal substitu-

25
La Lettre du Sénologue - n° 2 - octobre 1998
es effets bénéfiques du traitement hormonal substitu-
tif (THS) de la ménopause sont connus de tous. Son
intérêt est tel, et ses bénéfices immédiats sont telle-
ment évidents, que de nombreuses femmes le réclament, y
compris des femmes traitées antérieurement pour un cancer du
sein. Pour certaines d’entre elles, les risques de rechute sont
faibles, et il est tentant de leur prescrire un traitement qui leur
apportera rapidement des effets bénéfiques. Avant de leur pro-
poser un traitement hormonal substitutif, il est de notre devoir
de définir les risques et les bénéfices de cette prescription, puis
de déterminer les populations pour lesquelles les bénéfices
seront supérieurs aux risques. Enfin, nous devons regarder s’il
n’existe pas une alternative, un autre traitement ayant un
meilleur rapport risque/bénéfice, même avec des bénéfices
moindres, voire différents.
LES BÉNÉFICES DU THS
Les bénéfices immédiats du THS sont les plus évidents : dispa-
rition des bouffées de chaleur, maintien de la libido et diminu-
tion de la sensation de fatigue. En l’absence de traitement hor-
monal, les désordres vasomoteurs liés à la privation d’estro-
gènes sont mal combattus par les traitements symptomatiques
à notre disposition. Autoriser le THS aux cancers du sein gué-
ris leur serait bénéfique de ce point de vue.
Le THS a un rôle préventif démontré dans l’ostéoporose. Des
études cas-témoins ont montré que l’estrogénothérapie dimi-
nuait de 50 % le risque de fracture du col du fémur. Une étude
randomisée prospective a montré que ce traitement était
capable d’augmenter la masse osseuse. L’ostéoporose doit-elle
être le prix à payer pour la guérison du cancer du sein ?
Les études épidémiologiques montrent que le THS réduit les
accidents coronariens de 45 %.
Les estrogènes ont un effet favorable démontré sur les lipides,
avec une baisse du LDL cholestérol, une augmentation des tri-
glycérides et du HDL cholestérol.
Le THS lutte efficacement contre l’atrophie et la sécheresse
vaginale, ce qui peut être obtenu avec le même succès par un
traitement local.
LES RISQUES DU THS
Le THS comporte aussi des risques, qu’il est nécessaire d’éva-
luer le plus précisément possible avant de le prescrire aux
femmes traitées pour un cancer du sein.
Le THS entraîne un risque accru de thrombophlébites. Ce
risque est jugé suffisamment mineur pour ne pas en limiter
l’indication dans la population générale.
Les risques liés au cancer du sein sont supposés importants,
puisque le cancer du sein reste une contre-indication absolue
au THS. Cette contre-indication existe de longue date. Elle est
fondée essentiellement sur des données expérimentales, qui ont
montré le rôle des estrogènes dans la cancérogenèse, et sur des
données cliniques anciennes, qui relatent des stimulations, par
l’estradiol, de cancers du sein évolués. Cependant, les données
précises sur l’effet du THS après cancer du sein font défaut.
De nombreuses études se sont intéressées à l’augmentation
éventuelle du risque de cancer du sein après THS. Plusieurs
méta-analyses ont été réalisées sur ce sujet. La méta-analyse
d’Oxford montre une augmentation faible du risque de cancer
du sein sous THS et une corrélation entre la durée de traite-
ment et le risque de cancer du sein.
Quelle serait la conséquence d’une augmentation modérée du
risque chez des femmes déjà prédisposées ? L’augmentation
modérée du risque de développer un cancer du sein sous THS
ne représente-t-elle pas, en fait, une moyenne entre une aug-
mentation faible dans une population non sensible et une aug-
mentation élevée dans une population à risque ? Les femmes
qui ont déjà développé un cancer du sein font évidemment par-
tie de la population à risque.
En dehors de l’augmentation du risque de développer un cancer
du sein, les risques potentiels du THS sur le cancer du sein lui-
même nous sont totalement inconnus : apparition plus rapide de
rechutes de la maladie qui seraient de toute façon survenues
plus tard en son absence, stimulation de cellules quiescentes
qui n’auraient jamais proliféré, ou absence de conséquence ?
Du point de vue clinique, faut-il craindre une augmentation
des rechutes, des rechutes plus évolutives, une modification si
minime qu’elle passerait inaperçue, voire aucune modification
de l’évolution dans une population bien choisie ?
Proposer le THS aux femmes traitées antérieurement pour un
cancer du sein sans avoir au préalable réalisé un essai rando-
misé bien conduit revient à admettre que l’on connaît le méca-
nisme d’action des estrogènes sur d’éventuelles rechutes, et
donc qu’il est possible, dès maintenant, de définir une popula-
tion hors d’atteinte. C’est au moment de la définition de cette
population que les choses deviennent délicates. Définir une
population de cancers du sein pour laquelle les estrogènes
n’auraient pas d’effet délétère revient probablement à définir
une population pour laquelle le tamoxifène n’aurait aucun
effet bénéfique. Ce pourrait être le cas des femmes traitées
pour un cancer du sein sans envahissement ganglionnaire, qui,
après plusieurs années de surveillance, peuvent être considé-
rées comme guéries.
Plaidoyer pour un essai randomisé
●
Thierry Delozier*
*Centre Baclesse, route Lion-sur-Mer, 14021 Caen.
L
261133F/n°2 20/04/04 17:16 Page 25

DOSSIER THÉMATIQUE
26
La Lettre du Sénologue - n° 2 - octobre 1998
e cancer du sein est actuellement, dans les pays
industrialisés, le cancer le plus fréquent chez la
femme, et son incidence est encore en augmentation.
Cette augmentation, plus nette pour les stades précoces, est la
conséquence directe des campagnes de dépistage. Quoi qu’il
en soit, les femmes atteintes, ménopausées lors du diagnostic
de leur cancer ou préménopausées au diagnostic, mais que la
chimiothérapie va ménopauser de façon précoce, ne peuvent
aujourd’hui bénéficier d’un traitement hormonal substitutif, de
crainte qu’un tel traitement ne stimule une éventuelle cellule
cancéreuse résiduelle.
THS ET RISQUE DE CANCER DU SEIN
Il n’y a pas, dans la littérature, malgré la publication depuis
1971 de près de 50 études épidémiologiques, d’arguments per-
mettant de conclure définitivement sur l’implication des estro-
gènes dans la genèse du cancer du sein (leur rôle potentiel
dans la promotion des cancers préexistants ne peut en
revanche être nié).
La plupart de ces études sont des études cas-témoins, et la
majorité d’entre elles ne retrouvent pas de relation entre la sur-
venue d’un cancer du sein et l’utilisation d’estrogènes en post-
ménopause, à l’exception peut-être des traitements par estro-
gènes au long cours (utilisation supérieure à dix ans). L’inter-
prétation de ces études est difficile pour plusieurs raisons :
THS après cancer du sein : la réalisation d'un essai randomisé est-elle
encore possible ?
●
Nadine Dohollou*
*Clinique de Bordeaux-Nord, Bordeaux.
L
Un essai randomisé a montré que le tamoxifène donné tardive-
ment (de deux à dix ans après le traitement initial) à des
femmes apparemment guéries et à faible risque de rechute (N-
essentiellement) réduisait de façon significative les rechutes.
Cette population sélectionnée aurait pu être candidate au THS.
Il est impossible d’affirmer a priori que le THS n’entraînerait
aucune augmentation des rechutes. Il est également impossible
d’affirmer le contraire. Toutes les discussions sont possibles
sur ce sujet, tous les arguments peuvent être avancés, mais
aucune certitude ne peut être obtenue sans un essai contrôlé
randomisé.
EXISTE-T-IL UNE ALTERNATIVE AU THS ?
Si l’on considère la prévention de l’ostéoporose, le tamoxifène
est à retenir ; il a en outre un rôle préventif incontestable sur le
cancer controlatéral. Bien sûr, il n’a aucun effet sur les symp-
tômes vasomoteurs. Ses risques sont connus et, pour certains,
sont acceptables au point de le tester en traitement préventif du
cancer du sein dans une population à risque. D’autres anti-
estrogènes sans effet estrogénique sur l’endomètre sont en
développement. Le raloxifène, peu efficace dans le cancer du
sein, a été testé pour prévenir l’ostéoporose chez les femmes à
risque. Il entraîne aussi une réduction des cancers du sein. Les
nouveaux anti-estrogènes spécifiques (SERM) apporteront
peut-être la solution. En attendant, le tamoxifène est à retenir si
l’argument essentiel du THS est la prévention de l’ostéoporose.
NÉCESSITÉ D’UN ESSAI THÉRAPEUTIQUE RANDOMISÉ
La mise en route d’une nouvelle thérapeutique est le plus sou-
vent envisagée à la suite de raisonnements issus de données
expérimentales ou d’observations épidémiologiques. Les expé-
rimentations animales permettant de confirmer les observa-
tions initiales sont une étape importante du développement
d’une nouvelle thérapeutique (nouvelle molécule ou nouvelle
attitude thérapeutique). Enfin, des études chez l’homme,
d’abord de phases I et II sur de petits échantillons cohortes,
évaluent la faisabilité, puis des essais randomisés sont indis-
pensables pour affirmer l’efficacité et évaluer la toxicité du
nouveau traitement par rapport à une attitude thérapeutique de
référence. Pourquoi le THS après cancer du sein échapperait-il
à cette procédure prudente et raisonnable ? En l’absence de
données expérimentales en sa faveur, c’est le raisonnement cli-
nique qui nous incite à le proposer aux femmes traitées pour
un cancer du sein, ce qui n’est pas suffisant pour justifier sa
généralisation. Les quelques publications de cohortes de plu-
sieurs dizaines de cancers guéris traités par THS n’emportent
pas la conviction. Il ne faut pas compter sur des études cas-
témoins pour répondre à la question posée. On sait également
le peu de valeur qu’il faut accorder aux comparaisons histo-
riques.
Il est maintenant indispensable d’étayer notre raisonnement
par des données solides. Seul un essai thérapeutique randomisé
comprenant une population suffisante, avec un recul important,
permettra de résoudre ce problème.
La tentation de proposer le THS à des patientes traitées depuis
longtemps pour un cancer du sein et/ou présentant des facteurs
pronostiques favorables est grande. Pourquoi les priver de ce
traitement, si elles le demandent et si les risques de récidive de
la maladie sont minimes ? Cette attitude, louable sur le plan
humain, dérange notre immobilisme et permet de remettre en
question la contre-indication absolue du THS chez les femmes
traitées antérieurement pour un cancer du sein. Il serait dom-
mage que cette attitude de remise en question se transforme en
une prise de position forcenée, refusant toute tentative de
réponse à cette question importante. ■
261133F/n°2 20/04/04 17:16 Page 26
1
/
2
100%