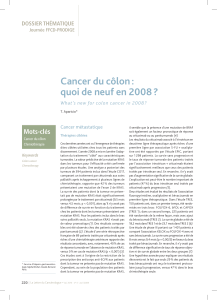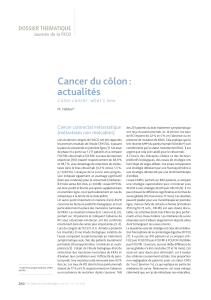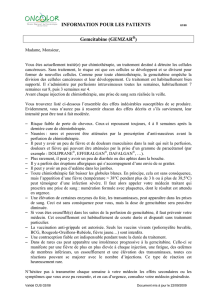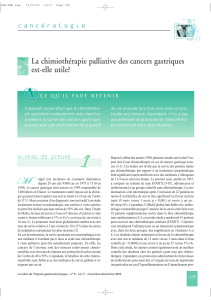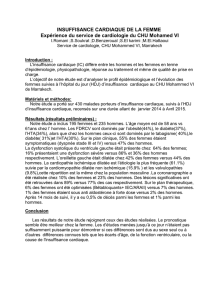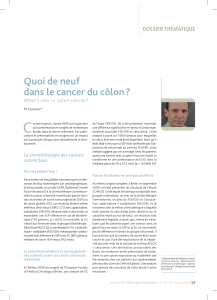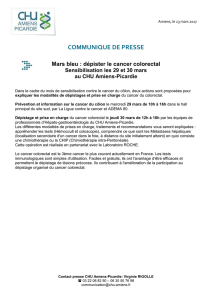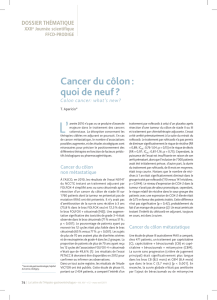Cancers digestifs DOSSIeR THÉmATIQue Gastrointestinal cancers Cancers du pancréas

52 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 1 - janvier 2009
DOSSIER THÉMATIQUE
Rétrospective 2008
Cancers digestifs
Gastrointestinal cancers
Pauline Afchain*, Astrid Lièvre**, Christophe Tournigand*
* Service d’oncologie médicale,
hôpital Saint-Antoine, Paris.
** Service d’hépato-gastroenté ro-
logie, hôpital européen Georges-
Pompidou, Paris.
Cancers du pancréas
Cancers pancréatiques non résécables
Il n’y a pas eu d’avancées majeures en 2008 dans la
prise en charge des adénocarcinomes pancréatiques
non résécables. La gemcitabine reste la molécule
phare. Le bénéfice des associations en termes de
survie globale (SG) n’est statistiquement significatif
que dans deux études : celle de R. Herrmann portant
sur la capécitabine (1) et celle de M.J. Moore portant
sur l’erlotinib (2).
Une étude complémentaire s’est intéressée au
bénéfice clinique et à l’amélioration de la qualité
de vie obtenus avec l’association gemcitabine-capé-
citabine par rapport à la gemcitabine seule. Cette
étude randomisée concernait les 319 patients de
l’étude de R. Herrmann, 19 % d’entre eux étant
traités dans le bras gemcitabine-capécitabine et
20 % dans le bras gemcitabine. La durée de la
survie a été respectivement de 9,5 et 6,5 mois
(p < 0,02). Le bénéfice clinique prédominait dans le
bras gemcitabine-capécitabine : 46 % versus 40 %,
mais s’annulait environ 2 mois avant l’échec du
traitement (3).
Soulignons les résultats négatifs d’autres théra-
pies ciblées dans les cancers du pancréas non
résécables.
Une étude de phase II ouverte, randomisée 2
➤
pour 1, a évalué l’association gemcitabine-axitinib
(inhibiteur sélectif des VEGF récepteurs 1, 2 et 3), en
comparant l’effet de 1 000 mg/ m
2
de gemcitabine
associés ou non à 2 prises orales quotidiennes de
5 mg d’axitinib (4). L’objectif primaire était la SG.
L’analyse était faite en intention de traiter (ITT). La
SG était de 6,9 mois (IC
95
: 5,3-10,1) avec l’associa-
tion et de 5,6 mois (IC
95
: 3,9-8,8) avec la gemcita-
bine seule (différence non significative). Ces résultats
ne sont que préliminaires, et un essai de phase III
est en cours.
À l’ASCO, les résultats négatifs de la combinaison
➤
bévacizumab-erlotinib, évaluée dans une étude de
phase III (étude AVITA) randomisant 707 patients
entre gemcitabine-erlotinib-bévacizumab et gemci-
tabine-erlotinib-placebo, ont été présentés. Les
chiffres de survie sont décevants (médiane de SG
de 7,1 mois versus 6 mois ; p = NS), avec des survies
sans progression (SSP) de 4,6 mois et 3,6 mois
(p = 0,0002) [5].
En dehors des thérapies ciblées, soulignons les
résultats prometteurs du S1, un dérivé oral de
fluoro pyrimidine inhibant la dihydropyrimidine
deshydrogénase. Deux petites études de phase II
rapportent ces résultats, l’une avec le cisplatine
et l’autre avec l’irinotécan. La première porte sur
30 patients atteints d’une tumeur du pancréas
métastatique : la survie médiane est de 9 mois
(IC
95
: 6,0-14,5), et le taux de survie à 1 an de 35,7 %
(IC95 : 19-55) [6]. La toxicité de grade 3 est héma-
tologique (13 % de cas de leucopénie, 7 % de cas
de neutropénie, 3 % de cas d’anémie et 3 % de cas
de thrombopénie) ; les autres toxicités sont l’ano-
rexie (13 %) et les nausées-vomissements (7 %). La
seconde étude (100 mg/m
2
d’irinotécan à J1 et J14,
par cycles de 28 jours, associés à 80 mg/m
2
/j de S1
de J1 à J14) [7] porte sur 16 patients traités pour une
tumeur métastatique du pancréas. Certains avaient
reçu une première ligne de traitement par gemci-
tabine. Le nombre moyen de cycles de traitement
était de 4, et le taux de réponse de 43,7 % (IC95 :
19,5-68,1). Le temps médian jusqu’à progression
(TMP) était de 4,9 mois, et la médiane de survie de
11,3 mois. Les principales toxicités étaient la neutro-
pénie de grade 3-4 (5 des 16 patients) et la diarrhée
de grade 3 (1 patient).
En ce qui concerne la stratégie de traitement, deux
études importantes ont été présentées à l’ASCO. La
première, française (8), comparait deux séquences
thérapeutiques inverses : gemcitabine avant ou après
LV5FU2-cisplatine, avec changement de schéma

La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 1 - janvier 2009 | 53
Points forts
Publication finale de l’étude SHARP, présentée à l’ASCO l’année précédente, qui confirme le bénéfice en termes
»
de survie du sorafénib chez les patients ayant un carcinome hépatocellulaire.
Indication d’une chimiothérapie par FOLFOX pré- et postmétastasectomie chez les patients atteints d’un cancer
»
colorectal avec des métastases hépatiques résécables d’emblée.
Entrée en pratique courante de la détection du statut K-ras des tumeurs colorectales avant la prescription d’un
»
anticorps anti-EGFR (cétuximab et panitumumab), la présence d’une mutation du gène K-ras étant un facteur de
résistance à ces anticorps.
Démonstration de l’efficacité de FOLFOX ou XELOX associé au bévacizumab en première ligne de traitement »
chez les patients ayant un cancer colorectal métastatique.
Mots-clés
Carcinome
hépatocellulaire
Cancer colorectal
Cétuximab
Panitumumab
Bévacizumab
K-ras
Chimiothérapie
Highlights
» Final publication of the
SHARP study, presented at
ASCO last year, confirming the
survival benefit of sorafenib in
patients with hepatocellular
carcinoma.
» Indication of FOLFOX chemo-
therapy before and after metas-
tasectomy in patients with
colorectal cancer with operable
liver metastases.
»The entry into practice of the
detection of the K-ras status
of colorectal tumors before
prescribing of anti-EGFR (cetux-
imab and panitumumab): the
presence of a mutation of K-ras
gene is a factor of resistance to
these antibodies.
» Demonstration of the effec-
tiveness of XELOX or FOLFOX
associated with bevacizumab
in the first line in patients with
metastatic colorectal cancer.
Keywords
Hepatocellular carcinoma
Colorectal cancer
Cetuximab
Panitumumab
Bevacizumab
K-ras
Chemotherapy
thérapeutique en cas de progression ou de toxicité.
Aucune différence significative en termes de survie
n’était retrouvée, mais la gemcitabine entraînait
plus de toxicité hématologique en deuxième ligne.
Enfin, l’oxaliplatine confirme sa place en deuxième
ligne, avec les résultats de l’étude allemande
CONKO 003, qui randomisait, après échec de la
gemcitabine, 160 patients entre un schéma LV5FU2
et un schéma LV5FU2-oxaliplatine. La médiane de SG
passait de 13 à 26 semaines dans le bras oxaliplatine
(p = 0,014), et la médiane de SSP de 9 à 13 semaines
(p = 0,012) [9].
Cancers localement avancés
Il n’y a pas eu de publication nouvelle cette année,
la stratégie thérapeutique optimale restant celle,
définie dans les publications 2007, d’une chimiothé-
rapie première suivie, en l’absence de progression
métastatique et en cas de bon contrôle tumoral,
d’une association de radio-chimiothérapie.
Cancers réséqués :
quel traitement adjuvant ?
La rechute locorégionale ou métastatique survient
dans plus de 75 % des cas après résection à visée
curative, avec une survie sans récidive (SSR) à 5 ans
de 23,4 % selon les données de la National Cancer
Database (10). La question de l’intérêt d’un traitement
adjuvant dans ce contexte avait été soulevée par
l’essai de l’ESPAC, qui avait démontré qu’une chimio-
thérapie à base de 5-FU pendant 6 mois apportait un
avantage en survie, alors qu’une radio-chimiothérapie
adjuvante semblait, au contraire, délétère. Cepen-
dant, l’intérêt du 5-FU n’ayant jamais été démontré
en situation métastatique, à la différence de celui de
la gemcitabine, aucun consensus n’avait été retenu.
L’étude allemande CONKO 001, publiée en 2007
dans The Journal of the American Association (11),
apportait une solution rationnelle et manifestement
utile en situation adjuvante après résection à visée
curative. Cet essai de phase III randomisé incluant
368 patients ayant eu une intervention à visée cura-
tive avait montré un bénéfice significatif en termes
de SSP dans tous les sous-groupes : R0, R1, T1, T2-3,
N0 et N+. La SG médiane était significativement
augmentée dans le bras gemcitabine : 24,2 versus
20,5 mois (p = 0,02). Cette étude sans biais apparent
confère à la gemcitabine le statut de traitement adju-
vant standard après résection R0 ou R1 d’un adéno-
carcinome pancréatique, et ce quel que soit le statut
ganglionnaire (N0 et N+). Les résultats actualisés à
l’ASCO confirment ce bénéfice, avec une SSP à 3 et
à 5 ans de 23,5 % versus 8, 5 % et de 16 % versus
6,5 %, respectivement. En termes de SG, les résultats
sont toujours en faveur du bras gemcitabine, avec une
médiane de 22,8 mois versus 20,2 mois (p = 0,005),
soit des taux de survie à 3 et 5 ans doublés : 36 %
versus 19,5 % et 21,5 % versus 9 %. L’étude de phase II
randomisée publiée dans le Journal of Clinical Onco-
logy par S. Heinrich replace l’association cisplatine-
gemcitabine au cœur de l’actualité. Les résultats
étaient prometteurs, mais cette étude ne portait
que sur 28 patients, dont 26 étaient réséqués et plus
de 80 % avec une résection R0 (12). En ITT, la SSP
et la SG étaient respectivement de 9,2 mois (IC95 :
5,6-12,9) et de 26,5 mois (IC95 : 11,4-41,5) pour les
duodéno-pancréatectomies céphaliques, et de 9 mois
(IC
95
: 6,99-10,1) et 19,1 mois (IC
95
: 15-23,1) pour les
spléno-pancréatectomies caudales. La gemcitabine
semble, en outre, améliorer le statut nutritionnel et
la qualité de vie des patients dont le pronostic est le
plus favorable et la SSP la plus prolongée.
Néanmoins, la place d’une irradiation en situation
périopératoire reste toujours controversée. Eu égard
aux conclusions de l’ESPAC1, l’étude américaine de
phase II visait à obtenir 65 % de survie à 18 mois
après duodéno-pancréatectomie R0-1. Des résultats
satisfaisants sont affichés, avec une SG de 27,1 mois
(14 mois de SSP) mais au prix d’une lourde morbidité
ayant entraîné l’arrêt prématuré de l’essai, et d’une
toxicité de grade supérieur ou égal à 3 pour 96 % des
patients. Le traitement était lourd, puisqu’il associait
une radiothérapie de 50,4 Gy sur 38 jours à une
chimiothérapie avec 5-FU, CDDP et IFNα.
On attend les résultats de l’étude de phase II inter-
groupe française évaluant, chez les patients R0, la
gemcitabine avec et sans radiothérapie.
Enfin, notons l’étude portant sur le nombre de
ganglions étudiés comme facteur pronostique
lorsque ceux-ci se révèlent tous négatifs : l’analyse

54 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 1 - janvier 2009
Cancers digestifs
DOSSIER THÉMATIQUE
Rétrospective 2008
d’au moins 11 ganglions est nécessaire. La médiane
de survie est ainsi réduite de 5 mois entre le groupe
de patients dont aucun ganglion n’était tumoral
sur au moins 11 ganglions analysés (20 mois) et le
groupe sans atteinte ganglionnaire sur moins de
10 analysés (15 mois) [13].
Cancers œsogastriques
Cancers gastriques résécables
Le bénéfice de la chimiothérapie périopératoire des
adénocarcinomes œsogastriques est validé depuis la
publication, en 2006, dans le New England Journal of
Medicine, des résultats de l’étude contrôlée et rando-
misée de phase III menée par l’équipe de D. Cunnin-
gham, avec 3 cycles d’épirubicine-cisplatine-5-FU
(ECF) avant puis après chirurgie œsogastrique (14).
Les taux de SG (objectif principal de l’étude) à 5 ans
étaient de 36 % dans le groupe chimiothérapie péri-
opératoire versus 23 % dans le groupe contrôle. En
termes de SSP, le hazard-ratio (HR) était en faveur de
la chimiothérapie (0,66 ; IC
95
: 0,53-0,81 ; p < 0,001).
Sa toxicité ne fait pas perdre de bénéfice au patient,
et elle conduit à une régression de la taille tumorale
pouvant faciliter et optimiser le geste chirurgical.
Cette étude n’intègre pas la problématique de la
radiothérapie dans la prise en charge adjuvante des
adénocarcinomes gastriques, mais a le mérite de
répondre à la question de l’intérêt de la chimiothé-
rapie, dont le bénéfice est dorénavant démontré.
Aujourd’hui, une autre question pratique est posée,
inhérente à la démarche actuelle de traitement
pré opératoire. Elle concerne les critères prédictifs de
réponse à la chimiothérapie, dont on sait qu’elle est
associée à une meilleure survie : l’étude MUNICON
(Metabolic Response Evaluation for Individualisation
of Neoadjuvant Chemotherapy in Oesophageal and
Oesophagogastric Adenocarcinoma) a permis de
confirmer la valeur prédictive de la réponse métabo-
lique précoce, ouvrant la perspective d’un algorithme
thérapeutique reposant sur les résultats de la TEP au
FDG (15). Une étude prospective de la réponse méta-
bolique dans les cancers gastriques révèle néanmoins
des difficultés, puisque environ 30 % des cancers
gastriques ne sont pas suffisamment contrastés.
Le manque de sensibilité technique est probable-
ment lié au caractère diffus de ces tumeurs, avec
des cellules en bague à chaton, et à leur caractère
mucineux. Les tumeurs initialement FDG positives
peuvent être évaluées pour leur réponse. Les tumeurs
initialement négatives seraient de pronostic équiva-
lent à celui des tumeurs des patients secondairement
étiquetés comme non répondeurs. Enfin, l’utilisation
d’autres traceurs devrait permettre d’augmenter la
sensibilité de ces techniques.
Cancers gastriques et œsophagiens
avancés
D. Cunningham a rapporté, dans le New England
Journal of Medicine (REAL 2), l’efficacité et l’in-
nocuité de l’association capécitabine-oxalipla-
tine dans les cancers œsogastriques avancés, en
première ligne. Cette association était comparée
à du 5-FU-cisplatine selon un schéma 2:2 avec
une randomisation en 4 bras de trithérapie : ECF
versus épirubicine-cisplatine-capécitabine (ECX), et
épirubicine-oxaliplatine-5-FU (EOF) versus épirubi-
cine-oxaliplatine-capécitabine (EOX) [16]. L’objectif
principal était la non-infériorité en termes de SG
d’un traitement comprenant de la capécitabine
comparativement au 5-FU, et d’une trithérapie avec
de l’oxaliplatine comparativement au cisplatine.
Le HR est de 0,86 pour la comparaison capécita-
bine-5-FU (IC
95
: 0,80-0,99), et de 0,92 pour celle
entre oxaliplatine et cisplatine (IC95 : 0,80-1,1). La
SG est meilleure avec EOX qu’avec ECF (HR = 0,80
dans le groupe EOX ; p = 0,02). Les toxicités des bras
5-FU-capécitabine sont similaires, mais il y a moins
de neutropénie, d’alopécie, de toxicité rénale et de
complication thromboembolique de grade 3-4 avec
l’oxaliplatine qu’avec le cisplatine. À l’inverse, il y a
plus de neuropathie et de diarrhée avec l’oxaliplatine
(tableau I).
Tableau I. Étude REAL 2 : médiane de survie et survie à 1 an
dans les 4 bras de traitement.
Médiane de survie
(mois) Survie à 1 an (%)
ECF 9,9 37,7
ECX 9,9 40,8
EOF 9,3 40,4
EOX 11,2 46,8
En 2007, le S1, prodrogue orale du 5-FU associée
à un inhibiteur de sa principale enzyme catabo-
lique, disponible en Asie, a confirmé sa place dans
le cancer de l’estomac, notamment avec la mise en
évidence de son efficacité en adjuvant des cancers
de l’estomac de stades II et III dans une population
japonaise (17). En 2008, des études en situation

Taux de survie
8
4
2
6
10
0
0 126 18 24 30
Mois
p (log-rank) = 0,2327
HR : 0,856 (IC95 : 0,663-1,106)
Irinotécan + S1
36
S1
Survie
Figure 1. Étude IRIS : irinotécan versus irinotécan-S1.
S1 Irinotécan-S1 p
Réponses objectives (%) 26,9 41,5 0,035
Survie sans progression (mois) 3,6 4,5 0,8
Survie globale (mois) 10,5 12,8 0,2
La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 1 - janvier 2009 | 55
DOSSIER THÉMATIQUE
métastatique sont aussi séduisantes, toujours dans
des populations asiatiques. Une étude chinoise (18)
a inclus 230 patients atteints de tumeur gastrique
non résécable (localisée ou métastatique), en
première ligne. Il s’agissait d’une randomisation
en 3 bras : bras A, 80 mg/m
2
/j de S1 p.o. J1-J28
toutes les 6 semaines ; bras B, 80 mg/m2/j de S1
p.o. J1-J28 toutes les 6 semaines avec 60 mg/m2
de cisplatine à J8, et bras C, avec 600 mg/m2/j de
5-FU et 20 mg/m
2
de cisplatine J1-J5 toutes les
4 semaines. Les résultats sont nettement en faveur
de l’association S1-cisplatine, avec 37,8 % de réponse
objective (RO), un temps jusqu’à progression de
159 jours, versus 126 pour le bras A et 85 pour le
bras C, et une SG de 433 jours versus 207 pour le
bras A et 309 pour le bras C. Une seconde étude,
de phase II, coréenne, justifie l’association avec le
docétaxel (19) dans la même population. Dans les
2 bras de cette étude (bras docétaxel-S1, docétaxel
à 35 mg/m2 à J1 J8 et S1 à 70 mg/m2 de J1 à J14, et
bras docétaxel-cisplatine, docétaxel 35 mg/m2 à J1
J8 et cisplatine 35 mg/m2 à J1 et J8), le traitement
était administré toutes les 3 semaines. Les résultats
sont en faveur du bras docétaxel-S1, avec une SG
de 21,1 mois et un taux de réponse de 46 %. Une
troisième étude (en abstract à l’ASCO GI) associe
l’irinotécan au S1, avec un bénéfice non significatif
sur la survie (figure 1) [20].
Enfin, plusieurs études de phase II ont été présentées
à l’ASCO, évaluant les thérapies ciblées, sans que
cela puisse justifier leur utilisation actuelle.
Carcinomes endocrines
Deux articles ont porté sur les carcinomes endocrines
(CE). D’abord, l’efficacité du sunitinib, inhibiteur de
tyrosine kinase oral, est rapportée dans le Journal of
Clinical Oncology par l’équipe de Boston (21). Une
telle efficacité pouvait être suggérée par la surex-
pression du VEGF et de son récepteur par les tumeurs
endocrines. Il s’agissait d’évaluer le sunitinib dans
une étude de phase II portant sur une double cohorte
de patients atteints de tumeurs de l’intestin grêle et
de tumeurs du pancréas d’histologie endocrine. Cent
sept patients sur 109 ont reçu 50 mg/j de sunitinib
4 semaines sur 6. Les résultats sont présentés dans
le tableau II. La tolérance, bonne, est similaire dans
les 2 groupes, sans différence de qualité de vie ou
de fatigue. Cette étude reste critiquable puisqu’elle
n’est pas randomisée, mais confirme la nécessité
de mettre en place une vraie étude de phase III
randomisée.
La seconde étude rapporte les résultats précoces
d’une radio-embolisation intrahépatique, par embo-
lisation artérielle avec des microsphères radioactives
chargées en yttrium 90, sur 148 patients traités dans
10 centres participants. Cent quatre-vingt-cinq
procédures ont pu être effectuées pour des locali-
sations secondaires intrahépatiques (22). La médiane
d’activité mesurée était de 1,14 GBq (0,33-3,30 GBq),
avec une médiane de 99 % du taux qu’il était initiale-
ment prévu de délivrer (38,1 à 147,4 %). Environ 67 %
des patients avaient une toxicité de grade 3 avec,
le plus souvent, une fatigue. L’évaluation morpho-
logique montrait une stabilité dans 6,7 % des cas,
une réponse partielle (RP) dans 60,5 % des cas, une
réponse complète (RC) dans 2,7 % des cas et une
progression de la maladie dans 4,9 % des cas. Il n’y
a eu aucune défaillance hépatique par irradiation.
La médiane de survie est évaluée à 70 mois.
Ces résultats utilisant une technique innovante
méritent d’être confirmés, notamment dans une
étude de phase III randomisée.
Tableau II. Étude de phase II : sunitinib dans les tumeurs endocrines (21).
Taux
de réponse
objective (%)
Taux
de stabilisation
de la maladie (%)
Temps
jusqu’à progression
(mois)
Survie
à 1 an
(%)
Pancréas 16,7 68 7,7 81,1
Intestin grêle 2,4 83 10,2 83,4

56 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 1 - janvier 2009
Cancers digestifs
DOSSIER THÉMATIQUE
Rétrospective 2008
Tumeurs stromales digestives
Une étude de phase III a été publiée dans le Journal
of Clinical Oncology. Il s’agit d’un essai intergroupe
(muticentrique) randomisant des patients atteints de
GIST métastatiques ou non résécables entre une dose
classique de 400 mg/j d’imatinib et une double dose
(800 mg/j) [23]. L’objectif principal de cette étude
incluant 746 patients de 148 centres (États-Unis et
Canada) pendant 9 mois était de démontrer une
différence en termes de SG ou de SSP. Les patients
dont la maladie progressait sous la dose standard de
400 mg passaient dans le bras 800 mg/j (33 % des
patients). Après un suivi de 4,5 ans, la SSP médiane
était respectivement de 18 mois et de 20 mois pour
les patients des bras dose standard et double dose, et
la SG médiane de 55 et 51 mois. Il n’y avait de diffé-
rence significative pour aucun de ces 2 critères, ni
pour le taux de réponse tumorale. La conclusion est
donc qu’il n’y a pas d’intérêt à doubler la dose chez
les patients dont la maladie progresse sous imatinib.
Cet essai reste cependant critiquable rétrospective-
ment. En effet, les avancées des connaissances sur
les mutations de c-kit ou de PDGFR-A ont à ce jour
révélé une sensibilité variable au traitement selon le
type de mutation tumorale, rendant probablement
caduques ces conclusions, au moins pour les muta-
tions de l’exon 9 (10-18 % des différentes mutations
connues), dont on sait qu’elles peuvent bénéficier
d’une dose initiale d’imatinib de 600 mg au lieu de
400 mg/j (taux de réponse à l’imatinib : 45 %). À l’in-
verse, la mutation de l’exon 11, la plus fréquemment
retrouvée (60 à 80 % des cas), a un taux de réponse
à l’imatinib de 80 % à la dose de 400 mg.
À l’ASCO 2008, A. Adenis a complété les résultats
de l’étude BFR14 sur la poursuite du traitement par
imatinib versus son arrêt en situation de contrôle
tumoral. Il a évalué l’utilité de poursuivre au-delà
de 3 ans le traitement par imatinib pour les patients
stables ou répondeurs, et a montré que la SSP à 1 an
des patients ayant poursuivi l’imatinib était de 88 %,
versus 25 % en cas d’arrêt (p < 0,001). Ces résultats
sont confirmés à 3 ans (92 % versus 29,7 %) pour les
50 patients dont la maladie ne progressait pas au
moment de la randomisation (24). Le temps médian
jusqu’à nouvelle progression dans le bras arrêt était
de 7 mois. Mais le contrôle tumoral a été de nouveau
obtenu chez les 19 patients ayant repris l’imatinib
après cette nouvelle progression (100 %). La SG à
1 an est identique dans les 2 bras. Des résultats inté-
ressants sont également rapportés pour les patients
de l’étude BFR14 traités en continu par imatinib et
qui étaient mis en rémission complète (25) ainsi que
pour ces mêmes patients répondeurs mais en réponse
partielle ou stabilisation tumorale et bénéficiant
ou non d’une chirurgie seconde (26). La rémission
complète est encore de meilleur pronostic, avec une
SSP à 2 ans de 84,4 % (versus 63,3 pour le groupe
réponse partielle et 27,9 mois pour le groupe stabilité
tumorale ; p < 0,0001) et une SG à 3 ans de 85,7 mois
(versus 80,7 versus 48,6 ; p = 0,0054). Enfin, en situa-
tion de contrôle tumoral, le taux de survie à 1 an
est plus important chez les patients opérés (R0,
R1) : 94 %, versus 70 % en l’absence d’intervention
complémentaire ; la SSP est, à 2 ans, de 93 %.
En deuxième ligne de traitement, la place du sunitinib
est confirmée, en termes de SG. Une autre méthode
statistique permettait d’annuler l’impact initial du
crossover sur le calcul de la survie, et parvient à
démontrer la significativité du bénéfice en survie
apporté par le sunitinib après progression sous
imatinib (doublement de la médiane de SG).
Carcinomes hépatocellulaires
Traitements systémiques
Après des années mornes, le carcinome hépato-
cellulaire (CHC) s’est vu mis à l’honneur, grâce aux
résultats de l’étude SHARP (Sorafenib HCC Assess-
ment Randomized Protocol), présentés à l’ASCO 2007
et publiés dans le New England Journal of Medi-
cine (27). Cette étude multicentrique internationale
de phase III a évalué un traitement par sorafénib,
petite molécule inhibitrice de tyrosine kinase ciblant,
entre autres, les récepteurs VEGF 1 et 3, à la dose de
400 mg x 2/j, versus placebo, dans le traitement des
CHC avancés chez des patients en bon état général
(ECOG 0-2) avec cirrhose non décompensée (score
Child-Pugh A). Plus de 600 patients ont été inclus.
Le traitement était administré jusqu’à progression
clinique ou radiologique. L’essai a été interrompu
prématurément en raison de l’efficacité démontrée
du sorafénib en termes de SG. Une augmentation
significative de la SG (10,7 mois versus 7,9 mois ;
HR = 0,69 ; p = 0,00058) a été observée dans le
groupe recevant le sorafénib (figure 2).
Cette amélioration de la survie n’était pas liée à
l’amélioration du taux de réponse (2,3 % versus
0,4 %) mais à un meilleur contrôle évolutif, le délai
jusqu’à progression passant de 12,3 semaines dans
le bras placebo à 24 semaines dans le bras sorafénib
(p < 0,001). La tolérance du traitement était satisfai-
sante ; les effets indésirables les plus fréquents sous
sorafénib étaient la diarrhée de grade 3 (8 %), l’amai-
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%