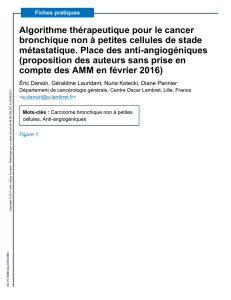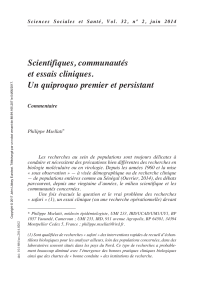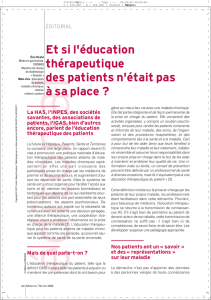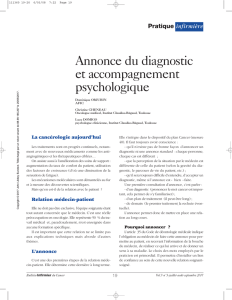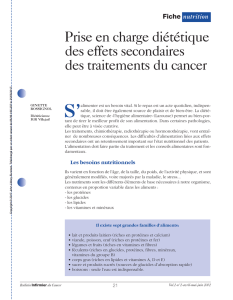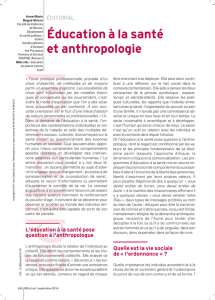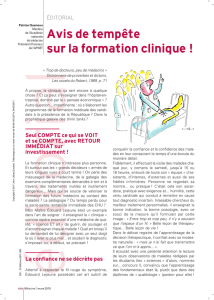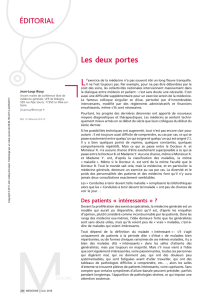Prévenir le risque cardiovasculaire : le travail

Sciences Sociales et Santé, Vol. 31, n° 2, juin 2013
Prévenir le risque cardiovasculaire:
le travail éducatif au cœur du dépistage
Julien Cazal*, Jean-Paul Génolini**
Résumé. Le dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire en préven-
tion primaire est singulièrement fondé sur une approche «globale» du
risque, mêlant à la fois aspects cliniques et éducatifs dans la relation thé-
rapeutique. Dans un contexte plus ou moins empreint d’incertitude, nous
montrons, suivant une approche interactionniste, que les points d’appui
de la formation du patient à l’autonomie résident certes dans le travail
d’objectivation et d’individualisation du risque mais aussi, plus large-
ment, dans le travail d’accord autour de l’acceptabilité de ce dernier. En
ce sens, l’éducation du patient s’inscrit dans un jeu d’attentes et d’enga-
gements réciproques entre professionnel et patient visant, in fine, à ren-
forcer la confiance dans la relation de soins.
Mots-clés: risque cardiovasculaire, incertitude, confiance, autonomie,
relation thérapeutique.
doi: 10.1684/sss.2013.0201
�Julien Cazal, sociologue, docteur en STAPS, Laboratoire PRISSMH-SOI, EA-4561,
Université Toulouse 3 Paul-Sabatier, 118, route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex
9, France ; [email protected]
�� Jean-Paul Génolini, psychologue social, maître de conférences, Laboratoire
PRISSMH-SOI, EA-4561, Université Toulouse 3 Paul-Sabatier, 118, route de
Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 9, France ; [email protected]
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

6JULIEN CAZAL, JEAN-PAUL GÉNOLINI
La prévention des maladies cardiovasculaires est devenue, au cours
de la dernière décennie, un enjeu majeur de santé publique. Selon les
recommandations institutionnelles, un traitement précoce des facteurs de
risque (1) permettrait de réduire les maladies cardiovasculaires et la sur-
venue de complications graves à plus ou moins long terme. Certains éta-
blissements de santé proposent une prise en charge dite «globale» du
risque à travers des dispositifs de dépistage, de traitement et de suivi, en
conjuguant le travail médical avec une éducation visant la mise en respon-
sabilité et l’autonomie (Sandrin-Berthon, 2000) du patient à l’égard de sa
maladie. La fonction essentielle du dépistage est d’évaluer, de contrôler le
risque, de prescrire des traitements, d’investiguer la maladie par des ana-
lyses complémentaires, d’orienter vers d’autres services, ou encore de for-
muler des recommandations d’hygiène. Mais les dispositifs de dépistage
ne font pas que qualifier un risque cardiovasculaire, ils le construisent afin
d’exhorter les patients à rester attentifs à leur santé.
La hiérarchisation des risques cardiovasculaires est un point de
départ, voire un point d’appui, à l’éducation pour la santé (2) et la mise en
responsabilité du patient. Au cours du dépistage, celui-ci est confronté à
une «culture du risque» (3). Les fonctions diagnostique et prescriptive,
somme toute banales dans une activité médicale, font elles-mêmes l’objet
d’une appropriation par le patient. Celui-ci peut se montrer sceptique face
à des informations qui ne correspondent pas à des symptômes de souf-
france ou de limitation. Il peut, à l’inverse, s’inquiéter de son état de santé
qu’il découvre alarmant. L’apprentissage du risque cardiovasculaire est
déterminé par le transfert d’une rationalité de type probabiliste, nourrie à
la fois par l’épidémiologie et par la nécessité (tant pour le patient que le
médecin) d’assumer l’incertitude sur l’évolution de l’état de santé.
(1) Selon les termes utilisés en cardiologie, on peut distinguer les facteurs de risque
dits « majeurs » (diabète, hypertension artérielle, dyslipidémie, tabagisme, âge), des
facteurs de risque dits « prédisposants » (obésité, sédentarité, hérédité).
(2) La conceptualisation du changement de comportement en santé publique repose
principalement sur des modèles individualistes tels que celui des « croyances pour la
santé » ou Health Belief Model (Rosenstock, 1974). Celui-ci postule « qu’un individu
est susceptible de poser des gestes pour prévenir une maladie ou une condition
désagréable s’il possède des connaissances minimales en matière de santé et s’il consi-
dère la santé comme une dimension d’importance dans sa vie » (Godin, 1991 : 70).
(3) Reprenant cette notion de Giddens (1994), la culture du risque découlerait du pro-
cessus d’individualisation des sociétés modernes, où chacun serait en mesure d’éva-
luer rationnellement les risques qu’il encourt et de mettre en œuvre les conduites
adaptées.
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

ÉDUCATION DU PATIENT ET RISQUE CARDIOVASCULAIRE 7
Construction experte et domestication du risque reposent sur une relation
thérapeutique de mise en confiance à l’égard de l’institution médicale. En
effet, la désignation d’un type de risque par le médecin présuppose qu’un
accord se réalise autour de l’incertitude médicale (4), donnant lieu à l’éla-
boration d’un risque «acceptable» qui, pour Giddens (1994), dépend d’un
«savoir induit» et se situe à la base de la confiance envers les «systèmes
experts » (5).
Notre recherche analyse la façon dont se diffusent les risques et se
tissent les relations de confiance au cours de la consultation médicale dans
un climat d’incertitude sur la santé. À partir des orientations interaction-
nistes et pragmatiques, elle ouvre l’analyse culturelle des risques en santé,
des approches socio-représentationnelles (Douglas et Calvez, 1990) aux
pratiques et techniques utilisées dans le pronostic du risque cardiovascu-
laire. Elle complète, en éducation pour la santé, l’analyse de l’autorégula-
tion (Clark et Zimmerman, 1990) par un regard constructiviste sur les
«stratégies participatives ». Plus généralement, elle permet de compren-
dre, à partir des interactions médecin-patient, les mécanismes incidents de
la formation d’un usager responsable, véritable «auxiliaire» du milieu
médical (Pinell, 1992): un «homo medicus » (6).
Nous faisons l’hypothèse que le cadre situationnel du dépistage est
une mise en autonomie du patient sous contrôle médical. À la manière des
«dispositifs de confiance » (Karpik, 1996), les consultations permettent
de « nous informer, de garantir la fiabilité des informations et de nous
assurer de la crédibilité des engagements des institutions ou de ceux qui
exercent les pouvoirs, et donc de nous protéger de leurs manipulations,
mensonges et tromperies » (Quéré, 2005 : 208). Le diagnostic sur le risque
cardiovasculaire à la fois produit de l’incertitude et crée les conditions de
la confiance. Cette dernière ne se réduit pas à l’expertise des évaluations
(4) Comme cela a été montré dans le domaine de la cancérologie (Fainzang, 2006).
(5) Par « systèmes experts », l’auteur entend « des domaines techniques ou de savoir-
faire professionnel concernant de vastes secteurs de notre environnement matériel et
social », auxquels les non-initiés sont contraints, faute de compétences, d’accorder
leur confiance. Ces systèmes représentent, par exemple, l’ensemble des techniques,
technologies ou encore savoirs médicaux qui sont manipulés par les professionnels
dans l’interaction avec le patient.
(6) Cette notion, proposée par Pinell (1992) dans son étude à propos de la lutte contre
le cancer, est le pendant sanitaire de l’homo economicus. Elle correspond à une figure
idéale du « malade d’aujourd’hui » qui serait « prédisposé à jouer le jeu ». Elle
implique d’envisager les patients comme des acteurs rationnels au sujet de la maladie
et du risque.
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

8JULIEN CAZAL, JEAN-PAUL GÉNOLINI
et à la transparence d’un jugement médical objectif; elle se gagne dans la
sphère des interactions médecin-patient (7) et dans la possibilité d’exercer
un contrôle sur l’incertitude qui naît du diagnostic.
Dans une première partie, nous analysons les différentes formes
d’incertitude propres à l’exercice de la prévention cardiovasculaire.
L’incertitude s’inscrit dans le niveau d’expertise sur une pathologie, dans
les pratiques cliniques, dans les techniques et les technologies disponibles
et/ou utilisées. Elle est aussi assujettie à un système de valeurs qui en fait
un outil au service de l’influence. La détermination des « facteurs de
risque», le classement en «groupe à risque», les recommandations sur
les «conduites à risque» sont des activités qui permettent de contrôler
l’incertitude en refermant la culture du risque sur le savoir médical. Par-
delà l’expertise épidémiologique et clinique, la prévention étend le pou-
voir du médecin à un contrôle de la vie. L’incertitude n’est pas
uniquement induite par un bilan de santé, elle se développe aussi dans les
interstices des prescriptions et recommandations, dans un jeu d’attentes
réciproques entre médecin et patient. La seconde partie montre, à partir de
données empiriques, que la frontière entre ce qui peut être mis en risque
et ce qui reste inéluctablement incertain, n’est pas donnée mais construite
(Theys, 1991). Elle s’appuie sur l’observation ethnographique des consul-
tations médicales autour de l’individualisation du risque. Les médecins
abordent rationnellement et méthodiquement un «risque cardiovasculaire
global» (8). Ce faisant, ils cherchent, au cours de ce travail diagnostique,
des prises leur permettant de suggérer des conduites d’autocontrôle. Ils
travaillent donc sur un « ordre négocié » (9) (Strauss, 1992) qui vise
(7) Il s’agit, suivant le principe du « dispositif de promesse » (Karpik, 1996), d’éviter
toute forme d’opportunisme, le médecin pouvant se voir reprocher de n’avoir pas tout
dit au patient, au même titre que le patient pourrait ne pas appliquer des recommanda-
tions qui lui ont été faites.
(8) Selon un rapport de l’ANAES, « l’approche recommandée en France (…) pour
évaluer le risque cardiovasculaire global repose sur la sommation des facteurs de
risque, chacun étant considéré comme binaire (présent ou absent) et ayant un poids
identique. Ce risque est estimé faible, modéré ou élevé selon le nombre de facteurs de
risque présents. Les principales recommandations internationales préconisent d’esti-
mer le RCV global. Il n’y a pas, en 2004, de consensus concernant le choix de la
méthode d’estimation de ce risque (sommation des facteurs de risque ou modélisation
statistique) » (ANAES, 2004 : 9).
(9) Pour Strauss, il n’existe pas d’ordre social qui serait unilatéralement imposé. En
particulier dans le domaine médical, l’ordre des interactions résulte la plupart du temps
d’une action concertée entre les individus.
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

ÉDUCATION DU PATIENT ET RISQUE CARDIOVASCULAIRE 9
«l’acceptabilité» du risque cardiovasculaire, c’est-à-dire la détermination
d’un risque suffisamment élaborée, facilitant la confiance et le maintien
des engagements réciproques dans la gestion de la maladie. L’équilibre est
délicat et repose à la fois sur la diffusion et l’assimilation de données épi-
démiologiques, et sur une approche clinique plus singulière des informa-
tions médicales personnelles, des symptômes de la maladie, etc. Il est
perceptible dans les divers types de «cadrage» (10) qui animent la rela-
tion thérapeutique et «travaillent» à restaurer la confiance entre médecin
et patient.
L’approche interactionniste et pragmatique que nous déployons dans
notre recherche s’appuie, sur le plan méthodologique, sur un corpus d’ob-
servations réalisées lors d’une enquête ethnographique au sein d’un ser-
vice hospitalier de «détection et de prévention de l’athérosclérose» (11).
Référés par leur médecin traitant à la suite d’une consultation, la plupart
des patients sont pris en charge au sein du dispositif sous forme d’hospi-
talisation de jour ou de «journée de dépistage» (12). Nous avons ainsi
pu suivre plus d’une trentaine de ces journées (environ 180 heures) et
(10) L’interaction médecin–patient peut être analysée comme une succession de
«cadrages de l’individu » (Goffman, 1991) par les soignants. Ces derniers s’ajustent
aux intérêts d’arrière-plan des patients mais participent aussi à leur construction. Nous
en restons pour l’étude au constat d’existence de ces intérêts d’arrière-plan sans en pré-
ciser la nature stratégique ou dispositionnelle. Pour Dodier (1993a), la notion de
cadrage de l’individu est liée au régime d’action dans lequel s’engage l’acteur et au
modèle d’expertise auquel le médecin se réfère.
(11) L’athérosclérose se caractérise par une accumulation, sur la paroi des artères, de
lipides ou de graisses (mauvais cholestérol), de produits du sang, etc., pouvant entraî-
ner avec le temps des lésions. C’est le principal responsable, entre autres, de l’infarc-
tus du myocarde.
(12) Le service a été créé en 1994 à l’initiative de quelques cardiologues « sensibles »
à la prévention des maladies cardiovasculaires, et dont l’un d’entre eux est actuelle-
ment le chef de service. Au départ centrée sur le diagnostic des troubles cardiométa-
boliques impliqués dans l’athérosclérose, l’offre a été complétée par la mise en place
d’un programme d’éducation thérapeutique au début des années 2000 au moment,
notamment, où un programme national de réduction des risques cardiovasculaires voit
le jour. On compte aujourd’hui quatre autres services similaires répartis en France au
sein de CHU.
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%