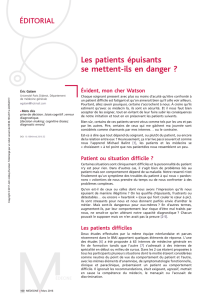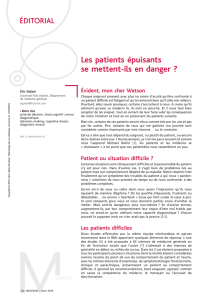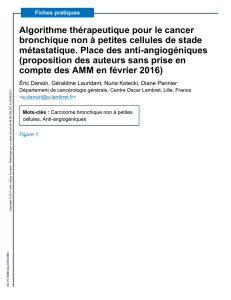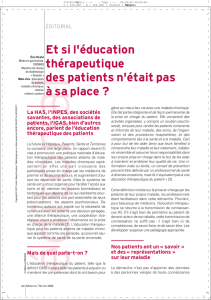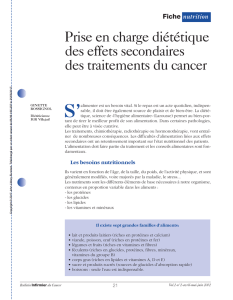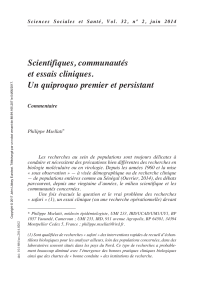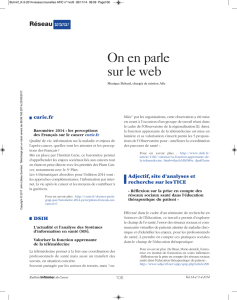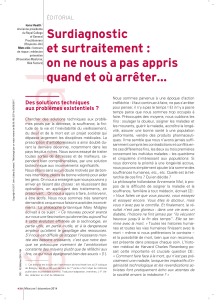Les deux portes - John Libbey Eurotext

Les deux portes
L’exercice de la médecine n’a pas souvent été un long fleuve tranquille.
Il ne l’est toujours pas. Par exemple, pour ne pas être débordées par le
coût des soins, les collectivités nationales interviennent massivement dans
le dialogue entre médecin et patient : c’est sans doute une nécessité. C’est
aussi une difficulté supplémentaire pour un exercice serein de la médecine.
Le fameux colloque singulier se dilue, perturbé par d’innombrables
intervenants, modifié par des règlements administratifs et financiers
envahissants, même s’ils sont nécessaires.
Pourtant, les progrès des dernières décennies ont apporté de nouveaux
moyens diagnostiques et thérapeutiques. Les médecins se sentent techni-
quement mieux armés en ce début de siècle que leurs collègues du début du
siècle dernier.
Si les possibilités techniques ont augmenté, tout n’est pas encore clair pour
autant : il est toujours aussi difficile de comprendre, au cas par cas, ce qui se
passe exactement entre quelqu’un qui soigne et quelqu’un qui est soigné [1].
Il y a bien quelques points de repères, quelques constantes, quelques
comportements répétitifs. Mais ce qui se passe entre le Docteur A. et
Monsieur X. n’a aucune chance d’être exactement superposable à ce qui se
passe entre le Docteur B. et Madame Y. Aucune chance, même si Monsieur X.
et Madame Y. ont, d’après la classification des maladies, la même
« maladie ». Même si le Docteur A. est sorti de la même Faculté que le
Docteur B. Tout le monde sait cela, mais la médecine, et en particulier la
médecine générale, demeure un exercice au cas par cas. La diversité et le
poids des personnalités des patients et des médecins font qu’il n’y aura
jamais deux consultations exactement semblables.
Les « Conduites à tenir devant telle maladie » remplissent les bibliothèques
alors que les « Conduites à tenir devant tel malade » ont peu de chances de
voir le jour...
Des patients « intéressants » ?
Devant la prolifération des exercices spécialisés, la médecine générale est un
modèle qui aurait pu disparaître, alors qu’il est, d’après les enquêtes
d’opinion, plutôt considéré comme incontournable par les patients. Dans les
rangs des médecins eux-mêmes, l’idée demeure forte que les généralistes
sont sans doute utiles, mais qu’ils voient peu de « vrais » malades, c’est-à-
dire de malades qui soient intéressants.
Tout dépend de la définition du malade « intéressant » : s’il s’agit
uniquement de patients à la période dite « d’état » de maladies bien
répertoriées, ou de formes cliniques rarissimes de ces mêmes maladies, il y a
bien des malades dits « intéressants » dans les salles d’attente des
généralistes, mais pas toujours en majorité. Mais s’il nous vient à l’idée
que sont également intéressantes, voire passionnantes, toutes ces personnes
qui digèrent mal, qui ne dorment pas, qui ont des douleurs peu
systématisables, qui sont fatiguées avant d’aller travailler, qui ont des
tableaux de pathologies difficiles à comprendre, etc...., alors les salles
d’attente se trouvent pleines de patients intéressants, voire captivants. Sans
compter que certains symptômes d’allure banale peuvent précéder, parfois
pendant longtemps, l’apparition de pathologies sévères, ce qui impose une
attention soutenue.
ÉDECINE
244 MÉDECINE Juin 2016
ÉDITORIAL
Jean-Loup Rouy
Ancien maître de conf
erence libre de
m
edecine g
en
erale, UFR de Bobigny
559 rue Pipe Souris, 77350 Le M
ee-sur-
Seine
DOI: 10.1684/med.2016.75
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

En réalité, la salle d’attente d’un médecin du vingt-et-
unième siècle ressemble à celle du médecin de mille neuf
cent. Il y a toujours des personnes qui ont des maladies
passagères qu’il faut gérer au mieux. D’autres qui
commencent des pathologies potentiellement graves
qu’il vaudrait mieux déceler à temps.
L’adjectif « grave » mérite d’ailleurs quelques précisions :
un cancer, c’est possiblement grave. Mais, par exemple,
certaines peurs d’avoir une maladie de cœur, ou certaines
douleurs au long cours, ou certaines addictions à toutes
sortes de toxiques courants, cela peut être grave aussi, en
ce sens que cela peut parfaitement gâcher la vie, celle du
patient comme celle du médecin.
D’autres patients, nombreux, nous apportent des symp-
tômes difficiles à interpréter, variables dans le temps,
souvent tenaces. Les médecins peuvent avoir tendance à
conclure que ces personnes « n’ont rien », ou plus
exactement rien « d’intéressant ». C’est précisément
cette référence floue aux nosologies connues qui fait
que ces patients sont particulièrement dignes d’intérêt
[2]. Ils posent, à eux seuls, de nombreuses questions :
–pourquoi certains donnent-ils l’impression qu’ils ne
peuvent même pas envisager une seconde de se passer de
leurs symptômes ?
–pourquoi peut-on être amenés à supposer que des
personnes, qui n’arrivent pas à dire leur mal avec des mots
se trouvent comme « obligées » de parler avec des
symptômes de leur corps ? Et ce, sans qu’elles le sachent,
ni, le plus souvent, ne l’admettent ?
–pourquoi a-t-on tendance à se sentir en échec devant
ces patients ?
–pourquoi certains malades, parmi ceux que nous
baptisons « fonctionnels », « psychosomatiques », etc.
se sentent-ils « rejetés » vers des spécialistes, vers des
psys, vers des médecines parallèles ?
–pourquoi les Facultés de Médecine ont-elles tendance à
marginaliser ces questions, pourtant essentielles ?
Parle-t-on la même langue ?
La Faculté de Médecine nous a appris que l’interrogatoire
du patient est très important. C’est d’ailleurs vrai. Mais
deux éléments ont été peu ou pas abordés :
–d’une part, les patients utilisent les mots de tous les
jours, et nous essayons de les traduire, dans un jargon de
plus en plus moléculaire. Ce langage technique médical
va d’ailleurs devenir de plus en plus physico-chimique, au
fur et à mesure que nous comprenons mieux les processus
biologiques, pathogènes en particulier ;
–d’autre part, une question courte et précise du médecin
amenant une réponse courte et précise du patient
demeure un événement positif mais qui ne résume pas
l’entretien malade-médecin. Souvent, en réponse ou non
à des questions du médecin, certains patients partent
dans des discours éventuellement interminables, à
première vue d’un intérêt limité. Nous n’avons pas
vraiment appris à prendre en compte ces discours, ni
même à les écouter. Or ils ont, évidemment, une ou des
fonctions. Ne serait-ce, par exemple, que pour occuper
l’espace en évitant d’aborder les questions difficiles.
Le prétexte du temps limité dont nous disposons nous
permet de nous auto-absoudre, alors que laisser parler un
patient peut avoir une fonction diagnostique, voire
thérapeutique [3].
Le langage sert donc à se faire comprendre, dans
l’exercice médical comme ailleurs. Le patient adapte
son langage à son médecin, du moins à l’idée qu’il se fait
des capacités de son médecin à entendre. En général,
le médecin est considéré plutôt comme un homme de
science, et il va donc falloir s’adresser à lui dans un
langage estimé scientifique : par exemple, douleur,
cholestérol, tension, poids, fatigue, sommeil, etc. Ces
notions semblent familières aussi bien au médecin qu’au
patient. Elles font appel à des connaissances, nécessaire-
ment mises à jour pendant toute la vie professionnelle.
Il peut arriver que ce langage « technique » soit suffisant,
du moins dans un certain nombre de cas.
Par contre, il est souvent possible de percevoir, derrière ce
langage d’allure technique, un deuxième langage,
comme s’il s’agissait d’un deuxième canal de communi-
cation. Ce deuxième canal laisse passer, plutôt sous forme
d’allusions, des doutes, des peurs, des ébauches de
questions sexuelles, des angoisses de mort. Deux attitudes
médicales théoriques sont possibles dans cette situation :
soit ne pas vouloir entendre ces plaintes plus ou moins
cachées, soit les détecter et vouloir à tout prix qu’elles ne
restent pas cachées. Aucune de ces deux attitudes n’est en
général pertinente, et ce n’est que dans une relation
thérapeutique, souvent au long cours, que les choses
pourront, éventuellement, se clarifier. Rien ne peut se
faire si le médecin, soit n’entend pas, soit entend trop
bien et veut aborder, « de force », le domaine psycho-
affectif plus ou moins en arrière-plan.
Certains patients, évoqués plus haut, donnent donc
l’impression qu’ils ont perdu, ou n’ont jamais eu, la
capacité à s’exprimer avec le langage habituel des mots.
Ils semblent être condamnés à parler avec des malaises,
des maladies, qui peuvent même être inquiétantes, et ce,
quelquefois pendant une vie entière. Cette situation,
fréquente, est à l’origine de beaucoup de difficultés.
Le langage étant fait pour communiquer et se compren-
dre, le risque est grand d’arriver à une incompréhension
mutuelle :
–le médecin soupçonne l’existence de problèmes cachés,
« dissimulés », ce qui l’amènerait presque à en vouloir à
son patient ;
–le malade ne comprend pas l’attitude du médecin qui
ne paraît pas toujours le prendre au sérieux.
Les conséquences de ces difficultés à se comprendre sont
faciles à constater : examens répétés, pour une réassu-
rance aléatoire, bilans spécialisés dans le même but,
ruptures éventuelles qui laissent malade et médecin
malheureux, insatisfaits l’un et l’autre [4].
Deux portes ?
Au cours de certaines consultations, il semble donc bien y
avoir deux canaux de communication simultanés entre
patient et médecin, deux portes différentes entre le
patient et nous : une porte A et une porte B.
MÉDECINE Juin 2016 245
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

–Par la porte A, qui est plutôt bien ouverte en général,
patient et médecin communiquent avec les mots des
Facultés de Médecine : douleur, digestion, éruption,
cholestérol, tension artérielle, etc. Depuis quelque temps,
le vocabulaire des patients s’est enrichi avec Google et
Wikipedia, sans que ce soit toujours bénéfique.
Pour que la communication par cette porte soit efficace,
il faut se mettre d’accord sur la signification technique de
chaque mot, ce qui n’est pas toujours évident, le « foie »
du patient n’étant pas forcément celui du médecin. Il est
également nécessaire que le médecin soit aussi à jour que
possible au niveau de ses connaissances. Mais, d’une
façon générale, quitte à se faire aider par des examens
biologiques, radios et autres collègues spécialistes, les
choses, même complexes, se passent plutôt bien par cette
porte A.
–C’est par la porte B que les choses sont plus difficiles.
D’abord, elle n’est pas toujours franchement ouverte, et
ce n’est pas étonnant. En effet, par cette porte-ci, le
patient se plaint, ou voudrait donc plus ou moins se
plaindre, de peurs, désirs, mort, sexualité. Au lieu de
présenter des éléments biologiques mesurables, il aime-
rait, plus ou moins confusément, amener le médecin sur
un terrain difficile, une difficulté venant du fait que le
médecin peut se sentir personnellement concerné par ces
problèmes, non seulement en tant que médecin mais
aussi en tant qu’homme. De plus, ces sujets sont, à juste
titre, considérés comme difficiles et donc périlleux. Il est
bien tentant de se déclarer incompétent dans ces
domaines. Et les choses sont en fait encore bien plus
complexes : tout se passe comme si cette fameuse porte B
avait deux clefs, une détenue par le patient, l’autre par le
médecin. Parfois, le patient voudrait ouvrir la porte avec
sa clef, mais la clef du médecin la maintient fermée.
Parfois, percevant une demande dans ce domaine, le
médecin ouvre avec sa clef, espérant des confidences,
mais c’est le patient qui garde son côté fermé. Rien ne
bougera, sauf si chacun ouvre en même temps avec sa
clef...
Pourquoi ne pas imaginer, au risque de caricaturer, que si
les demandes pressantes du patient se heurtent à une
porte B fermée, ses demandes par la porte A vont aller en
s’accentuant ? Autrement dit, que notre patient ne va pas
aller mieux, voire qu’il va aller plus mal si on l’a mal
entendu ?
Il y a là un sujet de recherche permanente et inaboutie.
L’objectif final est de faire qu’il n’y ait qu’une seule porte.
Les progrès dans ce domaine sont loin d’être certains tant
la communauté médicale est persuadée que les gênes et
les molécules vont finir par tout expliquer. Ce qui pourrait
enfin permettre de fermer définitivement cette malheu-
reuse porte B.
Ouverte ou fermée, la complexité de la nature humaine
étant ce qu’elle est, il y a peu de chances de se débarrasser
de cette porte B tout de suite. Essayer d’en tenir compte
serait peut-être plus réaliste. Mais, c’est vrai, ce n’est pas
facile.
~Liens d’intérêts : l’auteur déclare n’avoir aucun lien
d’intérêt en rapport avec l’article.
RÉFÉRENCES
1. Balint M. Le médecin son malade et la maladie. Paris : Petite Bibliothèque Payot,
1966.
2. Bury J. Comment passer du « vous n’avez rien... qui m’intéresse » à « ce qui
m’intéresse, c’est que vous n’avez rien ». Psychologie médicale 1977 ; 9 : 2353-8.
3. Balint E, Norell JS, Barisse R. Six minutes par patient : interactions en consultations
de médecine générale. Paris : Payot, 1976.
4. Rouy JL, Pouchain D. Relation médecin-malade et médecine générale. Encycl Med
Chir AKOS Encyclopédie Pratique de Médecine 2003 ; 1-0025.
246 MÉDECINE Juin 2016
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.
1
/
3
100%