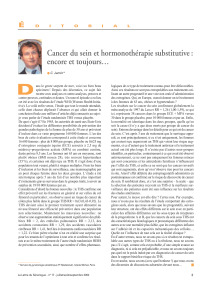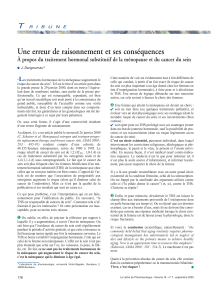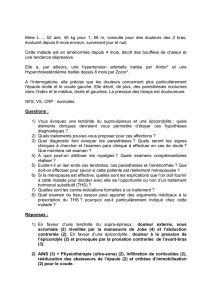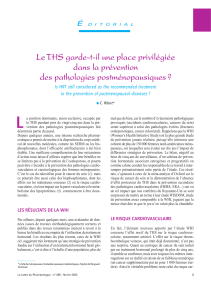Lire l'article complet

383
progrès en
Progrès en prévention
Bénéfices et risques
du traitement
hormonal substitutif
de la ménopause,
en dehors du risque
cardiovasculaire
Bénéfices du THS
Pallier la carence estro-
génique
Le THS est le meilleur
traitement des signes de
carence estrogénique, en
particulier des bouffées de
chaleur (2-4). Elles prédo-
minent au début de la
ménopause et sont généra-
lement transitoires. Quoi
qu’il en soit, elles durent
rarement plus de cinq ans.
Pour certains auteurs,
compte tenu des effets
secondaires potentiels du
THS (voir plus loin), c’est
cette seule indication,
limitée au début de la
ménopause, qui est retenue, le THS étant
interrompu après quatre à cinq années. Il
n’existe pas, en effet, de solution thérapeu-
tique alternative aussi efficace pour le trai-
tement des bouffées de chaleur. D’autre
part, le THS améliore la sécheresse vagina-
le et la baisse de la libido en rapport avec la
carence estrogénique. Ces effets bénéfiques
s’estompent à l’arrêt du THS.
Prévenir l’ostéoporose
et ses complications
Le THS prévient l’ostéoporose et ses
complications. Il augmente en effet la
densité minérale osseuse (2, 4-7). Cette
action dure tant que dure le traitement, et
sa pérennisation nécessiterait la poursuite
du traitement sans interruption. Dans le
cadre des études épidémiologiques d’ob-
servation, le THS est associé à une réduc-
tion de 50 à 80 % des
fractures vertébrales et de
25 % des fractures non
vertébrales, après au
moins cinq ans d’utilisa-
tion (2-4, 7, 8). Les
études d’intervention ran-
domisées mettant en évi-
dence un effet du THS sur
la réduction de l’inciden-
ce des fractures sont en
revanche peu nombreuses
et portent sur des effectifs
souvent limités.
Améliorer la cognition
Le THS aurait des effets
sur la cognition et sur la
prévention de la maladie
d’Alzheimer (2-4, 8, 9).
Prévenir le cancer du
côlon
Enfin, le rôle du THS
dans la diminution du
risque de cancer du côlon
a été évoqué (2-4, 8, 9).
Risques du THS
L’ h yperplasie endomé-
triale
Le THS de la ménopause est associé à un
risque d’hyperplasie endométriale. Cette
hyperplasie est atypique dans la moitié
des cas constituant alors un risque de can-
cer de l’endomètre (2-4, 8-10). Ce risque
est limité au THS par estrogènes seuls, il
disparaît en effet si le traitement associe
estrogènes et progestatifs. Chez une
femme ayant encore son utérus, il est donc
indispensable d’associer un progestatif au
traitement par estrogènes.
Le risque veineux thrombo-embolique
Le THS est associé à un risque accru de
maladie thrombo-embolique veineuse.
Jusqu’à la publication de l’étude HER (Heart and
Estrogen/Progestin Replacement) (1) en 1998, le
traitement hormonal substitutif (THS) de la ménopause
était largement recommandé pour la majorité des
femmes, en l’absence des contre-indications classiques.
De plus, compte tenu des résultats des études épidémio-
logiques d’observation de prévention primaire de la
maladie coronarienne, l’opinion s’était généralisée
selon laquelle le THS de la ménopause avait un effet
bénéfique sur la prévention de la maladie coronarien-
ne, en particulier chez les femmes diabétiques ou
hypercholestérolémiques. L’étude HER (1) a obligé à
reconsidérer cette prescription large. A-t-elle pour
autant bouleversé les habitudes thérapeutiques ou enta-
mé le “capital-sympathie” dont bénéficie le THS ? Avant
d’aborder le problème particulier du risque cardio-
vasculaire, les bénéfices et les risques du THS de la
ménopause seront rappelés à la lumière des publica-
tions épidémiologiques les plus récentes. Enfin, les alter-
natives au THS et leurs aptitudes à régler ou non les
questions soulevées par l’étude HER seront évoquées.
* Service d’endocrinologie et des maladies de
la reproduction, CHU Bicêtre et Faculté de
médecine Paris-Sud, Le Kremlin-Bicêtre.
Service de biostatistique et d’informatique
médicale, CHU Necker-Enfants malades et
Faculté de médecine, Paris.
Comment envisager le traitement substitutif de la
ménopause après l’étude HER
Philippe Chanson*, Paul Landais**

384
Act. Méd. Int. - Hypertension (12), n° 4, avril 2000
progrès en
Progrès en prévention
Dans une revue récente de la littérature,
ce risque apparaît deux à trois fois supé-
rieur chez les femmes sous THS à celui
des femmes ménopausées non traitées
(11, 12). Les études sont concordantes
sur ce point. Toutefois, le risque absolu
reste faible. En effet, le THS n’est à
l’origine que d’un cas supplémentaire de
thrombose veineuse pour 5 000 années-
patientes de traitement. En d’autres
termes, il faut traiter 5 000 femmes pen-
dant un an pour constater la survenue
d’une thrombose veineuse de plus chez
les femmes traitées par rapport aux
femmes non traitées. Pour l’embolie pul-
monaire, cela signifie la survenue d’un
cas supplémentaire pour 20 000 années-
patientes chez des femmes sous THS par
rapport à des femmes non traitées. Sous
THS, chez les femmes plus âgées ayant
déjà une affection coronaire (comme par
exemple dans l’étude HER), ce risque
s’accroît. Un événement thrombo-embo-
lique veineux supplémentaire est consta-
té pour 250 années-patientes par rapport
à une population témoin non traitée. Sur
quatre ans, on observe un événement
thrombo-embolique veineux de plus que
dans une population témoin non traitée,
pour 62 femmes traitées par THS.
Le risque de cancer du sein
Une méta-analyse de 51 enquêtes épidé-
miologiques réalisées au cours des
vingt-cinq dernières années a porté sur
près de 160 000 femmes, dont plus de
900 avaient reçu un THS pendant quinze
ans ou plus. Cette analyse a montré que
chez les femmes en cours de traitement
ou ayant reçu un THS, et ce sur une
durée de plus de cinq ans, le risque de
cancer du sein était augmenté par rap-
port à des femmes jamais traitées (RR
1,35 [IC 95 % : 1,21-1,49]) (13). Le
risque augmentait avec la durée du trai-
tement de 2,3 % par an. En Amérique du
Nord et en Europe, l’incidence cumulée
de cancer du sein chez les femmes âgées
de 50 à 70 ans et n’ayant jamais utilisé
de THS est d’environ 45 pour 1 000
femmes. L’accroissement du nombre de
femmes qui, commençant un THS à
l’âge de 50 ans, feront un cancer du sein,
sera de 2 [IC 95 % : 1-3] après cinq ans
d’utilisation du THS, de 6 [IC 95% : 3-
9] après dix ans et de 12 [IC 95% : 5-20]
après quinze ans (13).
Ces données ont été confirmées par une
étude plus récente avec un effet addi-
tionnel lié à l’utilisation des progesta-
tifs (14). Toutefois, si l’on n’a pas pris
le traitement pendant plus de cinq ans et
au fur et à mesure que l’on s’éloigne de
la date d’arrêt du traitement, le risque
du cancer du sein s’estompe. Ainsi, un
THS indiqué dans le but de diminuer
les bouffées de chaleur et interrompu
avant cinq années ne semble donc pas
conférer un risque accru de cancer du
sein (2, 4).
D’autre part, les cas de cancer du sein
chez les femmes recevant ce type de
THS, représenté surtout par des estro-
gènes conjugués équins sans progestatif
associé, ont été le plus souvent des
formes localisées de pronostic plus favo-
rable que ceux mis en évidence chez les
femmes sans traitement de substitution
(15). Cependant, cette constatation est
discutée, compte tenu d’un biais poten-
tiel de détection (dépistage différentiel
et diagnostic plus précoce chez les
femmes sous THS) (16).
Les autres risques
Les données concernant la pathologie
bénigne du sein, la diminution de la sensi-
bilité et de la spécificité de la mammogra-
phie dans le dépistage du cancer du sein,
associées aux THS, sont encore controver-
sées (2, 4, 17).
Le THS de la ménopause semblait associé
à une augmentation du risque d’affection
vasculaire dans l’étude HER (1), cepen-
dant les résultats définitifs (http://epibio-
stat.ucsf.edu/HERS/) n’ont pas confirmé
ce fait (RR1.34 [CI 95 % : 0,98-1,84].
Traitement hormonal substitutif
de la ménopause et risque
cardiovasculaire
THS et facteurs de risque
cardiovasculaire
Effets sur les lipides
Les effets observés sur les lipides sont
cohérents avec les résultats des enquêtes
épidémiologiques de prévention primaire.
En effet, au cours de la première année du
traitement, le THS administré par voie
orale abaisse le LDL-cholestérol athéro-
gène et élève le HDL-cholestérol, protec-
teur (2-4, 12, 18, 19). À plus long terme
(au-delà de trois ans), ces effets devien-
nent plus modestes, voire non significa-
tifs. L’effet des estrogènes sur l’augmenta-
tion des triglycérides semble limité aux
estrogènes administrés per os. Lorsque
ceux-ci sont administrés de manière per-
cutanée, il ne semble pas exister d’effet
sur les triglycérides (2, 12). Signalons que
les femmes diabétiques ont peut-être une
réponse moindre en termes de HDL-cho-
lestérol, mais augmentent plus leurs
concentrations de triglycérides que les
femmes non diabétiques (20, 21).
En principe, les progestatifs ont un effet
opposé sur le cholestérol, en particulier
sur le HDL-cholestérol, mais cet effet
dépend de la dose du progestatif utilisé et
de son caractère androgénique ou non. En
pratique clinique toutefois, que les pro-
gestatifs soient présents ou non, les effets
lipidiques des estrogènes paraissent
inchangés.
Effets sur les facteurs de l’hémostase
Les estrogènes administrés par voie orale
diminuent le fibrinogène et l’activité du
PAI-1 (inhibiteur de l’activateur du plas-
minogène) et augmentent la fibrinolyse.
Ces actions sont plutôt bénéfiques, mais
l’effet prédominant est, en revanche, pro-
coagulant, lié à une augmentation des
marqueurs d’activation de la coagulation

385
progrès en
Progrès en prévention
et à une diminution de l’activité anti-
thrombine plasmatique (12, 22). On note-
ra que les estrogènes percutanés ont peu
(voire pas) d’effets sur la coagulation ou
sur la fibrinolyse (12).
Effet sur l’endothélium vasculaire
Les estrogènes ont également, sur la paroi
artérielle, un effet vasodilatateur endothé-
lium-dépendant (19, 23).
THS et risque cardiovasculaire
Les résultats des enquêtes épidémio-
logiques d’observation parues avant
l’étude HER
Risque coronarien
Dans les études d’observation, le THS est
associé à une diminution de 35 à 55 % du
risque coronarien (2-4, 9, 18, 19, 24).
D’après une méta-analyse récente de qua-
torze enquêtes épidémiologiques, à propos
de l’association entre la prise d’un THS et
la survenue de survenue d’un événement
coronarien majeur (infarctus du myocarde
et décès d’origine coronarienne), la réduc-
tion du risque sous THS était de 38 % (RR :
0,62 [IC à 95 % : 0,56-0,69]) (12). Le THS
était constitué de dérivés conjugués équins
des estrogènes dans la majorité des études.
Risque d’accident vasculaire cérébral
Il est différent selon la nature de l’acci-
dent (12). Le THS paraît augmenter le
risque d’accident vasculaire cérébral
ischémique (augmentation du risque de
12 %) et diminuer le risque d’accident
hémorragique (diminution du risque de
35 %) (12, 25).
Commentaires
En dépit de ces résultats favorables du
THS sur le risque cardiovasculaire, de
nombreux auteurs se sont interrogés sur la
validité de ces résultats et ont envisagé
l’existence de biais, en particulier biais de
sélection ou biais d’observance (18, 26,
27). Les femmes traitées par THS ont, en
effet, un niveau socio-éducatif supérieur,
une meilleure observance du traitement,
sont plus minces, en meilleure santé et ont
en général un meilleur profil vis-à-vis des
facteurs de risque cardiovasculaire (heal-
thy user effect des anglo-saxons) (11, 24).
On aurait ainsi tendance à surestimer les
effets bénéfiques du THS en présélection-
nant des femmes à moindre risque cardio-
vasculaire. Des données récentes sem-
blent confirmer cette notion (28). Un biais
d’observance est aussi possible : les
femmes prenant un THS de manière pro-
longée sont des femmes plus observantes
; et l’on sait que, quel que soit le traite-
ment pris, l’observance est, en soi, un fac-
teur de réduction de mortalité cardiovas-
culaire (12).
Les résultats de l’essai HER
L’étude HER est la première étude randomi-
sée analysant l’effet du THS (sous forme
d’estrogènes conjugués équins associés à
l’acétate de médroxyprogestérone) comparé
à celui d’un placebo chez des femmes ayant
déjà eu un événement coronarien (1). Il
s’agissait donc d’un essai de prévention
secondaire. Les résultats furent pour le
moins inattendus, puisque après 4,1 années
de suivi, les femmes traitées par THS
n’avaient pas présenté moins d’infarctus du
myocarde ou de décès de cause coronarien-
ne que les femmes traitées par placebo, res-
pectivement 179 versus 182 événements,
soit un risque relatif de 0,99 [IC 95 % : 0,81-
1,22]. Il semblait même que, lors de la pre-
mière année, le THS était associé à une
majoration du risque, disparaissant par la
suite.
Même si cette étude n’était pas indemne
de critiques méthodologiques, elle a semé
le trouble dans les esprits, ce d’autant que
les résultats des enquêtes antérieures
paraissaient concordants et que la notion
d’effet protecteur cardiovasculaire du
THS en prévention primaire avait fait son
chemin. Les auteurs et les éditorialistes
n’ont d’ailleurs pas manqué, à cette occa-
sion, de souligner la valeur irremplaçable
des études randomisées plutôt que des
études d’observation avant de tirer des
conclusions définitives (1, 26, 27, 29). Il
n’est pas inutile de rappeler que cet essai
HER concernait la prévention secondaire
des événements coronariens, et que les
enquêtes épidémiologiques concernaient
surtout leur prévention primaire.
Qui croire : essais cliniques ou enquêtes
d’observation ?
Les biais possibles des études
d’observation
Les données épidémiologiques concer-
nant les bénéfices et les risques du THS
sont essentiellement issues d’enquêtes
d’observation, études de cohortes ou
études cas/témoins en l’occurrence. Cette
procédure consiste à observer la survenue
d’un ou de plusieurs phénomènes dans
une population donnée et dans des condi-
tions précisément définies pour en tirer
des informations descriptives, voire étio-
logiques. Cependant, dans ce dernier cas,
les informations étiologiques qu’elle pro-
cure ne permettent pas une inférence cau-
sale aussi rigoureuse qu’une procédure
expérimentale telle qu’un essai clinique.
Dans ce dernier type d’approche, l’obser-
vateur modèle le cadre de son action afin
de tirer des implications de causalité entre
le traitement retenu et le résultat obtenu,
ce que les enquêtes ne permettent pas de
contrôler aussi étroitement. Leurs résul-
tats sont ainsi exposés à des biais, c’est-à-
dire à des effets susceptibles d’altérer la
représentativité des résultats.
L’évolution du risque coronarien dans
l’étude HER
Les résultats de l’étude HER doivent aussi
être regardés avec une attention particuliè-
re pour ce qui concerne la première année
de traitement (1, 29). On s’aperçoit en
effet que le risque relatif d’affection coro-
naire, non seulement ne baisse pas au
cours de la première année de traitement,
mais accuse même une discrète (mais
significative) augmentation (42,5 événe-
ments pour 1 000 années-femmes de THS
versus 28 événements pour 1 000 années-
femmes sous placebo, p = 0,03). Après la
première année, le nombre d’événements
pour 1 000 années-femmes diminue de
façon nette chez les femmes sous THS,

386
Act. Méd. Int. - Hypertension (12), n° 4, avril 2000
progrès en
Progrès en prévention
alors qu’il augmente chez les femmes
sous placebo ; le risque relatif diminue
donc et, au terme des quatre ans de l’essai,
on n’observe plus de différence significa-
tive entre les deux groupes.
Tentative d’explication…
Comment, d’une part expliquer cette discor-
dance, entre l’essai HER et les enquêtes d’ob-
servation antérieures ? Et pourquoi, d’autre
part, le risque relatif observé avec le THS
augmente-t-il lors de la première année de
l’étude HER, puis diminue-t-il par la suite ?
La première hypothèse serait que le THS,
tel qu’utilisé dans l’étude HER, n’a pas
d’effet sur le risque cardiovasculaire, et
que le profil observé d’augmentation ini-
tiale du risque et de décroissance ultérieu-
re n’est que le fruit du hasard (29). Cette
absence d’effet, contredisant ceux des
études d’observation, pourrait en partie
être expliquée par des biais de sélection et
d’observance évoqués plus haut (12) et/ou
par le type de progestatif utilisé dans
l’étude HER, l’acétate de médroxyproges-
térone, dont l’action pourrait contrebalan-
cer les effets bénéfiques des estrogènes. Il
s’agit, parmi les progestatifs, de celui qui
a les effets les moins favorables sur le
HDL-cholestérol. Cette première hypo-
thèse n’emporte pas la conviction, car elle
mêle au raisonnement des résultats de pré-
vention primaire et de prévention secon-
daire. Que le résultat de l’étude HER
remette en question les résultats des
enquêtes d’observation de prévention
secondaire répond à une logique indiscu-
table. En revanche, qu’ils jettent l’op-
probre sur l’ensemble des résultats des
enquêtes de prévention primaire ne relève
pas d’une logique évidente. On ne parle pas
des mêmes patientes ni du même risque. Il
n’est pas immédiat de tenir pour acquis
que la probabilité de faire un premier
accident coronarien est analogue à la pro-
babilité de faire un nouvel accident,
compte tenu qu’on en a déjà présenté un
(et, bien sûr, non fatal).
La seconde hypothèse pose que l’alter-
nance effet délétère puis effet bénéfique
du THS au cours du temps serait due à un
processus réel mais opposé du traitement
utilisé. Après quatre ans de suivi, l’effet
net du traitement est nul, mais que serait-
il advenu si l’on avait poursuivi l’étude
au-delà de ce terme : l’effet bénéfique mis
en évidence dans les études d’observation
aurait-il alors émergé (29) ? Il est souvent
difficile aux études d’observation de
mettre en évidence ce type d’effets délé-
tères initiaux. On pourrait évoquer, par
exemple, que certains groupes de femmes
seraient plus sensibles aux effets délétères
du THS dès sa mise en route (pendant les
quatre premiers mois de traitement) et
que, progressivement, les effets délétères
du traitement seraient moins prévalents
que les effets bénéfiques.
Quoi qu’il en soit, avant de conclure à
l’absence d’effet protecteur cardiovascu-
laire du THS, il paraît nécessaire d’at-
tendre les résultats d’autres études pros-
pectives randomisées, en particulier
celles qui offriront un suivi supérieur à
cinq ans. On attendra ainsi, par exemple,
les résultats (prévus pour 2007 !) d’un
nouvel essai clinique, le Women Health
Initiative Trial, dont l’objet est d’évaluer
les bénéfices et les risques du THS. Il
s’agit d’un essai clinique lancé aux
États-Unis et randomisant THS contre
placebo, avec un recrutement nécessaire
de 27 000 femmes, âgées de 50 à 79 ans,
et suivies pendant neuf ans (30).
Ces questions encore non résolues doivent
stimuler l’identification de patientes à
risque d’événements cardiovasculaires à
l’institution du THS. Un risque initial
accru pourrait être associé à des facteurs
de risque génétiques portant, par exemple,
sur les facteurs de coagulation, à la pré-
sence de plaques athéromateuses plus vul-
nérables au cours de la mise en route du
traitement ou encore à l’existence de cer-
taines interactions médicamenteuses qui
favoriseraient l’augmentation de facteurs
sanguins procoagulants.
Les alternatives thérapeutiques
Les diphosphonates
S’ils ont prouvé qu’ils prévenaient, de
façon aussi satisfaisante que le THS, la
déminéralisation osseuse et le risque de
fractures vertébrales et non vertébrales, ils
n’ont, bien évidemment, aucun effet sur
les bouffées de chaleur ni sur les signes de
carence estrogénique et n’ont pas non plus
d’effet sur le plan cardiovasculaire (2, 4,
6, 7). En leur faveur, il faut aussi souligner
qu’ils n’augmentent pas le risque de can-
cer du sein.
Les modulateurs spécifiques des récep-
teurs des estrogènes (SERM)
Ce sont des stéroïdes, de structure
proche de celle des estrogènes, capables
de se lier aux récepteurs des estrogènes
mais d’y induire un effet agoniste sur
certains tissus et antagoniste sur d’autres :
le SERM (Selective Estrogen Receptor
Modulator) idéal serait donc celui ayant
un effet agoniste sur l’os et la paroi vas-
culaire, mais un effet antagoniste sur
l’endomètre et le sein !
Le tamoxifène
Il n’a pas d’effet sur les bouffées de chaleur.
Il diminue le risque de cancer du sein, chez
les femmes à risque, de 45 %. Il augmente
le risque de maladie veineuse thrombo-
embolique de façon identique au THS. Il
n’a pas d’effet sur l’ostéoporose (4).
Le raloxifène (2, 4, 19, 31, 32)
Il diminue le risque de cancer du sein de
75 % à trois ans. Il diminue le risque de
fracture vertébrale de 30 à 50 %. Il ne
modifie pas le risque de fracture non ver-
tébrale. Il augmente la densité minérale
osseuse d’environ 2 % aux différents
sites. Il ne s’accompagne pas d’une aug-
mentation du risque de cancer de l’endo-
mètre. Il n’a pas d’effet sur les bouffées de
chaleur. Il diminue le LDL-cholestérol
sans augmenter les triglycérides. Il aug-
mente le risque d’événements thrombo-

387
progrès en
Progrès en prévention
emboliques veineux par trois, comme le
THS. Ses effets sur le risque cardiovas-
culaire de la femme sont inconnus, mais
une étude menée chez la guenon ovariec-
tomisée a montré que le raloxifène ne
reproduit pas les effets de réduction des
plaques d’athérome dont est capable le
traitement par les estrogènes, laissant
penser que le raloxifène n’est pas un
agoniste des récepteurs des estrogènes
sur la paroi vasculaire (33).
Conclusion
Le traitement hormonal substitutif de la
ménopause reste, en l’an 2000, un traite-
ment efficace pour prévenir l’ostéoporose
postménopausique et ses conséquences
sur les fractures, en particulier verté-
brales. C’est également le meilleur traite-
ment des bouffées de chaleur de la méno-
pause. Il s’accompagne toutefois d’un
risque absolu minime (mais néanmoins
bien réel) de survenue de cancer du sein,
surtout lorsque son utilisation est supé-
rieure à cinq années.
L’étude HER a jeté quelques doutes quant
à son effet de protection cardiovasculaire
initialement suggéré par les études d’ob-
servation; il est même peut-être (c’est à
vérifier) à l’origine d’une augmentation
des événements coronariens dans la pre-
mière année de traitement, augmentation
disparaissant par la suite. Pour l’instant, il
n’est donc plus raisonnable de considérer,
en particulier chez les femmes à risque
cardiovasculaire, que le THS de la méno-
pause constitue en soi un traitement pré-
ventif des événements coronariens, ce
d’autant qu’il augmente le risque veineux
thrombo-embolique. Aussi, à elle seule,
l’existence d’un terrain à risque d’affec-
tion cardiovasculaire ne peut pas être
actuellement retenue comme une indica-
tion au THS. Les statines constituent sûre-
ment une meilleure alternative dans ce
contexte (34).
Les alternatives au THS chez la femme
ménopausée sont possibles. Ainsi, l’exer-
cice physique non seulement protège du
risque cardiovasculaire, mais également
limite la déminéralisation osseuse et pro-
tège des fractures vertébrales. Le traite-
ment par les diphosphonates n’a pas les
effets du THS sur la carence estrogé-
nique mais a, sur l’os, un effet équiva-
lent. Enfin, on attend beaucoup des
modulateurs spécifiques des récepteurs
des estrogènes (SERM). Leurs effets sur
l’os sont globalement équivalents de
ceux du THS, mais ils ont l’avantage
supplémentaire de diminuer le risque de
cancer du sein (au moins dans les études
à court terme). Ils présentent en revanche
le même risque de survenue d’événe-
ments thrombo-emboliques veineux que
le THS. Ils ne semblent pas, d’après les
études portant sur simplement trois ans
de suivi, s’accompagner d’une modifica-
tion du risque coronarien. Malheureuse-
ment, même s’ils améliorent un peu les
signes de carence estrogénique (séche-
resse vaginale), ils n’ont aucun effet sur
les bouffées de chaleur.
Les indications habituelles du THS carac-
térisées par la prévention des signes de
carence estrogénique, la prévention de
l’ostéoporose et de ses conséquences sont
donc les indications essentielles à consi-
dérer pour la mise en route d’un THS de
la ménopause. L’idéal serait, bien évidem-
ment, de disposer de moyens permettant
de reconnaître, parmi les femmes à risque
cardiovasculaire, celles qui sont à risque
de présenter une aggravation des événe-
ments coronariens en début de THS, afin
de mieux définir les contre-indications
chez ces femmes.
Enfin, on espère beaucoup en la mise
au point de nouvelles molécules
capables d’être agonistes sur certaines
cibles des estrogènes tout en étant anta-
gonistes sur d’autres et qui permettront
donc de garder les bénéfices des estro-
gènes tout en évitant leurs inconvé-
nients !
Références bibliographiques
1. Hulley S., Grady D., Bush T., Furberg C.,
Herrington D., Riggs B. et coll. Randomized
trial of estrogen plus progestin for secondary
prevention of coronary heart disease in post-
menopausal women. Heart and Estrogen/pro-
gestin Replacement Study (HERS) Research
Group (see comments). Jama 1998 ; 280 (7) :
605-13.
2. Greendale G.A., Lee N.P., Arriola E.R. The
menopause. Lancet 1999 ; 353 (9152) : 571-80.
3. Belchetz P.E. Hormonal treatment of post-
menopausal women (see comments). N. Engl.
J. Med. 1994 ; 330 (15) : 1062-71.
4. McNagny S.E. Prescribing hormone repla-
cement therapy for menopausal symptoms.
Ann. Intern. Med. 1999 ; 131 (8) : 605-16.
5. Effects of hormone therapy on bone mineral
density : results from the postmenopausal
estrogen/progestin interventions (PEPI) trial.
The Writing Group for the PEPI (see com-
ments). Jama 1996 ; 276 (17) : 1389-96.
6. Hosking D., Chilvers C.E., Christiansen C.,
Ravn P., Wasnich R., Ross P. et coll. Prevention
of bone loss with alendronate in postmenopausal
women under 60 years of age. Early
Postmenopausal Intervention Cohort Study
Group. N. Engl. J. Med. 1998 ; 338 (8) : 485-92.
7. Eastell R. Treatment of postmenopausal
osteoporosis (see comments). N. Engl. J. Med.
1998 ; 338 (11) : 736-46.
8. Col N.F., Pauker S.G., Goldberg R.J.,
Eckman M.H., Orr R.K., Ross E.M. et coll.
Individualizing therapy to prevent long-term
consequences of estrogen deficiency in post-
menopausal women. Arch. Intern. Med. 1999 ;
159 (13) : 1458-66.
9. Grady D., Rubin S.M., Petitti D.B., Fox C.S.,
Black D., Ettinger B. et coll. Hormone therapy
to prevent disease and prolong life in postme-
nopausal women (see comments). Ann. Intern.
Med. 1992 ; 117 (12) : 1016-37.
10. Effects of hormone replacement therapy on
endometrial histology in postmenopausal
women. The Postmenopausal Estrogen/Pro-
gestin Interventions (PEPI) Trial. The Writing
Group for the PEPI Trial (see comments).
Jama 1996 ; 275 (5) : 370-5.
11. Oger E., Scarabin P.Y. Assessment of the
risk for venous thromboembolism among users
of hormone replacement therapy. Drugs Aging
1999 ; 14 (1) : 55-61.
 6
6
1
/
6
100%