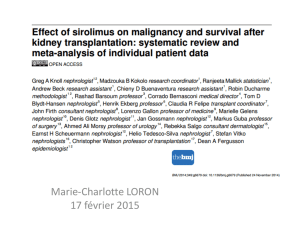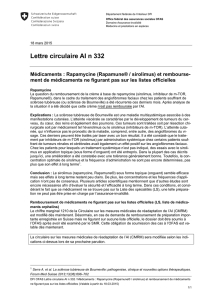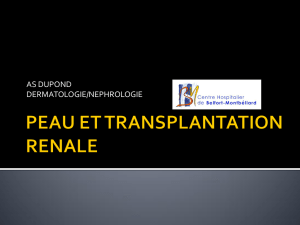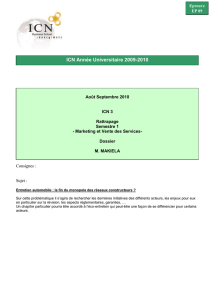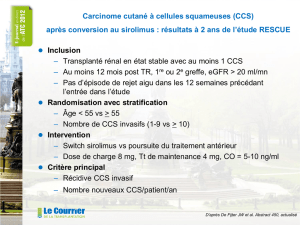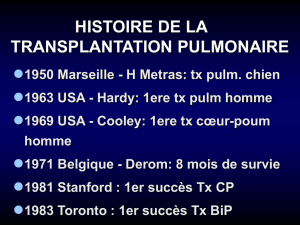Sirolimus en transplantation rénale : données récentes et modalités d’utilisation »

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XI - n° 2 - avril-mai-juin 2011
94
Mise au point
Résumé
Abstract
»
Si la survie des greffons rénaux à court terme s’est nettement
améliorée au cours des dernières années, la survie à long terme est
restée inchangée du fait de la survenue de rejets humoraux chroniques,
de néphropathies chroniques d’allogreffe (fibrose interstitielle/atrophie
tubulaire) et de décès des patients avec un greffon fonctionnel,
décès principalement dus à des maladies cardiovasculaires et à des
cancers. Une part de cette évolution négative à long terme est liée à
la toxicité rénale des inhibiteurs de la calcineurine (ICN) et au fait que
ces immunosuppresseurs augmentent le risque de cancer.
»
Des stratégies de conversion précoce des ICN par des inhibiteurs de la
mTOR, tel le sirolimus, se sont récemment développées, apportant une
alternative à la poursuite des ICN. Le rationnel de la conversion précoce
se fonde sur les effets bénéfiques du sirolimus sur la prévention et le
ralentissement de la prolifération tumorale et sur la fonction rénale.
»
Le profil des patients pouvant bénéficier d’une conversion précoce
est à définir en fonction de différents critères. Le délai de conversion
doit prendre en considération les exigences liées à la prévention du
rejet, à la toxicité des ICN ainsi que les contraintes liées au patient. La
conversion précoce peut être initiée de 2 façons : brutale ou progressive.
Cette conversion doit être programmée, explicitée au patient candidat
dès les premières consultations, et nécessite de bien connaître les
effets indésirables du sirolimus et la gestion de leur prise en charge.
Mots-clés : Sirolimus - Conversion précoce - Cancer - Fonction rénale
- Effets indésirables.
Although short term survival of kidney graft dramatically
improved over the last years, there has been no improvement
in long term survival, because of the occurrence of chronic
humoral rejection, chronic allograft nephropathy (interstitial
fibrosis/tubular atrophy) and death of patients with a
functioning graft, mostly due to cardiovascular diseases and
cancers. This long term negative evolution is partially due to
renal toxicity of calcineurin inhibitors (CNI) and the increased
risk of cancer associated with these molecules.
Recently, early conversion strategies from CNI to mTOR
inhibitors, like sirolimus, were developed as an alternative to
current CNI-based strategies. Rationale for early conversion is
based on sirolimus properties in terms of cancer prevention and
antiproliferative effects, and its positive impact on renal function.
Patients eligible to early conversion must be highly selected
according to different factors. Timing for conversion is defined
according to considerations of reject prevention, CNI toxicities
and patient specific constraints. Early conversion may be initiated
in two different ways: abrupt or progressive. This conversion must
be anticipated, explained to the eligible patient since the very
first visit and imply that the physician has a good knowledge of
sirolimus induced-side-effects and their management.
Keywords: Sirolimus - Early conversion - Cancer - Kidney
function - Side-effects.
Sirolimus en transplantation rénale :
données récentes et modalités d’utilisation
Sirolimus in kidney transplantation: recent data and practical use
Nassim Kamar*, Laurent Becquemont**, Philippe Grimbert***, Didier Ducloux****
* Service de néphrologie,
dialyse et transplantation
d’organes, hôpital Rangueil,
CHU de Toulouse.
** Service de pharma-
cologie, hôpital Bicêtre,
LeKremlin-Bicêtre.
*** Service de néphrologie
et transplantation, hôpital
Henri-Mondor, Créteil.
**** Service de néphrolo-
gie, dialyse et transplanta-
tion rénale, hôpital Saint-
Jacques, Besançon.
La survie des greffons rénaux à court terme s’est
nettement améliorée ces dernières années du
fait de l’utilisation d’immunosuppresseurs de
plus en plus puissants. Toutefois, la survie à long terme
est restée inchangée pour plusieurs raisons, parmi les-
quelles la survenue de rejets chroniques et de néphro-
pathies chroniques d’allogreffe (fibrose interstitielle
et atrophie tubulaire [FI/AT]), ainsi que le décès de
patients avec un greffon fonctionnel. Les maladies
cardiovasculaires et les cancers sont les premières
causes de décès (1, 2). L’utilisation d’inhibiteurs de la
mTOR, tel le sirolimus, permet de prévenir le risque
de cancer et de préserver la fonction rénale, au moins
chez certains patients.
Utilisation des inhibiteurs de la mTOR
pour prévenir le risque de cancer
Il a été montré que 10 à 15 % des décès après trans-
plantation rénale étaient dus à des cancers, et que
50 % des patients développaient un cancer 15 à 20 ans
après la transplantation (3). Ce risque de cancer est
augmenté du fait de l’immunosuppression, et notam-

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XI - n° 2 - avril-mai-juin 2011 95
Sirolimus en transplantation rénale : données récentes et modalités d’utilisation
Figure 1. La voie PI3K-AkT-mTOR.
Akt
p53 p53
Facteur de croissance
cytokines
P13K
PTEN
TSC1
TSC2
mTORC2 mTORC1
SIROLIMUS
mTOR mTOR
rictor
organisation
du cytosquelette angiogenèse apoptose traduction,
synthèse protéique
ractor
S6K1 4E-BP
S6 elF-4E
Rheb
PDK1
ment par l’utilisation des ICN, et de par certaines infec-
tions virales.
Rôles de certains virus
dans le développement de cancers
Certaines infections virales observées après transplan-
tation rénale augmentent le risque de cancer, tels le
virus Epstein-Barr (EBV) et le lymphome, le Human
Herpes virus (HHV8) et le sarcome de Kaposi, le papil-
lomavirus et les cancers spinocellulaires et du col utérin,
ainsi que les virus des hépatites B et C et le carcinome
hépatocellulaire.
Rôle de l’immunosuppression
dans le développement de cancers
Dans un modèle de souris Scid/Beige, l’injection de
cellules néoplasiques rénales entraîne l’apparition de
métastases pulmonaires (4). Le nombre et la taille de
ces métastases pulmonaires du cancer rénal sont signi-
ficativement plus importants chez les souris ayant reçu
un traitement par ciclosporine A que chez les souris
contrôles n’en ayant pas reçu. La ciclosporine A favorise
le développement de cancers en induisant des muta-
tions somatiques, en bloquant la réparation de l’ADN
ainsi que l’apoptose, et favorise le développement de
métastases, probablement via le Transforming Growth
Factor (TGF)-β (4).
La voie PI3K-AkT-mTOR semble intervenir dans le
développement de nombreux cancers chez l’homme.
Les inhibiteurs de la mTOR jouent un rôle important
dans la prévention et le ralentissement de la proliféra-
tion tumorale en bloquant cette voie et en bloquant
l’angiogenèse (5) [figure 1]. L’effet antiangiogénique
du sirolimus est en rapport avec une diminution de
la production de Vascular Endothelial Growth Factor
(VEGF) [5]. Dans le sarcome de Kaposi, il existe une
surexpression de VEGF. L’utilisation du sirolimus chez
des transplantés rénaux ayant un sarcome de Kaposi
a entraîné une disparition des lésions et une rémission
histologique (6, 7). Toutefois, une autre étude n’a pas
permis d’observer les mêmes résultats (8).
Rôle bénéfique des inhibiteurs
de la mTOR chez le transplanté rénal
H.M. Kauffman et al. ont montré que l’utilisation d’un
inhibiteur de la mTOR était un facteur indépendant
protecteur contre la survenue de cancer de novo après
transplantation rénale (9). Les résultats de l’étude
Rapamune Maintenance Regimen ont montré que les
nombres cumulés de cancers cutanés et de cancers
non cutanés étaient significativement plus bas chez
les transplantés rénaux recevant du sirolimus et des
corticoïdes que chez ceux recevant la combinaison de
ciclosporine A, sirolimus et corticoïdes (10). L’effet béné-
fique des inhibiteurs de la mTOR sur la prévention de
survenue de cancers a été également mis en évidence
lors des études de conversion des ICN aux inhibiteurs
de la mTOR, telle l’étude CONVERT (11). Toutefois, il n’est
pas établi que cet effet bénéfique est dû à l’utilisation
du sirolimus ou à l’arrêt des ICN.
Rationnel de conversion précoce d’un inhi-
biteur de la calcineurine aux inhibiteurs
de la mTOR : bénéfice sur la fonction rénale
Rationnel de la conversion précoce
Une part de la dysfonction chronique de l’allogreffe est
due à la toxicité rénale des ICN. L’arrivée des inhibiteurs
La voie PI3K-AkT-mTOR est une voie de signalisation intracellulaire majeure, qui contrôle la croissance et la prolifé-
ration cellulaire en réponse aux nutriments, aux facteurs de croissance ou aux hormones. Toute anomalie de cette
voie est susceptible de favoriser le processus oncogène. L’inhibition de mTORC1 par le sirolimus se traduit par l’arrêt
de la croissance au stade G1 des cellules tumorales traitées, du fait de l’interruption sélective de la traduction des
protéines régulatrices du cycle cellulaire.

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XI - n° 2 - avril-mai-juin 2011
96
Mise au point
de la mTOR a soulevé l’espoir d’une épargne possible
des ICN. Les stratégies d’utilisation des inhibiteurs de
mTOR ont évolué au cours du temps. L’utilisation du
sirolimus de novo sans ICN s’est heurtée à une incidence
accrue de rejet aigu et à des complications chirurgi-
cales (12). La conversion tardive des ICN pour le siro-
limus a montré dans l’étude CONVERT (11) un bénéfice
limité aux patients ayant une bonne fonction rénale
(clairance de la créatinine > 40 ml/mn). Plus récemment,
une stratégie de conversion précoce, reposant sur un
triptyque logique, a été développée :
✓
utiliser les ICN durant la période postchirurgicale et
tant que le risque de rejet aigu reste élevé ;
✓arrêter prématurément les ICN car leur toxicité est
précoce et peu réversible ;
✓
réserver cette stratégie au profil de patients ayant
bénéficié de la conversion tardive au sirolimus dans
l’étude CONVERT.
Deux études ont comparé une stratégie de conver-
sion programmée précoce au maintien d’un traitement
fondé sur l’emploi d’un ICN.
✓
Dans l’étude Concept (13), les patients, sélection-
nés le jour de la transplantation (tableau I), recevaient
initialement un traitement séquentiel associant basi-
liximab, ciclosporine, mycophénolate mofétil (MMF)
et corticoïdes. Trois mois après la transplantation, les
patients étaient randomisés en 2 bras : conversion de la
ciclosporine pour le sirolimus ou maintien du même trai-
tement (tableau I). Le critère principal était la fonction
rénale à 1 an estimée par la clairance de la créatinine
(Cockcroft et Gault) ; 192 patients ont été randomisés.
À la fin de l’étude, la clairance de la créatinine était
significativement plus élevée chez les patients ayant eu
une conversion (13). Ces résultats ont été confirmés dans
une étude d’extension à 4 ans (14). Le pourcentage de
patients ayant eu un rejet après la randomisation était
numériquement supérieur dans le groupe conversion,
sans toutefois atteindre le seuil de significativité (13).
✓
L’étude Spare The Nephron (STN) a été plus récem-
ment publiée (15). Dans cette étude, les patients, rece-
vant du MMF et un ICN (ciclosporine ou tacrolimus),
étaient randomisés entre le premier et le sixième mois
suivant la transplantation pour continuer ce traitement
ou remplacer l’ICN par le sirolimus. À 1 an, le débit de
filtration glomérulaire (DFG) mesuré par la clairance de
l’iothalamate n’était pas différent entre les 2 groupes,
mais la fonction rénale s’était davantage améliorée
dans le groupe sirolimus que dans le groupe ayant
poursuivi l’ICN (+ 24,4 ml/mn dans le bras sirolimus
versus + 5,2 ml/mn dans le bras contrôle ; p = 0,012).
Les résultats concordants de ces deux études sug-
gèrent que la conversion précoce d’un ICN pour le
sirolimus est associée à une amélioration de la fonc-
tion rénale.
Le mécanisme expliquant l’amélioration de la fonction
rénale après conversion de la ciclosporine au sirolimus
n’est pas univoque. Dans une étude ancillaire de l’étude
Concept, A. Servais et al. (16) n’ont pas retrouvé de dif-
férence dans le score de fibrose 1 an après la transplan-
tation chez les patients ayant eu ou non une conversion
au sirolimus. Il est possible que la conversion à 3 mois
soit déjà trop tardive ou le moment de la biopsie, trop
précoce.
Place de la conversion précoce dans
les stratégies immunosuppressives actuelles
Les données de Concept à 48 mois permettent de
dégager un premier indice en faveur de l’effet favorable,
au moins à moyen terme, de la conversion. Plusieurs
points restent cependant à discuter : compte tenu
des différents biais dans l’étude STN et du fait que la
ciclosporine était le comparateur dans l’étude Concept,
aucune donnée solide ne permet de juger de l’effet de
la conversion lorsque les patients reçoivent du tacro-
limus. De plus, le seul critère biologique retenu dans
les études Concept et STN ne peut résumer l’ensemble
des exigences en termes d’immunosuppression. Des
données supplémentaires concernant le coût, la qualité
de vie, l’efficacité et la tolérance à long terme sont indis-
pensables. Néanmoins, même s’il persiste un doute
raisonnable sur les effets à long terme de la conversion
sur la fonction rénale, le bénéfice de cette stratégie sur
le risque de cancer repose sur des données solides et
concordantes.
Tableau I. Critères d’inclusion, d’exclusion et de non-randomisation dans l’étude Concept.
Critères d’inclusion
Receveur adulte (18-75ans) d’une première transplantation rénale
Critères d’exclusion
Receveur d’un rein de donneur vivant ou de donneur à cœur arrêté
Antécédent de transplantation rénale
Transplantations multiples
Ischémie froide > 36 h
Âge du donneur > 65ans
Panel Reactive Antibody (PRA) > 30 %
Infection active
Antécédent de cancer
Globules blancs < 2 500/mm3
Hémoglobine < 9 g/100ml
Critères de non-randomisation à la 12e semaine post-transplantation
Épisode de rejet aigu d’un grade ≥ 1 (classification de BANFF)
Clairance calculée de la créatinine < 40ml/mn
Variation de la créatinine sérique > 30 % dans les 15 derniers jours
Protéinurie > 1 g/j
Dose de mycophénolate mofétil < 1,5 g/j

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XI - n° 2 - avril-mai-juin 2011 97
Sirolimus en transplantation rénale : données récentes et modalités d’utilisation
Quel patient peut bénéficier
de cette conversion et à quel délai
après la transplantation ?
Profil du patient
En s’appuyant sur les critères d’inclusion et d’exclu-
sion des études Concept (13) et de STN (15), il s’agit
des patients adultes à risque immunologique faible
ou modéré ayant reçu un rein non marginal, et dont
l’évaluation à 3 mois ne retrouve pas d’antécédent de
rejet aigu sévère ou récidivant ni d’altération significa-
tive de la fonction du greffon ou d’effets indésirables
du MMF (tableaux I et II).
Parmi ces patients, certaines catégories doivent faire
discuter de l’opportunité de la conversion :
✓
les patients receveurs d’un rein provenant d’un don-
neur vivant apparenté : le problème chez ces patients
est de pouvoir garantir des résultats à long terme équi-
valents à ceux publiés aujourd’hui ;
✓
les patients chez lesquels les corticoïdes ont été
arrêtés : compte tenu d’une relation possible entre
arrêt des corticoïdes et survenue d’un rejet aigu dans
le bras sirolimus de l’étude Concept (13), le sevrage en
corticoïdes doit être considéré avec prudence chez les
patients sous sirolimus-MMF ;
✓les patientes jeunes, en âge de procréer et chez les
hommes jeunes (lire Effets indésirables, p. 99) ;
✓
les patients chez lesquels la conversion ne doit pas
être envisagée en cas de dyslipidémie non contrôlée
par un traitement optimal ;
✓
les patients chez lesquels il existe une protéinurie
modérée qui doit faire reconsidérer l’opportunité de la
conversion (lire Effets indésirables, p. 99).
À l’inverse, certaines catégories de patients pourraient
avoir un bénéfice supérieur :
✓les patients ayant des antécédents de cancer ;
✓
les patients ayant reçu un rein considéré comme
marginal, mais ayant, 3 mois après la transplantation,
une fonction rénale correcte (clairance ≥ 40 ml/mn,
protéinurie < 1 g/j).
Enfin, certains patients méritent une évaluation supplé-
mentaire de l’intérêt d’une conversion aux inhibiteurs
de la mTOR :
✓
les patients à haut risque cardiovasculaire : des
données expérimentales (souris apoE -/-) suggèrent
que le sirolimus aurait un effet favorable sur la plaque
d’athérome (17) ;
✓
les patients à risque immunologique élevé : l’impact
de la conversion précoce devrait être étudié chez des
patients considérés à haut risque immunologique, mais
n’ayant pas eu de rejet aigu précoce.
Moment de la conversion
Le moment de la conversion était fixé à 3 mois après
la transplantation dans Concept et dans un délai
variant entre 1 mois et 6 mois après la transplanta-
tion dans STN.
Le délai de conversion doit prendre en considération
les nécessités liées à la prévention du rejet aigu (main-
tien des ICN dans la période à risque), les exigences
liées à la toxicité des ICN (fibrose interstitielle chez 35 %
des patients 1 an après la greffe) et les contraintes liées
aux patients (espacement des consultations, reprise
d’activité). La période idéale se situe probablement
entre le deuxième et le troisième mois suivant la
transplantation.
Modalités de conversion
L’introduction d’un inhibiteur de la mTOR est le moment
le plus délicat du traitement. On va en effet exposer un
patient dont la fonction rénale est satisfaisante à un
risque théorique de rejet aigu et/ou d’effets indésirables.
D’autre part, du fait de la longue demi-vie du sirolimus
(40 à 60 heures), le temps pour arriver à l’état d’équilibre
va être long (7 à 14 jours) et source de modifications
inadaptées de posologie.
C’est donc dans les conditions les plus confortables
que doit être entreprise la conversion d’un ICN vers le
sirolimus. Dans le cadre d’une conversion précoce, une
courte hospitalisation permettra de faire une biopsie
systématique du greffon pour exclure un rejet infracli-
nique, de pratiquer une mesure de l’aire sous la courbe
(ASC) d’acide mycophénolique et de bien informer
le patient sur les effets indésirables potentiels et les
moyens de les prévenir. L’information du patient est
fondamentale pour obtenir une bonne adhérence au
nouveau traitement.
On peut initier la conversion de manières progressive
ou brutale (figure 2, p. suivante).
Tableau II. Critères d’inclusion, d’exclusion et de non-randomisation dans l’étude Spare The Nephron.
Critères d’inclusion
Receveur adulte (18-75ans) d’une transplantation rénale (donneur vivant autorisé)
Critères d’exclusion
Transplantations multiples
Critères de non-randomisation 1 à 6mois post-transplantation
Épisode de rejet aigu d’un grade > 1 (classification de BANFF) ou épisode de rejet aigu
cortico-résistant
Clairance calculée de la créatinine < 30ml/mn ou créatinine > 2,5mg/dl
Cholestérol > 3g/l ou triglycérides > 3,5 g/l

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XI - n° 2 - avril-mai-juin 2011
98
Mise au point
Figure 2. Conversion ICN/sirolimus.
Conversion brutale
- arrêt ICN
- MPA baisse 25 - 50 %
- Ctc ≥ 10 mg/j
- Smx-Tmp
- SRL dose de charge de 6 mg/j
- puis SRL 2 - 3 mg/j
- T0 ≥ 7 jours cible 5 - 10 ng/j
Conversion progressive
- baisse 50 % ICN
- maintien MPA
- Ctc ≥ 10 mg/j (1 mois)
- Smx-Tmp
- SRL dose de charge = 0
- puis SRL 1 - 2 mg/j
- T0 ≥ 7 jours cible 5 - 10 ng/j
- puis arrêt CNI, ctl T0 J14
Conversion
Si MPA + ICN +Ctc Si bithérapie avec ICN
ou MPA + Tacro + Ctc
MPA : acide mycophénolique ; Ctc : corticoïdes ; ICN : inhibiteurs de calcineurine ; Tacro : tacrolimus ; Smx-Tmp :
sulfaméthoxazole-triméthoprime ; SRL : sirolimus ; T0 : concentration résiduelle de sirolimus.
Conversion progressive
La conversion progressive est à préférer lorsque le
patient est sous tacrolimus, car ce dernier n’interagit
pas sur la pharmacocinétique du sirolimus. Lorsque
l’équilibre est atteint sous une demi-dose de tacro-
limus, l’arrêt de celui-ci n’engendre pas de modifica-
tion de la posologie journalière de sirolimus ni de sa
concentration résiduelle. Le risque de sous-dosage
précoce de sirolimus est moins préoccupant, car il
persiste une part d’immunosuppression du tacro-
limus. Il n’est donc pas nécessaire d’employer une
dose de charge. Ainsi, le risque de surdosage et d’ef-
fets indésirables est donc minimisé. On commence
le sirolimus à une posologie de 1 à 2 mg/j selon le
poids (1 mg/j si inférieur à 70 kg, 2 mg/j si supérieur
à 70 kg). Dans le même temps, on baisse de moitié la
posologie du tacrolimus. En cas de trithérapie (ICN,
corticoïdes, MPA), afin de limiter le risque de cyto-
pénie, la posologie d’acide mycophénolique peut
être baissée de 25 % si l’ASC est dans la fourchette
de 30 à 60 µg.h/ml ou de 50 % si l’ASC est supérieure à
la fourchette cible. Si l’ASC de l’acide mycophénolique
est au-dessous de la fourchette cible, la posologie
est maintenue inchangée. En cas de bithérapie, il est
préférable d’adapter la posologie de MPA dans la
fourchette thérapeutique. Des algorithmes bayésiens
de calcul d’ASC de MPA pour la spécialité Myfortic®
devraient être prochainement disponibles. Afin de
limiter le risque d’apparition d’aphtes, la posologie
de corticoïdes doit être laissée à 10 mg/j. Si le trai-
tement immunosuppresseur ne comprend pas ou
plus de corticoïdes, il est préférable d’en introduire
temporairement le temps d’atteindre un équilibre
dans la fourchette thérapeutique. La fourchette de
concentration résiduelle de sirolimus à viser se situe
entre 5 et 10 ng/ml ; dans les 6 premiers mois de greffe,
on visera plutôt 8 ng/ml, et au-delà, plutôt 6 ng/ml.
Ces chiffres hors AMM ne sont en rien validés mais ils
reflètent davantage la pratique courante actuelle. Les
cibles de l’AMM (12 à 20 ng/ml) sont probablement
associées à une fréquence supérieure d’événements
indésirables. Du fait de la longue demi-vie du sirolimus,
il faut attendre au moins une semaine après la der-
nière modification de posologie avant de contrôler la
nouvelle concentration résiduelle. Les avantages de la
conversion progressive sont la sécurité apportée par
l’ICN (moins de risque de rejet aigu) associée au plus
faible risque de surdosage et donc à une meilleure
tolérance. Les inconvénients tiennent essentiellement
à la durée pour atteindre l’équilibre.
Conversion brutale
La conversion brutale est à préférer lorsque le patient
est sous ciclosporine, car cette dernière interagit sur
la pharmacocinétique du sirolimus via une inhibition
du CYP3A4 et de la P-glycoprotéine. Aussi, lorsque les
concentrations cibles de sirolimus sont obtenues en
présence de ciclosporine à demi-dose, il va falloir après
arrêt définitif de la ciclosporine adapter à nouveau la
dose de sirolimus pour retrouver un équilibre dans
la fourchette thérapeutique. Il est donc plus simple
d’arrêter brutalement la ciclosporine. On débute alors
avec une faible dose de charge (6 mg) justifiée par
la longue demi-vie du sirolimus et par la nécessité
de ne pas courir le risque d’un sous-dosage qui, en
l’absence d’ICN, exposerait le patient à un risque accru
de rejet aigu. Dès le lendemain de la dose de charge,
la posologie journalière est de 2 à 3 mg selon le poids
(2 mg/j si < à 70 kg, 3 mg/j si > à 70 kg). Les conseils
pour les corticoïdes et l’acide mycophénolique sont
les mêmes qu’en cas de conversion progressive. Il
en va de même pour la concentration résiduelle de
sirolimus à atteindre et la fréquence de mesure de
concentrations résiduelles (≥ 7 jours). Les avantages
de la conversion brutale tiennent à la plus grande
rapidité pour atteindre l’équilibre. Les inconvénients
sont un risque plus important de surdosage, qui entraî-
nerait davantage d’effets indésirables (concentration-
dépendants) et donc, davantage d’échecs (retour au
traitement par ICN).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%