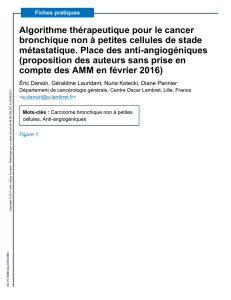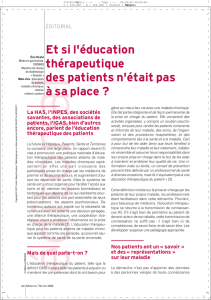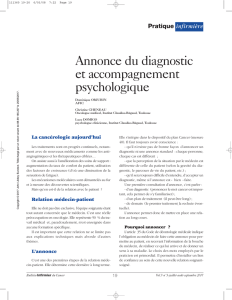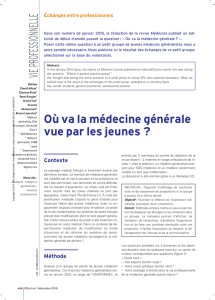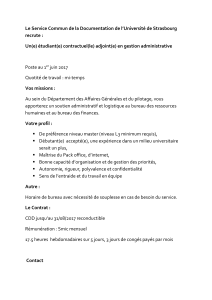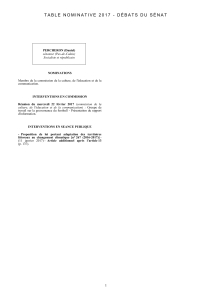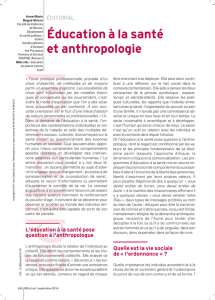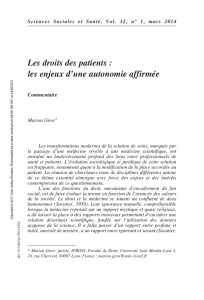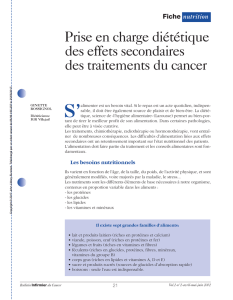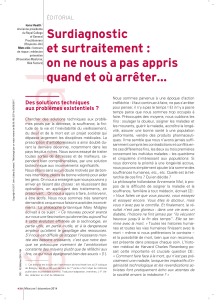Imputer, reprocher, demander réparation. une sociologie de la

Sciences Sociales et Santé, Vol. 33, n° 2, juin 2015
Imputer, reprocher,
demander réparation. Une sociologie
de la plainte en matière médicale
Janine Barbot*, Myriam Winance**, Isabelle Parizot***
Résumé. L’article étudie les plaintes des patients (ou de leurs proches)
qui s’estiment victimes de préjudices liés à l’activité médicale. Sur la
base d’un corpus de courriers adressés au dispositif de règlement amiable
créé par la loi du 4 mars 2002, nous analysons les trois opérations
critiques qui structurent la plainte: imputer des dommages à des soins,
reprocher des pratiques ou des conduites inappropriées et formuler des
demandes en matière de réparation. Au travers de ces opérations
critiques, nous mettons en évidence les manières par lesquelles les plai-
gnants construisent des modes de raisonnement et de mise en cause,
mobilisent des horizons d’attentes vis-à-vis des soins et conçoivent les
doi: 10.1684/sss.2015.0205
* Janine Barbot, sociologue, Cermes3 – Centre de recherche, médecine, sciences,
santé, santé mentale, société (CNRS-UMR 8211, INSERM-U988, EHESS, université
Paris-Descartes), site CNRS, 7, rue Guy Môquet, 94801 Villejuif Cedex, France ;
** Myriam Winance, sociologue, Cermes3 – Centre de recherche, médecine, sciences,
santé, santé mentale, société (CNRS-UMR 8211, INSERM-U988, EHESS, université
Paris-Descartes), site CNRS, 7, rue Guy Môquet, 94801 Villejuif Cedex, France ;
*** Isabelle Parizot, sociologue, CMH – Centre Maurice Halbwachs (CNRS, ENS,
EHESS), Équipe de recherche sur les inégalités sociales (ERIS), 48, boulevard
Jourdan, 75014 Paris, France ; [email protected]
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Downloaded by a robot coming from 88.99.165.207 on 05/06/2017.

78 JANINE BARBOT, MYRIAM WINANCE, ISABELLE PARIZOT
possibilités d’apaisement des souffrances qu’ils leur attribuent. Nous
identifions ainsi différentes sources d’ajustement et de désajustement
entre ces perspectives profanes de la plainte et le travail effectué par le
dispositif.
Mots-clés : plaintes, accidents médicaux, dispositif d’indemnisation,
responsabilité, solidarité.
Depuis les années 1970, aussi bien aux États-Unis qu’en Europe, la
question de l’accroissement réel ou supposé des plaintes des patients (ou
de leurs proches) suscite des débats particulièrement vifs. Certains travaux
ont mis en avant la montée en puissance de patients «procéduriers » ou
«vindicatifs » et ont critiqué les comportements « consuméristes » qui
affecteraient de façon négative les pratiques médicales ou les coûts du
système de santé (1). De nombreuses recherches ont, au contraire, mis
l’accent sur les difficultés rencontrées par les personnes pour faire valoir
les dommages liés aux soins, en raison des rapports de domination propres
au secteur médical et des asymétries de statuts et de compétences qui s’y
exercent au détriment des patients et de leurs familles (2). Des études ont
montré, dans le contexte états-unien principalement, le faible taux de
recours des patients au regard de la réalisation effective d’évènements
délétères et la sous-représentation parmi les plaignants des patients les
plus vulnérables (3).
Des travaux de sciences sociales se sont, par ailleurs, développés
autour de l’analyse de la plainte considérée comme un outil permettant
d’évaluer le fonctionnement des structures hospitalières, d’améliorer la
qualité des soins et le dialogue entre médecins et malades, ou de prévenir
(1) Pour une revue critique des études portant sur la « médecine défensive » et les réac-
tions des professionnels de santé face à la « judiciarisation des soins », voir Barbot et
Fillion (2006). Pour un exemple des analyses de plaintes sous l’angle du « consumé-
risme médical », voir Peneff (2000).
(2) Pour une mise en perspective de ces travaux, voir notamment Mulcahy (2003).
(3) Ce sont, par exemple, les grandes enquêtes de Localio et al. (1991) et Burstin et al.
(1993).
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Downloaded by a robot coming from 88.99.165.207 on 05/06/2017.

SOCIOLOGIE DE LA PLAINTE EN MATIÈRE MÉDICALE 79
la survenue de risques médicaux et sanitaires (4). Dans ce cadre, des typo-
logies ont pu être dressées pour rendre compte de l’ampleur et la nature
des réclamations adressées aux services de soins, en termes de secteurs
concernés ou de motifs d’insatisfaction. Notre article propose, quant à lui,
d’effectuer deux déplacements. Nous aborderons la plainte formulée par
le patient (ou par ses proches) quand il s’adresse à une instance «tierce»,
en dehors du colloque singulier avec son médecin ou des établissements
de soins (5). Nous aborderons également de plus près le travail effectué
par le patient (ou par ses proches) pour faire valoir qu’il est (ou a été)
affecté, empêché ou diminué par un événement lié aux soins, et le plus
souvent pour demander que quelque chose soit fait en retour (6). Cet
article propose ainsi d’aborder la pratique de la plainte, au carrefour des
différentes opérations critiques que les personnes mettent en œuvre quand
elles s’adressent, par courrier, à un dispositif national dédié à l’indemni-
sation des accidents médicaux.
Cadre d’analyse
Notre analyse tirera parti de la discussion de deux grands ensembles
de travaux qui ont porté sur la plainte en dehors du domaine médical:
ceux qui se sont intéressés à l’analyse de plaintes écrites dans différents
contextes d’énonciation, et ceux qui ont porté sur la formation des recours
devant un tiers judiciaire. Dans le premier ensemble, les travaux ont mis
en évidence deux grandes figures de la plainte : la dénonciation et la
supplique. L. Boltanski, depuis une sociologie de la critique, a étudié un
corpus de lettres adressées au journal Le Monde (1979-1981) visant à
dénoncer publiquement des situations d’injustice. Il montre comment ces
(4) Voir, par exemple, les travaux anglo-saxons de Lloyd-Bostock et Mulcahy (1994),
Nettleton et Harding (1994) et Mulcahy (2003) ; pour la France, de Vernejoul et al.
(1999), Amar et Minvielle (2000), Quinche (2001) et Amalberti et al. (2007). Pour la
Belgique, voir Cantelli (2011) sur le « travail politique » mené par différents acteurs
hospitaliers pour transformer les « troubles » exprimés par les patients en actions de
prévention.
(5) Dans cette même perspective concernant les plaintes individuelles, voir Parizot et
Morgny (2007).
(6) Une telle démarche a pu être entreprise dans les travaux qui ont porté sur les
plaintes des victimes dans le cadre de grands drames collectifs, en lien avec des mobi-
lisations associatives. Pour les cas du sang contaminé ou de l’hormone de croissance,
voir Barbot et Fillion (2007), Fillion (2008) et Barbot et Dodier (2010, 2015).
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Downloaded by a robot coming from 88.99.165.207 on 05/06/2017.

80 JANINE BARBOT, MYRIAM WINANCE, ISABELLE PARIZOT
dénonciations doivent satisfaire à des contraintes de dé-singularisation du
cas et de montée en généralité pour être jugées «normales» — c’est-à-
dire lorsque, partant d’un cas particulier, les plaintes entendent acquérir la
légitimité nécessaire pour accéder à l’opinion publique et constituer une
cause (Boltanski et al., 1984). La supplique répond, quant à elle, à des
contraintes différentes. Prenant appui sur les courriers adressés au Fonds
d’urgence sociale en 1998, D. Fassin (2000) a analysé la manière dont les
personnes répondent à l’«injonction politique de se raconter» dans le but
de se voir attribuer une aide financière. En analysant le style, le registre et
les arguments utilisés, l’auteur identifie deux figures rhétoriques princi-
pales de la supplique: la nécessité (basée sur la démonstration comptable
de l’insuffisance des ressources par rapport aux besoins) et la compassion
(basée sur le pathos et l’appel à l’émotion face aux malheurs) (7). Toutes
deux renvoient, selon l’auteur, aux composantes morales de la politique
moderne de la pitié; elles répondent ce faisant à sa logique qui impose aux
pauvres un exercice de «subjectivation» pour endosser la figure de l’as-
sisté–autonome, capable d’exprimer ses besoins et de former des attentes
(Fassin, 2000).
Le deuxième ensemble de travaux s’inscrit dans la lignée des propo-
sitions de W. Felstiner, R. Abel et A. Sarat, notamment dans leur article
intitulé «Naming, Claiming, Blaming» (1980). Ces travaux se sont inté-
ressés aux recours aux dispositifs judiciaires, en proposant un cadre d’ana-
lyse des différentes étapes par lesquelles les personnes ordinaires
transforment leurs expériences de dommages en griefs et leurs griefs en
litiges. Si seule une infime partie des expériences dommageables donne
lieu à des litiges, c’est parce que les personnes doivent pour cela franchir
plusieurs étapes. La première consiste à prendre conscience de l’existence
d’offenses: d’inaperçues, celles-ci doivent devenir perçues. La seconde
consiste à attribuer ces offenses à la faute d’un individu ou d’une entité
sociale (c’est la formation du grief ou reproche). Dans la troisième étape,
il s’agit de réclamer à l’offenseur quelque chose en retour. Cette approche
de la plainte a permis notamment de ré-ouvrir la question des inégalités
sociales d’accès à la justice jusqu’alors abordée, très partiellement, par
une sociologie du droit centrée sur le fonctionnement des institutions judi-
ciaires et peu attentive aux expériences des personnes qui mobilisent le
(7) Deux autres figures rhétoriques sont également identifiées par Fassin, la justice et
le mérite, bien plus rarement mobilisées dans les courriers étudiés. Dans son étude des
lettres de détresse adressées à la Fondation Abbé Pierre, F. Chateauraynaud (1996)
identifiait la présence de quatre « logiques » ou « régimes » : l’appel au secours, l’ac-
cusation/dénonciation, le recours administratif et le témoignage ou récit de vie.
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Downloaded by a robot coming from 88.99.165.207 on 05/06/2017.

SOCIOLOGIE DE LA PLAINTE EN MATIÈRE MÉDICALE 81
droit (8). Les auteurs ont insisté sur l’importance des dimensions cogni-
tives et morales associées à la plainte.
Ces deux ensembles de travaux mettent en évidence l’importance du
travail normatif effectué par les plaignants quand ils s’adressent à un
dispositif requérant un certain degré de formalisation de la plainte (9). En
recourant à l’étude des plaintes écrites, les premiers ont dégagé l’existence
de figures rhétoriques dominantes, dont l’expression est indissociable des
anticipations formées par leurs auteurs quant à leurs conditions de récep-
tion dans des dispositifs dédiés, l’un à la dénonciation des situations d’in-
justice, l’autre aux situations de détresse sociale. Les écrits des plaignants
témoignent alors de leurs capacités, plus ou moins étendues, à construire
des plaintes, plus ou moins réussies, visant à s’ajuster aux contraintes de
«normalité» ou de «moralité » pesant sur leur demande. Nous ne cher-
cherons pas, quant à nous, à identifier une ou plusieurs figures typiques de
la plainte dans le domaine médical, mais à procéder à une décomposition
analytique des courriers, attentive à la diversité de ce que font les gens
(10). Dans cette perspective, nous privilégierons une analyse en termes
d’opérations critiques qui place le regard sur les modalités par lesquelles
les personnes qui s’adressent à un dispositif de règlement amiable dédié à
l’indemnisation des dommages liés à l’activité médicale sont conduites à
évaluer un état de santé, à chercher à l’expliquer, et à envisager des solu-
tions pour y remédier. Si notre travail fait ainsi directement référence à la
trilogie «Naming, Claiming, Blaming » de Felstiner et al. (1980), nous ne
l’abordons pas comme eux en termes de phases successives, comme un
enchaînement logique qui conditionne la trajectoire des plaignants vers le
procès (et le dispositif judiciaire). Les opérations critiques que nous
étudions sont repérées à travers l’analyse des énoncés produits par les
patients, à un moment donné dans un contexte d’énonciation particulier.
Les plaintes sont adressées ici à un dispositif hybride, extra-judiciaire,
articulant de façon inédite mise en cause et appel à la solidarité, et laissant
une assez grande liberté d’énonciation aux personnes qui y recourent.
(8) Dans une perspective institutionnelle, la sociologie du droit portait généralement
l’attention sur la dernière phase, à travers le problème de l’accessibilité des tribunaux.
(9) Sur une utilisation de la notion de travail normatif, voir Barbot et Dodier (2015).
(10) Une perspective du même ordre a été proposée par C. Durand (2014) qui s’est
intéressé aux « opérations rhétoriques de mobilisation et d’atténuation du droit » dans
les doléances adressées par les prisonniers au Contrôleur général des lieux de privation
de liberté.
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Downloaded by a robot coming from 88.99.165.207 on 05/06/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
1
/
29
100%