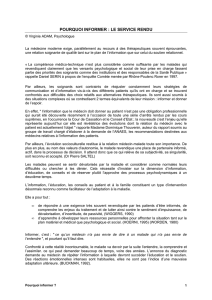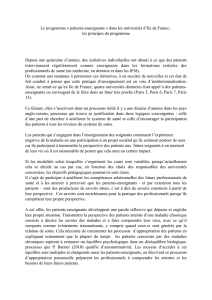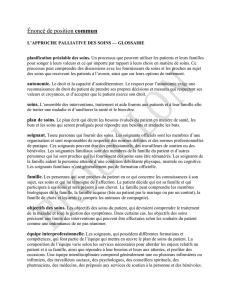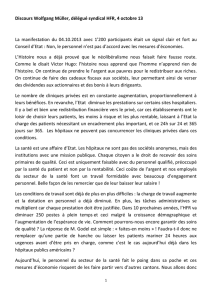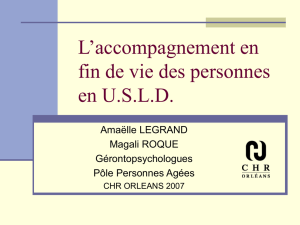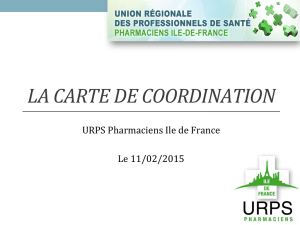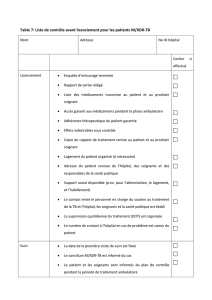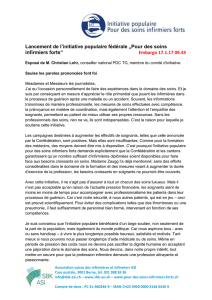les soins au patient - Ministère des Affaires sociales et de la Santé

1
LES SOINS AU PATIENT : DEMARCHE ARTISANALE OU INDUSTRIELLE ?
19/11/2012 15:11
Jean-François PINEL
Neurologue
CHU Rennes
"Consacrer les valeurs du service public, c'est dire que
l'hôpital n'est pas une entreprise."
Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de la
Santé Septembre 2012
INTRODUCTION
Deux mondes se côtoient dans le système hospitalier, l'un soignant, l'autre administratif ;
pendant longtemps certains étaient au service des autres pour leur permettre d'exercer leur
métier en toute quiétude et sans trop de contraintes; ces temps révolus voyaient les coûts
exploser, les problèmes de santé public parfois délaissés, cet absence de régulation pouvant
entrainer des dérives de tous ordres ; depuis plusieurs années le désir de traiter la santé
comme un bien commercial avec des administratifs qui dirigent et des soignants qui oeuvrent
sous contrôle à conduit à un mouvement au sein duquel le terme hôpital-entreprise a pris
racine.
L’hôpital (que l'on se devrait de nommer "établissement public de santé" puisque dans la
novlangue le terme "hôpital" a été banni de tous les textes officiels, peut-être parce qu'il
faisait référence étymologiquement à l'accueil, l'hospitalité, la charité voire à la gratuité) doit
il répondre à une logique d’entreprise ou d’artisanat ? A question abrupte, réponse sans
nuance : seuls les dirigeants, les manageurs, les contrôleurs, les inspecteurs, les gestionnaires,
les certificateurs, les accréditeurs…bref, les non soignants et les non soignés peuvent hésiter ;
pas les soignants, pour qui chaque cas est unique, chaque problématique individuelle, chaque
réponse adaptée à la personne, dans une logique plus "artisanale".
A priori tout oppose artisanat et industrie : l’artisanat c’est l’indépendance, la responsabilité
individuelle de toutes les fonctions, la qualification professionnelle de la personne, le savoir-
faire reconnu, un travail sur des unités concrètes, uniques, le tout renvoyant de l’artisan une
image culturelle forte, gage de qualité. Le monde de l’entreprise représente quant à lui un
ensemble d’activités à but commercial (c’est dans la définition de l’entreprise) avec une
production en série; cette conception sous-entend une division du travail, une responsabilité
limitée à un geste précis; la notion d’entreprise fait évoquer immédiatement une dimension
d’échelle, le quantitatif devenant aussi important que le qualitatif.
Le terme entreprise nous évoque également deux idées qui n'appartenaient pas au monde de
l'hospitalisation publique : celle de la rentabilité et celle, sans doute corolaire, du
management directif : pendant longtemps le monde "marchand" a été étranger à l'organisation
hospitalière, mais, depuis quelques années, certains "leaders" et malheureusement décideurs

2
croient voir dans les établissements de santé des entreprises banalisées achetant main d'œuvre
et capitaux pour vendre des prestations dans un marché concurrentiel. Le discours
économique vient à coiffer le discours médical; même certains économistes s'en offusquent
reconnaissant que "l'idée selon laquelle des malades vont, en quelque sorte, être mis aux
enchères est à priori contraire à la vision humaniste que l'on peut avoir du système de santé et
peut aussi apparaitre choquante" (M. Mougeot, Système de Santé et concurrence, Paris,
Economica, 1994).
Le management d'une structure, dont le but imposée est de tenir un budget, contraint à une
verticalisation des décisions, à une hiérarchisation forte, à une absence de démocratie, bref à
une gestion de type top-bottom avec une tentative d'assujettissement à chaque niveau; il serait
plus juste, concernant l'hôpital, de parler de technocratisation donnant le pouvoir à des non-
professionnels de l'acte de soin pour orienter les stratégies organisationnelles des différentes
fonctions métiers de l'hôpital et en particulier des fonctions médico-soignantes. Dans les
années 80, on pouvait considérer trois groupes au sein des systèmes de santé : les
professionnels (groupe dominant), les gestionnaires (groupe très visible mais moins important
que le premier) et finalement la communauté (groupe réprimé) (selon Alfort R.1975 cité par
Ferlie E. Les cliniciens et la nouvelle gestion publique : adaptation plutôt que
déprofessionnalisation radicale Ruptures, revue transdisciplinaire en santé 1997, 2 : 237-
251) ; la montée en puissance du New Public Management, l'ascension des gestionnaires à un
statut plus prestigieux, la disparition de la déférence envers les professionnels ont conduit, à
inverser les rôles, confiant aux gestionnaires le rôle dominant. Sous la pression économique,
un management directif risque de conduire à une démotivation à travers une non
reconnaissance des compétences spécifiques des acteurs; cette forme de
déprofessionnalisation conduit à une baisse des performances en exploitant pas les
potentialités professionnelles de chacun.
Pourtant, dans un système aussi complexe et coûteux que la santé, les approches doivent être
multiples et les expériences peuvent être tirées de la gestion industrielle: les techniques de
management d’entreprise, les méthodologies et circuits de travail de l’industrie devraient
suggérer des pistes d’amélioration vers, maitre-mots, l’efficience et la performance.
Plutôt que de dichotomiser entre administrateurs et soignants, il est plus pertinent de séparer
ce qui relève dans la gestion ou le soin de la standardisation ou de la singularité.
A - NIVEAU DE LA GESTION
"Dès lors qu'une organisation promet le bonheur en
échange d'une confiance totale dans ses méthodes et ses
dirigeants, les notions de manipulation et d'emprise ne
sont jamais loin."
Michela Marzano - Le contrat de défiance
La notion d'hôpital évolue et nous aurions tort de croire que la pensée unique de l'hôpital-
entreprise est définitive : au VI ème siècle les hôpitaux recueillaient les âmes perdues
(logique compassionnelle), à partir du IXème siècle, les errants et les mendiants (logique
sociale), à partir du XVIIème on s'est intéressé aux patients avec des organes malades
(logique clinique) puis à partir du XIX ème siècle l'hôpital est entré dans une logique de
professionnalisation et par les ordonnances de 1958 un lieu d'enseignement, de recherche et

3
de soins, avec depuis une sur-spécialisation et une segmentation des activités sur des
pathologies ciblées.
Cette description diachronique est, bien sûr, théorique et il suffit de fréquenter un service
d'urgence d'une grande ville (service public, s'entend) pour constater que toutes les logiques
s'entassent péniblement dans les couloirs ! Espérons que le dogme de la pensée unique
"hôpital-entreprise", "équilibre budgétaire", "parts de marché", ne sera qu'une mode politico-
gestionnaire qui saura s'effacer devant la notion de pertinence des soins et de santé "durable".
Une entreprise se doit de rechercher des parts de marchés, de croitre, de développer de
nouvelles niches ; cela a-t-il du sens pour la santé ? Pourrait on se réjouir d’avoir de plus en
plus de patients et de maladies, des fréquentations en augmentation dans les services
d’accueil et d’urgences, de faire dépenser plus aux patients et à leurs mutuelles. Une logique
marchande conduit à souhaiter de plus en plus de clients et de maladies à sur-traiter (par
l'écriture de recommandations maximalistes, de surconsommation de biologie et d'imagerie
voire à suggérer de nouvelles maladies, se rapprochant alors de la démarche du docteur
Knock) : certains acteurs économiques, industriels dans le champ de la santé peuvent
subrepticement nous faire glisser vers cette dérive. La facturation des chambres individuelles
pour raison de confort hôtelier nie leur pertinence en terme de confidentialité, de propagation
des infections nosocomiales, de simple repos du malade. Fort du savoir-faire et de la
reconnaissance de la médecine française la question peut se poser, pour traiter une clientèle
étrangère fortunée, de délocaliser des hôpitaux (le plus souvent dans des pays producteurs de
pétrole) ou d'offrir des prestations "particulières" en France; cette dernière option ne risque-t-
elle pas de créer une médecine différente sur le territoire français entre ceux qui ont la carte
Gold et ceux qui n'ont que la carte vitale ? Aujourd'hui, les soignants des hôpitaux publics
s'enorgueillissent de traiter de la même façon les patients quels que soient leurs revenus, cette
valeur fait sens et je ne suis pas convaincu que l'argent gagné ainsi n'aurait pas un effet
délétère sur la cohérence du système.
Structurellement, un CHU se présente comme une entreprise avec ses pôles de production, de
logistique, de gestion des ressources humaines, de sécurité, de gestion de la qualité, de
finances et de contrôle de gestion; les récentes lois ont renommé le conseil d'administration et
le conseil stratégique en conseil de surveillance et directoire ; ce glissement sémantique
dénué de sens pour les soignants doit en avoir pour d'autres. D'ailleurs force est de
reconnaitre que le vocabulaire diffère entre gestionnaires et soignants : d'un côté on parle de
malades, de familles, de soignants, d'unités de soins, d'équipe, de service, de durée
d'hospitalisation et de l'autre d'usagers sinon de clients, de groupes homogènes de malades ou
de séjours (GHM ou GHS), de masse budgétaire, d'EPRD, de PMSI, de DMS, de TMO (bref
beaucoup de d'indicateurs quantitatifs avec des sigles que volontairement je n'explicite pas).
Sans doute devrait-on garder une vision simpliste d'une entreprise : un hôpital est un
producteur de soins, les clients sont les patients et les acteurs les soignants. Améliorer la
production, ce serait rendre l'outil plus performant ; comprendre les demandes et aider les
producteurs devrait être le but des administrateurs; investir dans les outils de production et
non pas se perdre dans les structures de contrôle, qui ne donnent que l'apparence de la
rationalité. S'appuyer sur des indicateurs non reconnus par les acteurs de terrain, non
pertinents tant sur la quantité que la qualité des soins ne permet pas un management partagé
et cohérent. Les vrais indicateurs devraient se rapprocher de ce qui touche à l'amélioration de
l'état de santé, voire les morts évitées, tels que la santé se définit par l'Organisation Mondiale
de la Santé. Il faut se garder sous prétexte d’évaluation de créer des items purement
quantitatifs ou monétaires: vanter les mérites d'une structure qui réalise beaucoup

4
d’interventions et est rentable n’a de sens que si les indications sont justifiées. Un président
de la république a précisé, dans un discours en 2008, qu’il n’était pas nécessaire pour un
hôpital d’être en déficit pour bien soigner ; cela est vrai, mais gardons-nous de penser qu’un
hôpital en équilibre ne nous leurre pas avec des indicateurs purement budgétaires ; comme
pour un état, un PIB élevé n’est pas synonyme de bonheur pour la population et n'est donc
pas non plus l'indicateur de bonne santé pour le pays.
Une vision trop budgétaire place le patient dans une situation de marchandise plus que de
client, il devient le prétexte plus que le but de l’entreprise ; cette dérive s'est vue dans
l’audiovisuel commercial où le spectateur n’est plus à l'évidence le client, ce sont les
annonceurs; l’audience n’est plus qu’un indicateur intermédiaire et la satisfaction de ceux qui
écoutent ou regardent n'est plus la finalité première.
En matière de santé, le client, trop impliqué, est facile à abuser; objet, le patient passe au gré
des réformes et suivant l'angle de vision de "source de revenus" à "centre de coût", dépenses
qu'il faut minimiser ou transférer (sous-traitance). Le malade et la santé des patients ne sont
plus les objectifs primaires du système mais c'est "la santé du système de santé" qui semble
dorénavant le but.
Cette évolution conduit à l'inflation des technostructures, à la politisation des décisions, à la
réduction effective de la qualité des soins, au délitement des équipes, à la démoralisation des
personnels; plus grave, ce management produit une perte de confiance des salariés dont
l'expérience est dévalorisée au profit de savoirs gestionnaires
Cette vision technocratique entraine des surcoûts à l'intérieur (traçabilité, enquêtes,
rapports…) et à l'extérieur des établissements : sur 52 millions d'euros de budget annuel l'
Agence Nationale d’Appui à la Performance pour les établissements de santé et médico-
sociaux (l'ANAP) aurait dépensé 35 millions (de l'argent pris sur le budget de la santé) pour
payer des sociétés privées menant enquêtes, distribuant conseils et faisant des audits en
consommant le temps des professionnels de terrain : fallait-il débourser plus d' un million six
cent mille euros pour que les médecins de Hôpitaux civils de Lyon définissent leur projet
médical (ce qui correspond à plus de 30 emplois annuels); le budget annuel de l'ANAP elle-
même correspond à plus de 1000 emplois paramédicaux.L'Inspection Générale des Finances
vient de tenter dévaluer le rapport coût/bénéfice de ces "annexes" et à ainsi recensé en France
plus de 1244 agences tournant autour du thème de la santé, agences qui emploient 442.830
employés. Et si celui qui savait était celui qui faisait; et si l'expert n'était pas celui qui mène
l'expertise mais celui qui à l'expérience, le professionnel, l'artisan; et s'il n'était pas nécessaire
de faire appel à des officines extérieures pour écrire les projets médicaux d'établissements,
pour restructurer les services, pour adapter des plannings…
Cette conviction que des professionnels du management et de l'audit sont plus à même que
les "acteurs" pour définir leur organisation va à l'encontre d'une confiance sinon d'un respect
du professionnel, c'est une logique d'entreprise. Responsabiliser le personnel, lui donner, à lui,
les outils pour évaluer, planifier, améliorer son activité,lui apprendre les méthodes pour
progresser aurait eu un impact durable différent: c'était l'idée directrice de la réforme sur la
nouvelle gouvernance de Jean-François Matteï en 2005, avec le souhait de "changer (…) et
redonner ambition et espoir à l’hôpital à travers la mise en œuvre de principes simples : la
confiance et la responsabilité partagée ";l'esprit de cette loi n'aura jamais été appliqué.

5
Certes, durant des décennies les médecins se sont peu intéressés à ces problématiques
organisationnelles; précisons néanmoins que les interrogations venant des professionnels de
terrain n'étaient pas toujours relayées par l'administration; la fluidité du parcours du patient
tant aux urgences que dans les suites d'une hospitalisation en médecine ou chirurgie a
toujours préoccupé les médecins; nos directions ne se sont vraiment intéressées à ce
gaspillage et ses conséquences qu'avec l'arrivée d'un indicateur financier (la tarification à
l'activité) qui a semblé plus pertinent que la durée excessive de certains séjours de patients en
attente de lits en soins de suite, soins de longue durée ou EHPAD.
Admettons néanmoins que le but d'un hôpital soit son équilibre financier, là encore le concept
d'hôpital entreprise ne tient pas : les "prix" lui sont imposés par une tutelle qui s'en sert
comme moyen de régulation; il ne revient pas à la structure de se mettre à l'équilibre, les
tarifs étant modulés pour être des outils de régulation sinon de contrainte; la tarification à
l'activité a ainsi montré ces limites, la course à la quantité restant bloquée par un budget
global et des taux directeurs qui de locaux sont devenus nationaux (c'est l'inverse d'une
autonomie et d'une décentralisation).
Dans ce marché ou la libre concurrence s'affiche (désir de convergence des tarifs entre public
et privé), les patients sont définis par le filtre normatif des Groupes Homogènes de Malades
ou de Séjours à travers le PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information);
comment faire reconnaitre la réalité et la valoriser; les critères dits objectifs (âge, typologie
des actes…) sont insuffisants; l'évaluation ignore l'évolution des critères de précarité dans les
hôpitaux publics en particulier en gériatrie, médecine interne, obstétrique, pédiatrie, maladies
infectieuses. Les temps de prise en charge plus longs, les trajectoires plus complexes, les
compétences professionnelles nécessaires et peu représentées dans les structures
commerciales (assistants socio-éducatifs, rééducateurs, diététiciens, psychologues….)
rendent les séjours plus couteux ou moins rentables financièrement. La logique marchande ne
peut se prévaloir puisque le "produit" n'autorise pas le "benchmarking". L'hôpital public
devrait être évalué dans ces situations de quasi monopole (pour les personnes qui ne pourront
rentrer à leur domicile, pour les migrants, les personnes sans couverture sociale…). Drôle de
loi du marché, drôle de système où, pour les urgences par exemple, la dénomination des
services est identique entre privé et public, mais où les usagers sont triés dans un non-dit
connu de tous. La gestion de l'imprévu a un coût, imposant des gardes, des astreintes, des
plages libres, du personnel parfois disponible, vécu comme en surnombre. Ce ne sont pas les
budgets mais les résultats qu'il faudrait contrôler, c'est terriblement plus complexe. Une
entreprise n'est jugée que sur ses résultats financiers, sa production n'est qu'un moyen.
Nous risquerons des dérives quand les directeurs généraux des hôpitaux seront rémunérés en
fonction de leur résultat budgétaire, quand ils pourront venir du milieu industriel sans
formation à la santé, quand les CHU seront évalués par des agences de notation type
Moody’s, quand l’organisation aura exclu toute délégation aux médecins et aux soignants et
que ces derniers n’auront que des voix consultatives pour les grandes décisions, quand le
management sera essentiellement du haut vers le bas, des financeurs sur les producteurs.
Nous devrons alors être terriblement inquiets pour l’avenir de la santé publique.
Dans cette vision où les dirigeants sont les financeurs et les soignants les dépensiers, la
nécessaire dynamique de tous les agents (soignants et non soignants) autour d'une cohésion
d'entreprise basée sur des valeurs partagées, est perdue ; le personnel s'interroge devant les
injonctions paradoxales qu'il subit. Cette dichotomie financeurs/dépensiers ne se produit pas
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%