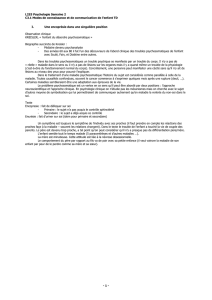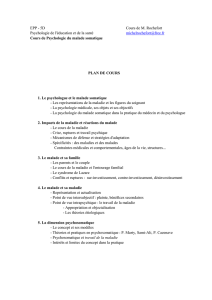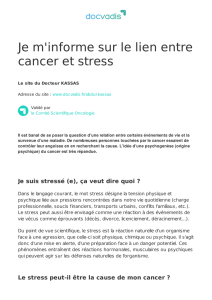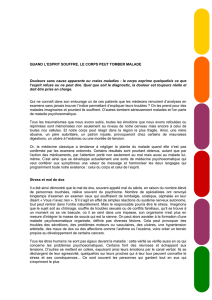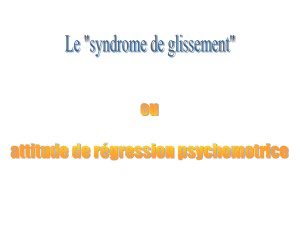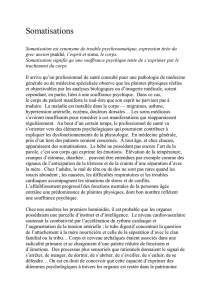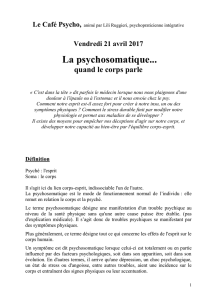Douleurs pelviennes chroniques : entre le sacré et le honteux

34 | La Lettre du Gynécologue • n° 378-379 - janvier-février 2013
DOSSIER THÉMATIQUE
Gynécologie-obstétrique
et psy
Douleurs pelviennes
chroniques : entre le sacré
et le honteux
Pelvic chronic pains: between sacral and shameful
P. Lévy-Soussan*
* Psychiatre, psychanalyste, Paris.
L
a localisation pelvienne de la douleur, trajec-
toire des nerfs honteux et sacrés, peut vite
– trop vite – être interprétée comme relevant
immédiatement d’une cause psychique, tant la
mariée est belle et la région évocatrice de sexua-
lité. L’accusation d’hystérie n’est jamais loin dans
l’entourage de la patiente, et parfois dans le cercle
des médecins, car la théorie de l’utérus migrateur
est toujours présente dans l’inconscient médical,
utérus qui peut bien déclencher toutes ces dou-
leurs quand il viendrait à bouger pour fuir sa primo-
localisation ! N’oublions pas que faire respirer des
sels à une femme évanouie avait été mis en place à la
suite de cette théorie dans le but de faire redescendre
l’utérus par répulsion de cette odeur si désagréable…
Nous ne développerons pas ici le versant hypo-
condriaque des algies pelviennes qui nécessiterait
un chapitre à part, l’hypocondrie étant largement
méconnue de nos jours.
Ces douleurs sont parfois particulièrement difficiles
d’accès aux médecins tant elles sont honteuses et
culpabilisées par la femme, mais aussi par l’homme,
je le rappelle ici par souci d’exhaustivité.
Parfois elles sont sacrées : inatteignables, rebelles à
toute approche clinique, organisant des rituels, des
pratiques quasi magiques, réorganisant la vie entière
de la patiente dans les formes les plus sévères.
Le médecin est alors interpellé par des sentiments
violents et contradictoires vis-à-vis de la patiente : il
oscille entre agressivité et empathie. Certains, plus
pressés par la volonté “d’en finir” avec la douleur,
voire avec la patiente, que par raison médicale, mul-
tiplieront les examens agressifs invasifs, insistant
parfois pour mettre en place des thérapies lourdes,
une chirurgie intempestive. D’autres banaliseront
le tableau clinique, laissant la patiente à sa soli-
tude, voire à sa responsabilité, après lui avoir dit
que “c’était dans la tête”.
Les autres tenteront, une fois qu'ils auront récu-
péré la patiente à la suite d’une errance diag-
nostique et thérapeutique, de ne pas tomber dans
le piège du médecin tout-puissant, sacré aux yeux
de la patiente, sans lui promettre non plus la terre
promise. L’approche des douleurs chroniques néces-
site une patience et une empathie souvent mises à
rude épreuve par la patiente.
Nous détaillerons ici le masque algique de la dépres-
sion parfois concomitante avec une midlife crisis
– que nous appelons en France une crise du milieu
de la vie – tant la dépression est fréquente, en parti-
culier chez la femme dans la période ménopausique.
L’approche multifocale et pluridisciplinaire est alors
pleinement justifiée pour ne pas être seul face à la
violence qu’un tableau douloureux communique à
l’ensemble des soignants.
Rappel sur les théories
psychosomatiques
“L’erreur présente répandue parmi les hommes est
de vouloir entreprendre séparément la guérison du
corps et celle de l’esprit.” Platon.
La théorie psychosomatique tente de donner une
théorisation psychique à la fois des maladies psy-
chosomatiques et des atteintes dites fonctionnelles
ou idiopathiques.
En aucun cas l’implication du psychique dans l’ori-
gine, l’évolution, la chronicité d’une douleur ne
doit laisser entendre au patient une phrase du type

La Lettre du Gynécologue • n° 378-379 - janvier-février 2013 | 35
Points forts
»
Nous situons les douleurs au sein d’une approche historique globale de l‘individu en rappelant les
similarités avec d’autres tableaux cliniques psychosomatiques et fonctionnels.
»
La localisation pelvienne de la douleur peut trop vite être interprétée comme relevant d’une cause
psychique sans que le médecin ait pris soin d’éliminer une cause somatique.
»
Le médecin est soumis à des sentiments contradictoires vis-à-vis de la patiente : il oscille entre agressivité
et empathie. C’est entre ces registres qu’il devra effectuer les examens complémentaires. L’approche des
douleurs chroniques nécessite une patience et une empathie que la patiente met souvent à rude épreuve.
La dépression masquée sera détaillée dans son versant algique, elle est fréquente chez la femme pré- ou
ménauposique et parfois concomitante avec une crise du milieu de la vie.
Mots-clés
Psychosomatique
Crise du milieu
de la vie
Dépression masquée
Highlights
»
Our approach to breast pain
is based on the patient’s overall
history; this approach is used
with other similar psychoso-
matic and functional clinical
profiles.
»
When the pain is located in
the pelvic region, the physician
could attribute it too hastily to
a psychic cause, without first
eliminating a possible somatic
origin.
»
The physician has conflicting
feelings about the patient: they
alternate between aggressivity
and empathy. He will have to
perform the complementary
examinations in this state of
mind. The management of
chronic pain requires great
patience and empathy, which
are often sorely tried by the
patient. We will discuss the
pain dimension of masked
depression, which is frequent
in pre-menopausal and meno-
pausal women, and sometimes
coincides with midlife crisis.
Keywords
Psychosomatic
Midlife crisis
Masked depression
“rassurez-vous, vous n’avez rien”, une fois le bilan
organique effectué pour éliminer une étiologie orga-
nique. Une telle phrase reflète non seulement un
déni massif du médecin face au poids du psychique
dans l’économie douloureuse d’une pathologie,
mais elle culpabilise aussi le patient vis-à-vis de sa
maladie ou, pire, lui fait penser que le médecin le
considère comme un fabulateur, ce qui fera échouer
toute prise en charge thérapeutique de la chronicité
de son atteinte algique.
C’est dans la seconde moitié du e siècle, en pleine
expansion de la vision organiciste de la maladie, que
le terme psychosomatique est utilisé pour la pre-
mière fois. La psychosomatique suppose au départ
l’existence de facteurs d’ordre psychique qui vont
rendre compte de la causalité et de l’étiopatho-
génie de certaines maladies. On peut constater à
quel point cette conception globaliste de l’homme
est proche de la vision hippocratique de la maladie,
tant la dialectique de l’âme et du corps est chose
ancienne. Pourtant, l’“âme” des anciens ne se résume
pas à la notion du “psychique” au
e
siècle, et
encore moins à la notion de “causalité psychique de
la maladie”, car elle était fortement sous l’influence
des “humeurs”, de l’environnement atmosphérique,
etc. La psychosomatique serait donc une approche
nouvelle d’un problème ancien d’une énigme tou-
jours actuelle.
F. G. Alexander, élève et collaborateur de S. Ferenczi,
a créé aux États-Unis un courant de psychosoma-
tique appelé “médecine psychosomatique”. Sa
conception repose sur une approche dualiste du
malade somatique associant un point de vue psy-
chanalytique et un point de vue physiopathologique
(tableau I). Ces travaux ont abouti à l’édification de
profils de personnalités reliés à un certain nombre
de maladies somatiques, dites psychosomatiques :
asthme, ulcère gastroduodénal, hypertension arté-
rielle, etc.
Pour lui, la maladie peut être la résultante d’une
somme de facteurs étiologiques intervenant plus
ou moins dans son apparition :
➤la naissance :
•facteurs génétiques,
•facteurs constitutionnels,
•
existence de traumatismes obstétricaux, d’une
fœtopathie d’origine infectieuse, toxique ;
➤l'enfance :
•nursing, qualité des interactions précoces,
•
climat affectif familial (carence, angoisse,
dépressivité), pathologie psychique parentale,
•
traumatismes physiques ou psychiques fami-
liaux ou personnels, carences affectives, deuils,
séparations pertes,
•maladies pouvant augmenter la vulnérabilité ;
➤l'adolescence, l'âge adulte :
•
traumatismes physiques, psychiques, deuils,
séparations, pertes,
•
qualité, quantité des expériences affectives,
sociales.
Dans cette logique, la théorie psychanalytique
a pu être mal utilisée, comme aboutissant à une
conception d’une “causalité purement psychique de
la maladie”, comme un facteur étiologique unique
et totalisant à mettre au même rang qu’une cause
purement organique qui déclencherait une maladie.
Le risque de cette vision est de ne plus appréhender
à leur juste valeur les composantes organiques
en cause dans l’étiopathogénie du trouble et de
culpabiliser à outrance le patient : “Vous avez fait
votre cancer.” Que d’échecs de prise en charge par
incompréhension radicale ou par passage intem-
pestif d’une simplification d’idées complexes dans
le grand public !
Il est bien plus intéressant de tenter d’appréhender
la charnière psychosomatique comme une unité
indissociable, une synthèse qui reste toujours à
interroger comme le dit l’adage : “Une maladie
psychosomatique est 100 % somatique et 100 %
psychique.” Cet adage souligne bien le monisme à
l’œuvre où tantôt le psychique, tantôt le somatique,
est le “tout” de la maladie, l’identité entre 2 versions
d’un processus unique.
Pour comprendre les conditions dans lesquelles a pu
se développer une maladie somatique, la psycho-
somatique psychanalytique actuelle ne part pas de
Tableau I. Théories psychosomatiques et conceptions
antagonistes de la maladie.
Notion de dualisme somapsyché : avoir une maladie
Approche mécaniste, anatomiste, atomistique, galiéniste
Notion moniste de la maladie : être malade
Approche vitaliste, humorale, totaliste, hippocratique

36 | La Lettre du Gynécologue • n° 378-379 - janvier-février 2013
Douleurs pelviennes chroniques : entre le sacré et le honteux
DOSSIER THÉMATIQUE
Gynécologie-obstétrique
et psy
la maladie comme le fait la médecine classique, mais
de l’individu malade et de son fonctionnement psy-
chique. La psychosomatique psychanalytique se situe
en opposition au courant strictement médical, car elle
part de la notion de maladie pour en rechercher tous
les facteurs étiologiques, biologiques et psychiques.
La pratique psychanalytique tente toujours d’élaborer
le sens d’un symptôme, quel qu’il soit.
Pourtant, avec les maladies psychosomatiques,
2 conceptions s’affrontent :
➤
le symptôme somatique serait vecteur d’un
sens dans la vie du sujet et aurait une dimension
symbolique ;
➤
le symptôme somatique serait un non-sens. Il
aurait une valeur substitutive, mais dépourvue de
dimension symbolique (École de Paris de psycho-
somatique). Il révélerait une vulnérabilité psy-
chique face à une saturation émotionnelle liée à des
confl its non élaborés, sans possibilité de décharge,
aboutissant à une transformation des productions
psychiques, affectives en somatisations et non en
symptômes névrotiques ou comportementaux.
Les somatisations résulteraient ainsi de l’échec des
systèmes de défense psychique. Deux concepts
semblent essentiels pour cette école, car ils sont
souvent retrouvés dans les décompensations soma-
tiques sévères :
➤la dépression essentielle (P. Marty), qui est une
modalité dépressive caractérisée par l’absence
d’expressions symptomatiques. Elle se défi nit par
un abaissement général du tonus de vie. On ne
retrouve dans le vécu dépressif essentiel ni sentiment
de culpabilité ni autoaccusation mélancolique. La
dépression essentielle se révèle ainsi par sa négati-
vité symptomatique ;
➤
la pensée opératoire, qui est un mode de pensée
actuelle, factuelle et sans lien avec une activité fan-
tasmatique ou de symbolisation. Elle accompagne
les faits plus qu’elle ne les représente.
Clinique
Trouble psychofonctionnel,
ou fonctionnel
On appelle trouble psychofonctionnel, ou fonc-
tionnel, toute altération de fonctionnement d’un
organe liée à des confl its psychologiques sans lésion
de cet organe.
Cette modifi cation entraîne soit une exagération du
fonctionnement normal, soit un amoindrissement
de la fonction de l’organe considéré.
Dans la zone pelvienne, comme le souligne le
Pr Marès dans ce même numéro (page 39), l’intri-
cation de multiples organes sensibles avec de nom-
breux facteurs déclenchants rend diffi cile l’isolation
d’une seule étiologie sans un examen clinique et
paraclinique soigneux.
Le tableau II rappelle les exemples de troubles fonc-
tionnels et de douleurs pelviennes. Et il ne faut pas
oublier les douleurs pelviennes déclenchées par
l’examen gynécologique lui-même, en particulier
avec spéculum, même effectué avec le plus grand
soin.
Trouble psychosomatique
On appelle trouble psychosomatique une affection
où la participation psychique joue un rôle important
dans le déclenchement des troubles organiques.
Un processus de somatisation est une chaîne d’évé-
nements psychiques qui favorisent le dévelop pement
d’une affection somatique.
Tableau II. Exemples de troubles fonctionnels.
Appareil cardiaque
Tachycardie secondaire à de la peur, de la joie, une surprise,
un stress chronique
Appareil respiratoire
Essouffl ement, spasme, oppression thoracique : stress
Appareil digestif
Augmentation de la sécrétion gastrique : agressivité,
situation confl ictuelle
Boule œsophagienne”, vomissements à la suite d’un stress
Majoration ou diminution des fonctions vésiculaires :
douleurs, dyskinésies vésiculaires
Hypo- ou hypersécrétion du pancréas : stress, confl it
Diminution du péristaltisme intestinal : constipation
fonctionnelle
Augmentation du péristaltisme intestinal : diarrhée
psychogène
Appareil locomoteur
Algies aiguës, chroniques
Crampes de l’écrivain, dystonies
Divers
Troubles sexuels : impuissance, dyspareunie, frigidité
Dysménorrhées
Douleurs pelviennes chroniques : zone colo-vésico-
musculo-neuro-génitale
- Facteurs traumatiques (physiologiques, psychologiques,
chirurgicaux, gestes invasifs)
- Facteurs infectieux
- Rapports sexuels : lien avec une dyspareunie
- Postexamen gynécologique
Annoncez
vous !
Des annonces
professionnelles
gratuites
pour
les étudiants
Contactez Valérie Glatin
au 01 46 67 62 77
ou faites parvenir
votre annonce par mail

La Lettre du Gynécologue • n° 378-379 - janvier-février 2013 | 37
DOSSIER THÉMATIQUE
Le tableau III présente des exemples classiques de
troubles psychosomatiques, mais la liste n’est pas
exhaustive tant l’apparition d’une somatisation
est l’une des manifestations les plus fréquentes de
réponse à un conflit psychique ou à un stress.
Dépression et dépression masquée
par les douleurs pelviennes
Tout tableau dépressif peut se révéler par un tableau
algique (40 % des dépressions). L'encadré décrit
un exemple dont l'étiologie n'est pas toujours bien
connue des somaticiens : celui du milieu de la vie.
Bien entendu, nous ne traiterons pas exhaustivement
l’ensemble des étiologies dépressives, nous ferons
juste un rappel de cette cause, fréquente dans un
tableau de survenue de la ménopause, dans une
période de bilan qu’une femme fait de sa vie affec-
tive, de couple, professionnelle ou sociale, des buts
oubliés, des objectifs jamais atteints.
La dépression masquée illustre parfaitement l’ap-
proche psychosomatique de l’individu comme une
totalité, tant le corps et l’esprit prennent des voix
si intriquées pour dire leur souffrance. L’esprit parle
par le corps, le corps parle par la douleur, symptôme
des plus psychiques et si trompeur.
Ulysse aurait-il été atteint d’une crise du milieu de
la vie chez Calypso, lui qui avait tout à sa portée
(L’Urgence, Milan Kundera) ? Pourquoi regarder en
arrière en milieu de vie : nost-algie, passé-doulou-
reux, ce mouvement qui paralyse l’avancée d’une vie
en une rumination incessante des plaisirs anciens.
Le présent est vécu sans désir ni passion, le futur
sans lendemain, autant de signes qui évoquent une
dépression, parfois masquée par un tableau algique.
La crise du milieu de la vie est l’exemple même de
la dépression avec résurgence du passé qui réactive
souvent autant de processus de deuil jamais bien
résolus, de promesses jamais tenues et qui ne le
seront jamais plus.
La dépression du milieu de la vie, l’âge du “Never
More”, comme le dit si bien Verlaine dans ses Poèmes
saturniens dédiés à la mélancolie, est l’exemple
même d’une cause psychogène d’une dépression
qui fait suite à un bilan trop lucide de sa vie, comme
seule la dépression le permet. Elle atteint aussi bien
les femmes que les hommes et peut prendre chez
les femmes le masque d’une douleur bien réelle : on
l’appelle alors dépression masquée. Le diagnostic
est alors plus délicat, car le tableau médical est
au devant de la scène. Le concept de dépression
masquée est relativement récent et date des années
70.
Malgré l’absence d’un consensus précis sur les impli-
cations étiologiques de cette dépression (endogène
ou psychogène ?), elle est caractérisée par le mas-
quage des symptômes dépressifs (humeur dépres-
sive, ralentissement psychomoteur) par d’autres
symptômes, le plus souvent somatiques. Le mas-
quage est un élément dépressif inapparent dont les
symptômes peuvent dominer le tableau clinique et
résumer à eux seuls l'ensemble de la symptomalogie
dépressive.
Dans la dépression masquée somatique, les manifes-
tations somatiques sont au premier plan, en particu-
lier les symptômes algiques. Les plaintes digestives,
lombaires, pelviennes, les céphalées traînantes
•Calypso,pendant7ans,retintUlyssesursonîle.Ilavaitla
plus belle femme du monde à ses côtés, l’existence d’un
demi-dieu, la dolce vita...
•Auboutde7années,ilreditàCalypso,quiluidemandait
les raisons de son malaise : “Je sais que la très sage Péné-
lope n’offre au regard ni ta beauté, ni ta stature, et néan-
moins, j’espère, je désire à tout moment me retrouver
chez moi et vivre l’heure du retour.”
•Àsonretour,UlysserapportaauroidePhéaciesesaven-
tures, mais chez lui, personne ne lui demanda de les
raconter, car elles appartenaient au passé.
Encadré. Ulysse et Calypso : crise du milieu de la vie.
Tableau III. Exemples de troubles psychosomatiques.
Appareil respiratoire
Asthme
Appareil digestif
Ulcèresgastriques,maladiedeCrohn,rectocolite-ulcéro-
hémorragique
Affections allergiques
Eczéma, rhume des foins, coryza spasmodique, urticaire
Appareil cardiaque
Hypertension artérielle, angine de poitrine, myocardiopathie
non obstructive de stress
Appareil locomoteur
Rachialgies
Appareil neurologique
Migraines, crises céphalalgiques
Douleurs pelviennes chroniques résiduelles par
sensibilisation centrale et/ou médullaire
Maladies générales
Maladies auto-immunes, maladies cancéreuses
Divers
Herpès

38 | La Lettre du Gynécologue • n° 378-379 - janvier-février 2013
Douleurs pelviennes chroniques : entre le sacré et le honteux
DOSSIER THÉMATIQUE
Gynécologie-obstétrique
et psy
sine materia sont particulièrement fréquentes. On
retrouve aussi des troubles du sommeil persistants,
résistants aux thérapeutiques hypnotiques, ainsi
que des états asthéniques qualifiés de fonctionnels.
Plusieurs caractéristiques aident à rattacher ces
troubles à la dépression :
➤plaintes vagues et variables d’un jour à l’autre ;
➤absence ou peu d’anxiété concomitante ;
➤
disproportion entre la plainte et le retentisse-
ment général considérable ;
➤normalité des bilans organiques ;
➤inefficacité des traitements somatiques ;
➤ déni farouche de toute dépression.
Au moindre doute, l’avis du psychiatre peut être
utile. Il instaurera un traitement antidépresseur
dont l’efficacité aura aussi une valeur rétrospective
diagnostique.
Principes thérapeutiques
Les principes thérapeutiques sont guidés par les
constatations suivantes :
➤
l’évolution d’une maladie est influencée par la
personnalité du sujet, sa résistance, sa résignation,
son renoncement, sa lutte, ses émotions ;
➤
le pronostic d’une maladie est lié à la qualité de
l’alliance thérapeutique ;
➤
l’approche multidimensionnelle du sujet ne
réduit plus ce dernier à sa maladie et améliore sa
qualité de vie.
➤
le traitement systématique de l’affection en
cause ou, quand il existe, un traitement curatif ou
palliatif.
Un traitement antidépresseur est mis en place dans
l’étiologie dépressive. Il peut avoir un but antalgique
dans certains cas. Parfois, la thérapie doit aussi
inclure une approche sociale de la maladie pour
éviter l’isolement ou la rupture des soins.
L’approche psychosomatique en médecine est aussi
une approche particulière de la relation médecin/
malade et de la maladie. Le sujet n’est ni réduit à
sa maladie ni considéré comme unique responsable
de ses troubles. Le piège du caractère plaqué de la
causalité psychique (“c’est dans la tête”) ne doit
jamais servir d’excuse pour ne pas faire d'investiga-
tions médicales poussées pour déterminer la cause
des problèmes.
Cette approche devrait aussi permettre de proposer
au patient une thérapeutique psychothérapique
complémentaire afin d’éviter qu’il ne s’enferme
dans une vision trop dissociée et dichotomique de
sa maladie où le somatique serait tout et le psy-
chique ne serait rien.
Le traitement psychothérapique des patients
atteints de douleurs chroniques doit être réalisé
par des psychanalystes formés à la clinique et
à la théorie psychanalytique, et ayant reçu une
formation approfondie dans le champ de la psycho-
somatique.
La psychothérapie ne doit pas simplement rassurer
face à l’irruption d’une douleur chronique mais aussi
analyser :
➤l’apparition, la genèse des symptômes ;
➤
l’évolution des symptômes en fonction des évé-
nements extérieurs et intérieurs ;
➤
l’impact de la douleur sur la personnalité (réac-
tions non spécifiques de la maladie) ;
➤
l’attitude face aux soins médicaux : résistance,
opposition, nomadisme, etc.
Plusieurs règles doivent être respectées :
➤
le traitement complémentaire des thérapeu-
tiques médicales, parfois chirurgicales ;
➤
Le lieu où se déroule la psychothérapie doit être
différent de celui dans lequel les soins médicaux
sont pratiqués ;
➤
le psychothérapeute ou le psychanalyste ne peut
être le médecin traitant.
Les troubles psychosomatiques des affections psycho-
fonctionnelles relèvent aussi de la relaxation, tech-
nique de détente du corps. Le thérapeute apprend
au patient à relâcher des groupes musculaires déter-
minés, segment de corps par segment de corps. La
technique la plus employée est celle de Schultz, du
nom de son auteur. La relaxation suppose parfois que
le patient poursuive ses exercices par lui-même. Elle
peut aussi être une relaxation d’inspiration psychana-
lytique quand elle est pratiquée par un psychanalyste.
Certaines approches de la douleur chronique incluent
des thérapies cognitives ciblées. ■
Pour en savoir plus
Marty P. L’ordre psychosomatique.
Paris : Payot, 1980.
Lévy-Soussan P. Psychiatrie, 3
e
éd.
Paris : Collection Med-Line ENC,
2007:548.
1
/
5
100%