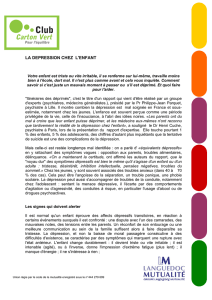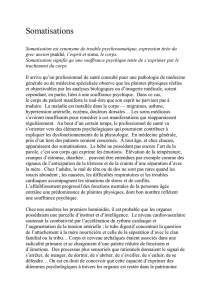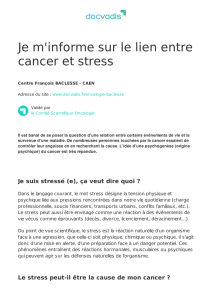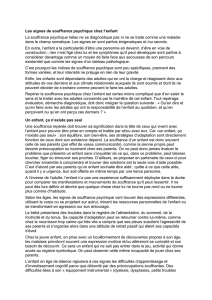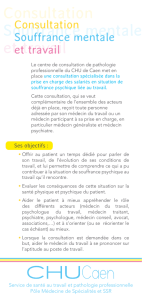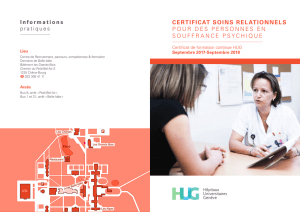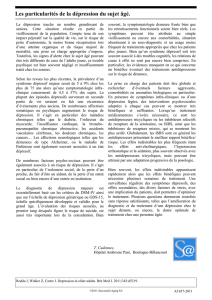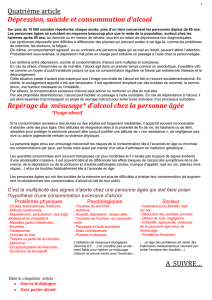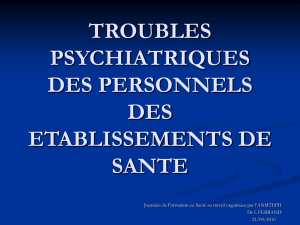Conclusion

L’Encéphale, 2007 ; 33 : Octobre, cahier 2
852
Conclusion
J. COGNEAU (1)
On sait que la dépression est un phénomène fréquent,
puisque la prévalence de l’épisode dépressif majeur, en
France, est d’environ 20 % pour toute la durée de vie et
10 % à six mois (1). Les dépressions sont traitées par les
médecins généralistes surtout depuis l’apparition d’anti-
dépresseurs plus maniables : ceci est donc relativement
récent dans notre pratique.
En pratique, les patients déprimés présentent sou-
vent des pathologies somatiques associées, parfois gra-
ves, importantes, et qui ne permettent donc pas, dans
le cours de la consultation, de donner toute sa place
aux éléments d’appréciation de la santé psychique du
patient. Or les patients qui sont en mauvaise santé phy-
sique courent plus de risques de devenir déprimés que
ceux qui sont en bonne santé (1).
Les trois cas cliniques que nous venons de voir ont
bien souligné l’importance d’une approche clinique
structurée. Il ne s’agit pas nécessairement d’utiliser une
échelle, mais de faire un bilan symptomatique précis. Le
diagnostic clinique se porte sur des éléments connus, la
référence étant le DSM-IV. Il est nécessaire également de
faire ce bilan initial pour suivre l’évolution des patients, et
en particulier évaluer la réponse au traitement. La rigu-
eur clinique est autant nécessaire dans le diagnostic des
troubles psychiques que pour les troubles somatiques.
L’intérêt d’un diagnostic clinique structuré est égale-
ment lié au fait que l’expression de la plainte, de la souf-
france, est très différente selon les personnes. Il est par
exemple beaucoup plus diffi cile de faire parler un hom-
me, surtout jeune, de sa souffrance, de ses symptômes,
et de lui faire comprendre qu’il a une dépression, parce
que la dépression est vécue comme culpabilisante : les
patients se sentent responsables de leur état psychique.
En faisant ce diagnostic et en leur expliquant le but de
la démarche psycho-éducative, on aide les patients à se
déculpabiliser, à dédramatiser, à comprendre.
Il faut également insister sur l’importance de l’évalua-
tion systématique du risque suicidaire (1) : ce n’est pas
parce que le patient n’en parle pas qu’il n’y a pas de ris-
que suicidaire, et ce n’est pas parce que le médecin en
parle qu’il augmente ce risque (2).
Autre point majeur dans les états dépressifs, celui de
l’observance : en ce qui concerne les nouvelles prescrip-
tions, trop nombreux sont les patients qui ne prennent
qu’une seule boîte et n’ont recours à aucun médecin ou
aucun soignant dans les trois à six mois qui suivent. Il
ne faut pas craindre de médicaliser la prise en charge
de la souffrance psychique : lorsqu’un diagnostic précis
est porté, il ne faut pas hésiter à convoquer le patient, à
l’évaluer à courte échéance en début de traitement, et à
lui fi xer des rendez-vous réguliers. Si l’on relâche cette
surveillance, les patients ont tendance à penser qu’on les
convoque seulement après trois mois parce qu’ils vont
mieux et qu’ils n’ont plus besoin de voir le médecin, et
donc plus besoin de prendre leur traitement.
Enfi n, les relations médecins généralistes/psychiatres
sont des relations parfois diffi ciles qu’il faut améliorer : la
prise en charge avec le psychiatre devrait être une colla-
boration réelle pour le médecin généraliste, dans laquelle
il soit possible de se parler, de se comprendre et d’éva-
luer le devenir du patient, pour lui donner les meilleurs
soins possibles.
Références
1. AFSSAPS octobre 2006, Bon usage des médicaments antidé-
presseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des trou-
bles anxieux de l’adulte -
http://agmed.sante.gouv.fr/htm/5/rbp/indrbp.htm
2. ANAES octobre 2000, La crise suicidaire : reconnaître et prendre
en charge.
http : //www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_271964
(1) Médecin généraliste à Tours.
1
/
1
100%