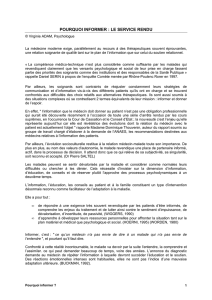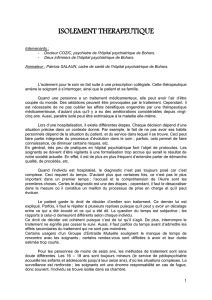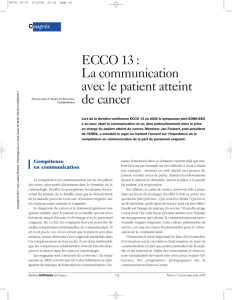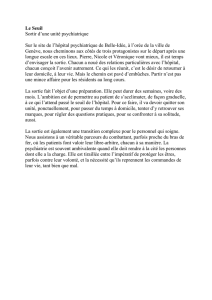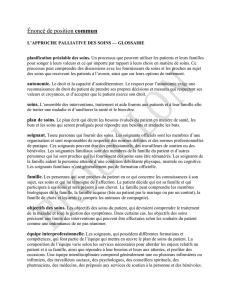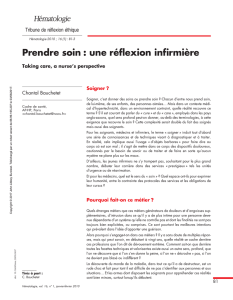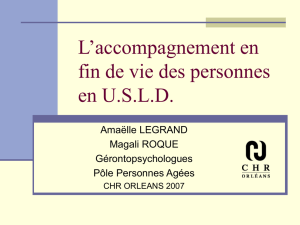Le travail en synergie avec les autres soignants

Journal Identification = IPE Article Identification = 0928 Date: May 24, 2012 Time: 3:0 pm
L’Information psychiatrique 2012 ; 88: 361–4
LES CÉRÉBROLÉSÉS
Le travail en synergie avec les autres soignants
Jean-Pierre Vignat
RÉSUMÉ
La prise en charge des patients cérébrolésés implique, simultanément et successivement, plusieurs professionnels de
santé. La mise en place d’un partenariat, dont sont rappelés les prérequis, est indispensable. Même si tous les soignants
concourent explicitement à la restauration de l’autonomie du patient, la mise en synergie implique une modélisation
commune de l’atteinte cérébrale et de ses conséquences. L’approche psychopathologique est nécessaire pour la construction
d’une représentation partagée des troubles. Pour travailler en synergie, forme accomplie de la collaboration, les soignants
s’inscrivent dans un système avec le patient et son environnement proximal.
Mots clés : lésion cérébrale, prise en charge, équipe pluridisciplinaire
ABSTRACT
Working in synergy with other caregivers. The management of patients with brain damage implies, simultaneously
or successively, several health professionals. The establishment of a partnership, where prerequisites are required, is
indispensable. Although all caregivers contribute explicitly to restore the patient’s autonomy, the synergy implies a common
modelling of the brain injury and its consequences. The psychopathological approach is necessary for the construction of
a shared representation of disorders. In order to work in synergy, in an effective form of collaboration, caregivers must be
an integral part of a system with the patient as well as their immediate environment.
Key words: brain injury, management, multidisciplinary team
RESUMEN
El trabajo en sinergia con el resto del equipo sanitario. La atención a los pacientes cerebro-lesionados implica, simultánea
y sucesivamente, a varios profesionales de salud. Es indispensable la previa puesta en marcha de un acuerdo cuyos
prerequisitos se recordarán. Aunque todo el equipo sanitario esté explícitamente volcado a la restauración de la autonomía
del paciente, la puesta en sinergia supone una modelización común de la vulneración cerebral y de sus consecuencias.
El enfoque psicopatológico es necesario para construir una representación compartida de los trastornos. Para trabajar en
sinergia, forma cumplida de la colaboración, el equipo sanitario se inscribe en un sistema con el paciente y su entorno más
próximo.
Palabras claves : lesión cerebral, atención global, equipo pluridisciplinar
Psychiatre, 6, avenue Leclerc, 69007 Lyon, France
Tirés à part : J.-P. Vignat
doi:10.1684/ipe.2012.0928
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦5 - MAI 2012 361
Pour citer cet article : Vignat JP. Le travail en synergie avec les autres soignants. L’Information psychiatrique 2012 ; 88 : 361-4 doi:10.1684/ipe.2012.0928
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Journal Identification = IPE Article Identification = 0928 Date: May 24, 2012 Time: 3:0 pm
J.-P. Vignat
La prise en charge des patients cérébrolésés implique,
simultanément et successivement, plusieurs professionnels
de santé. De ce fait, la coordination de leur intervention
est une nécessité et cette évidence semble dispenser d’aller
plus loin.
La réalité est moins simple ; la coordination ne se
résume pas à la gestion du temps et de l’espace entre les
intervenants ni au constat que chacun concourt, comme il
se doit, au but commun : la restauration, le maintien ou
l’amélioration de l’autonomie et de la liberté du patient
et l’apaisement de ses souffrances. Par ailleurs, la coor-
dination, au sens de l’ajustement et de l’harmonisation des
actions, ne répond pas véritablement aux besoins du patient
cérébrolésé grave.
Le retour aux données
Il est nécessaire de revenir aux données du problème ;
la lésion cérébrale entraîne des atteintes fonctionnelles
directes, exprimées par les troubles neurologiques moteurs,
sensoriels et cognitifs, repérables et mesurables par diffé-
rentes méthodes. On sait qu’une partie de ces manifestations
traduisent la mise en œuvre de divers mécanismes adaptatifs
de l’appareil neurobiologique. Les désordres cérébraux se
manifestent parfois par une sémiologie « psychiatrique »,
notamment comportementale. Les atteintes cognitives ne
se limitent pas aux fonctions instrumentales ; elles reten-
tissent, parfois profondément, sur l’appareil psychique et
d’abord sur le sentiment de soi défini comme « l’éprouvé
de différenciation d’avec les autres, d’unité et d’identité,
avec une stabilité des limites du soi et de sa permanence »
[1].
L’éprouvé corporel modifié, souvent considérablement
du fait de l’atteinte neurologique, parfois douloureuse, met
en cause les assises-mêmes de la construction psychique,
au plan de l’image du corps, de la représentation de l’espace
et de la relation aux autres et à la réalité.
La conscience de la déficience, à laquelle s’ajoute le cas
échéant un syndrome psychotraumatique et/ou le matériel
psychique subsistant du passage en réanimation (le « trou
réa » décrit par Grosclaude [2]), est également à prendre en
compte. Les défenses qu’active l’appareil psychique, en lien
avec l’appareil neurobiologique, modifient encore la donne.
Ces remaniements s’opèrent selon les lignes de la structure
psychique. La prise en charge s’inscrit ainsi obligatoirement
à la jonction du somatique, du psychique et du social.
La nécessité d’une modélisation
globale
Au terme des bilans neurologique, neuropsychologique,
psychiatrique, orthophonique, psychomoteur...et social du
patient, il est souhaitable de construire une modélisation
globale. Chaque professionnel intervenant auprès du patient
peut y référer son axe de lecture des troubles.
Dans la pratique clinique, cette construction ne va pas
de soi. Les axes de lecture sont le plus souvent exclu-
sifs les uns des autres ou, au mieux, ont la caractéristique
des lignes parallèles. De plus, les symptômes d’allure psy-
chiatrique au plan de l’humeur (tonalité dépressive ou
joviale), du discours (rapport déformé à la réalité) ou du
comportement (bizarreries ou inadaptations) sont rappor-
tés à l’atteinte cérébrale sans autre précision et ainsi placés
hors champ de lecture. Il est bien certain que l’existence
d’une lésion cérébrale renforce la tentation du « tout neu-
robiologique ».
De ce fait, le sens et la fonction des symptômes ne
sont pas systématiquement recherchés. C’est particulière-
ment regrettable pour les troubles du comportement chez
les patients dont l’expression verbale est réduite, altérée ou
détruite. On sait la fonction de réponse répétitive de ces
comportements aux modifications de l’environnement.
Ces modifications incluent les événements en péri-
immédiat du comportement, notamment le positionnement
des professionnels et leur réaction vis-à-vis du patient ainsi
que celle des personnes à proximité. L’impasse qui est
ainsi faite a deux conséquences : la répétition inlassable du
comportement et la difficulté de toute coordination entre
les intervenants. Inversement, l’approche de ces comporte-
ments implique la mise en œuvre d’une méthode spécifique
appliquée par tous les professionnels concernés.
Les soignants
Les professionnels de santé susceptibles d’intervenir
directement auprès d’un patient cérébrolésé sont en
nombre : neurologue, neuropsychologue, kinésithérapeute,
ergothérapeute, orthophoniste, psychomotricien, psychia-
tre... Certains sont présents dès le constat de l’atteinte
cérébrale, d’autres dans les suites précoces, au titre de
l’évaluation et/ou de la rééducation puis de la réadaptation.
D’autres sont en charge de la restauration du lien social,
souvent réduite à la récupération des droits sociaux ; pour
autant, l’action des professionnels du service social consti-
tue une véritable composante du soin. D’autres encore,
notamment le psychologue et le psychiatre, sont souvent
requis en cas de difficultés ou d’incidents dans l’évolution :
état dépressif, trouble du comportement par exemple. De
plus, certains aspects cliniques sont systématiquement
tenus pour des complications alors qu’ils expriment des
mécanismes défensifs ou des stratégies adaptatives.
Cet aspect de la prise en charge mérite qu’on s’y arrête
un instant. La prévalence très élevée de la dépression post-
stroke est aussi connue que celle du baby-blues. Néanmoins,
le psychologue et le psychiatre ne sont habituellement
sollicités que lorsque la stagnation de la récupération est
rapportée à la dépression. Diagnostiquée tardivement, la
362 L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦5 - MAI 2012
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Journal Identification = IPE Article Identification = 0928 Date: May 24, 2012 Time: 3:0 pm
Le travail en synergie avec les autres soignants
décompensation est plus difficile à traiter en même temps
que la rééducation et la réadaptation sont compromises,
parfois définitivement. On pourrait en dire autant en ce
qui concerne les troubles psychotraumatiques dont on
pensait que les atteintes corporelles constituaient une pro-
tection.
Les atteintes cérébrales, dès lors qu’elles entraînent des
déficiences fonctionnelles importantes qui mobilisent les
intervenants de première ligne suivis des rééducateurs,
apparaissent encore trop souvent comme des mises entre
parenthèses des troubles psychiques antécédents, notam-
ment des troubles de la personnalité, même si la lésion
cérébrale est directement la conséquence d’un comporte-
ment suicidaire ou à risque.
L’intervention indirecte des soignants n’est pas à
sous-estimer. Ce champ est celui de l’environnement de
proximité du patient : conjoint, enfants, parents ; il convient
d’y adjoindre les aidants professionnels qui peuvent être
concernés. Cette intervention vise à un étayage associant
une information et, si nécessaire, une contenance émotion-
nelle. Elle nécessite le même souci de coordination que le
soin direct.
À noter que les soignants ne sont pas les seuls profes-
sionnels à intervenir auprès des patients cérébrolésés. Des
enseignants, des moniteurs techniques notamment sont pré-
sents dans les centres de réadaptation. La coordination, pas
toujours facile, mérite néanmoins d’être recherchée.
Les formes de relation entre soignants
À y regarder de près la relation entre les professionnels
intervenant auprès d’un même patient peut offrir des formes
très différentes, aussi bien dans le cadre institutionnel que
dans le cadre libéral qui lui succède souvent. Il convient de
distinguer la prestation de service, la sous-traitance et le par-
tenariat, en allant du plus simple au plus complexe. Dans la
prestation de service, l’intervenant assure un soin limité en
étendue et en durée, à la demande directe d’un autre profes-
sionnel ou indirecte, via le patient lui-même ou plus souvent
un proche. Dans la sous-traitance, l’intervenant – individu
ou équipe – assure une partie, majeure le cas échéant, de
la prise en charge sur délégation du coordonnateur des
soins. Ces deux formes sont parfaitement acceptables. Elles
ont cependant l’inconvénient de ne pas inclure un retour
obligatoire d’information, avec le risque d’une absence de
coordination véritable.
Le partenariat est la forme la plus achevée de la relation
entre les professionnels. Il peut s’établir entre des institu-
tions, des équipes, des professionnels isolés mais aussi entre
les professionnels d’une même équipe. Il suppose plusieurs
préalables incontournables qu’une formule simple peut
résumer : un partenariat ne peut s’établir que lorsque chaque
partenaire a formé de son ou ses partenaires pressentis une
représentation dans laquelle ceux-ci se reconnaissent. Cha-
cun est ainsi amené à préciser son champ de compétence,
ses fondements théoriques, sa méthode d’intervention, ses
moyens, ses limites, etc. afin de permettre aux autres de
former une représentation adaptée.
Cette phase préparatoire n’est pas toujours réalisée,
moins par manque de temps que parce qu’elle semble super-
flue, et le terme de partenariat est alors utilisé sans référence
au concept. C’est ce qui rend compte des difficultés de cer-
taines coopérations ou de leur échec. En revanche, cette
phase est réalisée rapidement lorsque chaque professionnel
a pu précédemment découvrir le métier des autres et s’en
faire une représentation pertinente.
La représentation des troubles
et l’approche psychopathologique
La modélisation commune des troubles résultant d’une
atteinte cérébrale ne va pas de soi. La phase préparatoire
au partenariat la facilite. On est cependant encore éloi-
gné d’une représentation partagée des troubles en général
et de ceux d’un patient en particulier. Cette représenta-
tion ne concerne pas seulement les sphères sensorielles,
motrices, cognitives, émotionnelles mais aussi la relation à
l’autre, le rapport à la réalité, le contrôle des impulsions...
L’approche psychopathologique est ainsi autant nécessaire
que les approches plus habituelles.
Le profil psychopathologique entre dans la représenta-
tion des troubles et dans le projet personnalisé de prise en
charge. Celui-ci est partagé par tous les professionnels de
santé. Les objectifs sont définis en commun, l’action de
chacun s’inscrivant dans l’interaction avec le patient et,
de ce fait, interagissant avec l’action des autres. Il s’agit
moins d’une interaction technique que d’une interaction
psychologique. Le risque est celui d’une interférence entre
les effets psychiques des interventions. Ces effets sont
pour une part liés au jeu des attitudes et contre-attitudes
(entendues comme l’ensemble des réactions conscientes et
inconscientes des professionnels vis-à-vis d’un patient) des
intervenants. Ainsi, l’attitude maternante d’un profession-
nel et la démarche d’autonomisation d’un autre peuvent
se trouver en contradiction, voire placer le patient dans un
conflit de loyauté ou dans un système paradoxal.
En d’autres termes, la définition et la validation par-
tagées des objectifs, qui représentent déjà une démarche
ambitieuse, ne sont pas suffisantes. Il serait souhaitable
de mettre en place une concertation sur le positionnement
relationnel et l’attitude de chaque intervenant vis-à-vis du
patient. Cette concertation est tout autant importante vis-à-
vis de l’entourage proximal du patient. Les divergences,
parfois les véritables discordances, des informations et
des attitudes des professionnels parasitent la prise en
charge et majorent la souffrance des aidants familiaux. Les
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦5 - MAI 2012 363
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Journal Identification = IPE Article Identification = 0928 Date: May 24, 2012 Time: 3:0 pm
J.-P. Vignat
assistants de service social peuvent à cet égard apporter
une contribution particulièrement importante de par leur
compétence en proximologie.
Les dispositifs anticlivages
Du fait de leur structure psychique – par définition anté-
cédente – du type état limite notamment ou de l’activation
de mécanismes de défenses prégénitaux, un nombre impor-
tant de patients induisent des phénomènes de clivage – ou
de déliaison – chez les intervenants, individuellement et
collectivement. Cela rend compte du caractère strictement
factuel, style rapport de gendarmerie, de la description du
patient, ou plus exactement de ses troubles, par certains
professionnels et de leur difficulté à s’inscrire dans une
démarche concertée.
Pour être méconnu, le risque n’en est pas moins bien
présent et actif sur les prises en charges. Par suite, la mise
en place d’un espace de concertation, même à titre ponc-
tuel, a la fonction d’un dispositif anticlivage. Toutefois,
celui-ci est opérationnel à la seule condition d’employer
une méthode du type synthèse clinique qui assure la liberté
de la parole et permet à chacun de travailler sur son res-
senti dans la rencontre du patient et au cours de sa prise
en charge. Convaincre tous les intervenants de l’intérêt de
cette méthode n’est pas la moindre des tâches.
Les points de vulnérabilité au clivage se situent à plu-
sieurs niveaux dont certains ont déjà été évoqués, ainsi le
positionnement et l’attitude des différents professionnels.
Les divergences des objectifs de soins peuvent exprimer
le clivage. Un aspect moins connu du clivage réside dans
les divergences du repérage et de l’interprétation des résis-
tances au traitement chez le patient, ses proches mais aussi
les soignants. À titre d’exemple, la stagnation des progrès
de la récupération locomotrice sera mise au compte de
la détérioration des fonctions exécutives en récusant toute
référence au maintien de la dépendance du patient lié à la
réorganisation du système conjugal ou familial.
La synergie, enfin
L’effet de l’action conjuguée est plus grand que la
somme des effets attendus si les acteurs agissaient indé-
pendamment. Cette définition classique de la synergie ne
dit rien de la condition fondamentale, à savoir que les
acteurs sont engagés dans un système. C’est effectivement
un système implicite ou explicite qui est créé autour du
patient ou plutôt avec lui et avec son environnement proxi-
mal. C’est en termes systémiques que l’organisation des
soins et les relations entre les intervenants peuvent être
pensées.
Cette conception ne va pas de soi ; les intervenants
appartiennent souvent à des services différents ou à des ins-
titutions différentes ou, pour certains, sont de statut libéral.
Il est cependant possible de proposer un tel modèle.
Travailler en synergie avec les autres soignants n’est pas
plus facile pour le psychiatre que pour les somaticiens et les
rééducateurs. Accepter les approches différentes des autres
soignants exige un effort de compréhension constamment
entretenu. Par ailleurs, la tentation est grande de s’en tenir
au schéma classique de la prise en charge du patient malade
mental. La présence d’une sémiologie familière au psy-
chiste, comme les idées délirantes ou l’humeur dépressive,
ne doit pas faire oublier la dimension de l’atteinte cérébrale
et les multiples niveaux de son impact, et des modifications
qui s’ensuivent.
Conflits d’intérêts : aucun.
Références
1. Racamier PC. Le moi, le soi, la personne et la psychose.
Essai sur la personnation (rééd.). L’Évolution psychiatrique
2007 ; 72 : 659-79.
2. Grosclaude M. Réanimation et coma, soins psychique et vécu
du patient. Paris : Masson éditions, 2002.
364 L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦5 - MAI 2012
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.
1
/
4
100%