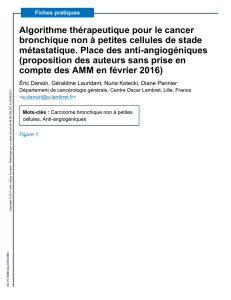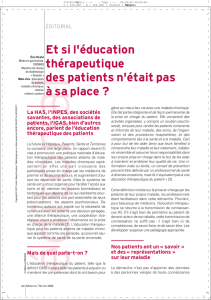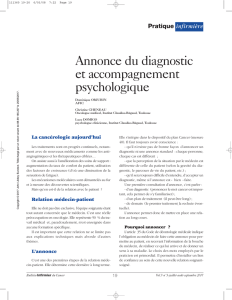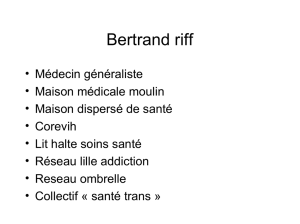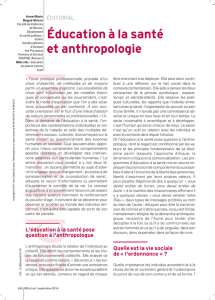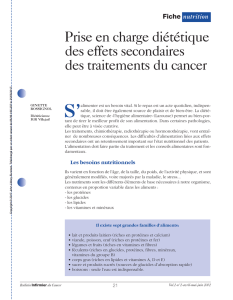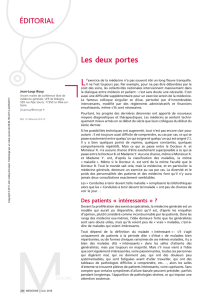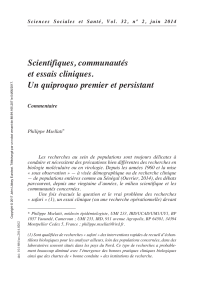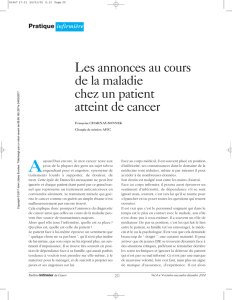Entre médicalisation et dépathologisation : la

Sciences Sociales et Santé, Vol. 30, n° 3, septembre 2012
Entre médicalisation
et dépathologisation : la trajectoire
incertaine de la question trans
Thomas Bujon*, Christine Dourlens**
Résumé. La question trans, longtemps marginalisée et confinée dans des
cercles de spécialistes, est aujourd’hui au cœur de débats publics très vifs.
Les enjeux cognitifs occupent une place centrale dans ces controverses
qui opposent principalement médecins et militants du mouvement trans-
genre autour de la désignation de la transsexualité en tant que pathologie.
Dans des lieux très divers, les protagonistes défendent leurs points de vue
et font valoir leur expertise à propos du diagnostic psychiatrique, de la
prise en charge médicale, de l’accès aux soins ou des droits des person-
nes. Ils s’affrontent parfois de manière radicale, ajournant ainsi toute ten-
tative d’administration politique du problème. Écartelée entre
médicalisation et dépathologisation, lestée de lourds enjeux — tels que
ceux relatifs à la distinction de genres ou au rôle social de la médecine —
la question trans connaît une trajectoire très incertaine dont cet article se
propose de décrire les lignes de fuite et les bifurcations.
doi: 10.1684/sss.2012.0303
* Thomas Bujon, sociologue, TRIANGLE : Action, discours, pensée politique et éco-
nomique, UMR 5602 CNRS, Université Jean-Monnet, 6, rue Basse des Rives, 42023
Saint-Etienne Cedex 2, France ; [email protected]
** Christine Dourlens, sociologue, TRIANGLE : Action, discours, pensée politique et
économique, UMR 5602 CNRS, Université Jean-Monnet, 6, rue Basse des Rives,
42023 Saint-Etienne Cedex 2, France ; [email protected]
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

34 THOMAS BUJON, CHRISTINE DOURLENS
Mots-clés: transsexualité, médicalisation, dépathologisation, problème
public.
La mise en politique de certaines questions de santé suit parfois des
chemins quelque peu inattendus. Si, la plupart du temps, elle vise à
inscrire un problème sanitaire sur l’agenda public, à mettre en place un
programme d’action susceptible de le résoudre, bref à élargir le champ de
la santé publique en y inscrivant une nouvelle rubrique, elle peut aussi
parfois recouvrir des enjeux a priori opposés. Ceux-ci concernent alors
moins la reconnaissance d’un problème comme relevant du domaine de la
santé que son extraction, au moins partielle, de ce champ (1).
D’une manière générale, la mise en politique des questions de santé
semble participer d’un processus plus large, celui de la médicalisation.
Selon les travaux qui s’intéressent à ce processus, certaines questions,
auparavant définies en termes de déviances ou de comportements naturels,
sont désormais appréhendées et traitées en tant que problèmes médicaux
et tendent à s’inscrire sous une juridiction médicale (Conrad, 1992 ;
Conrad et Schneider, 1992; Fox, 1977; Zola, 1972). La médicalisation
est souvent analysée comme la résultante de plusieurs mouvements: la
problématisation d’une question en termes de pathologie, la mobilisation
d’un savoir spécialisé et la reconnaissance politique de l’entité ainsi insti-
tuée. Ces mouvements scellent une définition commune du problème et
installent des formes de prise en charge qui s’étayent mutuellement. En
forçant quelque peu le trait, la médicalisation se présente comme animée
par une logique univoque: celle de l’accroissement continu du savoir et
du pouvoir médical (Berlivet, 2011).
Cependant, la plupart des travaux sur la médicalisation, se démar-
quant d’une approche linéaire du phénomène, en contestent le caractère
«inévitable et impitoyable » (Clarke et al., 2000) et en révèlent la com-
plexité. Ils relèvent que, loin de se présenter comme un mouvement sim-
ple et homogène, la médicalisation (ainsi que son envers, la
démédicalisation) est aussi «une série de processus dynamiques impli-
quant, d’une part, des interactions entre profanes, professionnels, com-
pagnies d’assurances, consortiums, administrations gouvernementales,
(1) L’article prend appui sur un programme de recherche en cours concernant l’émer-
gence de la question « trans » comme problème public. Il faut y associer — même si
les propos n’engagent que les auteurs de l’article — Elsa Comails-Chappellet, docto-
rante en sociologie.
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

LA TRAJECTOIRE INCERTAINE DE LA QUESTION TRANS 35
médicaments, technologies et outils divers et, d’autre part, l’influence de
divers savoirs, d’intérêts politiques et économiques et de vastes organisa-
tions, tous en compétition les uns avec les autres» (Clarke et al., 2000:
19, notre traduction).
De fait, nombre de travaux relèvent que la médicalisation est portée
par des acteurs très hétérogènes, alors que d’autres pointent aussi que son
accomplissement est inégal, comme en témoigne la mise en évidence de
différents degrés de médicalisation (Conrad, 1992). Aussi indéniable soit-
elle (Faure, 1998), la médicalisation se révèle être un phénomène parfois
instable et porteur de tensions: les mouvements dont la convergence est
censée construire le processus de médicalisation sont réversibles et ne sont
pas forcément synchrones. Ils peuvent même parfois se désolidariser. Il en
est ainsi lorsque le développement du pouvoir médical ne repose pas sur
la mobilisation des savoirs de la médecine, mais sur la seule extension de
son autorité morale (Fassin, 2005; Fassin et Memmi, 2004). Il en va de
même quand, inversement, des compétences et des techniques médicales
sont mises en oeuvre, en dehors de l’identification d’une quelconque
pathologie, pour aider l’individu à se dégager des contraintes du biolo-
gique et l’accompagner dans la réalisation de lui-même.
Cette discordance entre les mouvements au travers desquels s’ac-
complit la médicalisation est susceptible de provoquer certaines tensions.
Alors que la congruence de ces mouvements contribue à ancrer l’inscrip-
tion d’une question dans la sphère médicale et à en assurer la pérennité, la
remise en question de l’un ou l’autre d’entre eux ou leur désynchronisa-
tion (Rosa, 2010) peut, au contraire, bouleverser la trajectoire du pro-
blème concerné qui résiste alors à tout cadrage stable. Soumise à des
forces contradictoires et privée d’une orientation directrice, son inscrip-
tion comme problème public se disperse et peine à se stabiliser.
La question trans, qui soulève aujourd’hui de vives controverses (2),
nous semble une question particulièrement heuristique pour aborder les
tensions au cœur des processus de médicalisation ainsi que les configura-
tions exploratoires de l’action publique qu’elles induisent. De fait, les
conflits et débats qu’elle suscite aujourd’hui recouvrent très largement des
(2) Dans un contexte de luttes définitionnelles, le vocabulaire utilisé est soumis à une
obsolescence rapide et il est l’objet de conflits très vifs. Chaque qualificatif employé
renvoie à une prise de position spécifique, réfère à des mondes différents et est régu-
lièrement sujet à polémique. Dans ce projet, nous utiliserons de manière indifférenciée
les termes qui nous semblent actuellement les plus génériques, soit : trans, personne
trans, personne transsexuelle. Sur les enjeux liés à l’usage des termes sur le terrain de
l’enquête, voir Hérault (2007) et Giami et al. (2011).
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

36 THOMAS BUJON, CHRISTINE DOURLENS
enjeux définitionnels. Plus précisément, ils concernent la pertinence de
son appréhension dans le registre du pathologique et questionnent les
conditions d’une médicalisation sans pathologisation.
Dans le contexte d’un encadrement normatif assez lâche et d’une
présence encore discrète de l’autorité publique, il n’existe aucun véritable
consensus sur la qualification de la question trans et sur ses modes de prise
en charge. L’incertitude est très forte et elle contraint les acteurs — per-
sonnes trans et médecins — à fabriquer, en temps réel, des réponses aux
situations problématiques qu’ils rencontrent. Les personnes trans, en effet,
lorsqu’elles revendiquent le droit à l’autodéfinition de soi, sont amenées à
interroger le rôle de la médecine, et à tenter d’en déplacer les frontières au
delà du pathologique et du curatif. Les médecins, directement confrontés
dans leurs pratiques quotidiennes aux déplacements des frontières entre le
normal et le pathologique, et aux situations d’indétermination qu’ils
engendrent, sont conduits à prendre en charge des questions morales et
politiques qui, d’ordinaire, n’interfèrent pas directement dans l’exercice
de leur profession. C’est donc bien sur le mode de « l’exploration »
(Callon et al., 2001) que la question trans est actuellement saisie par les
différents acteurs. Elle fait débat dans plusieurs espaces et à diverses
échelles et fait se rencontrer des acteurs qui agissaient habituellement dans
des mondes tout à fait étanches. Elle en fait émerger d’autres, modifiant
les positions, défaisant les coalitions au sein desquelles, à partir de la mise
en œuvre de pratiques diverses, de nouvelles définitions s’échafaudent et
se succèdent à un rythme rapide. Il convient donc de s’interroger sur la
manière dont l’incertitude définitionnelle qui caractérise la question trans,
écartelée entre médicalisation et dépathologisation, met les acteurs
concernés à
l’épreuve de la fragilité normative et les conduit à inventer, en situation,
l’action publique.
Cet article ponctue le premier moment d’une recherche amenée à se
déployer dans des espaces très divers où se construisent, parfois aux mar-
ges de la santé publique, des pratiques et des expertises dont l’articulation
avec les administrations politiques et les agences sanitaires restent à
décrire. Sur le plan méthodologique, ce programme ambitionne de suivre
— en temps réel — la trajectoire de la question trans en décrivant com-
ment les acteurs concernés — médecins de différentes spécialités médica-
les, militants du mouvement transgenre, experts en santé publique,
membres d’organisations internationales etc. — tentent de se saisir de
cette question et d’infléchir l’action publique. Nous interrogeons, depuis
deux ans maintenant, les acteurs de la prise en charge médicale du «trans-
sexualisme» en France. Cette enquête par entretiens semi-directifs et par
observation des conditions de prise en charge se déroule au sein d’une
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

LA TRAJECTOIRE INCERTAINE DE LA QUESTION TRANS 37
équipe médicale d’un centre hospitalier. Elle est complétée par une
enquête par entretiens semi-directifs auprès de personnes (auto)trans-
identifiées ou de personnes parties prenantes du mouvement transgenre.
Nous proposons, comme d’autres chercheurs avant nous (Hérault, 2007),
de développer une approche «symétrique» (Epstein, 2001) de la question
trans afin d’aborder la façon dont émergent et circulent diverses formes de
savoirs et d’expertises. Ainsi, cet article est largement programmatique et
propose une lecture de la trajectoire de la question trans en tant qu’elle fait
naître des formes inédites d’action publique.
La controverse trans
Depuis la fin du XIXesiècle et comme un grand nombre d’autres
« déviations » sexuelles, la transsexualité est envisagée sous un angle
essentiellement médical. Les hypothèses étiologiques successives dont
elle a fait l’objet — qu’elles privilégient l’explication organique ou psy-
chique — convergent vers une approche en termes de pathologie. Dans
cette perspective, toute personne née homme et se considérant comme une
femme ou inversement née femme et se considérant comme homme, et
qui souffre de cette discordance, doit pouvoir bénéficier d’une prise en
charge thérapeutique. Celle-ci a comme « objectif de rétablir la cor-
respondance sexe/genre nécessaire à l’équilibre mental et à l’intégration
sociale» (Macé, 2010 : 501). Néanmoins, à l’intérieur même de ce cadre
commun, diverses interprétations se confrontent. Si les interprétations
psychanalytiques, parmi lesquelles certaines considèrent la réassignation
hormono-chirurgicale comme une « réponse folle à une demande folle »
(Chiland, 2003 : 119), défendent la nécessité d’une démarche psychothé-
rapeutique, d’autres théories, notamment celles qui sont issues de la sexo-
logie clinique (3), défendent la voie de la transformation corporelle au
(3) De nombreux médecins psychiatres français ont pu élargir leur approche de la
sexualité et de la transsexualité en se formant dès les années 1970 à la sexologie cli-
nique qui connait un renouveau à l’époque (Giami et de Colomby, 2001). Par la suite,
de nombreuses recherches en sexologie (sex research) prolongeant en partie celle de
H. Benjamin — comme celle de R. Blanchard, par exemple — tenteront de renouve-
ler l’approche du transsexualisme en faisant de la sexualité un critère décisif d’inclu-
sion ou d’exclusion du processus de réassignation hormono-chirurgical. Sur les débats
internes et les rapports ambigus que la psychiatrie entretient avec la sexologie à pro-
pos des pathologies sexuelles et sexuées, voir Hérault (2010).
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%