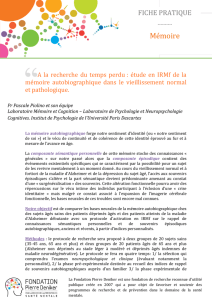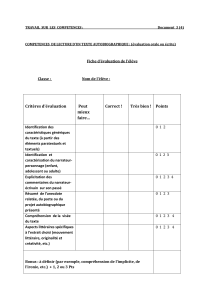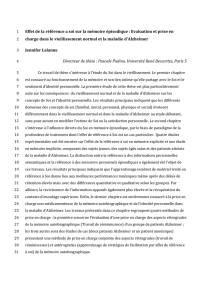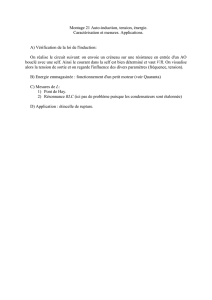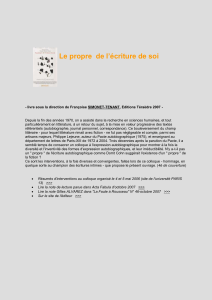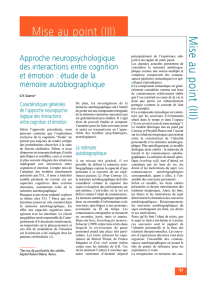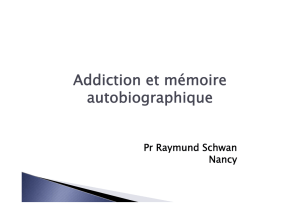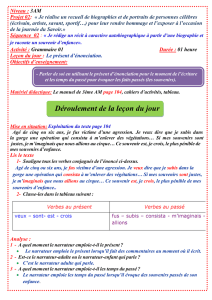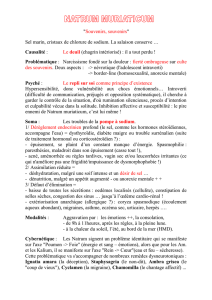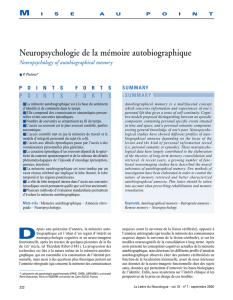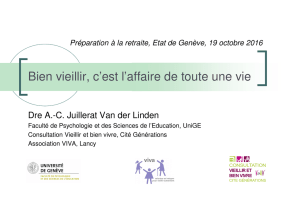A la recherche du self : théorie et pratique de la mémoire

© L’Encéphale, Paris, 2008. Tous droits réservés.
Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com
journal homepage: www.elsevier.com/locate/encep
2ème SESSION
A la recherche du self : théorie et pratique de
la mémoire autobiographique dans la maladie
d’Alzheimer
P. Piolino
CNRS FRE 2987, Laboratoire de Psychologie et Neurosciences Cognitives, groupe de recherche Mémoire et Apprentissage,
Université Paris Descartes,
Inserm-EPHE-Université de Caen-Basse Normandie, Unité E0218, Laboratoire de Neuropsychologie, CHU Côte de Nacre,
Caen, France.
Philosophes et psychologues ont longtemps débattu la na-
ture de la conscience de soi (self) et souligné sa relation
avec la mémoire. Parmi eux, William James fut l’un des
premiers à défi nir la conscience de soi par ses liens avec la
mémoire autobiographique : aussi loin que cette conscien-
ce peut remonter vers le passé, aussi loin s’étend l’identité
personnelle. C’est le souvenir des expériences vécues, en-
veloppé de « chaleur » et d’ « intimité », qui fonde l’iden-
tité du sujet. Depuis une vingtaine d’années plusieurs mo-
dèles théoriques en psychologie cognitive se sont intéressés
à défi nir les liens entre Self et mémoire autobiographique.
Plus récemment, les études en neuropsychologie se sont
penchées sur les troubles du self et de la mémoire auto-
biographique dans diverses étiologies et lésions cérébrales,
tant sur le plan de la séméiologie que sur celui des subs-
trats neuronaux [31]. La maladie d’Alzheimer, qui est la
plus fréquente des démences, pose de manière exemplaire
la question du lien entre l’atteinte du self et de la mé-
moire autobiographique. L’objet de cette présentation est
d’évoquer dans un premier temps des notions théoriques et
pratiques sur la mémoire autobiographique, un des aspects
essentiel du self, puis dans un second temps de présenter
les résultats des recherches en neuropsychologie sur la mé-
moire autobiographique dans le vieillissement normal et la
maladie d’Alzheimer.
Défi nition et modèles structuro-fonctionnels
de la mémoire autobiographique
La mémoire autobiographique est souvent considérée
comme la mémoire du self. Elle nous permet de répondre
à la vaste question, « qui suis-je » ? Toutefois, le self pré-
sente un aspect multidimensionnel qui dépasse les aspects
purement mnésiques. Beaucoup de types de processus
sont englobés dans le terme « self ». De fait, suivant les
auteurs, les défi nitions en sont très diverses [12]. Certaines
conceptions du self soulignent les diverses connaissances
que le sujet a de lui-même sur différents aspects de son
identité (physique, social, comportemental, ou émotion-
nel…), d’autres la notion de conscience phénoménologique
de soi ou de métacognition. Certains chercheurs comme
Northoff et Bermpohl [24] utilisent le terme self pour dé-
signer un ensemble de processus cognitifs de référence à
soi mis en jeu dans diverses activités cérébrales comme la
conscience, la perception ou encore la mémoire autobio-
graphique. Ces processus, de façon globale, sous-tendraient
l’implication commune d’un réseau cérébral médian impli-
quant à la fois le cortex préfrontal, le cortex cingulaire
et le précunéus. Ainsi, la mémoire autobiographique n’est
qu’un des aspects du self, quoique son aspect essentiel
d’après Conway et Pleydell-Pearce [8]. Qu’est-ce que la
Adresse e-mail : [email protected]
L’auteur n’a pas déclaré de confl its d’intérêts
L’Encéphale (2008) 34 Supplément 2, S77–S88

S78
mémoire autobiographique ? Nous en avons tous une idée.
Souvent, dans les esprits, la mémoire autobiographique,
c’est la « mémoire » par excellence. Celle qui nous permet
de conserver du passé des images chargées d’émotion, des
souvenirs de fêtes et de vacances en famille, et de chaque
moment clé de notre vie. Parmi les fonctions attribuées
à la mémoire autobiographique, la construction de l’iden-
tité personnelle et la poursuite des buts du sujet occupent
une place prépondérante. De plus, la mémoire autobio-
graphique cimente les interactions familiales et sociales
[3]. Ainsi, les patients atteints de diffi cultés importantes
de mémoire autobiographique ont dans la vie quotidienne
des troubles d’identité et des troubles du comportement.
Les modèles cognitifs proposent des défi nitions beaucoup
plus strictes de la mémoire autobiographique en resituant
cette dernière dans les modèles de la mémoire humaine.
La mémoire autobiographique est alors défi nie comme un
système mnésique servant à encoder, stocker et récupérer
un ensemble de représentations dont le « self » est le sujet
central. C’est une mémoire à très long terme qui possède
un rôle majeur dans la construction et le maintien de notre
identité.
Au sein des modèles contemporains de la mémoire hu-
maine, on a souvent associé la mémoire autobiographique
à la mémoire épisodique. La mémoire épisodique est une
mémoire à long terme, déclarative, qui permet l’acquisi-
tion et la rétention des événements personnellement vécus
et situés dans un contexte spatio-temporel précis ; et sur-
tout – c’est un point majeur dans la défi nition actualisée
- dont la récupération s’accompagne d’un rappel conscient
du contexte d’encodage [39]. Ainsi pour répondre au carac-
tère d’épisodicité, la récupération de l’événement doit im-
pliquer un voyage mental temporel au cours duquel l’évé-
nement est revécu avec les détails phénoménologiques qui
ont participé à l’étape de l’encodage. Elle est principale-
ment sous-tendue par le cortex préfrontal et le lobe tem-
poral médian. A cette mémoire s’oppose la mémoire sé-
mantique qui est une mémoire des mots, des concepts, des
idées, et plus largement de toute information, pourrait-on
dire, dès lors que la récupération de celle-ci s’effectue de
manière indépendante au contexte d’encodage. Tulving
[39] a proposé d’opposer deux états de conscience en lien
avec ces deux types de mémoire : la conscience autonoéti-
que qui s’accompagne d’un sentiment de reviviscence ; la
conscience noétique qui autorise uniquement un sentiment
de familiarité. Le self est l’une des trois caractéristiques,
avec le temps subjectif et la conscience autonoétique, qui
défi nit la mémoire épisodique comme mémoire des sou-
venirs autobiographiques inscrits dans un contexte spatio-
temporel précis. Le self refl ète l’implication du sujet dans
l’événement et sert de base à la prise de conscience de sa
propre identité. Les processus de stockage et de récupé-
ration liés au self sont considérés indépendants de la mé-
moire sémantique qui stocke des connaissances générales
ou personnelles décontextualisées. En somme, la notion de
self chez Tulving est celle d’un self phénoménologique lié
à la capacité de reviviscence des souvenirs autobiographi-
ques émaillés de détails phénoménologiques et spatiotem-
porels. Toutefois, la mémoire autobiographique comprend
aussi une part importante de mémoire sémantique. Celle-ci
peut être préservée chez les patients cérébrolésés tandis
que la part épisodique est souvent atteinte. Tulving lui-
même, à partir de l’étude de la mémoire autobiographique
d’un patient ayant un syndrome amnésique [40], remarque
que ce dernier demeure capable d’accéder à certains types
de connaissances sémantiques personnelles (les noms de
personnes de l’entourage, les adresses, les événements ha-
bituels…) alors qu’il se montre dans l’incapacité d’accéder
au souvenir du moindre événement particulier de son exis-
tence qui possède une quelconque spécifi cité spatiotempo-
relle et intensité émotionnelle. Ceci donnait à la mémoire
autobiographique de ce patient une teinte assez particuliè-
re, comme si la mémoire de son passé était impersonnelle.
L’observation de Tulving est une observation importante.
En effet, que nous suggère-t-elle ? Cette observation nous
suggère qu’avoir une mémoire autobiographique fonction-
nelle, nous conférant un sentiment d’identité et de cohé-
rence satisfaisants impose à la fois une préservation des
aspects sémantiques (en leur absence, il existe une perte
totale de l’identité à la manière de certains patients qui
ont perdu toute la mémoire de leur passé) mais aussi la ca-
pacité à revivre certains épisodes du passé qui ont pu être
importants pour nous, qui possèdent une coloration émo-
tionnelle, et enfi n à voyager mentalement vers le temps
subjectif.
Certains modèles de mémoire reprennent cette idée
d’une coexistence au sein de la mémoire autobiographi-
que d’aspects épisodiques et d’aspects sémantiques [8].
Notamment, le modèle de la mémoire du self de Conway
[7] est un modèle de reconstruction du souvenir autobiogra-
phique s’appuyant sur l’interaction entre trois systèmes :
le self de travail (« working self »), le self à long terme,
et le système de mémoire épisodique, qui permet de ren-
dre compte d’une organisation structurale hiérarchique de
la mémoire autobiographique et de son fonctionnement
(Fig. 1). Le self de Conway répond à une défi nition structuro
fonctionnelle assez différente de celle de Tulving puisque
les aspects conceptuels du self sont mis en avant et moins
les aspects phénoménologiques. Conway défi nit en effet le
self à long terme comme une véritable représentation sé-
mantique de nous-mêmes, une structure de connaissances
servant à organiser les souvenirs que nous avons de nos ex-
périences personnelles, un modèle d’intégrité et de cohé-
rence de notre propre soi. Le self de travail est constitué
par un ensemble complexe de processus de contrôle dirigés
par les buts actuels du sujet, ses désirs, et ses croyances.
Le self de travail peut être considéré comme un ensem-
ble de processus exécutifs liés aux lobes frontaux et au
Système Attentionnel Superviseur du modèle de Normann
et Shallice ou à l’administrateur central de la mémoire de
travail de Baddeley. Il contraint à la fois l’encodage et la
construction des souvenirs sur la base de deux principes : la
correspondance et la cohérence [6]. D’une part, il permet
d’encoder les expériences vécues correspondant aux buts
activés et, d’autre part, il maintient une représentation
stable et cohérente de l’interaction du self avec le monde,
permettant ainsi un sentiment continu d’identité. En vertu
de ces principes, les buts du self de travail infl uencent la
P. Piolino

S79
construction des souvenirs en modulant l’accessibilité de
certaines représentations.
Le self à long terme est une structure de connaissances
sémantiques personnelles à différents niveaux d’abstrac-
tion qui comprend le self conceptuel et la base des connais-
sances autobiographiques. Le self conceptuel regroupe les
connaissances sémantiques personnelles les plus abstraites
qui spécifi ent les scripts personnels, les catégories d’ap-
partenance et les schémas socialement établis, les images
de soi possibles ou désirées, et génèrent ainsi les attitudes,
les valeurs, les croyances. Il peut être décrit sous forme
de règles orientant les contenus de la base de connaissan-
ces autobiographiques. Celle-ci abrite des connaissances
générales organisées de façon hiérarchiques en trois ni-
veaux d’abstraction emboîtés (schémas de vie, périodes de
vie, évènements généraux) et constitue la principale voie
d’accès aux souvenirs épisodiques autobiographiques. Les
schémas de vie renvoient à des informations très généra-
les sur l’histoire globale de l’individu (e.g. le travail, la
famille…). Ils s’appuient notamment sur des conventions
sociocognitives à propos de l’ordre et des thèmes domi-
nants du schéma de vie classique de la culture d’appar-
tenance de l’individu. Les périodes de vie sont associées
à des connaissances sur des buts et des activités liées à
de longues durées (e.g. lieux et personnes liés la période
scolaire). Enfi n, les événements généraux correspondent à
des connaissances liés temporellement ou organisés autour
d’un thème commun sur des événements répétés (e.g.
« les cours de sport ») ou étendus d’une durée supérieure
à 24 heures (e.g. « le voyage linguistique à Nuremberg »)
et se mesurent en jours, semaines ou mois. Le système de
mémoire épisodique sous-tend le niveau de spécifi cité le
plus élevé (e.g. « la cueillette des cèpes avec Gunther et
Jeannette dans la forêt noire ») et stocke des informations
de brève durée (quelques secondes, minutes ou quelques
heures au maximum). Il permet de retenir des informations
sur les activités reliées aux buts actuels (présent psycholo-
gique) et contient donc des détails sensoriels, perceptifs,
cognitifs et affectifs liés à l’évènement et organisés selon
un ordre chronologique. Il implique l’imagerie mentale et
une expérience de reviviscence du passé qui s’apparente à
la conscience autonoétique de Tulving. La nature épisodi-
que d’un souvenir dépend de l’accès à ce niveau de détails,
sans quoi les souvenirs restent génériques (sous-spécifi és).
Un accès direct au souvenir spécifi que est possible dans
certains cas où l’existence d’indices perceptivo-sensoriels
très proches de la situation d’encodage conduit immédia-
tement à la reviviscence de l’événement autobiographique
en dispensant des différentes étapes de la recontextuali-
sation. Tout le monde connaît l’épisode de la « madeleine
de Proust ». Dans la majorité des cas cependant, les souve-
nirs autobiographiques épisodiques sont des constructions
mentales transitoires établies par le self de travail défi ni
par l’installation d’un but, sa valence, et l’allocation de
ressources exécutives. Ces processus favorisent préféren-
tiellement l’accès indirect aux souvenirs épisodiques par
l’intermédiaire de l’activation de connaissances séman-
tiques pertinentes à l’action en cours (présent psycholo-
gique) afi n de permettre la résolution de l’activité pour
atteindre des buts actuels et actifs. Ainsi, le système de
mémoire du self facilite l’accès aux représentations sup-
portant le soi et les buts actuels ou distord, voire inhibe,
les représentations en désaccord avec le soi et ses buts afi n
d’éviter un état de dissonance et les affects négatifs qui en
résulteraient. Il existe un phénomène de rétroaction entre
le type de souvenir auquel on accède et le self : autrement
dit, les souvenirs auxquels on accède confortent notre mo-
dèle de soi. Lorsque des patients, en situation pathologi-
que, accèdent à des souvenirs de mauvaise qualité, ou pri-
vilégient des souvenirs avec une valence négative comme
cela est le cas dans la dépression, ils confortent une image
négative d’eux-mêmes. Le cycle de récupération de souve-
nirs négatifs se voit renforcé alors que l’accès aux souve-
nirs à valence positive se fait de plus en plus rare et à un
niveau plus générique [19]. La mémoire autobiographique
est donc une mémoire mouvante se reconstruisant en per-
manence, tout à fait différente d’une mémoire cristallisée.
Ainsi, lorsqu’un sujet âgé ou un patient va rapporter inlas-
sablement le même souvenir, il ne s’agit pas à proprement
parler d’un souvenir autobiographique, mais plutôt d’un
schéma, d’un script qui caractérise son passé mais n’a pas
le caractère d’une reviviscence épisodique.
Souvenirs autobiographiques
Le Self à Long terme
Système
de Mémoire
Episodique
Connaissances
Autobiographiques
Le Self
Conceptuel Self de travail
Fonctions
exécutives
Shéma
Historique
Personnel
Périodes
de vie
Evénements
Généraux
Script personnel
Self possible
La croyance
Image
sensorielle
A la recherche du self : théorie et pratique
Figure 1 Schéma du modèle de la mémoire du self (adapté de 7).

S80
La distribution temporelle est un autre des aspects in-
téressants de la mémoire autobiographique. Plusieurs sou-
venirs épisodiques seraient formés chaque jour, mais tous
ne résisteraient pas au passage du temps, seuls les plus
pertinents (en fonction des buts actuels de l’individu) étant
retenus. Dès lors qu’ils sont sans importance et sans carac-
tère émotionnel particulier, la plupart de nos expériences
vécues sont oubliées au même titre qu’une liste d’items
apprise en situation de test. De plus, dans la vie quotidien-
ne, la fréquence de répétition des événements similaires
détermine une transition de la mémoire épisodique vers
la mémoire sémantique par un processus de sémantisation
[5] : la capacité de rappel des circonstances épisodiques
de chaque événement s’efface au profi t du rappel des ca-
ractéristiques communes. Ainsi pour une grande part, la
mémoire sémantique personnelle est issue d’un processus
d’abstraction à partir de souvenirs épisodiques et de ce
fait, les processus de stockage (comme les processus de
récupération) des représentations mnésiques épisodique ou
sémantique sont nettement moins indépendants que ne le
suggère le modèle de Tulving. Certains événements spéci-
fi ques vont être conservés dans les détails tout au long de
la vie car ils sont marquants dans la constitution de notre
self et représentent un changement de but. Ces souvenirs
épisodiques défi nissant le soi (Self-Defi ning Memories, [6])
sont caractérisés par la densité des images mentales et des
affects, le haut niveau de répétition du souvenir, le lien
avec des souvenirs qui partagent le même thème central
pour l’individu, et l’accessibilité. Concernant les souvenirs
autobiographiques épisodiques, la distribution temporelle
observée avec la méthode des mots-indices (voir infra)
comporte trois phases distinctes [35] : la fonction de ré-
tention, l’amnésie infantile et, à partir de la quarantaine,
le pic de réminiscence (Fig. 2). La fonction de rétention
concerne les souvenirs des vingt dernières années et cor-
respond à une courbe d’oubli classique au cours du temps
avec un effet de récence marqué. L’amnésie infantile
caractérise la pauvreté du rappel des événements vécus
avant l’âge de 4-5 ans, avec une absence presque totale de
souvenirs des trois premières années de vie [33]. Le pic de
réminiscence correspond à la supériorité du rappel des sou-
venirs encodés à l’adolescence et à l’âge de jeune adulte
(entre 10 et 30 ans) par rapport aux autres périodes du
passé. Ce phénomène observé dans les souvenirs anciens
a beaucoup intrigué les chercheurs. Quelle explication en
donner ? L’explication du phénomène n’est pas consensuel-
le. Certains auteurs invoquent un mécanisme d’encodage
spécifi que et, d’autres, un mécanisme particulier de récu-
pération puisque cette période de vie fournit des indices de
rappel particulièrement effi caces (« le jour du mariage »).
Mais l’explication la plus probable est celle liée au Self.
Cette période de vie déterminante pour la construction
et le maintien du sentiment d’identité dépendrait de l’in-
fl uence des intérêts et des buts personnels les plus stables
qui continueraient d’exercer une infl uence tout au long de
la vie [6]. En revanche, si la distribution temporelle des
connaissances sémantiques personnelles est marquée par
la même courbe d’oubli, il existe ensuite l’installation d’un
plateau, ce qui signifi e qu’à partir d’un certain moment
(5 à 10 ans après l’encodage), dès lors qu’une information
est conservée, elle le sera toujours.
Certaines recherches se sont intéressées à déterminer
le substratum neuronal de la mémoire autobiographique.
Les activations cérébrales sont enregistrées en tomogra-
phie par émission de positons (TEP) ou en imagerie par
résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) lorsque des su-
jets sains évoquent mentalement des souvenirs personnels
à partir d’indices (des mots, phrases ou photographies) ou
bien les reconnaissent. Ces études de neuroimagerie fonc-
tionnelle mettent en évidence l’implication d’un vaste
réseau cérébral frontal, temporal, et postérieur. Les ré-
gions frontotemporales notamment gauches semblent
impliquées dans les processus contrôlés de reconstruc-
tion du souvenir et les régions plus postérieures dans la
production des images mentales associées aux souvenirs
(pour revue, 27). Les études en électrophysiologie (EEG)
fournissent des données complémentaires en précisant le
décours temporel des réponses cérébrales dans ce vaste
réseau. Les travaux de Conway et al. [7] ont montré que
les changements de potentiels corticaux ont lieu dans le
réseau frontal gauche lors de la phase d’initiation d’ac-
cès au souvenir, puis dans les réseaux plus postérieurs lors
de la phase de reconstruction par les connaissances géné-
rales (lobe temporal gauche) et la phase de reviviscence
Figure 2 Distribution temporelle des souvenirs autobiographiques épisodiques chez un sujet âgé de 50 ans (d’après 36).
0 10 20 30 40 50
·
·
·
·
·
Durée de rétention (ans)
(1) La fonction de rétention:
déclin du nombre de souvenirs au cours du temps
(2) Le pic de réminiscence:
grand nombre des souvenirs encodés entre l'âge de 10 et 30 ans
(3) L'amnésie infantile:
quasi absence de souvenirs encodés avant l'âge de 3 - 4 ans
0 10 20 30 40 50
3
·
·
·
·
·
2
1
%
P. Piolino

S81
des détails spécifi ques (régions bilatérales temporales et
postérieures). Plus spécialement, le rôle de l’hippocampe
dans le travail de reconstruction de souvenirs anciens fait
actuellement débat. Certains auteurs postulent que l’hip-
pocampe interviendrait dans l’encodage et la récupération
des souvenirs récents (durant quelques années) mais ne
serait plus sollicité dans la récupération des souvenirs an-
ciens [2]. D’autres pensent que l’intervention de l’hippo-
campe est indispensable dans la récupération de souvenirs
autobiographiques, peu important leur ancienneté, pourvu
qu’ils soient épisodiques [22]. Dans l’ensemble, les résul-
tats des études confortent ce dernier modèle. Cependant,
ces recherches présentent souvent des limites méthodolo-
giques puisque les sujets rappellent ou reconnaissent des
événements personnels anciens qu’ils ont évoqués peu de
temps avant l’enregistrement en TEP ou IRMf, ce qui gé-
nère une réactivation des traces mnésiques anciennes dans
le système hippocampique. Pour pallier ce biais méthodo-
logique, nous avons réalisé dans le laboratoire de neuropsy-
chologie et neuroimagerie fonctionnelle de l’Inserm à Caen
des études où les sujets devaient évoquer des souvenirs
autobiographiques récents et anciens, non réactualisés, à
partir d’indices personnalisés [28, 41]. Par ailleurs, la natu-
re épisodique de chaque souvenir était strictement contrô-
lée. Chez des femmes âgés de 60 à 75 ans, nous avons pu
tester les souvenirs de cinq périodes d’encodage recou-
vrant l’ensemble de leur vie (0/17 ans, 18/30 ans, plus de
30 ans, cinq dernières années, 12 derniers mois) à partir
d’indices (« la visite de la tour de Pise ») recueillis à l’aide
de leur conjoint. Toutes périodes confondues (analyse de
conjonction), les résultats ont montré l’activation en IRMf
d’un réseau cérébral commun impliquant principalement
des régions frontales gauches, et d’autres régions jouant
un rôle dans l’imagerie mentale comme le précunéus et
dans la récupération en mémoire épisodique comme le cin-
gulaire postérieur. Donnée plus intéressante, quelle que
soit la période de vie explorée, nous avons démontré une
activation hippocampique (d’autant plus bilatérale que les
périodes de vies étaient plus riches au niveau de la revi-
viscence des détails phénoménologiques et contextuels)
en accord avec l’hypothèse du rôle permanent de l’hippo-
campe dans les souvenirs autobiographiques. L’implication
de ce large réseau rend compte des différentes origines
cérébrales possibles des troubles de la mémoire autobio-
graphique : hypométabolismes fonctionnels et lésions cé-
rébrales de topographie variable voire dysconnexions céré-
brales, notamment fronto-temporales. D’après le modèle
de Conway, le travail de reconstruction du souvenir dans sa
pleine spécifi cité peut s’arrêter au cours d’une étape inter-
médiaire, pour différentes raisons. Les sujets ne vont alors
évoquer que des souvenirs très généraux sans pouvoir ac-
céder aux détails spécifi ques et phénoménologiques. C’est
le cas dans de nombreuses pathologies neurologiques ou
psychiatriques comme la maladie d’Alzheimer ou la dépres-
sion. Différentes causes peuvent rendre compte de cette
incapacité à effectuer un travail de reconstruction parmi
lesquelles un trouble de la mémoire de travail (altération
de la fonctionnalité liée à un dysfonctionnement frontal),
un défi cit de la mémoire sémantique (liée à un dysfonction-
nement temporal entravant l’accès aux détails spécifi ques)
et un défi cit de la mémoire épisodique (liés à un dysfonc-
tionnement hippocampique ou des régions impliquées dans
l’émotion et l’imagerie mentale entravant la reviviscence
des détails phénoménologiques et contextuels). Un même
défi cit constaté lors d’épreuves psychométriques (accès à
des souvenirs généraux et non spécifi ques) peut alors ré-
pondre à une grande variété de mécanismes neurocognitifs
(eg . « la démence frontotemporale, [21, 25] »).
Méthodes d’évaluation de la mémoire
autobiographique
Évoquons maintenant les méthodes d’évaluation de la mé-
moire autobiographique. Les tests dont dispose le clinicien
sont relativement assez nombreux, de ceux portant sur
des mots indices aux fl uences verbales autobiographiques
ou aux questionnaires (pour revue, [31]). La méthode des
mots-indices élaborée par Crovitz et Schiffman [9], à partir
de la méthode développée par Galton en 1883, consiste à
présenter successivement des mots (bébé, chat…) et à de-
mander au sujet d’évoquer le premier souvenir personnel
qui lui vient à l’esprit, puis de le dater (pour une version
récente de ce test, voir [16]). L’épreuve de fl uence verbale
autobiographique proposée à l’origine par Dritschel et al.
[11] consiste à énumérer en un temps donné (par exemple
60 secondes) deux catégories d’informations autobiographi-
ques, l’une sémantique (noms de personnes de l’entourage)
et l’autre épisodique (événements personnels) provenant
de plusieurs périodes (pour une version de fl uences auto-
biographiques en 2 minutes avec des normes françaises,
voir [31]). Dans la catégorie des questionnaires, le ques-
tionnaire AMI de Kopelman et al. [18] est le plus utilisé. Il
porte d’une part sur le rappel d’informations sémantiques
personnelles (noms de personnes, adresses…) et d’autre
part sur le rappel de souvenirs d’événements autobiogra-
phiques spécifi ques provenant de trois périodes distinctes :
l’enfance et l’adolescence, l’âge de jeune adulte, le passé
récent. Le Test Épisodique de Mémoire du Passé autobio-
graphique (TEMPau, [26, 27, 31, 32]) est un autre question-
naire qui propose des critères particulièrement stricts pour
évaluer la nature épisodique des souvenirs autobiographi-
ques. Il permet de distinguer les aspects sémantiques des
aspects épisodiques qui sont les seuls caractérisés par la
capacité à revivre mentalement des événements spécifi -
ques avec des détails phénoménologiques et contextuels.
Pour cinq périodes de vie (0/17 ans, 18/30 ans, plus de
30 ans, cinq dernières années, 12 derniers mois), le sujet
doit évoquer un événement spécifi que (unique, inférieur à
24 heures, situé dans le temps et l’espace et détaillé) pour
chacun des 4 thèmes de rappel proposés (une rencontre,
un événement professionnel, familial et un déplacement).
Pour la période récente, 8 thèmes sont proposés au lieu
de 4 permettant de tester la restitution des événements
vécus en fonction de l’intervalle de rétention. L’organisation
générale du test (périodes testées, thèmes explorés, exem-
ples d’indices) et des normes sont présentées Tableaux 1
et 2. Chaque souvenir évoqué est contrôlé lors d’un retest
A la recherche du self : théorie et pratique
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%