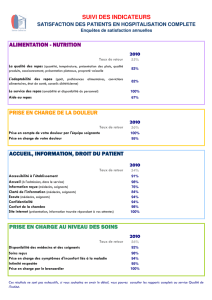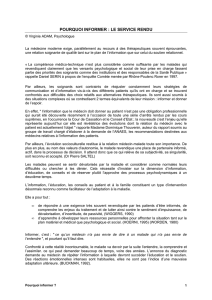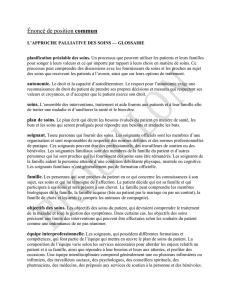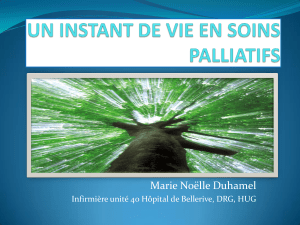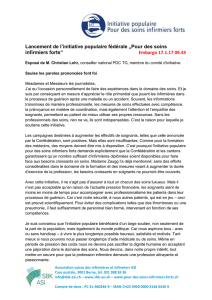Un asservissement pathogène - Pratiques, les cahiers de la

Un asservissement
pathogène
33 OCTOBRE 2009 47 PRATIQUES
Tous les observateurs s’accordent à
mettre en cause l’organisation du travail dans la
souffrance exprimée par les travailleurs. La
mobilité instaurée dans la philosophie de
l’entreprise, mais aussi la complexification des
tâches imposées, les cadences trop élevées, le
management par des cadres polyvalents et
incompétents, les pressions des institutions ou des clients se traduisant par des injonc-
tions paradoxales aux salariés aggravent leurs conditions de travail. A fortiori, le déni
par les entreprises de cette souffrance, associé à un renforcement de la culpabi-
lisation du travailleur souffrant, en renvoyant le problème à la sphère privée,
l’empêche de se saisir des arguments inscrits dans les lois du travail.
Les employeurs, pressés par le marché ou les institutions qui les mandatent,
se comportent en bourreaux et organisent le travail sur un mode guerrier.
Les institutions se transforment en systèmes d’oppression en toute
inconscience des effets produits tant sur les personnes que sur les
résultats.
Nous assistons à une dégradation généralisée de la qualité du
travail en même temps que de ses valeurs, contribuant à dépos-
séder les acteurs du sens même d’une part conséquente de
leur vie.
DOSSIER
La violence faite au travail

34
PRATIQUES 47 OCTOBRE 2009
DOSSIER
Le travail, angle
mort de la réforme
Les nouvelles méthodes managériales du travail entraînent des souffrances
qui ne seront pas prises en compte dans la réforme du système de santé.
Frédéric Pierru, sociologue, CNRS, Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales (IRISSO), Paris IX
Il peut sembler paradoxal qu’à l’heure de la célé-
bration de la valeur « travail », les conditions dans
lesquelles il est réalisé soient quasiment absentes des
vifs débats publics autour du système de santé et de
sa réforme. Certes, le slogan du « travailler plus
pour gagner plus » ne doit pas abuser ; il renvoie davan-
tage à l’utopie (néolibérale) d’une société de pleine
activité – dans laquelle l’activité, si dégradés soient
son statut, sa rémunération, ses conditions de réa-
lisation, est toujours préférable à l’inactivité de
l’« assisté » – qu’à la volonté de revenir à une société
de plein emploi, dans laquelle le travail, à plein
temps, est le support de solides droits sociaux et poli-
tiques 1. Néanmoins, une telle absence surprend. En
effet, les dix dernières années ont vu le thème long-
temps refoulé de la dégradation des conditions de
travail acquérir une publicité indéniable, même si
c’est très souvent sous des formes d’expression indi-
viduelles et pathologiques (le « harcèlement moral »,
etc.) qui font obstacle à la saisie de ses causes sociales
et organisationnelles. Cependant, cette publicité
nouvelle ne semble guère avoir atteint le débat
public sur la croissance des dépenses de santé. Seuls
les initiés savent, par exemple, que la branche
AT/MP verse une somme forfaitaire à la branche mala-
die du régime général au titre de la non ou sous-décla-
ration des maladies professionnelles et des accidents
du travail, légalement pris en charge par les cotisa-
tions des seuls employeurs. Tout se passe comme si,
une fois encore, les entreprises s’efforçaient d’exter-
naliser les coûts d’entretien et de « réparation » de
la main-d’œuvre vers les salariés eux-mêmes, ainsi som-
més de prendre financièrement en charge les consé-
quences sur leur santé de l’intensification du travail,
dont le coût social a été évalué à environ 3 % de la
richesse nationale 2! Une telle somme (56 milliards
d’euros pour 2007 !) devrait quand même se retrou-
ver pour partie dans le fameux « trou de la Sécu »,
au titre de la prise en charge, par exemple, des trou-
bles musculo-squelettiques (dont le nombre explose),
des dépressions (idem.) ou encore des cancers
professionnels, dont on sait qu’ils sont très largement
sous-estimés. Pourtant, quand il s’agit de lutter
contre la « dérive » des dépenses, rien, ou si peu, ne
concerne la prévention et l’amélioration des condi-
tions de la santé au travail. Pire, lorsqu’est invoquée
la forte croissance du poste des indemnités journa-
lières, c’est pour mieux stigmatiser les « abus » et les
« fraudes » de français décidément paresseux ou tire-
au-flanc, lovés dans les plis douillets d’un État
providence obèse qu’il conviendrait de soumettre
à une diète rigoureuse. Autrement dit, au lieu d’at-
tirer l’attention sur une des causes majeures de la
progression des dépenses de santé, le thème de la
forte augmentation des indemnités journalières
sert, au contraire, à remettre en cause les protections
du travail, les protections sociales (franchises,
augmentation de tickets modérateurs, etc.) comme
les protections juridiques (« assouplissement » du
code du travail). Un tel retournement anti-social est
aussi observable en ce qui concerne les conditions
de travail des personnels de santé, hospitaliers en
particulier.
Les personnels hospitaliers victimes
de la bureaucratie ?
Certes, les nombreux rapports officiels qui ont pré-
paré la dernière réforme de l’hôpital évoquent le
découragement et la démotivation des personnels
– ce qui se traduit concrètement par l’augmentation
tendancielle de l’absentéisme, des conflits sur le lieu
de travail, voire des démissions – ainsi que les mul-
tiples expressions, individuelles et collectives, des souf-
frances au travail. Mais cette évocation, loin d’amener
leurs auteurs à s’interroger sur la dégradation des
conditions de travail, est au service d’un récit moder-
La violence faite au travail U
§Bureaucratie,
§Conditions de travail,
§Personnel soignant,
§Hôpital

nisateur dans lequel les personnels hospitaliers
seraient d’abord les victimes, souvent consentantes,
de la bureaucratie hospitalière. Les rigidités « bureau-
cratiques », voilà la cause véritable des problèmes ren-
contrés par les soignants. L’insuffisance de moyens
humains, matériels et financiers, les rémunérations
peu attractives, la dérégulation, en amont, de la
médecine de ville qui engorge l’hôpital en aval,
l’empilement des réformes, source d’injonctions
contradictoires et d’attentisme, la « politique » (si
tant est que ce mot ait un sens en France) désastreuse
de régulation de la démographie des soignants ne
rentrent finalement que très peu en ligne de compte
et des enjeux réels de politiques publiques 3», celles
qui circulent dans des cénacles de plus en plus
internationalisés.
Moins de statuts (protecteurs), moins de règles,
moins de promotions à l’ancienneté, moins de hié-
rarchie et plus de contrats, plus d’évaluations, plus
de « souplesse » dans l’affectation des agents qui se
doivent de cultiver leur « polyvalence » et leur
« flexibilité », plus de rémunération au mérite, plus
de management par objectif : telle est la nouvelle pana-
cée. On comprend le désarroi de ces grands réfor-
mateurs lorsqu’ils voient celles et ceux qu’ils veulent
« libérer », « dynamiser », « récompenser », « épa-
nouir », « motiver », « mobiliser »… se mobiliser, en
effet, mais contre leurs préconisations pourtant
censées vouloir leur bien. Serait-ce là pur maso-
chisme ? Ou alors une énième manifestation de ces
fameuses « résistances au changement » qui servent
d’explication passe-partout lorsqu’on est confronté
à l’échec ? Ou, bien plutôt, ces refus répétés sont-ils
motivés par de vraies raisons, des raisons non
« rationnelles » du point de vue gestionnaire, mais
pourtant « raisonnables » au sens de justifiées et jus-
tifiables ? C’est ici que le sociologue est sociale-
ment utile : loin de se satisfaire du discours de la
hiérarchie des porte-parole autorisés du changement
nécessairement positif, nécessaire car positif, il va voir
de quoi il en retourne vraiment dans le monde
social et tente de donner un sens à ces refus, à ces
résistances, à ces mobilisations. Or, en l’espèce, du
côté de l’AP-HP, qu’observe-t-il ?
Vers la déshumanisation de l’hôpital
par la gestion ?
Ne nous attardons pas sur l’augmentation des
cadences, liée à l’effet ciseaux entre, d’un côté,
des services hospitaliers (et surtout les plus généra-
listes d’entre eux) qui font figure d’ultimes recours
pour des catégories modestes « chassées » de la méde-
cine de ville où les soins sont de moins en moins bien
pris en charge par l’Assurance maladie (dépassements
d’honoraires, franchises, etc.) et, de l’autre, des pénu-
ries locales de personnels ainsi que des ressources
insuffisantes. Les personnels soignants sont confron-
tés, comme les salariés des entreprises, au renfor-
cement des contraintes organisationnelles, sur les
délais et les rythmes, rendant le travail moins pré-
visible et moins maîtrisable, donc potentiellement
source de souffrances psychosociales. Tant que ces
cadences accrues leur donnaient le sentiment de pou-
voir préserver la qualité des soins dispensés aux
patients, elles demeuraient supportables. Mais le ren-
forcement continu des contraintes budgétaires
met à mal cet arbitrage : nombreux sont les soignants
qui estiment aujourd’hui ne plus avoir les moyens
de respecter a minima leurs normes professionnelles,
bref de pouvoir faire du « bon boulot ». Pire, l’im-
mixtion, au cœur de la relation soignante, de critères
de « rentabilité », avec la T2A, est perçue comme
35 OCTOBRE 2009 47 PRATIQUES
DOSSIER
UN ASSERVISSEMENT PATHOGÈNE
2
…/…
Les rigidités bureaucratiques,
voilà la cause véritable des
problèmes rencontrés par les
soignants.
pour expliquer la « crise » de l’hôpital. Aussi, point
n’est besoin d’augmenter les moyens financiers,
comme l’a rappelé le président de la République au
début de l’année 2009, qu’il juge suffisants. La
solution est à rechercher plutôt dans une meil-
leure organisation de l’hôpital, qui lui permettrait
d’entrer dans l’ère de la modernité des organisations
« flexibles », « responsables », « autonomes », « dyna-
miques », « gérées » de façon « optimale ». Bref, il
faut faire de l’hôpital une entreprise, libre de s’or-
ganiser, libre de recruter, libre d’affecter ses moyens
humains et matériels en fonction du « marché » local
de soins, avec à sa tête un vrai « patron » et un vrai
« conseil d’administration ». Il peut paraître étrange
que les réformateurs prennent comme modèle,
pour moderniser les services publics, les entreprises
alors même que les enquêtes des économistes, des
sociologues, des ergonomes aboutissent à la même
conclusion : la réorganisation des entreprises au cours
des années 1980 et 1990 a été synonyme, pour les sala-
riés, de pressions accrues en matière de productivité
et de performance, d’individualisation du rapport
au travail, d’insécurités grandissantes, d’injonctions
contradictoires, de stress, etc. qui, in fine, ont par-
ticipé de la montée des souffrances au travail,
notamment de nature psychosociale. Le fait est
que ceux qui pensent ces réorganisations, dans le privé
comme dans le public, connaissent de moins en moins
la réalité du travail des salariés. Les rapports qui ins-
pirent les réformes de l’hôpital sont ainsi rédigés par
de grands architectes de plus en plus ignorants du
vécu des agents opérationnels et qui, ainsi libérés du
principe de réalité, peuvent donner libre cours à leurs
« visions hyper-rationnelles et idéales de la réorga-
nisation, mais largement coupées des réalités admi-
nistratives, des cultures des administrations fusionnées

“
36
PRATIQUES 47 OCTOBRE 2009
DOSSIER
un grave facteur de corruption de l’éthique profes-
sionnelle. Le patient devient un coût (qu’il faut trans-
férer à d’autres) ou une source de revenu (qu’il faut
à tout prix conserver). Dans tous les cas, il se voit don-
ner un prix, une valeur monétaire, qui le rend
plus ou moins intéressant, car rentable. C’est une
véritable révolution, car pendant longtemps coexis-
taient à l’hôpital deux hiérarchies, médicale et
administrative, qui s’efforçaient de coexister paci-
fiquement. Dans le meilleur des cas, les « adminis-
tratifs » se battaient contre la tutelle pour arracher
les moyens demandés par les soignants. Reste que
les questions d’argent pénétraient assez peu l’uni-
vers des services hospitaliers. Avec la T2A, tout
change. Univers médical et univers gestionnaire ten-
dent à fusionner. Les soignants doivent faire eux-
mêmes les arbitrages gestionnaires, et, au besoin,
rationner les soins, car il en va de la « rentabilité »
de leur pôle. On comprend que la charge psycho-
logique et morale de leur travail s’en est trouvée consi-
dérablement alourdie.
Ce contexte de « flux tendus » et de montée en
puissance des impératifs gestionnaires aboutit à
transformer profondément le rapport que les soi-
gnants entretiennent avec leurs missions. Ainsi,
Philippe Askenazy montre que si les infirmières
déclarent de plus en plus porter de « charges
l’emploi, bref un « pion » (un terme qui revient
souvent au cours des entretiens) dans un jeu dont
les règles, obscures et changeantes, sont définies
par des puissances de plus en plus lointaines
(direction, tutelle). On pourrait multiplier les
exemples d’un phénomène qui touche aussi les
relations entre collègues. Dans tous les cas, la réi-
fication transforme les sujets en objets, rend tou-
jours plus hypothétiques l’engagement et l’inves-
tissement dans la relation de soins, de care disent
les anglo-saxons, qui lui sont pourtant indispensa-
bles. Au contraire, la rationalité gestionnaire sup-
pose un certain détachement, non seulement à
l’égard du service et des collègues (il faut savoir
être « polyvalent » et accepter les réaffectations),
mais aussi à l’égard du patient, qui devient un coût
à minimiser ou une ressource à maximiser.
Plus généralement, l’empilement désordonné des
indicateurs, des règles, des outils de gestion (T2A,
assurance qualité), des protocoles, autant d’ins-
truments censés instiller plus de « rationalité
économique », de « prévisibilité », de « qualité », vien-
nent violemment percuter des mondes profession-
nels longtemps dominés par les valeurs d’engagement,
de vocation, d’autonomie, d’auto régulation. La
culture de l’oral doit céder le pas à celle de la « tra-
çabilité » écrite. Celle de l’autocontrôle à celle de l’éva-
luation, non seulement en fonction de la « qualité »
(telle que définie par les spécialistes de la qualité, les
« qualiticiens »), mais aussi du coût des soins.
Contrairement à ce que prétendent les réformateurs,
l’entrée en gestion de l’hôpital ne peut que se tra-
duire par la bureaucratisation croissante du contexte
de travail, laquelle donne le sentiment aux soi-
gnants d’être dépossédés de la maîtrise des condi-
tions matérielles et même du sens de leur activité.
On retrouve ici le paradoxe de la modernité magis-
tralement identifié par le sociologue Max Weber :
le prix à payer pour une plus grande efficacité ou
rationalité (économique) des activités sociales est
celui du « désenchantement du monde », de la
« perte de sens » pour les individus. Dans toutes les
organisations, publiques et privées, le renforce-
ment des contraintes de compétitivité (pour le
privé) ou d’équilibre budgétaire (face à une
demande croissante, pour le public) à court terme
s’est traduit par une seconde vague de rationalisa-
tion du travail afin d’en augmenter la productivité 6.
Les promesses non tenues de
la « modernité » managériale
Bien que le « nouvel esprit du capitalisme 7» ait reven-
diqué les valeurs de l’autonomie et de la flexibilité
dans un travail qui s’effectuerait désormais en
équipe et/ou en réseau, la réalité à laquelle ont été
confrontés de nombreux salariés, dans les hôpi-
taux notamment, a été toute autre : hausse de la quan-
tité de travail, par ailleurs de plus en plus complexe,
pression temporelle, injonctions contradictoires,
La violence faite au travail U
…/…
Les personnels soignants sont
confrontés, comme les salariés
des entreprises, au renforcement des
contraintes organisationnelles.
lourdes », c’est parce que les patients sont désor-
mais perçus par elles en ces termes, ce qui atteste
de souffrances éthiques et de la difficulté à entre-
tenir de bonnes relations soignant-soigné 4. Nos
propres enquêtes mettent en évidence un phéno-
mène que le sociologue Axel Honneth a appelé le
« déficit de la reconnaissance », corollaire de la
« réification » qui « conduit à se percevoir ainsi
qu’à percevoir les partenaires de leurs interactions
et les biens de l’échange sur le modèle d’objets, et
donc à se rapporter à leur monde environnant
d’une façon qui, là encore, est uniquement celle
de l’observation » 5. Ainsi le patient, normalement
sujet d’attention et d’investissement de la part des
soignants, devient un objet « lourd », bref une
« charge » voire même, s’il refuse de se plier aux
impératifs du processus de production, un « pro-
blème » source de désorganisation pour le service.
De même, la « réification » renvoie au sentiment
de l’infirmière de ne plus être considérée par sa
hiérarchie comme une personne, mais comme
une « ressource humaine » dont il faut optimiser
1
/
4
100%