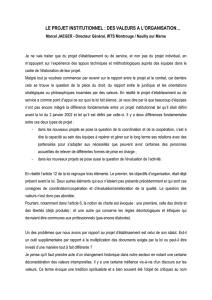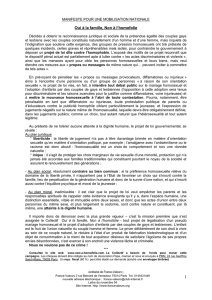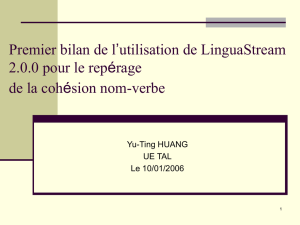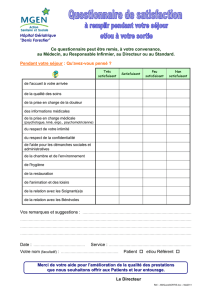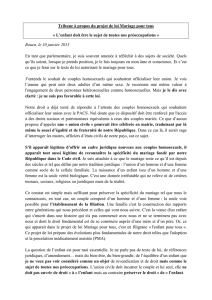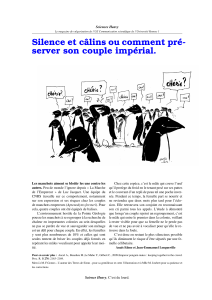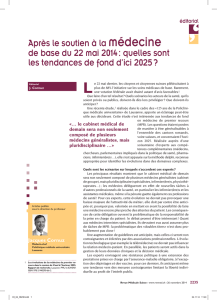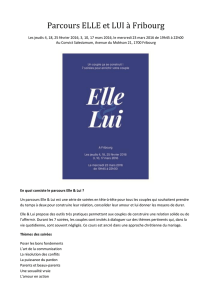Efficacitéà court et moyen termes des traitements d`urgence

V. Le Goff-Cubilier
S. Campergue
V. Sahli
S. León-Giraldo
L. Colin introduction
Le pôle Urgence-crise de l’Unité de consultation pour le couple
et la famille (UCCF) (Secteur psychiatrique ouest, Psychiatrie
adulte, Département de psychiatrie du CHUV) a pour mission
de répondre en urgence à la demande de familles et de cou ples en grande souf-
france et de leur offrir, le cas échéant, une prise en charge de crise. Dans notre pré-
cédent article,1 nous avions mentionné qu’une première revue de la littérature, re-
lative aux prises en charge dans l’urgence des familles et des couples, s’était mon-
trée plutôt décourageante. Notre équipe avait néanmoins postulé qu’intervention
d’urgence et travail de crise n’étaient pas incompatibles avec les thérapies fami-
liales, et nous avions mené une première étude1 sur un nombre restreint de situa-
tions. Nous présentons les résultats de cette étude com plétée de 2007 à 2010.
setting d’intervention
Les couples et familles sont reçus dans le cadre du pôle Urgence-crise de l’UCCF
sur appel téléphonique de leur part, dans un délai d’un à deux jours, toujours par
le même duo thérapeutique (psychiatre et psychologue). Une première séance
permet d’évaluer l’indication de l’urgence, son degré, et de proposer une prise
en charge adaptée à la situation : suivi de crise ou suivi thérapeutique habituel
(contrat de six séances espacées d’une fois par mois). Le suivi de crise propose
cinq séances à raison d’une séance par semaine. Ces séances se déroulent selon
un schéma en quatre étapes :
construction du système thérapeutique
ou
joining
,
reformu-
lation de la crise
par la construction d’hypothèses,
recadrage
qui permet de donner
un sens aux symptômes, d’autant plus vécus comme inexplicables qu’ils ont été
violents, et
réactualisation
, mouvement de recrudescence émotionnelle ou symp-
tomatique (fréquent en fin de prise en charge). Ceci permet de construire un pre-
mier bilan concluant à une fin de prise en charge ou à la décision commune de
poursuivre un travail avec les mêmes thérapeutes dans un setting mensuel.
revue de la littérature
Au cours de notre étude, nous avons approfondi la revue de la littérature anglo-
saxonne.2-9 Dans notre première publication, nous avions mentionné les travaux
Short and medium-term effectiveness
of the emergency-crisis treatments
for couples and families : results
and perspectives
From 2007 to 2010, the emergency-crisis unit
of the Couple and Family Consultation Unit –
UCCF (West Psychiatric Service, Prangins Psy-
chiatric Hospital, Psychiatric Department of
CHUV) has carried out a research about the
relevance and usefulness of emergency-cri-
sis, systemic-oriented treatments, for deeply
distressed couples and families. Besides epi-
demiologic data, we present results demons-
trating the efficiency of those treatments, both
at short term and at a one year’s range. The
global impact of such treatments in terms of
public health, but also economical issues,
make us believe that they should be fully in-
cluded in the new trend of psychiatric ambu-
latory care, into the social net.
Rev Med Suisse 2012 ; 8 : 533-8
De 2007 à 2010, le pôle Urgence-crise de l’Unité de consulta-
tion pour le couple et la famille (UCCF) (Secteur psychiatrique
ouest, Hôpital de Prangins, Département de psychiatrie du
CHUV), a mené une étude clinique sur la pertinence et l’utilité
des traitements d’urgence-crise, dans une optique systémique,
pour les couples et les familles en grave détresse. En sus des
données épidémiologiques sur cette population, nous présen-
tons ici les résultats qui démontrent l’efficacité de ces prises
en charge à court terme et à distance d’un an. L’impact global
de tels traitements en termes de santé publique, mais aussi
d’économicité des soins, nous fait penser qu’ils devraient s’ins-
crire dans la nouvelle orientation prise par les soins psychia-
triques ambulatoires au sein du tissu social.
Efficacité à court et moyen termes
des traitements d’urgence-crise
pour couples et familles : résultats
et perspectives
étude
0 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
5 janvier 2011 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
7 mars 2012 533
45_50_35824.indd 1 01.03.12 09:57

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
5 janvier 2011 0
de Pauzé et coll.,10 Ceccin,11 Ausloos,12 Pitmann13 et De-
Clercq.14 Parmi eux, seul DeClercq pensait que l’urgence
était à considérer comme une opportunité de changement
alors que Ceccin, Pitmann et Ausloos soulignaient plutôt le
risque que dans ces prises en charge en urgence, les soi-
gnants soient tentés de répondre à la demande des fa-
milles, qui est d’éviter le changement et de les maintenir
dans un état d’homéostasie ou de déresponsabilisation.
Dès les années 1960, des études ont été menées aux Etats-
Unis sur la prise en charge en urgence et les suivis de crise
de famille. Il s’agissait, dans les deux plus grandes études,
de patients arrivant dans un service d’admission d’urgence
d’hôpital psychiatrique (Langsley),6 et de patients arrivant
en hôpital général (DeClercq).14 Tous deux partent du prin-
cipe qu’il n’existe pas de crise individuelle sans crise du
contexte. La crise individuelle est clairement mentionnée
comme psychiatrique : «La psychiatrie est interpellée pour
faire face non à une psychopathologie lourde mais davan-
tage à des explosions systématiques plus souvent révéla-
trices de troubles de communication au sein du tissu social,
conjugal ou familial des patients» (DeClercq). L’intérêt de
l’étude de Langsley 6 est de présenter un groupe contrôle.
Un des critères choisis pour mesurer l’intérêt d’une inter-
vention familiale en urgence, lors d’une demande d’admis-
sion en psychiatrie de l’un des membres de cette famille,
était la décision de ne pas hospitaliser ce patient ainsi que
l’évaluation de ces patients quand ils pouvaient être main-
tenus à domicile. Dans les 75 cas du groupe étude, l’hospi-
talisation en urgence du patient désigné a été évitée. Durant
les six mois suivant la prise en charge de crise, seulement
19% des patients du groupe étude ont été hospitalisés en
hôpital psychiatrique, hospitalisation significativement plus
courte que celle des 75 cas du groupe contrôle, dont tous
les patients ont été hospitalisés et 21% d’entre eux ont été
réhospitalisés dans les six mois après l’admission.
D’autres études sont plus focalisées sur la prise en
charge des adolescents avec, comme critère d’efficacité de
ces interventions, le non-retrait de la famille ou placement
de l’adolescent en institution. Nous avions déjà mentionné
l’étude de Pauzé et coll.10 mais elle ne présente pas de
groupe contrôle. L’étude de Seeling et coll.,9 qui se base sur
un suivi intensif dans le milieu (suivi à six et douze mois),
utilisant les échelles de mesure
Family adaptability and cohe-
sion scale
et
Clinical rating scale
, montre qu’à 90 jours, 86% des
ados étaient toujours dans leur famille, à douze mois 75%
y étaient encore, aucun n’avait été hospitalisé.
De nombreuses études 2,3 n’ont pas de groupe contrôle,
ni d’évaluation des niveaux de fonctionnement de la famille.
Dans beaucoup de ces études partant d’un patient dési-
gné, le critère principal d’évaluation de ces interventions est
centré sur ledit patient. Au pôle Urgence-crise de l’UCCF, la
situation est différente : il s’agit d’une unité ambulatoire et
les familles y font appel pour elles-mêmes, qu’elles aient
ou non un patient désigné en leur sein.
méthodologie
Nous avons fait une hypothèse générale : répondre à la
demande en urgence serait thérapeutique à partir du mo-
ment où l’aspect fécond de la crise est exploité, et poursuivi
les deux hypothèses présentées dans notre précédent ar-
ticle : 1) le motif de la demande en urgence relèverait d’une
mise en danger majeure de l’équilibre du système (pour
les couples, la menace de séparation imminente et pour les
familles, un symptôme insupportable), et 2) le facteur de
crise relèverait d’un événement d’ordre situationnel, plutôt
que d’un événement du cycle de vie (tableau 1).
L’échantillon se compose de 45 couples et quinze famil-
les reçus par le pôle Urgence-crise entre fin 2007 et début
2010. Les données ont été récoltées à partir d’entretiens
cliniques d’orientation systémique, menés par deux théra-
peutes. Après la première séance d’urgence, les thérapeu-
tes ont rempli systématiquement une grille de codification
dont les items ont été saisis dans une base de données in-
formatisée avec le logiciel SPSS. La satisfaction des sys-
tèmes consultants a pu être récoltée à partir d’un question-
naire de type échelle de Lickert. Une catamnèse envoyée
à chaque patient nous a permis de mesurer l’évolution des
mêmes systèmes au bout d’une année.
A noter que cette étude respecte les principes des codes
de déontologie de la SSP (Société suisse de pédiatrie) et
de la FMH. Elle a été soumise à la commission d’éthique
de la recherche clinique de l’Université de Lausanne.
résultats
Epidémiologie
Nous avons cherché à savoir
quelle était la population qui
pouvait avoir besoin de faire recours au pôle Urgence-crise
d’une
consultation pour le couple et la famille. Sur les 60 cas rete-
nus par l’étude, 75% étaient des couples et 25% des fa mil les
(figure 1).
L’origine de la demande :
dans 31,7% des cas, la demande
est spontanée, c’est-à-dire que la famille fait elle-même la
démarche sans autre référent. 23,3% des situations sont
adressées par l’Hôpital de Prangins, 11,7% des situations
ont été référées par des confrères généralistes et 11,7% par
des thérapeutes installés. Le reste des situations nous est
référé par des hôpitaux somatiques ou les autorités locales.
Vérification des hypothèses
Motif de la demande en urgence :
tel qu’avancé par les sys-
tèmes eux-mêmes, la menace de séparation ou de divorce
est le premier motif des couples, alors que l’apparition de
534 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
7 mars 2012
Cycle de vie Hors cycle de vie
Naissance Séparation/divorce/relation
extraconjugale
Adolescence Violence
Leaving home Déscolarisation
Mode de constitution du couple Déménagement
Emménagement Travail
Mariage/pacs Maladie somatique ou psychique
Retraite Toxique
Décès Accident
Tableau 1. Facteurs de crise
45_50_35824.indd 2 01.03.12 09:57

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
7 mars 2012 535
symptômes physiques ou psychiques, est principalement
avancée par les familles. Différence statistiquement signi-
ficative entre familles et couples au test de Fischer (F(1,42)
= 18,666, p l 0,001) (figures 2 et 3).
Nous nous sommes interrogées sur les
facteurs qui semblaient
déclencher la crise dans ces systèmes
(tableau 1). Pour chaque
système, nous avons relevé jusqu’à trois facteurs de crise
classés par ordre d’importance dans la crise actuelle.
Le fac-
teur de crise primaire
pour les couples est d’abord leur mode
de constitution, puis une naissance. Pour les familles, ce sont
avant tout les problèmes liés à l’adolescence et ceux liés
au
leaving home
, à égalité avec les problèmes liés à la vio-
lence (tableau 2). Différence significative entre familles et
couples au test de Fischer (F(1,42) = 18,435, p l 0,05).
Dans notre étude, pour les deuxième et troisième facteurs
de crise, les différences observées entre familles et couples
deviennent statistiquement non significatives, mais, au sein
même de cette diffusion de facteurs, la violence semble se
dégager de façon très nette tant pour les couples que pour
les familles.
Evolution au cours de la prise en charge
A la fin des cinq séances d’intervention,
selon l’évaluation des
thérapeutes, 53,3% étaient en résolution partielle de crise,
dont la majorité a souhaité poursuivre un traitement dans
un setting habituel (figure 4). Pas de différence statistique
entre couples et familles au test de Fischer (F(1,42) = 4,681,
p = 0,290).
0 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
5 janvier 2011
Figure 1. Distribution de la population étudiée
25%
75%
Famille
Systèmes
Couple
Système Total
Famille Couple Système
Naissance 6,7% 20% 16,7%
Adolescence 26,7% 2,2% 8,3%
Leaving home 20% 11,1% 13,3%
Mode constitution couple 6,7% 31,1% 25%
Mariage/pacs 0% 2,2% 1,7%
Retraite 0% 4,4% 3,3%
Décès 0% 2,2% 1,7%
Séparation/divorce/relation 13,3% 4,4% 6,7%
extraconjugale
Violence 20% 6,7% 10%
Travail 0% 8,9% 6,7%
Maladie somatique ou psychique 6,7% 2,2% 3,3%
Toxiques 0% 2,2% 1,7%
Autres 0% 2,2% 1,7%
Tableau 2. Facteurs de crise primaire
Figure 2. Motifs de la demande des couples
2%
22%
11%
11%
54%
Menace séparation/divorce Infidélité
Violence physique Symptômes
Autres
Couple
Figure 3. Motifs de la demande des familles
7%
13%
53%
27%
Violence physique Infidélité
Autres Symptômes
Famille
Figure 4. Evolution en fin d’intervention
13%
33%
54%
Résolution de la crise
Résolution partielle de la crise
Autre
45_50_35824.indd 3 01.03.12 09:57

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
5 janvier 2011 0
Evaluations de la prise en charge d’urgence/
crise
La première évaluation,
à la fin des cinq séances de crise,
avait pour objet d’évaluer la fonctionnalité de notre struc-
ture et l’utilité clinique de nos prises en charge.
Neuf questions étaient posées, les patients pouvant
étalonner leur réponse de «très satisfaisant, satisfaisant,
moyennement satisfaisant», à «pas satisfaisant du tout» (ta-
bleau 3), 94 questionnaires retournés sur 119 envoyés ; 79%
de réponses.
Le tableau 4 montre que la fonctionnalité de la structure
est largement jugée très satisfaisante à satisfaisante, ainsi
que l’aide apportée par le traitement.
Enfin, 92% des patients se sont déclarés très satisfaits à
satisfaits de cette prise en charge, et la recommanderaient
à 90% (figure 5).
La deuxième évaluation,
catamnestique, envoyée par cour-
rier séparé à chaque membre du système traité, avait pour
but d’évaluer la pérennité des résultats obtenus une année
après la fin du traitement, 87 questionnaires retournés sur
119 ; 73% de réponses.
Neuf questions étaient posées, les patients pouvant éta-
lonner leur réponse de «Oui bien sûr, oui en partie, moyen-
nement», à «pas du tout» (tableau 5).
Un an après,
la prise en charge est considérée comme
ayant été bénéfique pour 65% des patients (figure 6). En
cas d’apparition de difficultés, il a été peu nécessaire de
reconsulter, 55% des patients considérant avoir pu utiliser
ce qu’ils avaient retiré du traitement (tableau 6).
conclusion
Le pôle Urgence-crise de l’UCCF a donc majoritairement
accueilli des couples, surtout à la demande de l’épouse.
Cette démarche a été initiée surtout de façon spontanée
ou sur conseil d’un professionnel. Ces demandes étaient
légitimes, puisqu’elles ont justifié à 95% un traitement de
crise confirmé par les thérapeutes après l’entretien d’éva-
luation.
536 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
7 mars 2012
Figure 5. Satisfaction globale en fin d’intervention
6%
92%
2%
Très satisfaisant à satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Pas de réponse
• Accessibilitéauxsoins
• Délaid’attenteentrel’appeltéléphoniqueetlepremierrendez-vous
• Nombredeséances
• Duréedesséances
• Rythmeouespacemententrelesséances
• Aideapportéeparlesthérapeutesrelativementauxproblèmes/difficultés
ayant motivé la demande
• Aideapportéeparlesthérapeutesaufonctionnementgénéralducouple
ou de la famille
• Evaluationglobaledecettepriseencharge
• Recommandationéventuelledecettepriseenchargeàdesconnais-
sances ou proches
Tableau 3. Evaluation de fonctionnalité et d’efficacité
du traitement
Très satisfaisant Satisfaisant Moyennement Pas satisfaisant Pas complété
satisfaisant du tout
Accès au soin 53,2% 30,9% 8,5% 1% 6,4%
Délai d’attente appel-premier rendez-vous 68,1% 19,2% 7,4% 0% 5,3%
Nombre de séances 44,7% 45,7% 6,4% 0% 3,2%
Durée des séances 57,4% 35,1% 3,2% 1,1% 3,2%
Rythme des séances 55,3% 37,2% 3,2% 1,1% 3,2%
Aide des thérapeutes par rapport aux 47,9% 40,4% 9,5% 1,1% 1,1%
difficultés motivant la demande
Aide des thérapeutes par rapport au 40,4% 40,4% 15% 2,1% 2,1%
fonctionnement général
Evaluation globale de cette prise en charge 52,1% 39,4% 6,4% 0% 2,1%
Tableau 4. Résultats de la première évaluation
• Unanaprès,letraitementest-iltoujoursconsidérécommeayantété
bénéfique?
• L’amélioration(si)obtenue,s’est-ellemaintenuedansletemps?
• Sinon,lesmêmesdifficultés/problèmessont-ilsréapparus?
• Oud’autresdifficultés/problèmessont-ilsapparus?
• Aveclerecul,lenombredeséancesest-ilconsidérécommeayantété
suffisant?
• Depuislafindelathérapie,avez-vouspenséàconsulterdenouveau?
• Sioui,pourlesmêmesdifficultés/problèmes?
• Oupourd’autresdifficultés/problèmes?
• Durantcetteannée,avez-vouspuutilisercequevousavezapprislors
dutraitement,quandvousavezrencontrédenouveauxdifficultés/
problèmes?
Tableau 5. Evaluation catamnestique du traitement
45_50_35824.indd 4 01.03.12 09:57

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
7 mars 2012 537
La menace de séparation est le
motif d’urgence
le plus si-
gnificatif dans les couples, alors que ce sont les symptômes
qui le sont chez les familles. La violence physique est pré-
sente de façon plus significative dans les familles que dans
les couples. Notre première hypothèse est donc confirmée,
com me le suggéraient les premiers résultats de la pré-
étude.1
Si l’on regroupe les différents
facteurs de crise
sous l’angle
de leur appartenance aux étapes normales d’un cycle de vie
ou non, on constate que le
facteur de crise primaire
relève,
principalement d’une étape normalement rencontrée dans
un
cycle de vie
et ce, qu’il s’agisse de couple ou de famille.
En ce qui concerne les facteurs de crise secondaires et ter-
tiaires, ils appartiennent principalement au groupe des fac-
teurs
hors cycle de vie
. L’ensemble de ces résultats tend à dé-
montrer que les couples et les familles vont avoir besoin
d’une consultation en urgence et d’une prise en charge de
crise à des moments-clés (étape normale du cycle de vie)
de leur évolution. Notre deuxième hypothèse est donc in-
firmée, comme le suggéraient les premiers résultats de la
préétude de 2009.
Néanmoins, notre étude nous a permis de découvrir que
des phénomènes plus complexes semblent régir la mise
en crise du système.
Ce qui crée la crise semble bel et bien découler du dé-
bordement des ressources adaptatives du système quand
se surajoutent, à une étape normale du cycle de vie, un ou
deux facteurs de crise supplémentaires, hors cycle de vie,
comme une maladie, un chômage, un déménagement.
C’est
la conjonction de ces deux éléments, cycle de vie et hors cycle de vie,
qui va probablement provoquer un débordement massif des res-
sources du système, débordement qui va se manifester par divers
symptômes de dysfonctionnement et rendre la consultation néces-
saire.
Ainsi, un symptôme aussi bruyant, inquiétant et dés-
tructurant que la violence au niveau des familles ou des
couples peut être interprété (en tant que facteur secon-
daire ou tertiaire) comme la goutte d’eau qui fait déborder
le vase et va permettre au système, à travers le «bruit» que
cela génère, de demander de l’aide, alors que les autres
facteurs de crise cumulés n’avaient jusque-là pas abouti à
une consultation.
La prise en charge en urgence des couples et des famil-
les telle que nous l’avons conçue répond très majoritaire-
ment à l’attente des patients, et le traitement de la crise
est également perçu comme étant efficace, non seulement
sur le problème ayant motivé la demande, mais aussi, plus
largement, sur le fonctionnement global du système traité.
Une année après, les patients considèrent toujours que le
suivi Urgence-crise a été bénéfique, alors même que l’amé-
lioration ne s’est maintenue que pour 50% des personnes.
61% de ces patients n’ont pas pensé à reconsulter, ayant pu
gérer par eux-mêmes, ce qui suggère un bénéfice à long
terme du traitement. Enfin, sur les 60 cas suivis, il n’y a eu que
quatre hospitalisations en psychiatrie d’un des membres
du système. Notre hypothèse générale est donc confirmée.
Notre étude rejoint ainsi les conclusions des travaux,
pour la plupart nord-américains ou belges,15 mais aussi suis-
ses16-18 et français,19 qui démontrent l’intérêt et la nécessité
de prendre rapidement en charge les systèmes familiaux,
et de l’impact de tels traitements, non seulement en termes
de santé publique, mais aussi d’économicité des soins.
0 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
5 janvier 2011
Figure 6. Bénéfice ressenti un an après la fin de l’in-
tervention
29%
65%
6%
Satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
Oui, Oui, Moyennement Non, Pas Non
bien sûr en partie pas du tout complété applicable
pour items
3-4-7-8
Prise en charge bénéfique après un an 32,4% 32,4% 5,9% 29,3% 0%
Amélioration maintenue dans le temps ? 20,6% 11,8% 17,6% 23,5% 26,5%
Si non, apparition des mêmes difficultés ? 12,5% 29,2% 0% 8,3% 0% 50%
Si non, apparition d’autres difficultés ? 20,8% 20,8% 0% 4,2% 0% 54,2%
Nombre de séances suffisant 37,6% 12,5% 12,5% 20,8% 16,6%
Avez-vous pensé à consulter de nouveau ? 20,8% 0% 8,3% 62,6% 8,3%
Si oui, pour les mêmes difficultés ? 12,5% 8,3% 4,2% 12,5% 0% 62,5%
Si oui, pour d’autres difficultés ? 8,3% 4,2% 4,2% 8,3% 0% 75%
Utilisation de ce qui a été appris en thérapie 33,3% 25% 25% 16,7% 0%
Tableau 6. Résultats de catamnèse à un an
45_50_35824.indd 5 01.03.12 09:57
 6
6
1
/
6
100%