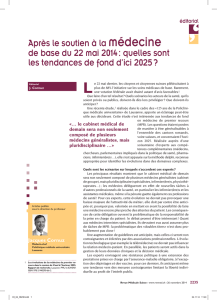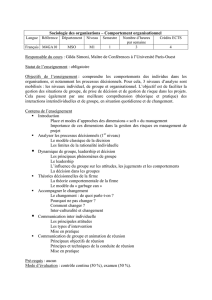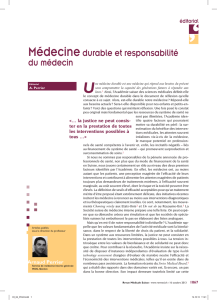Téléchargez le PDF - Revue Médicale Suisse

Éditorial
WWWREVMEDCH
mai 931
Tests diagnostiques
de laboratoire
hypersensibles veutil
toujours dire hyperutiles?
Prs VALÉRIE D’ACREMONT et FRANÇOIS CHAPPUIS
Au cœur de la consultation se trouve le diag-
nostic… Ceci est aussi vrai pour la ou le mé-
decin dont la tâche principale est d’identifier
de quelle maladie souffre son patient, que
pour ce dernier qui veut «savoir ce qu’elle ou
il a». Pendant longtemps, l’outil déterminant
utilisé était la clinique, dont la fiabilité n’est
pas aussi bonne qu’on l’espérait, en tout cas
pour les syndromes avec un diagnostic diffé-
rentiel très large, comme la fièvre par exemple.
En parallèle, avec l’explosion de la technolo-
gie, les tests de laboratoire ont proliféré avec
un rendu de résultat de plus en plus rapide.
Ceci permet de prendre une décision au mo-
ment même de la consultation, mais laisse
peu d’espace de réflexion pour s’assurer que le
résultat du test soit vraiment utile, et surtout
supprime le bénéfice du recul de quelques
jours laissant souvent le temps au
patient de guérir spontanément.
Lors d’une pathologie aiguë né-
cessitant une prise en charge le
jour même, cette rapidité est par
contre un avantage indéniable.
Le médecin doit alors se poser la
question: quel test choisir? Alors
qu’il n’y a pas si longtemps en-
core, il n’existait qu’un seul type
de test pour confirmer une maladie, il en
existe actuellement souvent plusieurs qui
ont chacun leurs particularités. Il peut d’ail-
leurs s’agir aussi bien de simples tests rapides
immunochromatographiques –pouvant avoir
une sensibilité équivalente au test conven-
tionnel – que de tests moléculaires multi-
plexés. Ces derniers sont souvent (mais pas
toujours, par exemple pour les bactériémies)
beaucoup plus sensibles que les tests utilisés
jusqu’à présent. Cette excellente performance
implique qu’ils vont détecter non seulement
des pathogènes potentiellement responsables
de la maladie mais également ceux qui repré-
sentent un simple portage ou une excrétion
prolongée après un épisode antérieur.
Même si la très bonne spécificité analytique
doit être saluée, la spécificité clinique par
contre est discutable. Que dire en effet d’un
test qui, dans les études contrôlées, est sou-
vent retrouvé positif chez les personnes en
parfaite santé? Ceci est d’autant plus vrai que
ces tests étant souvent multiplexés, des pa-
thogènes que l’on n’aurait habituellement
pas recherchés (pour cause de prévalence
très faible dans la population de patients
considérée par exemple) vont tout de même
être détectés. La tentation de donner quand
même un médicament pour traiter ce patho-
gène va être évidemment grande pour le mé-
decin et le patient. Lorsqu’il s’agit d’un virus,
un résultat positif peut aider à se retenir de
prescrire un antibiotique qui n’aura comme
seuls effets que de provoquer des effets
secondaires et d’induire des résistances chez
le patient et son entourage. Par
contre, dans le contexte d’une
diarrhée par exemple, où le panel
intestinal par PCR multiplex dé-
tecte avant tout des bactéries,
l’incitation à prescrire un anti-
biotique (qui n’aura souvent
aucune incidence sur le cours de
la maladie) est alors forte. Il con-
vient de rappeler que la recom-
mandation de l’OMS est de ne
traiter que la shigellose, les autres bactéries
guérissant la plupart du temps par elles-mêmes.
Dans ce contexte, on réalise vite que tout
nouveau test introduit sur le marché doit s’ac-
compagner d’une guidance pour les cliniciens
sur la pertinence de son utilisation dans un
contexte déterminé et sur l’interprétation du
résultat dans le contexte clinique (voir article
de Rochat et coll. dans ce numéro). Ces re-
commandations, quand elles existent, sont
souvent émises avec plusieurs années de dé-
calage, sauf peut-être dans les pays à ressources
limitées où les garde-fous de santé publique,
permettant de lutter contre la surconsomma-
tion médicale, sont heureusement plus solides
Articles publiés
sous la direction de
FRANÇOIS
CHAPPUIS
Service de médecine
tropicale et
humanitaire
Département de
médecine
communautaire, de
premier recours
etdes urgences
HUG, Genève
BLAISE GENTON
Policlinique médicale
universitaire
Département de
médecine
CHUV, Lausanne
CES RECOMMAN-
DATIONS, qUAND
ELLES ExISTENT,
SONT SOUVENT
ÉMISES AVEC
PLUSIEURS
ANNÉES
DEDÉCALAGE

REVUE MÉDICALE SUISSE
WWW.REVMED.CH
3 mai 2017
932
que chez nous. Le développement de ces
arbres décisionnels nécessite une étroite col-
laboration entre les experts du laboratoire et
les cliniciens connaissant non seulement le
domaine mais surtout la réalité du terrain où
le test va être utilisé, raison pour laquelle les
médecins généralistes doivent impérativement
être impliqués dans ce processus d’évaluation.
Les «utilisateurs finaux» devraient d’ailleurs
être impliqués non seulement dans les pro-
cessus décisionnels quant à l’utilisation de
nouveaux tests de laboratoire, mais également
dans celui de la pertinence du développement
d’un test déterminé. Que faire en effet d’un
test qui ne reflète pas la question que se pose
le professionnel de santé sur le terrain, même
si ce test possède les meilleures performan ces
analytiques? Ce n’est que dans un mouve-
ment clinicien-développeur-clinicien qu’un test
de laboratoire pourra trouver sa place sur le
marché et apporter un réel bénéfice pour le
patient et la société.
1
/
2
100%