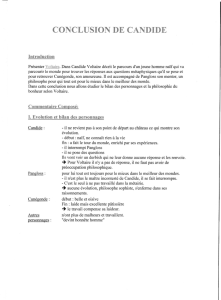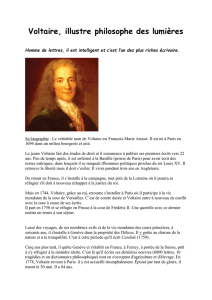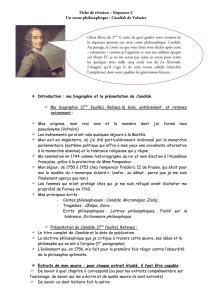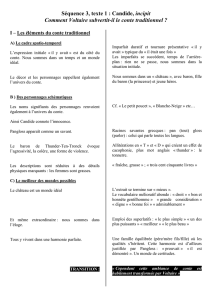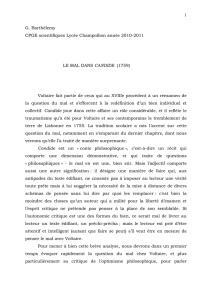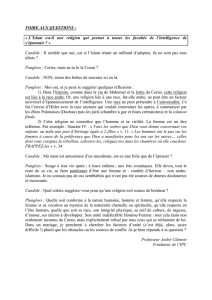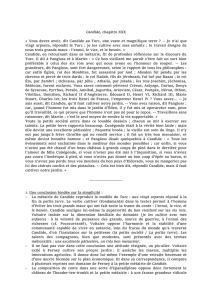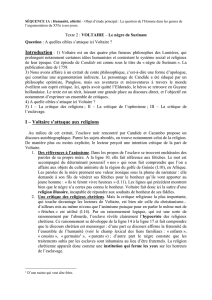Document

1
G. Barthèlemy
CPGE scientifiques Lycée Champollion année 2010-2011
LE MAL DANS CANDIDE (1759)
Voltaire fait partie de ceux qui au XVIIIe procèdent à un réexamen de la question du
mal et s’efforcent à la redéfinition d’un bien individuel et collectif. Candide joue dans cette
affaire un rôle considérable, et il reflète le traumatisme qu’a été pour Voltaire et ses
contemporains le tremblement de terre de Lisbonne en 1755. La tradition scolaire a mis
l’accent sur cette question du mal, notamment en s’emparant du dernier chapitre, dont
nous verrons qu’elle l’a traité de manière surprenante.
Candide est un « conte philosophique », c’est-à-dire un récit qui comporte une
dimension démonstrative, et qui traite de questions « philosophiques » - le mal en est une,
bien sûr. Mais l’adjectif comporte aussi une autre signification : il désigne une manière de
faire qui, aux antipodes du texte édifiant, ne consiste pas à imposer au lecteur une vérité
toute prête mais à lui suggérer la nécessité de la mise à distance de divers schémas de
pensée sans lui dire par quoi les remplacer : c’est bien la moindre des choses qu’un auteur
qui a milité pour la liberté d’examen et l’esprit critique ne prétende pas penser à la place de
son semblable. Si l’autonomie critique est une des formes du bien, ce serait mal de livrer au
lecteur un texte édifiant, un prêchi-prêcha ; mais le lecteur est prié d’être attentif et
intelligent (autant que faire se peut) s’il veut être en mesure de penser le mal avec Voltaire.
Pour mener à bien cette brève analyse, nous devrons dans un premier temps évoquer
rapidement la question du mal chez Voltaire, et plus particulièrement sa critique de
l’optimisme philosophique, pour parler ensuite de la conception voltairienne de la
philosophie, avant de nous intéresser au dénouement du conte.
I - Voltaire et le problème du mal
La question du mal au XVIIIe est en partie (et en tout cas pour Voltaire) celle de
l’ « optimisme », doctrine philosophique qui procède de Leibniz et consiste à dire que la
faiblesse de l’esprit humain lui interdit de pénétrer le « plan divin », les « desseins de la
Providence », c’est-à-dire de percevoir la totalité du réel et de l’Histoire, totalité au sein de
laquelle ce qui semble un mal à l’homme contribue en fait à un bien global. Le débat est à la
fois complexe, parce que la théologie et le bon sens s’y heurtent, et périlleux, parce que
contester l’existence de la Providence (l’existence d’un dessein de Dieu, qui par définition ne
saurait viser le mal), c’est mettre en cause le catholicisme. Dans la préface qu’il écrit pour
son « Poème sur le désastre de Lisbonne
1
» publié en 1756, Voltaire rappelle l’évidence
reconnue par tous les hommes, dit-il, selon laquelle « il y a du mal sur la terre ». C’est
pourquoi « le mot ‘‘Tout est bien’’ […] n’est qu’une insulte aux douleurs de notre vie », et il se
moque du discours « optimiste » qui consisterait à dire aux habitants de Lisbonne (c’est un
discours que Pangloss serait susceptible de tenir) qu’après le tremblement de terre les
maçons seraient plus prospères, certains animaux, nourris par les cadavres, plus gros, etc.
Ce qu’il faut, ajoute Voltaire, c’est se résigner à l’existence du mal, à considérer que son
origine est une énigme, et qu’il est nécessaire d’espérer en un au-delà de la vie et de croire
en la « bonté de la providence », en l’incapacité des lumières naturelles de la raison à rendre
compte, d’un point de vue métaphysique, du mal. Voltaire s’en prend ici à une tradition
religieuse et philosophique très sophistiquée qui s’est acharnée à fournir des interprétations
métaphysiques de l’existence du mal. Il leur oppose sa propre conviction religieuse (croyance
en un au-delà, existence d’une providence) qui permet à l’homme d’espérer, de croire en une
divinité encline au bien, mais pas de résoudre ce mystère du mal. Il écarte aussi une
polémique qui fait rage chez les métaphysiciens du temps et qui consiste à poser une
1
Rappelons de quoi il s’agit : le 1er novembre 1755, un tremblement de terre suivi d’un ras de marée et
qui provoqua un énorme incendie détruisit la fastueuse Lisbonne, causant au passage à peu près
30 000 morts. Ce fut pour l’Europe un traumatisme considérable, qui redonna toute son acuité au
débat sur le mal et la Providence.

2
alternative embarrassante autant qu’irréductible : si Dieu est bon et que le mal existe, c’est
que Dieu n’est pas tout-puissant ; si Dieu est tout-puissant et qu’il laisse subsister le mal,
c’est qu’il n’est pas bon.
Voltaire propose donc de délaisser un questionnement métaphysique qui lui semble
stérile ; en revanche, il s’intéresse aux mécanismes par lesquels l’homme est conduit à faire
le mal, dans la perspective d’une anthropologie fondamentale donc qu’il a développée dès
1735 dans son Traité de métaphysique. L’homme fait le mal, dit-il, en mésusant et en
abusant des passions et des besoins dont la bienveillance divine l’a doté comme autant de
ressorts qui le font agir dans le sens de l’accomplissement des fins providentielles : la vie
sociale, l’extension des arts et des plaisirs. l’homme est d’ailleurs également pourvu
d’instincts universels qui lui permettent d’identifier le bien et le mal, et chacun peut ainsi se
référer à des critères qui le sont tout autant
2
: « La vertu et le vice, le bien et le mal moral, est
donc en tout pays ce qui est utile ou nuisible à la société ».
Au rebours cette approche qui s’applique à prendre au sérieux les modalités
individuelles et collectives de l’existence des hommes, l’optimisme pèche doublement : il nie
la souffrance des hommes en prétendant adopter le point de vue de Dieu, et il constitue
ainsi une illustration paradigmatique des dégâts occasionnés par l’esprit de système. Mais
pour comprendre les enjeux de l’opposition de ces deux perspectives, il faut évoquer la
conception voltairienne de la philosophie.
II – La philosophie selon Voltaire
On saisit très bien les enjeux de cette opposition dans un texte de 1734 intitulé les
Lettres philosophiques. Voltaire a dû s’exiler en Angleterre à la suite d’un conflit avec un
aristocrate, et il y découvre deux choses dont il rend compte dans cet ouvrage: la monarchie
parlementaire et l’empirisme philosophique et scientifique. Cette découverte va l’aider à
mettre en forme l’opposition mentionnée ci-dessus. D’un côté, une philosophie qui se
préoccupe essentiellement de métaphysique, se prolonge en une théologie dogmatique
volontiers anti-humaniste qui dévalorise le séjour terrestre, fait de l’homme l’esclave d’une
Dieu vengeur et ne se préoccupe guère des moyens d’amender le sort des hommes. Voltaire
fige cette représentation dans les deux dernières « lettres », consacrées à Pascal, qui en
devient l’incarnation. De l’autre côté, l’Angleterre illustre le goût pour une philosophie
rationaliste et empirique, qui part du réel et de l’expérience, est indissociable d’un élan
scientifique qui lui-même constitue la promesse d’une emprise sur le réel indispensable à
ceux qui se préoccupent d’amender le monde des hommes. Parallèlement, ce goût pour
l’empirisme et la rationalité débouche sur l’esprit critique, la tolérance, une sorte de
diversité et de conflictualité sociale pré-démocratiques, et donc une société plus propice à
l’épanouissement des individus, abrités du fanatisme et de l’arbitraire royal (on l’a déjà
suggéré ci-dessus, tout ceci est indissociable de l’avènement du parlementarisme). Bref,
Voltaire constate en Angleterre comme une mutation de la raison : elle n’est plus l’outil dont
la tâche la plus noble est la compréhension des « mystères » (au sens chrétien du terme), elle
n’est plus avant tout tributaire du partage entre raison et foi, elle est l’outil de la
connaissance, de l’examen critique et du libre choix.
Car la question de la liberté, elle aussi, est transformée : elle n’est plus celle de la
confrontation entre la volonté de l’homme et celle de Dieu, mais la capacité à faire ce que
l’on est conduit à vouloir comme être raisonnable, sans qu’une instance s’interpose pour
imposer ses propres vues. La liberté est d’abord la liberté de penser, de l’examen critique
permettant la réfutation des diverses mystifications qui assurent, grâce à la collaboration du
pouvoir et de la religion, la pérennisation de la tyrannie, c’est-à-dire du mal politique. Tout
cela est indissociable du progrès, c’est-à-dire de l’amélioration du sort de l’homme (comme
individu et comme espèce), et de la question de l’action. Par là, nous en arrivons à Candide
(et à Candide).
III – Le mal dans Candide
Commençons par une citation de Jean Goldzink (Voltaire de A à Z, notice « Mal » -
largement exploitée dans cet exposé -, Hachette 1994) :
2
Par opposition au bien mensonger et mystificateur promus par exemple par les religions
institutionnelles, selon lesquelles vivre conformément au bien c’est aller à la messe, obéir à l’Eglise,
etc.

3
Comme le mal met en jeu la Divinité, la raison, l’Histoire, le bonheur,
l’amour, la société, les passions, tout conte voltairien relève de sa juridiction
philosophique, et toute destinée de personnage prend valeur de parabole
dans la balance des peines et des plaisirs. Le mal est au point le plus
sensible et le plus dramatique de la philosophie, [car il n’est] pas autre chose
que le face-à-face de Dieu et de l’homme, de l’homme et du monde, et il est à
la jointure de l’écriture abstraite et de l’écriture narrative.
Dans le cas de Candide, le rapport à la question du mal est exhibé dès le titre, qui
est en fait, on le sait, Candide ou l’optimisme, titre qui prend davantage de sens peut-être si
l’on sait qu’à l’optimisme voltaire voulait substituer le « méliorisme », position qui consiste à
dire qu’il ya globalement plus de bien que de mal, et que cette proportion peut encore être
améliorée, sous réserve d’éduquer les hommes et de s’appliquer à transformer le monde
(notamment en luttant contre l’intolérance, la superstition, et l’arbitraire
3
).
Comme le montre sa présentation dans l’incipit, Candide est un héros programmé
pour faire l’épreuve d’un monde dans lequel les innocents ne sont pas à la noce : c’est
un jeune homme à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces.
Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit avec
l’esprit le plus simple ; c’est […] pour cette raison qu’on le nommait Candide.
Rien de mieux qu’un héros innocent (aux deux sens du terme : qui ignore le mal, et
que sa naïveté prédispose à prendre des coups) pour illustrer un monde dans lequel le mal
fait rage
4
, et en être victime, surtout si le jeune homme est formé par une sorte de
mystificateur au raisonnement mécanisé (c’est Pangloss, bien sûr), et qui tient le langage
que voici (4e paragraphe) :
Il est démontré que les choses ne peuvent être autrement : car, tout étant
fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez
bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi portons-nous
des lunettes […] et, les cochons ayant été faits pour être mangés, nous
mangeons du porc toute l’année ; par conséquent, ceux qui ont dit avancé
que tout est bien ont dit une sottise ; il fallait dire que tout est au mieux.
Passons sur le détail des aventures de Candide, pour remarquer simplement que
chaque fois que se produit une embellie, il s’exclame triomphalement, au mépris de son
expérience, que Pangloss avait raison, que tout est bien, et venons-en aux deux derniers
chapitres, dont une curieuse tradition scolaire nous dit qu’ils livrent une leçon de sagesse
souriante.Candide et ses petits camarades (car un certain nombre de personnages se
retrouvent, par la grâce de récit, à Constantinople) découvriraient en définitive la solution
pour se soustraire au mal et instaurer une forme de sérénité ; cette solution consiste à
acheter un petit bout de terrain, à le mettre en culture et à cesser d’attendre de l’existence
amour, gloire et enthousiasme, à renoncer à gamberger – bref, il faut « cultiver son jardin »,
selon un précepte inventé et mentionné à deux reprises par Candide, qui aurait une
magnifique portée allégorique et nous convaincrait de la nécessité de nous résigner plutôt
que de courir le monde à la poursuite de chimères. On connaît le public idéal de ce genre de
« morale » : c’est celui que l’on caricature sous les traits du bourgeois ventru et essoufflé des
années 1840, celui dont il ne faut pas dire qu’il ne rêve pas, mais bien plutôt qu’il est
terrorisé par ses propres rêves
5
. Telle serait la sagesse proposée par Voltaire : opposons au
mal qui règne dans le monde extérieur et à nos propres démons cette activité éminemment
raisonnable qu’est le travail de la terre, source de richesse et de satisfaction, comme le dit
d’ailleurs le vieillard qui est le prescripteur de Candide dans cette affaire : « Le travail éloigne
de nous trois grands maux : l’ennui, le vice et le besoin ». Voilà qui est certes un beau projet
au regard des délires en échappement libre de Pangloss et de l’oisiveté délétère de nos héros.
Mais, comme dirait à peu près T. Gautier, s’empêcher de succomber au mal, est-ce
3
Ce qui ne suffit pas à faire de Voltaire un révolutionnaire.
4
Sade perfectionnera ce procédé en construisant pour sa part un diptyque de deux romans : Justine
ou les infortunes de la vertu / Juliette ou les prospérités du vice.
5
Malraux, préface du Démon de l’Absolu.

4
connaître le bien et le bonheur, dont on sait à quel point les philosophes du XVIIIe y sont
attachés ? Voyons donc les choses de plus près.
Faisons d’abord un état des lieux, au sens géographique du terme. La scène se passe
à Constantinople. Constantinople, ses mosquées, ses loukoums, ses baklavas, son
Bosphore, le mausolée d’Atatürk, etc. Pas du tout. Constantinople est la capitale de l’Empire
ottoman, c’est-à-dire du despotisme – autant dire du mal - selon une tradition qui remonte
au XVIIe siècle
6
. Ce n’est donc pas vraiment le genre d’endroit propice à un dénouement
euphorique. Voyez par exemple, dans ce fameux chapitre conclusif, ce à quoi assistent nos
héros :
On voyait souvent passer sous les fenêtres de la métairie des bateaux
chargés d’effendis, de bachas, de cadis [il s’agit, pour simplifier, de différents
dignitaires], qu’on envoyait en exil à Lemnos, à Mitylène, à Erzeroum. On
voyait venir d’autres cadis, d’autres bachas, d’autres effendis, qui prenaient
la place des expulsés et qui étaient expulsés à leur tour. On voyait des têtes
proprement empaillées qu’on allait présenter à la Sublime Porte.
Voilà qui est caractéristique des régimes despotiques : le tyran est seul au pouvoir et
vit dans la crainte, et développe même une sinistre paranoïa qui le conduit à semer la mort
autour de lui et à destituer par un caprice morbide ceux qu’il a promus par une faveur
imprévisible – et personne n’est à l’abri de ce mal contre lequel on ne peut se défendre. D’où
les propos du « bon vieillard » qui va donner aux héros cette fameuse leçon de sagesse,
lorsque celui-ci lui demandent ce qui s’est passé (il s’agit de l’exécution d’un énième
muphti) :
Je n’en sais rien, et je n’ai jamais su le nom d’aucun muphti ni d’aucun
vizir. J’ignore absolument l’aventure dont vous me parlez ; je présume qu’en
général ceux qui se mêlent des affaires publiques périssent quelquefois
misérablement, et qu’ils le méritent ; mais je ne m’informe jamais de ce
qu’on fait à Constantinople ; je me contente d’y envoyer vendre les fruits du
jardin que je cultive.
Voici comment l’on vit à Constantinople : pas en citoyen éclairé qui prend par à la vie
de son pays (comme dans le tableau un peu flatté de l’Angleterre qu’offrent les Lettres
philosophiques) mais comme des victimes potentielles du grand holocauste despotique
7
;
pour survivre, pour ne pas courir le risque d’être liquidé comme un témoin gênant, il faut
détourner les yeux, ne rien savoir des affaires publiques. Peut-on croire un instant que ce
modèle, dont Candide va prétendre s’inspirer, est crédible aux yeux de Voltaire ? Pour se
convaincre que c’est impossible, il suffit se reporter aux propos de Martin, le pessimiste de
la bande, qui vont « convertir » tous ses petits camarades (c’est la clausule de l’avant-dernier
paragraphe du conte) : « Travaillons sans raisonner ; c’est le seul moyen de rendre la vie
supportable ». Voilà bien un idéal digne des Lumières ! « Abrutissez-vous », comme disait
Pascal (tiens donc …) à ceux qui prétendaient au contraire chercher la foi par la raison.
Où est l’erreur ? Dans l’acceptation et l’usage de la raison, indûment convoquée ici
par Martin, lequel s’est déjà, dans ce même chapitre signalé par une appréciation de la
condition humaine singulièrement dépourvue de nuances :
6
Les adversaires politiques de Louis XIV (les protestants notamment) décrivaient volontiers
son royaume sous les traits de l’Empire du Grand Turc, selon un procédé auquel Voltaire
lui-même recourt dans sa pièce Mahomet ou le fanatisme (dans laquelle il veut avant tout
dénoncer la papauté) ou dans un texte très drôle qui s’intitule De l’horrible danger de la
lecture.
7
Le « bon vieillard » qui donne une véritable leçon de sagesse, ce n’est pas celui-ci, c’est
celui que Candide rencontre dans l’Eldorado (dans un royaume utopique, donc, mais dans
lequel la monnaie en usage est la livre-sterling …), au chapitre XVIII, qui est « le plus savant
homme du royaume », et un véritable philosophe, qui parle de morale, de religion, d’Histoire,
de politique et de commerce, pas un patriarche dominé par la peur et dont l’idéal de vie
(l’éthique serait-on tenté de dire) est en définitive assez misérable.

5
Martin surtout conclut que l’homme était né pour vivre dans les
convulsions de l’inquiétude, ou dans la léthargie de l’ennui. Candide n’en
convenait pas, mais il n’assurait rien. Pangloss avouait qu’il avait toujours
horriblement souffert ; mais ayant soutenu une fois que tout allait à
merveille, il le soutenait toujours, et n’en croyait rien.
Partant de telles postures intellectuelles, il n’est pas étonnant que ces éclopés de
l’existence en arrivent à se rallier à un projet qui les conduira à s’abrutir de travail. Mais
leur problème est qu’ils ignorent la raison philosophique voltairienne et restent prisonniers
de la métaphysique et sont coincés dans cette capitale du mal où ils ne peuvent par
définition envisager d’œuvrer pour le bien, mais seulement de trouver un moindre mal.
Cette situation de blocage nous est confirmée par l’épisode de la rencontre du derviche
(même chapitre) :
Il y avait dans le voisinage un derviche très fameux, qui passait pour le
meilleur philosophe de la Turquie ; ils allèrent le consulter ; Pangloss porta
la parole, et lui dit : « Maître, nous venons vous prier de nous dire pourquoi
un aussi étrange animal que l’homme a été formé.
- De quoi te mêles-tu ? dit le derviche, est-ce là ton affaire ? - Mais, mon
Révérend Père, dit Candide, il y a horriblement de mal sur la terre. -
Qu’importe, dit le derviche, qu’il y ait du mal ou du bien ? Quand sa
Hautesse envoie un vaisseau en Égypte, s’embarrasse-t-elle si les souris qui
sont dans le vaisseau sont à leur aise ou non ? - Que faut-il donc faire ? dit
Pangloss. - Te taire, dit le derviche. - Je me flattais, dit Pangloss, de
raisonner un peu avec vous des effets et des causes, du meilleur des mondes
possibles, de l’origine du mal, de la nature de l’âme et de l’harmonie
préétablie. » Le derviche, à ces mots, leur ferma la porte au nez.
Ce dialogue est irrésistible dans sa noirceur : d’un côté, le porte-parole d’un
dogmatisme religieux résolument anti-humaniste (les hommes sur la terre sont comme des
souris dans la cale d’un navire) dont on devine les liens avec le pouvoir despotique (« Quand
sa hautesse … »), en fonction d’une homologie évidente pour le lecteur « philosophe » de
Voltaire (le dogmatisme anti-humaniste est en religion ce qu’est le despotisme en politique :
une incarnation du mal) et d’une collusion elle aussi évidente ; de l’autre un métaphysicien
qui a certes retourné sa veste (il disait dans le premier chapitre que tout est bien) mais qui
reste prisonnier à la fois d’un formalisme intellectuel et d’un type de questionnement sans
objet, ce dont le derviche tire les conséquences en claquant la porte au nez de Pangloss
(pourquoi perdre son temps à discuter avec un dingue ?).
L’ultime échange entre Pangloss et Candide confirme la nature du ratage :
Toute la petite société entra dans ce louable dessein [formulé par Martin];
chacun se mit à exercer ses talents. La petite terre rapporta beaucoup.
Cunégonde était à la vérité bien laide ; mais elle devint une excellente
pâtissière ; Paquette broda ; la vieille eut soin du linge. Il n’y eut pas jusqu’à
frère Giroflée qui ne rendît service ; il fut un très bon menuisier, et même
devint honnête homme ; et Pangloss disait quelquefois à Candide : « Tous les
événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles ; car
enfin, si vous n’aviez pas été chassé d’un beau château à grands coups de
pied dans le derrière pour l’amour de Mlle Cunégonde, si vous n’aviez pas été
mis à l’Inquisition, si vous n’aviez pas couru l’Amérique à pied, si vous
n’aviez pas donné un bon coup d’épée au baron, si vous n’aviez pas perdu
tous vos moutons du bon pays d’Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des
cédrats confits et des pistaches. - Cela est bien dit, répondit Candide, mais il
faut cultiver notre jardin.
Voici Pangloss revenu à l’optimisme, concaténant les faits et les événements les plus
hétérogènes, d’importance fort variable, pour en arriver à ce résultat qui tourne en dérision
 6
6
1
/
6
100%