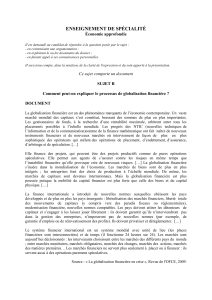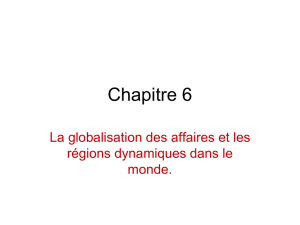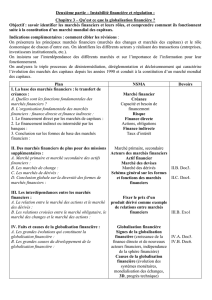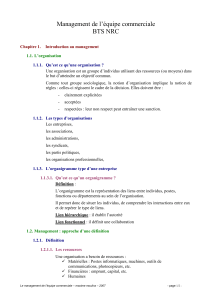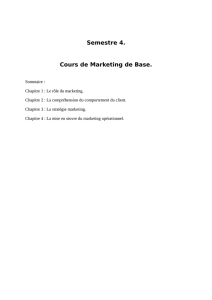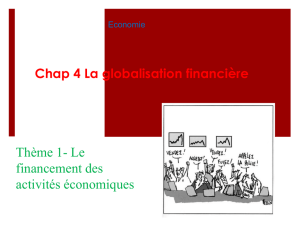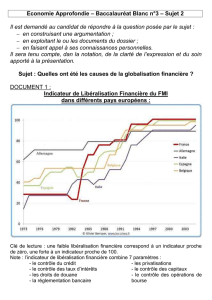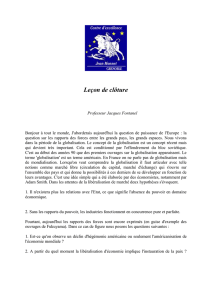UN DROIT SPONTANE DANS LA SOCIETE MONDIALE

Constitution duale :
De l’autonomie des secteurs de la société civile mondiale
Gunther Teubner
Traduction : Nathalie Boucquey
Les débats contemporains sur la globalisation présentent le droit comme pris dans des
développements économiques et politiques aboutissant à une dépolitisation, une centralisation
et une désindividualisation nouvelles des décisions dans la société. Au-delà d’observations
correctes dans le détail, ces débats sont porteurs d’une réduction politico-économique
drastique du rôle du droit dans le processus de globalisation, que je souhaite contester. Pour ce
faire, il convient tout d’abord de s’écarter de Wallerstein
1
, qui considère à tort l’élaboration
d’une société mondiale comme une priorité économique, et d’envisager les processus
autonomes de globalisation des domaines sociaux parallèles aux processus économiques. En
réaction contre l’ampleur du réductionnisme politico-économique, l’idée d’une globalisation
polycentrique s’est déjà profilée dans la théorie institutionnaliste de la « culture globale »
(global culture) de l’école de Stanford, les conceptualisations systémiques d’une société
mondiale fonctionnellement différenciée, et les nombreuses versions d’une « société civile
globale »
2
. Ce n’est qu’à cette condition que se révèle la complexité spécifique de la société
mondiale émergente, où se déploient simultanément des tendances de repolitisation, de
rerégionalisation et de réindividualisation
3
. Une thèse actuellement répandue sur la
globalisation du droit va être confrontée à une contre-thèse moins répandue :
Thèse : la globalisation signifie que le droit institutionnalise le glissement mondial du
pouvoir des acteurs étatiques vers les acteurs économiques.
Contre-thèse : la globalisation signifie que le droit a la chance d’institutionnaliser une
constitution duale de l’autonomie des secteurs de la société mondiale.
Le répertoire standard du débat sur la globalisation comprend la thèse suivante: dans la
globalisation, le rôle du droit ne consisterait pour l’essentiel qu’à formaliser le nouveau
déplacement de pouvoir entre les acteurs étatiques et les acteurs économiques. Le droit
enregistrerait les glissements aboutissant à un primat mondial de l’économie, et développerait
les concepts, normes et principes appropriés. Ici aussi, je souhaiterais critiquer le
retrécissement du débat juridique à la politique et à l’économie, et soulever une contre-thèse :
la globalisation donne aussi au droit la chance d’institutionnaliser une constitution sociale
duale, dont le développement s’ébauche dans les secteurs de la société mondiale.
Dans ce contexte, faut-il parler d’une société civile globale, en mesure d’opposer aux
mécanismes auto-régulatoires autonomisés des marchés et des arènes politiques globalisés un
troisième moment, un moment civil et démocratique ? Parallèlement à un renouvellement du
système politique, les espoirs de potentiel démocratique de la société mondiale se concentrent
1
Wallerstein, 1979
2
« Global culture » : Meyer, 1997 ; société mondiale : Luhmann, 1998, pp.373 sv. ; société civile globale :
Shaw, 1998.
3
Drori, 2000

en fait sur l’émergence d’une société civile à l’échelle globale, qui ouvrirait de nouvelles
chances de repolitisation et de réindividualisation
4
.
« Finalement, de nouveaux systèmes internationaux plus ou moins désireux de se
soustraire à l’emprise de l’Etat sont également apparus : les systèmes réglementaires
des marchés financiers internationaux, l’Internet, les réseaux d’organisations non
gouvernementales, les structures de décision des groupes transnationaux, mais aussi, à
l’ombre, le crime organisé, organisé à l’échelle mondiale, (…) qui constituent eux
aussi un potentiel mondial de démocratisation »
5
.
Mais quels sont les catalyseurs d’une société civile globale, qui pourraient opposer une
dynamique propre crédible à la dynamique économique et politique ? Aussi juste soit-il de
montrer qu’à côté de la politique et de l’économie, d’autres phénomènes sociaux se frayent
leur propre voie vers la globalisation, aussi difficile est-t-il d’identifier ces sujets de la société
mondiale. Les propositions d’identification oscillent entre l’idéalisation des mouvements
sociaux et la concentration sur les organisations formelles.
Vu leurs succès récents et spectaculaires, les mouvements de protestation sont pour ainsi dire
naturellement candidats à exercer un potentiel démocratique au niveau mondial
6
. Pourtant, ce
serait trop leur demander que de constituer un contre-pouvoir autonome face à la globalisation
de l’économie et de la politique. A vrai dire, ils sont indispensables en ce qu’ils thématisent
de manière provocante des problèmes de société dont aucune institution spécialisée ne se
charge, et leurs provocations devraient devenir d’autant plus signifiantes que les institutions
politiques nationales perdent du pouvoir. Pourtant, leurs activités ne sont que des irritations,
car elles n’ont guère la capacité de résoudre les problèmes qu’elles soulèvent. Les
mouvements de protestation sont fondamentalement parasitaires et présupposent des
institutions largement capables de résoudre des problèmes, auxquelles ils reprochent leur
étroitesse de vue bureaucratique et qu’ils peuvent provoquer à innover.
Faut-il identifier la société civile globale aux groupes d’intérêt à l’échelle mondiale ? De
façon similaire au pluralisme des groupes d’intérêt dans les Etats nationaux, ceux-ci peuvent
politiser les problèmes de la société civile et exercer une pression politique sur les institutions
politiques agissant au niveau global. Toutefois, cette vue accuse un rétrécissement à la
politique, ce qui entraîne des conséquences particulièrement fatales du fait de la faiblesse
notoire des institutions authentiquement politiques de la société mondiale.
A défaut des mouvements de protestation ou des groupes de lobby, que l’on retienne au moins
les ONG ! C’est dans les organisations non gouvernementales que l’on a pu trouver, entre
l’Etat et la multinationale, la nouvelle forme du succès des acteurs globaux
7
. Les succès
surprenants de Greenpeace, d’Amnesty International, des groupes environnementalistes et des
organisations pour les droits de l’homme semblent justifier d’y trouver le point de
cristallisation d’une société civile globale. Contrairement aux mouvements de protestation
diffus, les ONG disposent de la force de frappe et des moyens de rationalisation de
l’organisation formelle, les rendant capables de communiquer avec les organisations
gouvernementales et les entreprises multinationales. Pourtant, leur force organisationnelle est
en même temps leur faiblesse dans la société civile. C’est précisément dans l’organisation
4
Shaw, 1998, pp.238 sv.
5
Menzel, 1998, p.258.
6
Schulz, 1998 ; Falk, 1996.
7
Falk, 1996.

formelle que se trouve l’erreur de départ, car il ne s’agit pas d’un substitut à une dynamique
sociale comparable aux marchés globalisés et aux processus politiques.
A vrai dire, le seul candidat réaliste pour une société civile dynamique est le pluralisme des
systèmes sociaux à l’échelle mondiale. C’est ici que convergent les théories de la « culture
globale » (global culture), des systèmes sociaux autopoiétiques et de la société civile globale,
qui attirent l’attention sur une pluralité d’institutions globales entre l’économie et la
politique
8
. Ce n’est qu’à ce niveau que l’on trouve une dynamique sociale autonome,
possédant une chance d’autonomie face aux marchés mondiaux et aux politiques globales. Les
systèmes sociaux suivant, dans leur rationalité autonome, une voie propre vers la
globalisation, forment en premier lieu la base sociale relativement indépendante des processus
politiques et économiques au départ de laquelle les groupes d’intérêt, les organisations non
gouvernementales et les régimes de gouvernance privée, d’une part, et les mouvements
sociaux, d’autre part, peuvent développer leurs activités. A partir du moment où l’on veut
parler de façon réaliste des éléments de la société mondiale dans la société civile, il s’agit
donc d’une combinaison de sphères d’autonomie socio-structurellement stabilisées et de leur
focalisation organisationnelle.
C’est alors que l’on aperçoit les chances de globalisation cachées à la perspective politico-
économique : au sein des différents sous-systèmes sociaux, la dynamique de la globalisation
permet de reformer le lien entre la sphère spontanée et la sphère organisée. En même temps,
la globalisation signifie qu’un grand nombre de secteurs de la société se libèrent des
restrictions qui leur ont été imposées par la politique nationale. Les cartes sont à nouveau
jetées dans les rapports que les sous-systèmes entretiennent entre eux. Le processus de
globalisation ne donne pas seulement la chance d’affirmer l’autonomie des secteurs de la
recherche, de l’éducation, des soins de santé, des médias et de l’art, mais aussi d’établir pour
leurs activités un régime indépendant. De ce fait même, une tâche nouvelle incombe au droit,
celle d’institutionnaliser la constitution duale de la liberté de la société civile dans les
différents secteurs.
Dans les Etats nationaux, les domaines autonomes de la société civile ne pouvaient
développer aucun régime autonome méritant d’être mentionné. La recherche, l’éducation, la
médecine, les arts, les médias étaient des activités sociales localisées soit dans le secteur
privé, soit dans le secteur public. Pourquoi ces activités autonomes ont-elles toujours été
colonisées par des régimes politico-économiques, alors qu’il est évident que ce n’est ni sous la
domination politique, ni sous le principe de profit du marché que leurs rationalité et
normativité propres ne peuvent s’épanouir entièrement ?
La réponse se trouve dans le fait que l’on n’a jamais réussi, dans ces domaines, à
institutionnaliser un dualisme de rationalité formelle organisée et de spontanéité informelle
comme interaction dynamique dépourvue du primat de l’un ou de l’autre. Si les sous-systèmes
en question ont conquis une certaine autonomie par rapport à la politique et à l’économie, ils
l’ont reperdue dès qu’ils ont cherché à constituer l’ensemble du secteur social d’activité en
organisation formelle, et ont étouffé dans leur propre corporatisme. Plusieurs exemples
affligeants attestent cette mécompréhension du corporatisme, ayant en commun le fait d’avoir
pu établir un régime autonome face à la politique et à l’économie, mais de ne l’avoir fait que
comme domaine décisionnel formellement organisé, dépourvu de contrepartie suffisante dans
un domaine dynamique et spontané correspondant.
8
Meyer, 1997 ; Luhmann, 1998, 373 sv. ; Shaw, 1998.

Par contre, l’économie (entreprise / marché) et la politique (gouvernement / opinion publique)
sont historiquement parvenus à une telle constitution sociale duale, c’est-à-dire à la
différenciation interne d’un sous-système en un domaine spontané et un domaine organisé,
même si leur potentiel n’est pas non plus près d’être épuisé. Dans l’économie, le rapport entre
le secteur spontané constitué par le marché et le secteur organisé constitué par l’entreprise est
également fermement établi sur le plan global. Même si les entreprises économiques
hautement organisées ont pu considérablement accroître une expertise technique, des
capacités d’organisation et des techniques de financement, le secteur corporatif n’est pas
parvenu à soumettre l’ensemble du domaine économique à son contrôle. La globalisation elle-
même a exposé les plus grands groupes à la dynamique des marchés mondiaux, sans qu’ils ne
puissent la dominer, ni même qu’elle ne soit supprimée par les méga-fusions les plus récentes.
Il en va de même en politique, où le secteur organisé des partis politiques et de
l’administration étatique reste confronté au secteur spontané de l’électorat, du lobbying et de
l’opinion publique. Là aussi, la globalisation a renforcé considérablement l’aspect spontané de
la politique. Dans l’économie comme dans la politique, un domaine décisionnel hautement
rationalisé est ainsi exposé à une exigence chaotique impénétrable. Le secteur décisionnel
organisé ne reçoit aucun signal univoque du secteur spontané. En quelque sorte, il est
condamné à décider librement, et ce n’est que lorsque les décisions critiques sont tombées que
sont déclenchés les mécanismes de responsabilité spécifiques de la démocratie ou du marché.
Ce contraste entre le spontané et l’organisé semble être l’une des clés du succès des
démocraties modernes. Mais en même temps, il constitue le point de cristallisation pour de
nouveaux potentiels de démocratisation. Il s’agira toujours d’ajuster la balance précaire du
domaine spontané et du domaine organisé : les institutions démocratiques classiques
(participation, délibération, mécanismes électoraux) peuvent permettre d’augmenter le
potentiel de la démocratie, à condition de développer les contrôles réciproques du secteur
spontané et du secteur organisé.
Ce dualisme du secteur spontané et du secteur organisé comme principe d’une différenciation
fonctionnelle « réussie » est rarement envisagé dans ses implications pour la théorie de la
démocratie. La démocratie ne peut fonctionner que lorsque sont organisés et rationalisés des
potentiels décisionnels spécialisés, qui ne peuvent cependant contrôler totalement leur secteur
social, mais sont exposés à un processus de contrôle au travers d’une multiplicité
décentralisée de processus décisionnels spontanés. Généralement, l’on voit seulement que les
domaines autonomes de la politique, de l’économie, du droit et de la religion se sont
autonomisés les uns par rapports aux autres, en plusieurs impulsions, depuis la fin du moyen-
âge. Par contre, la différence critique du spontané et de l’organisé au sein d’un même sous-
système est beaucoup moins bien théorisée. Dans le système économique, elle a fait sa
première apparition lors de la révolution industrielle en Angleterre : l’économie n’était pas
constituée comme un simple marché atomistique d’acteurs individuels, ni comme une somme
d’organisations formelles, mais comme interaction d’organisations formelles dans des
marchés spontanément organisés. La différence politique correspondante fut constituée lors
des révolutions française et américaine, comme spontanéité de la démocratie et des droits
fondamentaux face à l’organisation formelle de l’Etat hautement rationalisé. Les autres sous-
systèmes, par contre, ne connaissent que des approches relativement faibles de cette
différenciation interne du spontané et de l’organisé. En Allemagne, le système scientifique
classique institutionnalisa une interaction entre la rationalité hautement organisée des
universités et une société cultivée et spontanée. Aujourd’hui, le meilleur pendant en est peut-
être le système universitaire des Etats-Unis, qui est parvenu, contrairement aux universités

européennes bureaucratisées et politisées, à combiner des activités organisées et spontanées
dans un régime relativement indépendant de la politique et de l’économie.
C’est la raison pour laquelle l’interprétation de la globalisation comme simple glissement de
pouvoir des acteurs politiques vers les acteurs économiques prend une fausse direction: il
s’agit aussi de l’émancipation des autonomies sociales. L’asphyxie des activités sociales dans
des hiérarchies politiques et dans des bureaucraties administratives est évidente, et le transfert
à l’économie déclenche l’interaction dynamique d’un marché spontané et d’une entreprise
organisée. Toutefois, le contrôle par le critère du profit bloque tout autant la rationalité propre
des secteurs de la société civile que le contrôle du pouvoir politique. Le déploiement de leurs
activités ne devient possible que lorsqu’ils réussissent à établir un régime autonome de
décisions organisées et de processus de contrôle spontanés, qui n’est pas identique au marché
régi par le profit, ni aux processus politiques régis par le pouvoir
9
.
Des constitutions pour les libertés de la société civile constituant des chances socio-
structurelles dans le processus de globalisation peuvent-elles être identifiées, ou même
juridiquement institutionnalisées ? Pour autant qu’elle ne tombe pas complètement dans les
remous des processus économiques de marché, la recherche à l’échelle mondiale semble
révéler des tendances suffisantes de développement d’un domaine spontané global. Il y est
largement question de dépolitisation, de débureaucratisation, de formes de concurrence non
économique, de pluralisation des financements, de concurrence entre les institutions de
recherche. Des tendances analogues se révèlent dans le secteur de l’éducation, où la
concurrence mondiale des universités les soustrait à la tutelle politique et bureaucratique, et
les expose davantage à la dynamique de contrôle de son propre secteur spontané.
Considérée comme une chance pour le droit, la globalisation consisterait alors à
institutionnaliser des constitutions spécifiques pour les villages globaux des secteurs
d’autonomie de la société, à distance relative de la politique et de l’économie. Le droit global
devrait avoir pour souci principal d’assurer la dualité de l’autonomie sociale dans les sous-
systèmes, c’est-à-dire une dynamique de contrôle du champ spontané et du champ organisé.
BIBLIOGRAPHIE
9
Voy. à ce sujet Teubner, 1998.
1
/
5
100%