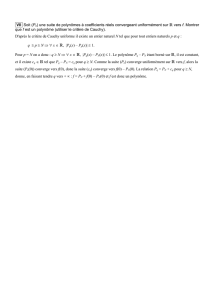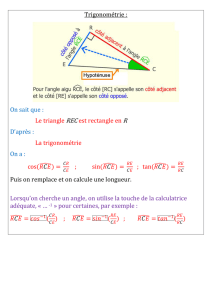Module I.1 : Compléments d`algèbre

Module I.1 : Compléments d’algèbre
I.1.1 Si les éléments (a, b)et (a′, b′)de (Z\ {0})×N∗sont équivalents, c’est-à-dire si
ab′=ba′, alors vp(ab′) = vp(ba′)⇒vp(a)−vp(b) = vp(a′)−vp(b′). Ainsi, l’application
(a, b)7→ vp(a)−vp(b)de (Z\{0})×N∗dans Zest compatible avec la relation d’équivalence
et passe au quotient en une application a
b7→ vp(a)−vp(b)de Q∗dans Z. (Si l’on prolonge
cette application à Qpar 07→ ∞, on obtient encore une valuation.)
En revanche, les couples équivalents (1,2) et (2,4) ont pour image respective par l’applica-
tion (a, b)7→ a2+ 1
b2+ 1 les rationnels distincts 2
5et 5
17 : cette application ne passe donc pas au
quotient, et l’on ne peut définir a
b7→ a2+ 1
b2+ 1 de Qdans Q.
I.1.2 Nous laisserons au lecteur le soin de vérifier que la relation est bien réflexive et symétrique et
prouverons le point le plus difficile, la transitivité. Supposons donc que (f1, J1)∼(f2, J2)et
(f2, J2)∼(f3, J3), les intervalles de coïncidence étant K⊂J1∩J2et K′⊂J2∩J3. Alors
K′′ := K∩K′est un intervalle ouvert contenant aet contenu dans J1∩J3et sur lequel f1
et f3coïncident, d’où (f1, J1)∼(f2, J2)et la transitivité.
Montrons la compatibilité à gauche de cette relation et de l’addition (qui est commutative).
On suppose que (f1, J1)∼(f′
1, J′
1), avec intervalle de coïncidence K. Pour comparer
(f1, J1) + (f2, J2)à(f′
1, J′
1) + (f2, J2), il suffit de vérifier que f1+f2et f′
1+f2sont
définies et égales sur L:= K∩J2⊂(J1∩J2)∩(J′
1∩J2), et que Lest bien un intervalle
ouvert contenant a; c’est immédiat. Le cas de la multiplication se traite pareillement.
Il est clair que, si (f1, J1)∼(f2, J2), alors f1(a) = f2(a); l’application (f, J)7→ f(a)est
donc compatible avec la relation d’équivalence, et passe donc au quotient. De même, si f1et
f2sont kfois dérivables et égales sur un intervalle ouvert contenant a, alors leurs dérivées en
ajusqu’à l’ordre ksont égales.
I.1.3 On a (par exemple) 16≡94, mais 3×1≡93×4, donc 3n’est plus régulier après passage
au quotient par ≡9. En fait, si n∈N∗, dire que a∈Nest régulier après passage au quotient
par ≡n, c’est dire que l’image de adans Z/nZest simplifiable, c’est-à-dire que aest premier
avec n.
I.1.4 (i) Bien sûr, selon les hypothèses du paragraphe 1.2.1 de la page 8, le groupe Mdoit être
commutatif. On vérifie alors que les éléments (a, 0) et (a′,0) de M×Msont équivalents
si, et seulement s’il existe c∈Mtel que a+c=a′+c, donc, Métant un groupe, si, et
seulement si, a=a′. Le morphisme M→Gest donc injectif. D’autre part, (a, b)∈M×M
est équivalent à (a−b, 0) ∈M×M, donc la classe de (a, b)dans Gest image d’un élément
de Met le morphisme M→Gest donc surjectif.
(ii) Puisque Aest intègre, x, y 6= 0 ⇒xy 6= 0 et Mest stable par multiplication; il est alors
immédiat que c’est bien un monoïde commutatif. La relation sur M×Mqui donne par passage
au quotient son groupe des fractions est la relation : (a, b)∼(a′, b′)si, et seulement s’il existe
c∈Mtel que ab′c=a′bc, c’est-à-dire ab′=a′b(puisque cn’est pas diviseur de 0). C’est
donc la restriction de la relation sur A×Mqui donne par passage au quotient le corps des
fractions de A. De plus, la définition du produit est la même dans les deux cas.

2Tout-en-un pour la licence •Niveau 2 •Solution des exercices
I.1.5 Nous noterons additivement les lois, mais la notation multiplicative est tout aussi justifiée
(comme dans l’indication). Notons a:= i(a)la classe de (a, 0) ∈M×Mdans G. La classe
de (a, b)est donc a−b. Tout morphisme grépondant à la question vérifie donc :
ga−b=g(a)−gb=gi(a)−gi(b)=f(a)−f(b).
Il n’y a donc qu’un tel morphisme possible.
L’application ϕ: (a, b)7→ f(a)−f(b)de M×Mdans G′passe au quotient; en effet,
a+b′+c=a′+b+centraîne f(a+b′+c) = f(a′+b+c), d’où (fétant un morphisme et
f(c)∈G′étant simplifiable), f(a)−f(b) = f(a′)−f(b′). Il est immédiat que l’application
g:G→G′obtenue par passage au quotient est telle que f=g◦i, et le lecteur vérifiera sans
peine que c’est un morphisme de groupes.
I.1.6 On a les équivalences :
i(a)inversible ⇔ ∃(b, s)∈A×S: (a, 1)(b, s)∼(1,1)
⇔ ∃(b, s)∈A×S:∃t∈S:tab =ts,
ce qui implique que adivise ts ∈S; réciproquement, si adivise s∈S, il suffit de prendre
t:= 1.
Lorsque S=A∗, on vérifie que A→S−1Aest injectif (aest dans le noyau si sa = 0 avec
s∈S, donc a= 0) et surjectif (a/s est l’image de as−1) ; on peut donc dans ce cas identifier
AàS−1A.
Si Scontenait le nilpotent s, on aurait 0 = sn∈S, ce que l’on a interdit. Si on l’avait permis,
on aurait (0,1) ∼(1,1) et l’anneau S−1Aserait trivial.
I.1.7 (i) Notons a/s l’image de (a, s)dans S−1A: ainsi, i(a) = a/1et l’inverse de 1/s est s/1.
S’il existe gcomme dans l’énoncé, alors :
g(a/s) = g(a/1)g(1/s) = g(a/1)g(s/1)−1=f(a)f(s)−1.
Le morphisme gest donc unique. Réciproquement, l’application (a, s)7→ f(a)f(s)−1passe
qu quotient, car :
(a, s)∼(a′, s′)⇔ ∃t∈S:tas′=ta′s,
ce qui entraîne f(a)f(s)−1=f(a′)f(s′)−1(calcul facile). Le lecteur vérifiera que l’applica-
tion gobtenue par passage au quotient convient.
(ii) Il suffit d’appliquer la « propriété universelle » ci-dessus au morphisme A→T−1Acar
l’image de Sdans T−1Aest formée d’éléments inversibles. Notons que le morphisme obtenu
s’écrit a/s 7→ a/s, mais les deux notations a/s désignent respectivement des classes dans
S−1Aet dans T−1A!
(iii) Puisque 0ne divise que lui-même, 06∈ T. Si t1, t2divisent respectivement s1, s2∈S,
alors t1t2divise s1s2∈Set Test une partie multiplicative, qui contient évidemment S, d’où
le morphisme S−1A→T−1A. Si tu =s∈S, alors l’élément a/t =au/tu de T−1Aest
image de au/s ∈S−1A, d’où la surjectivité. Si a/s a pour image 0∈T−1A, alors il existe
t∈Ttel que ta = 0. Prenant s′∈Smultiple de t(puisque t∈T), on a s′a= 0 , donc
a/s = 0 ∈S−1A, d’où l’injectivité.
(iv) Le morphisme S−1A→T−1Aa ici pour but le corps des fractions, et son injectivité se
prouve comme en (iii).
c
Dunod 2014

I.1 : Compléments d’algèbre 3
I.1.9 On sait déjà que ιaest un automorphisme de G. La loi de groupes sur Aut(G)est, bien
entendu, la composition et l’élément neutre est IdG. On calcule :
ιa◦ιb(x) = a(bxb−1)a−1= (ab)x(ab)−1=ιab(x),
d’où ιa◦ιb=ιab , et l’on a bien un morphisme de groupes.
Un élément adu noyau est tel que ιa= IdG, c’est-à-dire x=axa−1pour tout x: le noyau
est donc le centre de G.
Dire que Hest distingué, c’est dire que aHa−1⊂Hpour tout a, donc que Hest stable par
tous les automorphismes intérieurs.
Rappelons à ce propos que la propriété ∀a∈G , aHa−1⊂Himplique la propriété apparem-
ment plus forte ∀a∈G , aHa−1=H.
I.1.10 Puisque H′est distingué, on a un morphisme G′→G′/H′. Le noyau du morphisme
composé G→G′→G′/H′est f−1(H′)qui est donc bien distingué.
Si l’on prend H=G=un sous-groupenon distingué de G′et, pour f, l’inclusion canonique,
on obtient un contre-exemple à la deuxième question.
Supposons fsurjectif. Pour tout b∈G′, on a b=f(a)avec a∈Get :
bf(H)b−1=f(a)f(H)f(a−1) = f(aHa−1)⊂f(H),
et la réponse est positive : f(H)⊳G′.
I.1.11 On a nZ=mpZ⊂mZet le groupe mZ/nZest bien défini. Le composé des morphismes
surjectifs x7→ mx de Zsur mZet y7→ y(mod n)de mZsur mZ/nZest l’application de
l’énoncé, qui est donc un morphisme surjectif de Zsur mZ/nZ. Pour que a∈Zsoit dans le
noyau, il faut, et il suffit, que ma ∈nZ, c’est-à-dire que pdivise a. Le noyau est donc pZ,
d’où un isomorphisme x(mod p)7→ mx (mod n)de Z/pZsur mZ/nZ.
I.1.12 Rappelons que HG′={hg′|h∈H , g′∈G′}. Naturellement, e=ee ∈HG′(élément
neutre). D’autre part, avec des notations évidentes :
(h1g′
1)(h2g′
2) = h1(g′
1h2g′
1−1)(g′
1g′
2) = hg,
où h:= h1(g′
1h2g′
1−1)∈H(car celui-ci est distingué) et g:= g′
1g′
2∈G′. Ainsi, HG′est
stable par multiplication. De plus :
(hg′)−1= (g′−1h−1g′)g′−1=h′′g′′,
où h′′ := g′−1h−1g′∈H(car celui-ci est distingué) et g′′ := g′−1∈G′. Ainsi, HG′est
stable par passage à l’inverse. C’est donc un sous-groupe de G. Enfin :
(hg′)h0(hg′)−1=h(g′h0g′−1)h−1∈H,
car g′h0g′−1∈H(puisque celui-ci est distingué). On en déduit que Hest distingué dans
HG′.
L’élément hg′(mod H)de HG′/H est l’image de g′∈G′par le morphisme composé
G′→HG′→HG′/H . Ce morphisme est donc surjectif. De plus, g′∈G′est dans le
noyau si, et seulement si, g′∈H. Le noyau est donc G′∩H, d’où l’isomorphisme g′
(mod G′∩H)7→ g′(mod H)de G′
G′∩Hsur HG′
H.
c
Dunod 2014

4Tout-en-un pour la licence •Niveau 2 •Solution des exercices
I.1.13 Rappelons qu’un élément de torsion d’un groupe abélien (noté additivement) est un élé-
ment d’ordre fini. L’élément a:= a(mod Z)∈C/Zest de torsion si, et seulement
s’il existe m∈N∗tel que ma = 0,i.e. ma ∈Z, autrement dit si, et seulement si,
a∈Q/Z. L’image d’un élément de torsion par un morphisme est un élément de torsion (car
ma = 0 ⇒mf (a) = f(ma) = 0), et le seul élément de torsion de Cest 0, donc tout
morphisme fde C/Zdans Cest trivial sur Q/Z.
Rechercher un morphisme logarithme de C∗dans C, c’est rechercher une application log de
C∗dans Cqui soit un morphisme de groupe et telle que exp(log x) = x. Il revient au même
de chercher le morphisme L=1
2iπlog tel que EL(x)=x, où l’on a introduit l’application
E:z7→ exp(2iπz). Le morphisme Lserait donc nécessairement injectif. Le morphisme E
du groupe additif Csur le groupe multiplicatif C∗induit par passage au quotient un isomor-
phisme εde C/Zsur C∗. En composant, on obtiendrait donc un morphisme injectif de C/Z
dans C, ce qui est impossible d’après ce qui a été vu plus haut.
I.1.14 Puisque n=mp, on a nZ⊂mZ, l’image de l’idéal nZpar le morphisme surjectif
Z→Z/mZest nulle, et l’on obtient par passage au quotient un morphisme surjectif d’anneaux
Z/nZ→Z/mZ. Son noyau est formé des x(mod nZ)tels que x(mod mZ) = 0, c’est-à-
dire tels que x∈mZ: ce noyau est donc l’idéal mZ/nZde Z/nZ.
I.1.15 Il est clair que (X2+ 1)Z[X]⊂Z[X] = Aet que (X2+ 1)Z[X]⊂(X2+ 1)R[X] = J,
donc que (X2+ 1)Z[X]⊂A∩J. Soit réciproquement P∈A∩J. La division euclidienne
de P∈A=Z[X]par le polynôme unitaire X2+ 1 ∈Z[X]donne un quotient et un reste
Q, R ∈Z[X]. Comme c’est aussi une division euclidienne dans R[X]et que P∈J, le reste
Rest nul, et P= (X2+ 1)Q∈(X2+ 1)Z[X], d’où l’égalité A∩J= (X2+ 1)Z[X].
Le morphisme A→R[X]
(X2+ 1)R[X]=R+Ri = Ca pour noyau A∩Jet identifie donc
A
A∩J=Z[X]
(X2+ 1)Z[X]au sous-anneau Z+Zide Cformé des entiers de Gauß.
I.1.16 On sait déjà que la relation (congruence modulo un sous-groupedans un groupe commutatif)
est compatible avec l’addition. Soient a, b ∈Atels que a≡b(mod I), c’est-à-dire a−b∈I.
Alors, pour tout c∈A:
ca−cb =c(a−b)∈I⇒ca ≡cb (mod I)et ac−bc = (a−b)c∈I⇒ac ≡bc (mod I).
La relation est donc compatible avec la multiplication. Les mêmes méthodes que dans le
cours permettent alors de munir le groupe quotient A/I d’une (unique) structure d’an-
neau telle que la projection canonique A→A/I soit un morphisme d’anneaux : on pose
(a(mod I)) (b(mod I)) := (ab (mod I)).
Soit réciproquement une relation d’équivalence compatible avec l’addition et la multiplication.
En notant Ila classe de 0, on sait déjà que Iest un sous-groupe et que notre relation est la
congruence modulo I. La compatibilité avec la multiplication entraîne de plus que Iest un
idéal bilatère.
c
Dunod 2014

I.1 : Compléments d’algèbre 5
I.1.17 Soit M:= (ai,j )∈Mn(K). Alors Ei,j M Ek,l =aj,kEi,l . Si l’on suppose que Mest un
élément non nul d’un idéal bilatère Iet que aj,k 6= 0, on en déduit que Icontient tous les
Ei,l et donc que I=Mn(K). (Il est clair a priori qu’un idéal bilatère est en particulier un
sous–espace vectoriel).
Soient ϕet ψdes endomorphismes de l’espace vectoriel Ede dimension infinie. On suppose
que ϕest de rang fini. Alors ϕ◦ψet ψ◦ϕsont de rang fini (majoré par celu de ϕ), d’où la
stabilité de l’ensemble des endomorphismes de Ede rang fini par multiplication dans LK(E).
L’endomorphisme nul est de rang fini. Si ϕet ψsont tous deux de rang fini, leur somme est
de rang fini (majoré par la somme des deux rangs) et −ϕégalement. On a donc bien un idéal
bilatère. Il n’est pas nul, car il contient les projections sur des droites, ni égal à LK(E), car
IdEn’est pas de rang fini.
I.1.18 L’élément x∈Ea pour image 0∈E+F
Fsi, et seulement si, x∈F. Le noyau est donc
bien E∩F, d’où, par passage au quotient, une application linéaire injective de E
E∩Fdans
E+F
F. Si e∈E, f ∈F, l’élément (e+f) (mod F)de E+F
Fadmet pour antécédent e
(mod E∩F)dans E
E∩F, et le morphisme est surjectif.
Remarquons que, si tous ces espaces sont de dimension finie, on en déduit la formule :
dimKE−dimK(E∩F) = dimK(E+F)−dimKF.
Sous une forme encore plus utile :
dimK(E+F) = dimKE+ dimKF−dimK(E∩F).
I.1.19 On a vu dans [L1] que K[X] = <P > ⊕Kn−1[X], la décomposition A=P Q +Rétant
obtenue par division euclidienne. Cette décomposition est d’ailleurs valable pour n= 0, car on
a alors <P > =K[X]et Kn−1[X] = {0}. On a donc un isomorphisme d’espaces vectoriels :
K[X]/<P > ≃Kn−1[X]. Comme tout idéal non nul de K[X]est de la forme <P > avec P
unitaire de degré n>0, la conclusion s’ensuit.
I.1.20 Écrivons H1:= Ker λ1,...,Hk:= Ker λk, où λ1,...,λksont des formes linéaires non
nulles sur le K-espace vectoriel E. Alors H1∩... ∩Hkest le noyau de l’application li-
néaire Λ := (λ1,...,λk)de Edans Kk. D’après le théorème du rang, la codimension de
H1∩...∩Hkest égale au rang de Λ. Cette codimension vaut donc ksi, et seulement si, Λ
est surjective.
Par ailleurs, Λn’est pas surjective si, et seulement si, son image est contenuedans un hyperplan
de Kk, c’est-à-dire si, et seulement s’il existe une équation non triviale a1x1+···+akxk= 0
sur Kksatisfaite par tous les éléments de Im Λ, c’est-à-dire si, et seulement si, λ1,...,λk
sont liées.
c
Dunod 2014
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
 260
260
 261
261
 262
262
 263
263
 264
264
 265
265
 266
266
1
/
266
100%