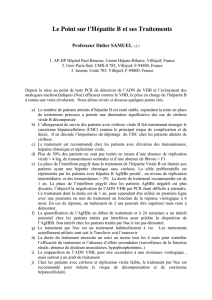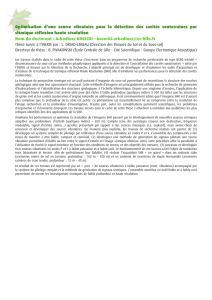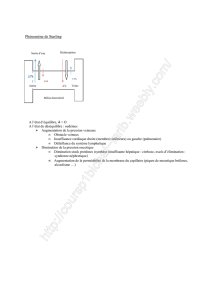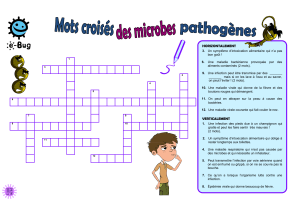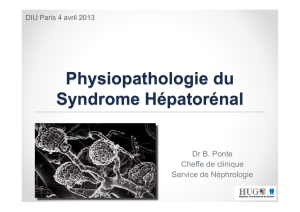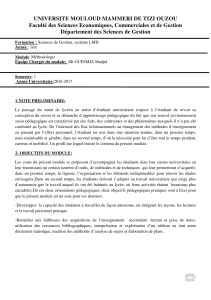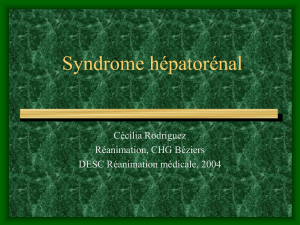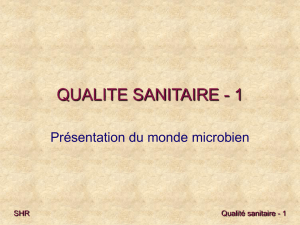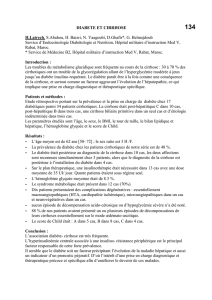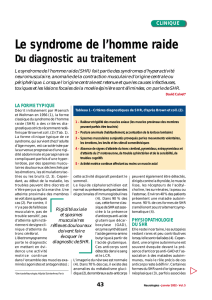C D o s s i e r t h...

Dossier thématique
Dossier thématique
5
La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue - Vol. XI - n° 1 - janvier-février 2008
échec thérapeutique. Durant la dernière décennie, la prévention
du SHR a considérablement progressé en raison du bénéfice
démontré de l’antibioprophylaxie et de l’expansion volémique
par perfusion d’albumine. Par ailleurs, l’utilisation de drogues
vasoactives est responsable d’une amélioration ou d’une régres-
sion du SHR dans environ 70 % des cas. Bien que le bénéfice de
survie lié à l’utilisation de la terlipressine ou de le noradrénaline
ne semble pas démontré sur l’ensemble des patients atteints de
SHR, la survie à 2 mois des patients répondeurs à la terlipressine
ou à la noradrénaline est significativement supérieure à celle des
patients non répondeurs. Le bénéfice de la corticothérapie pour
la survie à court terme chez les patients atteints de formes sévères
d’hépatite alcoolique aiguë est maintenant admis. De plus, des
études récentes ont développé des critères précoces permettant
de classer un patient comme répondeur à la corticothérapie.
L’intérêt de modèles pronostiques tels que le modèle de Lille est
l’identification dès le septième jour de traitement des malades ne
tirant aucun bénéfice de la corticothérapie. Les futurs travaux
devront tester de nouvelles molécules afin d’augmenter le pour-
centage de réponse au traitement et développer de nouvelles
stratégies pour les patients restant en impasse thérapeutique. La
prise en charge thérapeutique de l’infection du liquide d’ascite
a été considérablement modifiée par une étude randomisée qui
a montré une réduction du risque de SHR (10 % versus 33 %)
et de la mortalité à 3 mois (22 % versus 41 %) chez les patients
recevant l’association céfotaxime et expansion volémique par
perfusion d’albumine comparativement aux patients traités par
céfotaxime seul.
Les auteurs de ce dossier thématique, Arnaud Pauwels, Jean-Didier
Grangé, Philippe Sogni, Philippe Mathurin et Jean-Pierre Bronowicki,
ont analysé les travaux récents et les textes d’experts, résumé les
principales données issues de ces travaux et souligné les questions
non encore résolues. Je vous souhaite une bonne lecture. n
C
hez les patients ayant développé une complication de leur
cirrhose, l’utilisation de nouvelles molécules, les progrès
de l’hémostase endoscopique, la meilleure compréhen-
sion de la physiopathologie de ces complications et l’identifica-
tion précoce du sous-groupe ayant un risque élevé de décès à
court terme ont permis d’améliorer l’arsenal thérapeutique. Le
comité de rédaction de La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue
a considéré qu’un dossier thématique sur les complications de
la cirrhose était utile afin de résumer les principales données
des études récentes, mais aussi de mettre en perspective les
enjeux thérapeutiques. Les complications abordées dans ce
dossier sont le syndrome hépato-rénal (SHR), l’hémorragie par
rupture de varices œsophagiennes, l’infection du liquide d’ascite,
l’hépatite alcoolique sévère et la réactivation virale B dans la
cirrhose décompensée. D’emblée, une observation s’impose :
le pronostic de chaque complication a été considérablement
amélioré pendant la dernière décennie.
Les patients ayant une cirrhose virale B décompensée avec
réplication virale étaient jusqu’à il y a peu en impasse théra-
peutique. L’utilisation récente des analogues nucléosidiques
ou nucléotidiques permet le contrôle rapide de la réplication
virale et l’amélioration de la fonction hépatocellulaire. On
peut envisager un traitement à la carte chez les patients admis
pour une hémorragie digestive. Par exemple, l’association d’un
traitement vasoactif et d’un traitement endoscopique, moda-
lité considérée comme optimale, pourrait être restreinte au
sous-groupe de patients ayant une hémorragie active ou une
instabilité hémodynamique. En cas d’échec, la prise en charge
de deuxième ligne, bien que moins codifiée, peut faire appel
au TIPS, option permettant parfois de contrôler un patient en
Traitement des complications aiguës de la cirrhose :
les progrès thérapeutiques permettent une diminution
de la mortalité à court terme
IP Philippe Mathurin*
* Service d’hépato-gastroentérologie, hôpital Claude-Huriez, CHRU Lille.
Avant-propos
Question :
Qui a décrit ainsi le tableau clinique de la fissure anale aiguë ?
La dame mise en doute, ajouta seulement, qu’elle faisait à présent “des vents en allant à la selle, que c’était comme un vrai
feu d’artifice… Qu’à cause de ses nouvelles selles, toutes très formées, très résistantes, il lui fallait redoubler de précautions…
Parfois, elles étaient si dures les nouvelles selles merveilleuses, qu’elle en éprouvait un mal affreux au fondement…
Des déchirements… Elle était obligée de se mettre de la vaseline alors avant d’aller aux cabinets.” C’était pas réfutable.
Quizz fissure anale
1
/
1
100%