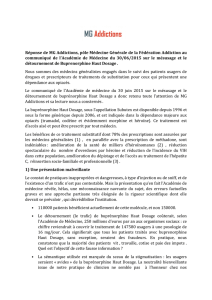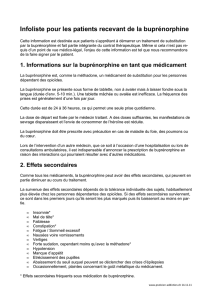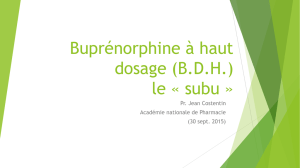Lire l'article complet

121
Le développement des traitements de substi-
tution par la méthadone, puis par la buprénor-
phine haut dosage, a tout à la fois contribué à
la profonde modification des modes de repré-
sentation des conduites addictives et les a
consacrés. “La stratégie de prise en charge de
la toxicomanie était auparavant centrée sur le
génie pharmacologique des molécules. Dans
cette représentation, qui occultait la recherche
du plaisir conduisant à la dépendance, point
commun de toutes ces substances, le produit
était responsable de tout. Et la stratégie théra-
peutique se cristallisait uniquement sur le
sevrage, en négligeant de prendre en charge
une véritable éducation à la santé”, exposait
en “prologue” le Pr Philippe-Jean Parquet
“À l’époque, l’intérêt s’était concentré sur
une figure emblématique, celle du grand
héroïnomane. Cette notion a dû être large-
ment pondérée avec la description de popula-
tions de toxicomanes bien diversifiées, allant
de l’usager nocif à celle de consommateurs
sans problème. Parallèlement, on a glissé du
concept de ‘toxicomane-délinquant’ à celui
de ‘toxicomane-patient’, tout en faisant
émerger la notion de vulnérabilité. Cette
vision différente et plus graduelle a permis
d’aboutir à la définition de micro-objectifs
fragmentés et parfois contradictoires. Ces
transformations ont conduit à légitimer des
pratiques nouvelles, et c’est dans le cadre
d’une stratégie devenue multifactorielle,
autour de ‘toxicomanes-patients’, qu’est née
la substitution.”
Désormais l’important était de favoriser l’ac-
cès aux soins et de permettre le recours prag-
matique à des actions visant la réduction des
risques et dommages encourus par les usa-
gers de drogues. En quelques années, la
notion de toxicomane-délinquant a donc fait
place à la notion d’usager de drogue considé-
ré comme un patient, ayant besoin d’une prise
en charge médicale comme les autres
patients, sans discrimination, en ville. “Les
autorités ont estimé que les médecins généra-
listes seraient les mieux à même d’assurer la
prise en charge des traitements de substitution
avec la buprénorphine haut dosage en méde-
cine de ville. Il s’agissait, en 1996, d’une stra-
tégie innovante en France. Et nombre de
questions se sont alors posées : les médecins
sauraient-ils prendre en charge ces patients?
Les malades allaient-ils adhérer à cette nou-
velle offre de soin de leur toxicomanie ?”,
résumait le Dr Laurent Cattan.
Des bénéfices communautaires
et individuels confirmés
La réponse est clairement affirmative, même
si le dispositif actuel et les pratiques profes-
sionnelles sont encore et toujours perfectibles.
Les chiffres des décès et des interpellations en
sont des indicateurs clés, tout comme les
résultats principaux de nombreuses études,
initiées par Schering-Plough, les associations
de patients, les DDASS, l’Assurance Maladie
(plus de 25 000 dossiers étudiés), l’OFDT
(Observatoire français des drogues et des toxi-
comanies), l’Agence du médicament, les
CEIP (Centres d’évaluation et d’information
sur la pharmacodépendance, Oppidum)…
Premier avantage : le nombre des surdoses,
évaluées à près de 500 par an en 1996, s’est
spectaculairement abaissé à près de 70 par an
à partir de 2000.
Deuxième avantage, significatif également :
les interpellations pour usage et revente d’hé-
roïne ont également diminué, tandis que celles
entraînées par l’usage ou la revente de canna-
bis et de cocaïne augmentaient.
En ce qui concerne les études portant sur les
prises en charge, toutes se sont accordées sur
leur cohérence : les patients restaient dans le
système de soins (68 % à deux ans, étude
Spesub), la posologie évoluant autour d’une
moyenne de 8 mg par jour (études Spesub en
1998, Oppidum et Anisse en 2000).
Quant au bénéfice individuel que les
patients ont manifestement retiré du traite-
ment de substitution par rapport à la pour-
suite de leur consommation d’héroïne, les
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
Buprénorphine haut dosage,
l’âge de raison
Florence Arnold Richez
En 1996, les pouvoirs publics autorisaient la mise en vente de la
buprénorphine haut dosage dans l’indication de traitement de
substitution des patients héroïnomanes. Sept ans plus tard, on compte
80 000 patients traités par buprénorphine haut dosage, dont 85 %
le sont par des médecins généralistes en ville. Sept ans plus tard –
échéance classique des “crises” conjugales comme des mises à plat
politiques – quel bilan en tirer ? Le compte-rendu de ce séminaire, qui
s’est tenu à Biarritz les 4 et 5 avril derniers, organisé par les
laboratoires Schering-Plough avec les interventions du Pr Philippe-
Jean Parquet (*) du Dr Jean-Pierre Daulouède (**) et du Dr Laurent
Cattan (***), est très clair : ce traitement a prouvé son intérêt en
termes de bénéfices pour la Santé Publique, pour l’individu, pour
les professionnels qui se sont impliqués effectivement pour une partie
d’entre eux. Mais qu’en est-il exactement du mésusage de la
buprénorphine haut dosage et du nomadisme de certains patients ?
(*) Professeur à l’université de Lille, président
du Conseil d’administration de l’OFDT.
(**) Médecin psychiatre. Directeur du centre
de soins en addictologie BIZIA, Médecin du
Monde, centre hospitalier de la côte Basque, à
Bayonne.
(***) Médecin généraliste, président de
l’Association nationale des généralistes pour la
réflexion et l’étude de l’hépatite C. ANGREHC.
Voir aussi l’article concernant : “La prise en
charge des toxicomanes par les traitements de
substitution dans les Hauts-de-Seine”, de B. Le
Dieu de Ville, publié dans le Courrier des
addictions 2003 ; 2, 5 : 52-9.

122
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
Le Courrier des addictions (5), n° 3, juillet-août-septembre 2003
études ont montré qu’une grande majorité
d’entre eux avaient abandonné l’héroïne
(étude Aides : 77 %).
Même constat positif en ce qui concerne la
réinsertion psychosociale.
Ainsi, l’étude Subtares, réalisée dès la mise
à disposition de la buprénorphine haut
dosage, met en évidence une amélioration
de la recherche de l’emploi et du logement,
tout comme, plus récemment, l’étude
Anisse : les patients sont mieux intégrés
dans leur travail. Ils quittent le squat pour
un logement stable et indépendant. Et ils
reconnaissent une diminution de la délin-
quance et de la prostitution…
Enfin, pour compléter ce bilan, des travaux
se sont focalisés sur l’évolution de l’infection
à VIH chez les patients : les séroconversions
VIH ont diminué et, selon les chiffres de
l’OFTD, la prévalence de l’infection à VIH
a diminué de 1995 à 1997 (18,7 % en 1995
et 15,4 % en 1997). Toujours dans le cadre
du sida, un travail réalisé à partir des don-
nées de la cohorte MANIF 2000 montre que
la prise en charge par Subutex®facilite l’ac-
cès et la compliance aux traitements antiré-
troviraux.
Les professionnels
se sont impliqués
Au début, l’étude Appropos a montré que
20 % des médecins généralistes prescri-
vaient de la buprénorphine haut dosage. On
dispose aujourd’hui d’une autre source de
données, celle de l’Assurance maladie, qui
peut, grâce au codage des médicaments,
mesurer combien de médecins assurent une
prise en charge des patients par une substi-
tution avec ce médicament : 23 % en
Aquitaine, 25 % dans les Bouches-du-
Rhône et 25 % en Picardie en 1999, puis
38 % dans cette même région en 2002…
“Bien sûr, tous ne prennent pas en charge le
même nombre de patients, et ce sont 11 %
d’entre eux qui s’occupent de près de la
moitié des patients ainsi traités”, corrigeait
le Dr Laurent Cattan. “La grande majorité
(70 %) travaillent en collaboration avec un
réseau, dont une partie (30 %) dans un
réseau formalisé”, précisait-il. Quant aux
pharmaciens, ils ont été rapidement moti-
vés et impliqués dans cette modalité de
prise en charge : près de 65 % délivrent ce
traitement, selon une étude menée par
Schering-Plough.
La réalité du mésusage :
le problème des injecteurs
“Détournement du système de soin avec
revente et trafic, non-respect des modali-
tés de prescription, association massive
avec les benzodiazépines, le mésusage est
identifié de façon quasi unanime à la pra-
tique des injecteurs, à la lourdeur de leur
comorbidité psychiatrique”, exposait ensuite
le Dr Jean-Pierre Daulouède. Les sources
très nombreuses – Aides, Oppidum, Assurance
maladie, Spesub, Subtares, Anisse, les
PES (programme échange de seringues) –
convergent sur le pourcentage moyen de
patients injecteurs suivis par les médecins
généralistes : entre 15 et 20 %, avec un
pourcentage plus élevé au début de la
prise en charge (de 20 à 13 % dans l’étude
Subtares, de 14 à 8 % après 1,5 an dans
Spesub), ou au sein d’une population net-
tement plus marginale (40 % en 2001 des
patients, dans une étude d’Aides). Ce
pourcentage d’injecteurs reste très sem-
blable selon que les patients sont traités
par buprénorphine haut dosage (19 %) ou
par méthadone (16 %). En revanche, on
observe des différences dans les sub-
stances injectées : les patients sous bupré-
norphine haut dosage s’injectent ce médi-
cament-là, alors que les patients sous
méthadone s’injectent de la cocaïne, des
benzodiazépines… et de l’héroïne. Ces
injecteurs disent tous qu’ils sont toujours
à la recherche d’un “effet-pic”, procuré
par l’injection : “Un héroïnomane est
habitué à passer ses journées avec une
alternance de pics d’opiacés et de phases
de manque, alors que le médicament en
une prise par jour lui assure une stabilité
neurobiologique tout au long de la journée.”
Quant au nomadisme médical, redouté au
démarrage de la prise en charge en ville des
patients par ce traitement, les études de
l’Assurance maladie montrent que 70 à
80 % des patients ont un prescripteur
unique, ce qui constitue un indicateur
objectif de la qualité de la prise en charge.
Et les autres ? Selon une étude menée par
Aides, certains usagers vivent totalement en
dehors du système de soins, d’autres justi-
fient l’achat de produits de substitution au
marché noir par l’inadéquation de la poso-
logie prescrite par leur médecin.
En miroir : les médecins
prescripteurs et leurs patients
Comment améliorer la prise en charge en
ville, le confort de vie des patients, inflé-
chir le détournement du médicament et son
mésusage ? Pour le savoir, il fallait aller au-
delà de cette photographie de la prise en
charge et de cet “état des lieux” chiffré,
pour saisir plus finement l’origine des dif-
ficultés rencontrées, et par les médecins et
par les patients : c’est l’objet que s’est fixé
une étude Louis Harris en cours de publi-
cation, qui a inclus 460 médecins, analysé
2547 questionnaires remplis par le méde-
cin et 1 291 auto-questionnaires de patients
envoyés directement par la poste. Dans
1172 cas, on pouvait apparier, en miroir,
fiche médecin et fiches patients.
Première constatation : “Le patient toxico-
mane n’est pas plus opposant, peu adhérant
au traitement, plus ‘infidèle’ qu’un autre
souffrant d’une pathologie lourde chronique”,
commentait le Dr Jean-Pierre Daulouède :
La réalité de la dépression
et des troubles psychiatriques
des patients
La dépression, l’un des points clés de
l’enquête Louis Harris, reste difficile à
évaluer avec rigueur : les médecins
parlent de 40 % d’épisodes dépressifs
au cours des derniers mois, dont 19 %
de dépressions avérées ; 48 % des
patients disent avoir souffert d'un épi-
sode dépressif (échelle MINI) au cours
du dernier mois.
L’importance de la consommation de
benzodiazépines constitue à l’évidence
un énorme problème : dans cette étude,
60 % des patients suivis par un système
de soins depuis plus de deux ans n’en
prennent plus, mais 15 % consomment
des benzodiazépines à demi-vie courte
et 14 % des molécules à faible ou
moyenne activité. Ces résultats repo-
sent l’épineux problème du cadre de
prescription de ces molécules et justi-
fient sans doute un travail de réflexion
plus poussé sur les comorbidités psy-
chiatriques et sur le nécessaire accom-
pagnement psychothérapeutique de
certains patients.

123
en effet, 75 % des patients sont suivis par le
même médecin depuis au moins deux ans,
une “permanence” de la prise en charge due
aussi à la nature même du traitement de substi-
tution. Et avant qu’ils ne soient ainsi pris en
charge ? Quatorze pour cent d’entre eux
avaient en fait déjà commencé le traitement
avec un autre médecin et 23 % y avaient déjà
recouru en autoprescription “sauvage”. “Une
entrée en matière pour une prise en charge plus
cadrée par la suite”, commentait le Dr Jean-
Pierre Daulouède.
Dans cette étude, les patients disent prendre
tous les jours en moyenne 7,8 mg de bupré-
norphine haut dosage et les médecins en pres-
crire en moyenne 7,7 mg, c’est-à-dire des
posologies conformes à l’AMM et en accord
avec les autres études qui évaluent la moyenne
nationale à 8 mg par jour.
L’enquête s’est penchée sur le mode de prise,
en évaluant notamment les multiprises journa-
lières et en précisant le profil des patients qui
ne respectent pas la posologie journalière en
prise unique, principe de base d’une prise en
charge cohérente. Ces patients qui ont des
prises multiples quotidiennes souffrent plus
souvent de troubles anxieux que les autres. Ils
consomment plus de benzodiazépines pres-
crites ou non. Ils ont un profil de toxicomanie
plus prononcé et, en particulier, des associa-
tions à la cocaïne plus fréquentes. Ils suscitent
plus facilement le soupçon de mésusage chez
leur médecin. Enfin, ils ont moins souvent une
délivrance quotidienne en pharmacie.
L’enquête a aussi évalué l’importance des
réseaux, condition d’optimisation du traite-
ment, en se focalisant sur le duo médecin-
pharmacien : dans 46 % des cas, le médecin
et le pharmacien ont formé un vrai réseau
autour de leur patient, mais dans 35 % des
cas, il n’y a pas eu de contacts. Quant aux
patients, 85 % se disant satisfaits, ils sont
84 % à aborder les problèmes qui se présen-
tent à eux avec leur médecin généraliste, puis
avec leur pharmacien…
Qui sont les injecteurs ? Pourquoi arrêtent-il d’injecter
leur buprénorphine haut dosage ?
Dans l’étude Louis-Harris, 17 % des patients interrogés disent s’être injecté le médi-
cament au cours du dernier mois. En revanche, ils sont plus de 40 % à dire s’être
injecté de la buprénorphine haut dosage au moins une fois dans leur vie. Ce sont
d’anciens injecteurs par voie veineuse, qui ont souvent pris de la buprénorphine haut
dosage de façon sauvage avant une prescription médicale. La recherche du bon dosage
pourrait être une des raisons avancées dans le cas du nomadisme médical et pharma-
ceutique. Enfin, ils ont souffert d’épisodes dépressifs. La très grande fréquence des
dépressions montre combien il est important que le généraliste puisse se tourner grâce à
son réseau, vers le spécialiste psychiatre, le psychologue ou le Centre spécialisé aux soins
des toxicomanes (CSST) pour une prise en charge psychothérapeutique.
Nombre de patients, toutefois, arrêtent les injections grâce aux informations que
leur donne le médecin sur la façon correcte de prendre de la buprénorphine haut
dosage et sur les risques qu’ils encourent (veinite, hépatotoxicité, phlébite, abcès) : 16 %
des patients injecteurs reconnaissent avoir cessé parce que leur médecin leur avait
réexpliqué que le médicament se prenait en sublingual, et 36 % parce que leur
généraliste les avait mis en garde contre les risques ; 10 % ont cessé lorsque celui-
ci a augmenté la posologie et 21 % à cause de problèmes de santé liés à l’injection.
La révolution de l’utilisation
de la buprénorphine haut dosage
en ville aux États-Unis
L’utilisation de la buprénorphine haut dosage par les médecins de ville
aux États-Unis est une révolution médicale, qui va permettre aux quatre
cinquièmes des héroïnomanes américains actuellement non traités par
la méthadone, et à une partie de ceux dont l’état est bien stabilisé par
celle-ci, d’être pris en charge efficacement et en toute sécurité, déclare
Glen R. Hanson, le directeur exécutif du Nida dans son éditorial du Nida
Notes.Par ailleurs, il juge cette modalité de traitement moins stigmati-
sante car moins contraignante que celle à la méthadone.
En effet, depuis octobre dernier, l’administration américaine (FDA) a,
donné l’autorisation de prescription en ville de ce médicament de sub-
stitution à 2 000 médecins, déjà testé par 2 400 patients au cours de la
dernière décade. Le “protocole” qui prévaut outre-Atlantique est de
commencer par stabiliser les patients avec la buprénorphine haut dosage
puis de les “passer” au suboxone, une combinaison de buprénorphine
haut dosage et de naloxone, qui permet de réduire les risques de mésu-
sage, et surtout l’injection de la buprénorphine haut dosage seule.
Glen R.Hanson (Directeur exécutif du NIDA, États-Unis).Nida Notes, mars
2003, vol 17, n°5 : 3-4.
Alcool et procréation médicalement
assistée : mauvaise association
On savait que la consommation d’alcool d’au moins six doses de boissons
par semaine, provoquait des flux menstruels plus importants, une élévation
du taux plasmatique d’estradiol, modifications hormonales susceptibles
d’avoir un impact sur la procédure de procréation médicalement assistée.
Cette étude récente qui a porté sur 221 couples ayant fait appel à ces tech-
niques dans 26 centres américains a montré que pour une consommation
de même importance, le “rendement” de la technique était nettement
infléchi à la baisse : ainsi une consommation de plus d’un verre de boisson
alcoolisée par jour (soit 12 g d’alcool pur), le nombre d’ovocytes recueillis
par aspiration baissait de 13 %, et que le risque de ne pas voir la pro-
cédure se conclure par une grossesse était accru d’un facteur 2,86. Ce
risque de ne pas mener une telle grossesse à son terme est quasi linéaire-
ment corrélé au volume d’alcool bu. En revanche, la consommation d’al-
cool par le père ne semble pas affecter sa propre fertilité ou le taux de suc-
cès de la PMA, apprécié par le nombre de grossesses initiées. Ce n’est pas
le cas du nombre de grossesses menées à leur terme, qui est d’autant
moins important que le père boit… et surtout de la bière !
Klonof-Cohen H et al. (États-Unis). Fertility & Sterility 2003 ; 79 : 330-9.
F.A.R.
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
1
/
3
100%