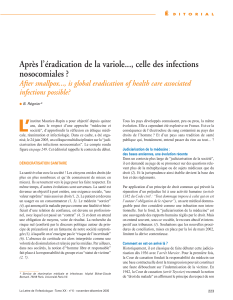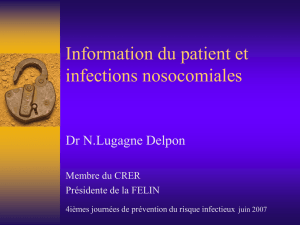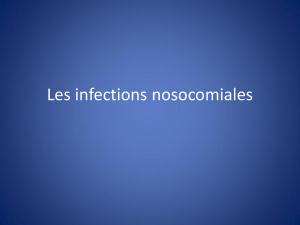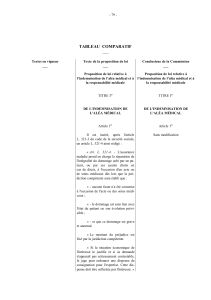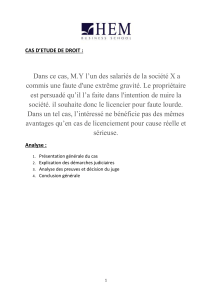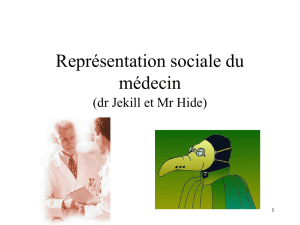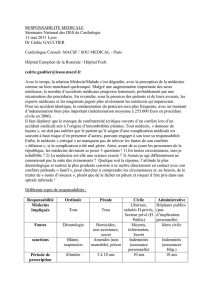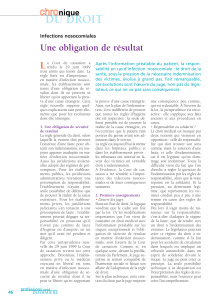L’ É

L’
institut Maurice-Rapin a pour objectif depuis quinze
ans, dans le respect d’une approche “médecine et
société”, d’approfondir la réflexion en éthique médi-
cale, réanimation et infectiologie. Dans ce cadre, a été organisé, le
24 juin 2005, un colloque multidisciplinaire sur la “judiciarisation
des infections nosocomiales”. Cet éditorial rappelle le contexte
du débat.
DÉMOCRATISATION SANITAIRE
La santé évolue avec la société ! Les citoyens ont des droits (de
plus en plus nombreux et qu’ils connaissent de mieux en mieux).
Ils se tournent vers le juge pour les faire respecter. En même
temps, d’autres évolutions sont survenues. La santé est devenue
un objectif à part entière, une exigence sociale, “une valeur suprême”
mais aussi un droit (1, 2). Le patient est devenu un usager ou un
consommateur (1, 3). Le médecin “sorcier” (4), qui annonçait la
maladie perçue comme une fatalité et bénéficiait d’une relation
de confiance, est devenu un professionnel, avec lequel est passé
un “contrat” (4, 5) et dont on attend une obligation de moyens,
voire de résultat. La recherche du risque nul (conforté par le dis-
cours politique autour du principe de précaution) est un fantasme
de notre société surprotégée (3), à laquelle on n’enseigne pas le
“risque de l’incertitude” (6). L’absence de certitude est alors inter-
prétée comme une volonté de dissimulation et relayée par les
médias. Par ailleurs, dans nos sociétés, la notion d’“homme libre
et responsable” fait place à la responsabilité du groupe et au “sta-
tut de victime” (2, 7).
Tous les pays développés connaissent, peu ou prou, la même évo-
lution. Elle a cependant été explosive en France. Est-ce la consé-
quence de l’électrochoc du sang contaminé au pays des droits de
l’homme ? Et d’un pays sans tradition de santé publique qui, bru-
talement, entend passer du rien au tout… ?
Judiciarisation de la médecine :
des bases anciennes, une évolution récente
Dans un contexte plus large de “judiciarisation de la société”, il
est demandé au juge de se prononcer sur des questions relevant
plus de la métaphysique ou de sujets médicaux que du droit (2).
Et la jurisprudence ainsi établie devient la base des lois et des
règlements.
Par application d’un principe de droit commun qui prévoit la répa-
ration d’un préjudice lié à une activité humaine (article 1382 du
Code civil : “Tout dommage impose à celui qui en est l’auteur
l’obligation de le réparer”), un acte médical dommageable peut
être considéré comme une infraction non intentionnelle. Sur le fond,
la “judiciarisation de la médecine” est une sauvegarde des rapports
humains réglés par le droit. Mais on entend souvent, sous ce vocable,
le recours abusif et intempestif aux tribunaux (1). Souhaitons que
les nouvelles procédures de conciliation, mises en place par la loi
de mars 2002, limitent la dérive contentieuse.
Comment en est-on arrivé là ?
Historiquement, il est classique de faire débuter cette judiciarisa-
tion dès 1936 avec l’arrêt Mercier. Pour la première fois, la Cour
de cassation fondait la responsabilité du médecin sur une base
contractuelle dont la transgression pouvait constituer une faute
débouchant sur l’indemnisation de la victime. En 1942, la Cour
de cassation (arrêt Teyssier) reconnaît la notion de “droit du
malade” en affirmant le principe du respect de son consentement
préalable. Ainsi, et peu à peu, les droits acquis par le citoyen, depuis
la Révolution, de réparation d’un préjudice subi vont s’appliquer
aux soins. L’activité médicale est devenue semblable aux autres
activités humaines ou considérées comme telles par la société.
La multiplication des affaires civiles soumises aux juridictions, au
cours des années 1960-1970 (2), lance en 1992 le débat de “l’aléa”.
En effet, pour indemniser les victimes, le juge devait nécessaire-
ment rechercher une faute, parfois “artificiellement”. L’idée est
alors émise de répartir la charge financière des accidents médi-
ÉDITORIAL
Après l’éradication de la variole...,
celle des infections nosocomiales ?
After smallpox..., is global eradication of health care associated
infections possible?
© La Lettre de l’Infectiologue 2005;XX(6):223-6.
●
B. Régnier*
3
La Lettre du Pneumologue - Volume IX - no1 - janvier-février 2006
* Service de réanimation médicale et infectieuse, hôpital Bichat-Claude Ber-
nard, Paris. Université Paris-VII.

caux selon qu’ils relèvent d’une faute ou du risque (aléa). Ce
dernier, appelé aléa médical, relèverait de la solidarité nationale.
Une autre coupure est intervenue avec le scandale du sang conta-
miné et de l’hépatite C, dans les années 1980, puis de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob, à la fin des années 1990 (1). La loi DMOS
de décembre 1991 ouvre le droit à indemnisation des personnes
contaminées par le VIH à la suite d’une transfusion. En avril 1993,
le Conseil d’État (arrêt Bianchi) ouvre des possibilités d’indemni-
sation pour des victimes d’accidents thérapeutiques d’une extrême
gravité. On est passé de l’obligation de moyens à l’obligation de
(sécurité) de résultats !
Les infections nosocomiales :
un régime d’exception fondé sur la jurisprudence
Il semble que l’infection nosocomiale (IN), tout en s’inscrivant
dans l’évolution de la judiciarisation de la médecine, ait été traitée
“à part”. En fait, son histoire jurisprudentielle démarre dès 1960,
avec un premier arrêt du Conseil d’État condamnant l’Assistance
publique de Marseille pour le cas d’un enfant admis pour rougeole
en 1952 et mort de variole, transmise par son voisin de chambre… !
Tout se passe comme si l’évolution jurisprudentielle allait consi-
dérer, au cours des quatre décennies qui allaient suivre, que les
infections nosocomiales, comme la variole, étaient complète-
ment éradicables !
Dans le cas de cet enfant, il y avait clairement eu négligence (faute),
dont la preuve a été facilement apportée. Par la suite, il s’avérera
qu’il peut être très difficile pour la victime de démontrer la faute
d’un médecin ou d’un établissement de santé (ES). Une nouvelle
étape sera franchie en 1988 par le Conseil d’État (arrêt Cohen) qui
condamnera l’AP-HP à la suite d’une méningite postopératoire à
La Pitié-Salpêtrière (Paris). Aucune faute ne sera retrouvée, mais
le Conseil d’État estimera que la survenue d’une infection traduit
une faute dans l’organisation du service public hospitalier (8). C’est
le principe de la faute présumée. Il y a aussi renversement de la
charge de la preuve, l’ES ne pouvant s’exonérer qu’en démontrant
l’absence de faute, mission quasi impossible… En 1996, la Cour
de cassation (arrêt Bouchard) étend ce principe de la responsabi-
lité pour faute présumée aux établissements privés. Enfin, en 1999
et à l’occasion de trois arrêts rendus le 29 juin 1999, la Cour de
cassation décide que les ES privés et les médecins sont tenus à une
obligation de sécurité de résultats (8). Le patient doit apporter la
preuve de la nature nosocomiale de l’infection. L’ES est alors consi-
déré comme responsable et devra en réparer les conséquences dom-
mageables. Il ne pourra en être exonéré que s’il démontre une
“cause étrangère” – par exemple que l’infection est totalement
“étrangère” au séjour hospitalier et était de “force majeure” –
c’est-à-dire imprévisible et irrésistible [inévitable] (9). Cette juris-
prudence pour les ES privés rejoint, de fait, celle des ES publics
(arrêt Cohen de 1988), avec le concept de “faute présumée” (8).
C’est l’ensemble de cette jurisprudence qui inspirera la législation.
En effet, la loi des droits du malade du 4 mars 2002, qui précise
les modalités d’indemnisation des conséquences des “risques sani-
taires”, indique (article L.1142-1) que les ES sont responsables des
dommages résultant d’infections nosocomiales. Parmi les accidents
médicaux, l’IN apparaît donc, a priori, comme le seul “fautif”. Mais
l’idée de faute n’est-elle pas devenue une fiction vide de sens (2) ?
Pourquoi ce régime d’exception ?
Les IN seraient-elles toutes et toujours évitables ?
En 1996, le rapport de Claude Evin sur les droits de la personne
malade au Conseil économique et social, préconisant notamment
l’indemnisation de l’aléa thérapeutique par la solidarité nationale,
enclenche la genèse de la loi de 2002. Après de difficiles discus-
sions, liées en particulier au financement du dispositif, Bernard
Kouchner présente le projet de loi en septembre 2001. Adoptée en
première lecture par le Parlement en novembre, la loi relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé sera signée
le 4 mars 2002. Concernant les événements indésirables ou les acci-
dents médicaux, la loi a deux objectifs : l’obligation de signale-
ment à des fins d’alerte et de vigilance et les règles de réparation
des conséquences dommageables. Si l’accident est “fautif”, il
engage la responsabilité de l’ES et sera indemnisé par l’assureur ;
s’il n’y a pas eu de faute, mais simplement risque ou “aléa”, il relè-
vera d’un fonds de solidarité nationale : l’ONIAM (Office natio-
nal d’indemnisation des accidents médicaux). Ce sont les CRCI
(Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales) qui s’assurent de la réalité et de la gravité du pré-
judice, du lien de causalité avec un accident médical et statuent
sur sa nature “fautive versus aléa”. Ces risques sanitaires liés au
“fonctionnement du système de santé” sont distingués en accident
médical, affection iatrogène et infection nosocomiale (les “événe-
ments indésirables liés aux produits de santé” sont souvent traités
à part). Le projet de loi initial prévoyait que chacun d’entre eux
puisse être qualifié de fautif ou d’aléa, mais un amendement de
Claude Evin, validé en commission parlementaire, a conduit à sor-
tir l’IN de l’aléa (10). La raison en est la jurisprudence constante
de la Cour de cassation (et du Conseil d’État) sur la présomption
de faute et l’obligation de sécurité de résultats avec son corollaire :
l’indemnisation dans le cadre de la responsabilité pour faute (avec
une garantie d’indemnisation plus importante pour les victimes).
Il semble que les débats aient été très difficiles, à la fois en commis-
sion parlementaire, en commission des affaires sociales du Sénat
puis en commission mixte paritaire. Plusieurs versions seront pro-
posées, car le ministre, Bernard Kouchner, estimera que le texte
manquait de clarté… (10). Il convient de reconnaître qu’en
l’absence de définitions médicales et/ou épidémiologiques consen-
suelles des accidents médicaux et affections iatrogènes, qui peuvent
comprendre les IN (!), et en raison des “frontières” floues entre
accidents fautifs et aléas, le législateur a dû “tenter de se débrouil-
ler” seul… Le débat terminologique autour des accidents médi-
caux, des IN et de la iatrogénie reprendra d’ailleurs un an plus
tard, avec la rédaction de la loi de Santé publique du 9 août 2004
(puis celle de l’Assurance maladie du 13 août 2004) et avec des
variations des termes employés (“événements indésirables graves
liés à des soins réalisés lors d’investigations, de traitements ou d’ac-
tions de prévention”… et, dans la liste des objectifs : “iatrogénie”,
qui englobe les IN) qui persistent encore à ce jour. Concernant la
responsabilité, les rédacteurs de la loi, ne disposant pas de références
ÉDITORIAL
4
La Lettre du Pneumologue - Volume IX - no1 - janvier-février 2006

scientifiques sur les IN fautives versus inévitables (aléatoires),
se sont fondés sur la jurisprudence. C’est donc parce que les juges
avaient estimé, depuis plus de 15 ans, que les IN (toutes…) tradui-
saient (par définition… ?) un dysfonctionnement de l’ES, que la
loi de mars 2002 a retenu ce principe. Néanmoins, deux problèmes
sont apparus : le maintien de la cause étrangère comme déchargeant
l’ES de sa responsabilité pour IN, et la réaction des assureurs !
En effet, la jurisprudence, si elle affirmait la responsabilité de l’ES
en cas d’IN, prévoyait néanmoins qu’il puisse en être exonéré
s’il apportait la preuve d’une cause étrangère [principe ancien et
général du droit] (10). En conséquence, dans la rédaction finale
de l’article l.1142-1, le premier alinéa indique que “Les ES sont
responsables des dommages résultant d’IN, sauf s’ils apportent
la preuve d’une cause étrangère” (alors que, pour les autres acci-
dents, c’est à la victime de prouver la faute). Le deuxième alinéa
précise que “lorsque la responsabilité d’un ES n’est pas engagée,
un accident médical, une affection iatrogène ou une IN ouvrent
droit à la réparation des préjudices au titre de la solidarité
nationale”.
Au regard de l’extrême difficulté de prouver la “cause étrangère”
d’une IN, les assureurs ont vivement réagi [vis-à-vis de la loi, et
pas seulement pour l’IN] (11, 12). Après une concertation avec
l’ensemble des acteurs, le partage des conséquences financières
des IN sera redéfini (loi About du 30 décembre 2002). Lorsque
le préjudice lié à une IN est grave (invalidité supérieure à 25 %)
et qu’aucune faute n’a été prouvée, c’est l’ONIAM qui indemnise
la victime au titre de la solidarité nationale. On voit donc que, pour
la même IN et en l’absence de faute documentée, l’ES est respon-
sable si l’invalidité est inférieure à 25 % et la victime indemnisée
par l’assureur, alors que si l’invalidité est supérieure à 25 %,
l’ONIAM indemnise.
Comme on le voit, la logique est politique et financière, alors que
la cohérence en termes de responsabilité médicale est plus dis-
cutable…
Depuis la loi de mars 2002, que s’est-il passé ?
Il semble possible, au travers de certains jugements récents ou
d’avis de CRCI, de discerner des tentatives d’interprétation de la
“cause étrangère”. D’une part, via la discussion infections endo-
gènes (flore du patient) versus exogènes, d’autre part, par la prise
en compte de l’état antérieur du patient. Il a parfois été considéré
que la présence du germe microbien dans l’organisme du patient
avant l’hospitalisation pouvait constituer une cause étrangère… !
Par ailleurs, la gravité de l’état de santé de certains patients a pu
être considérée comme le déterminant essentiel de l’infection, répon-
dant aux clauses “d’irrésistibilité”, voire “d’extériorité” de la cause
étrangère. On voit bien l’extrême difficulté de ces considérations.
Leur incohérence parfois aussi, puisqu’en aucun cas la nature endo-
gène de l’infection ne peut, en soi, amener à conclure à l’inévita-
bilité, ni même à l’absence de faute. La variabilité suggérée de ces
avis démontre le besoin de mieux définir les IN non liées à la qua-
lité des soins. Il semble donc bien exister aussi un “aléa juridique”,
avec des divergences de la jurisprudence (13).
Cette problématique est actuellement débattue par le CTINILS
(Comité technique national des infections nosocomiales et des
infections liées aux soins). Dans le cadre du programme national
de lutte contre les infections nosocomiales 2005-2008, des indi-
cateurs de performance des ES ont été définis, dont les taux de
certaines IN. Ces taux seront publics (public reporting) et permet-
traient un “hit-parade” des ES ! Dans ce contexte, ainsi qu’en rai-
son des objectifs de la loi de Santé publique (août 2004), a émergé
la question de cibler les IN dont la survenue était clairement liée
à la qualité des soins (et donc évitable…). Un groupe de travail
a commencé à y réfléchir, et il faut souhaiter que ses conclusions
puissent influencer les décisions à venir des juridictions et des CRCI.
Il serait aussi souhaitable que la société (notamment les associa-
tions d’usagers et les médias) participent au débat et à la “pédago-
gie du risque” (6). Donner des droits et des possibilités de recours
aux citoyens suppose aussi leur éducation. À ce titre, il est intéres-
sant de noter dans l’hebdomadaire Le Point daté du 25 août 2005
et consacré au “Palmarès 2005 des hôpitaux”, que dans l’apologie
du CHU de Bordeaux (classé premier de tous les ES… !) il est
dit que son service d’hygiène “gère chaque année 7 000 cas d’IN,
dans leur majorité bénignes et inévitables”… Prémice d’une prise
de conscience ? (Cet hebdomadaire avait publié, début 2005, la
“liste noire des hôpitaux” en hygiène hospitalière…).
Les raisons pour lesquelles les IN, parmi l’ensemble (très large…)
des événements indésirables liés aux soins (dont elles ne repré-
sentent que 20 %), sont les seules à être considérées comme systé-
matiquement fautives par la jurisprudence, ne sont pas claires.
On peut émettre plusieurs hypothèses à l’origine de ce régime
d’exception :
✓La part prépondérante, dans la jurisprudence, des IN “évitables”,
notamment des infections postopératoires en chirurgie orthopé-
dique “propre”, à l’origine d’une généralisation abusive ?
✓La difficulté des expertises judiciaires, peut-être insuffisamment
spécialisées au regard de la complexité des situations et de l’évo-
lution rapide des connaissances ? [Récemment, la Société amé-
ricaine des maladies infectieuses a diffusé des recommandations
relatives aux conditions requises pour optimiser l’expertise] (14).
✓La nature même de l’accident médical, une infection (“attraper
un microbe”, “transmettre un germe”) par rapport aux autres (effets
indésirables d’un médicament, perforation percolonoscopique
très rare mais “inévitable”, pour laquelle c’est le défaut d’informa-
tion qui est mis en cause, etc.), avec mauvaise compréhension de
la physiopathologie et de la circulation des germes ?
“Il faut que les usagers sachent que les IN ne disparaîtront pas,
en tout cas pas complètement”, écrivait, en janvier 2004, Jean Car-
let, président du CTIN (15).
✓La confusion induite par une terminologie devenue inadaptée
(infection “nosocomiale” versus “liée aux soins”) ?
✓L’électrochoc du sang contaminé, suivi des scandales de l’hépa-
tite C et du Creutzfeldt-Jakob ?
Où allons-nous ?
Sans remettre en cause un seul instant les progrès potentiels dus
à la loi de mars 2002 et à l’implication des usagers dans la qualité
5
La Lettre du Pneumologue - Volume IX - no1 - janvier-février 2006

des soins, il paraît nécessaire de faire évoluer la jurisprudence et
la législation, d’optimiser et d’harmoniser les avis des CRCI.
Dans le domaine des IN, les politiques ont donné une impulsion
qui a contribué à ce que notre pays enregistre des progrès remar-
quables. Tout en maintenant cette dynamique, il convient de
demeurer “conforme à l’état des connaissances”. En janvier 2004,
le président du CCNE (Comité consultatif national d’éthique),
Didier Sicard, dans un article intitulé “Protéger les malades ou s’en
protéger !”(16), mettait en garde contre une dérive contentieuse :
“Les procès, le plus souvent injustes, sont insupportables car ils
témoignent de la méconnaissance d’une réalité toujours plus
complexe qui finira par décourager les meilleures équipes”, un
risque déjà formulé par d’autres (5). Fin 2004, le juge Marie-
Odile Bertella-Geffroy, évoquant les rapports justice-santé, souli-
gnait l’incompréhension mutuelle de ces deux mondes et concluait
que “tout était à construire, ensemble” (17). Sans nul doute, la
communauté médicale y est prête.
Néanmoins, pour “construire ensemble”, il conviendrait de dispo-
ser de données robustes, notamment d’un suivi des avis des CRCI
et d’un recueil des expertises judiciaires et des jugements rendus
par les tribunaux. Il est curieux de constater, en l’absence de registre
exhaustif (13), que les magistrats peuvent avoir des estimations
très différentes des affaires. Certains évoquent une multiplication
des “affaires”, alors que d’autres considèrent que le contentieux
médical reste marginal au regard du volume de l’activité médi-
cale (13), au point de conclure : “la judiciarisation de la médecine,
mythe et réalité” (18). Espérons que la CNAM (Commission
nationale des accidents médicaux) joue le rôle d’observatoire du
risque médical, amiable et contentieux (13), et permette de faire
la part entre mythe et réalité, entre dérive contentieuse et “crise
de confiance” des assureurs (13, 18), et de comprendre l’argumen-
taire des expertises et avis rendus. Dans le souci du patient, la prio-
rité est de préserver (restaurer… ?) la relation de confiance (même
s’il y a “contrat”) entre le malade et le médecin (1).
■
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1.Vignaud F (avocat). La judiciarisation de la médecine. Comparaison entre
droit français et droit américain. In : 13e Journée d’Éthique médicale de
l’Institut Maurice-Rapin 2003. La judiciarisation de la médecine : www.
institutmauricerapin.org
2.Turcey V (vice-président du tribunal de grande instance de Reims). 13
e
Jour-
née d’Éthique médicale de l’Institut Maurice-Rapin 2003. La judiciarisation
de la médecine : www.institutmauricerapin.org
3.Burgelin JF (procureur général Cour de cassation). La judiciarisation de la
médecine. 13
e
Journée d’Éthique médicale de l’Institut Maurice-Rapin 2003.
La judiciarisation de la médecine : www.institutmauricerapin.org
4.Beloucif S. 2
e
journée de formation Maurice-Rapin. Paris 24 juin 2005.
www.institutmauricerapin.org
5.Saadoun D. La médecine saisie par le droit. 13
e
Journée d’Éthique médicale
de l’Institut Maurice-Rapin 2003. La judiciarisation de la médecine : www.
institut mauricerapin.org
6.Dacunha-Castelle D. Enseigner le risque. Le Monde, 7 octobre 2000.
7.Prieur C. L’affaire Marie L. révèle une société obsédée par ses victimes. Le
Monde, 23 août 2004.
8. Sargos P. Infections nosocomiales et responsabilité : la nouvelle jurisprudence
de la Cour de cassation. La Lettre de l’Infectiologue 1999;XIV(7):295.
9.Lucas-Baloup I. Le microbe : une “res nullius” cause étrangère ? 4
e
Journée
de FMC de la SRLF (Société de réanimation de langue française), Paris,
26 avril 2001.
10. Thouvenin D. 2
e
Journée de formation Maurice-Rapin. Paris 24 juin 2005.
www.institutmauricerapin.org
11. Duplessis AS. Aléa thérapeutique : l’indemnisation contestée. Le Généra-
liste, 13 novembre 2001.
12. Benkimoun P. Le casse-tête de l’indemnisation des victimes d’accidents
médicaux. Le Monde, 17 février 2000.
13. Garay A (avocat à la cour d’appel de Paris) Vous avez dit “judiciarisation”
de la pratique médicale ? 13e Journée d’Éthique médicale de l’Institut Maurice-
Rapin 2003. La judiciarisation de la médecine : www.institutmauricerapin.org
14. Infectious Diseases Society of America. Guidelines for infectious diseases
specialists serving as expert witnesses. Clin Infect Dis 2005;40:1993-4.
15. Carlet J. Infections nosocomiales : halte aux fantasmes ! Le Monde, 3 jan-
vier 2004.
16. Sicard D. Protéger les malades ou s’en protéger ? Le Monde, 29 janvier
2004.
17. Bertella-Geffroy MO. Justice et santé. L’évolution des rapports justice-santé.
Revue Sève – Les tribunes de la santé – hiver 2004 , p. 21-9.
18. Helminger L, Martin D. La judiciarisation de la médecine, mythe et réalité.
Revue Sève – Les tribunes de la santé – 2004;39-46.
ÉDITORIAL
6
La Lettre du Pneumologue - Volume IX - no1 - janvier-février 2006
1
/
4
100%