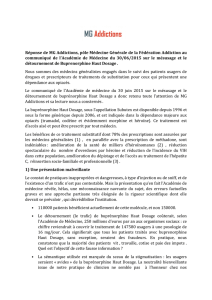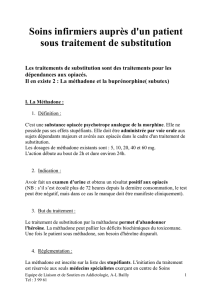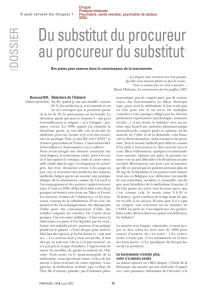Dix ans après… Lyon, 23 et 24 juin

121
Intitulée “ S t ratégies thérapeutiques pour les
p e r sonnes dépendantes des opiacés : place
des traitements de substitution”, la conférence
de Lyon s’est montrée consensuelle d’embl é e
sur presque tous les points : le bilan de la sub-
stitution en France est très positif sur les plans
sanitaire, social et même économique ; il fa u t
améliorer encore le dispositif de soins et le
doter des moyens essentiels ; favoriser le tra-
vail en réseau, la formation ; mieux préciser le
cadre de prescription et de délivrance ; pro-
m o u voir des bonnes pratiques ; mener une
politique de recherche et d’évaluation plus
e fficiente. Qui pourrait être “en dissensus”
avec ces propositions ? “Nous allons dans le
consensus mou”, protestait, en séance, le D r
Béatrice Stamboul de Montpellier… H a rd
ou s o f t , celui-ci a eu le mérite de préciser bien
des concepts, et d’annoncer clairement la cou-
leur : à Lyon, tous ont affi rmé leur souhait de
ne pas être confrontés à un retour en arr i è r e ,
au motif que le “mésusage de la bu p r é n o r-
phine haut dosage” (celui de la méthadone
n ’ ayant pas été abordé, comme ont été oubl i é s
un bilan des pratiques des centres et celui des
d é l é g ations aux médecins de ville) remettrait
en cause l’intérêt de ces traitements. “Il ex i s t e
un nombre limité (5 à 10 %) de patients hy p e r-
a buseurs pour leur consommation personnelle
plus que pour le trafic, de médecins hy p e r -
prescripteurs et de pharmacies à hy p e r d é l i -
vrance”, disait le Dr Bert r and Lebeau,
“C’est sur ce segment-là que l’interve n t i o n
des pouvoirs publics et des caisses d’assu-
rance maladie devrait se concentrer. Il est sou-
h a i t a b le de maintenir le large accès aux traite-
ments de substitution qui est la cause d’ex c e l -
lents résultats en termes de santé publ i q u e ,
mais en modifiant les règles du jeu. Le rôle
des caisses n’est pas seulement de rembourser
des frais, mais encore de contrôler. Il ne s’agit
pas de ‘fliquer’ tout le monde mais d’empê-
cher les prescripteurs fous de s’exploser en
vol !” Opinion reprise et complétée par A n n e
C o p p e l : “C’est par l’amélioration de la cli-
nique que l’on parviendra à réduire le détour-
nement et le mésusage des traitements…”.
Toute la finalité de la conférence ! Pour Je a n -
Jacques Deglon, de la Fondation Phénix, à
G e n è v e, la solution est très simple : “L’un des
intérêts majeurs des traitements de substitu-
tion est de faire chuter les trafics. Et la
meilleure façon d’y parvenir est de proposer
s u f fisamment de places pour les usagers
comme cela a été fait en Suisse où les petits
t r a f iquants que l’on rencontre encore sont…
quelques Français qui passent la frontière !”
Mais au fait de quoi parle-t-on ?
“Ce n’est pas une substitution”
Mots, jeux de mots… l’analyse sémantique
rapide de l’évolution des termes employ é s
pour définir ces traitements reste hautement
s i g n i f i c a t ive du sens donné par chacune “des
p a rties” à cette modalité de prise en charge des
usagers dépendant des opiacés : les usagers
eux-mêmes continuent à utiliser le term e
“ p roduit de substitution” ( v oir “Les douze
revendications d’EGUS 2004”). L’ A NA E S
parle de “médicaments de substitution aux
Dix ans après… Lyon, 23 et 24 juin
Première conférence de consensus
sur les traitements de substitution
F. Arnold-Richez
1994, Chatenay-Malabry : dans un climat de polémiques acerbes, se
tient la première conférence interuniversitaire sur “Intérêt et limites des
traitements de substitution”, suivie, quatre ans plus tard à Paris, de la IIe
conférence interuniversitaire sur les premières évaluations de ceux-ci. Les
organisateurs en étaient, dans les deux cas, ceux qui sont aujourd’hui
membres du comité de rédaction du C o u rrier des addictions et de la
Société d’addictologie francophone. Les experts étrangers montraient
alors les cliniciens français du doigt : “Mais que faites-vous donc… à
ne rien faire ?” Entre temps, en 1995, la méthadone, et, en 1996, la
buprénorphine haut dosage, obtiennent leur AMM. En 2004, ce sont
entre 60 000 et 75 000 usagers de drogues qui bénéficient de
traitements de substitution, dont 9 sur 10 pris en charge par la
médecine de ville. La moitié du nombre estimé de consommateurs
d’opiacés en France, et un Européen ainsi traité sur trois ! A l o r s ,
consensus ou réconciliation ? Validation consensuelle d’un état de fait
ou vrai débat pour de meilleures pratiques ? Qu’importe ! La tenue, dix
ans plus tard, à Lyon en juin dernier, de la première conférence de
consensus organisée par la Fédération française d’addictologie (*),
avec la participation de l’ANAES, était un m u s t . Une attente forte de
tous les professionnels, patients et institutions concernées. A-t-elle tenu
ses promesses ? À Lyon, on a beaucoup parlé et détaillé les bonnes
pratiques souhaitables pour la prise en charge par la buprénorphine haut
dosage, assez peu par la méthadone. Mais, les recommandations élaborées
par l’ANAES, avant même les délibérations du jury, et distribuées au début
de la conférence, s’en étaient en partie chargées… Les usagers, eux, avaient
prévu “le coup” et tenu quelques temps auparavant leurs États généraux…

122
Le Courrier des addictions (6), n° 3, juillet-août-septembre 2004
o p i a c é s ” et les résume par le sigle M S O ( vo i r
texte suiva n t ) . Les pouvoirs publics, en 1994,
ont abandonné la périphrase “empru n t é e ”
“outil de prise en ch a r ge ” pour “ m é d i c a -
m e n t ” (“le toxicomane” devenant en même
temps un “patient dépendant d’un opiacé”) .
“Et, en 1999, la MILDT ajoutait à l’énuméra-
tion des différents dispositifs de soins, ‘ t ra i t e -
ments de substitution’, comme catégorie par-
ticulière sans les intégrer dans une stratégie
thérapeutique globale”, expliquait A n n e
Coppel. Le Pr Marc Au r i a c o m b e , lui,
concluait pratiquement en introduction de la
conférence, que la méthadone et la bu p r é n o r -
phine haut dosage n’étaient pas des substituts.
Goût du paradoxe ? Non, mais de la rigueur
conceptuelle, très certainement. “Contraire-
ment à ce que ce mot peut laisser entendre, le
but n’est pas de substituer une substance à une
autre, au sens de ‘remplacer avec le même
e f fet’, mais d’agir sur un mécanisme de péren-
nisation de la dépendance : l’envie ou le
besoin compulsif de consommer”, ex p l i q u a i t -
il. Pour qu’un agent pharm a c o l ogique part i c i-
pe au traitement d’une dépendance, il est
nécessaire que l’envie de consommer soit suf-
fisamment atténuée pour délivrer le patient de
la contrainte que représente la dépendance. “Il
faut également que l’agent pharm a c o l og i q u e
n’ait aucun effet renforçant perceptible lors de
la prise. L’absence d’effet renforçant diff é r e n -
cie le traitement d’une drog u e .” Ainsi, le véri-
t a ble “traitement de substitution” serait l’hé-
roïne médicalisée que nous n’avons pas enco-
re développé en France (comme le sont les
substituts nicotiniques, inhaleurs et gommes,
pour le tabac). “Or, l’effet renforçant de la
méthadone et de la bu p r é n o rphine haut dosage
(l’euphorie), qui ‘fa i t ’ l’addiction, est très peu
i m p o r tant. Leur intérêt n’est donc pas qu’elles
remplacent l’héroïne, mais qu’elles réduisent
l’appétence pour elle. Les deux médicaments
s ’ i n s c r ivent pleinement dans la finalité princi-
pale des soins aux personnes dépendantes des
opiacés en leur permettant de devenir et de
rester abstinents dans le cadre d’une améliora-
tion générale de leur état de santé.” Une
conception que Fabrice Olive t , pour A s u d ,
réfutait avec vigueur : “Cette distinction entre
substitution vraie, dédiée à la réduction des
dommages ‘collatéraux’à la prise de drog u e s ,
et le traitement ‘nobl e ’ donné aux vrais
patients désireux de sortir de leur dépendance,
a une connotation idéologique et morale, ave c
en arrière-plan, l’idée toujours présente du
s e vrage…” “Dans le présupposé médical, il y
a une maladie, un diagnostic et un traitement
pour la traiter, lui répondait Marc
Auriacombe. Et nul n’a parlé d’abstinence du
médicament…”
“On n’a pas osé y croire...”
Vraie ou fausse substitution, depuis les années
quatre-vingt quinze, la mise à disposition de ces
deux traitements et aussi l’institution d’une
politique de réduction des risques, a obtenu des
résultats tellement favo r a b les “que nous
n ’ avons pas osé y croire et les diffuser”, ex p o-
sait Anne Coppel : entre 1994 et 1999, baisse
de 80 % des overdoses mortelles, de 67 % des
i n t e r pellations pour usage d’héroïne, des deux-
tiers de la mortalité par sida. “Associé à ces
résultats, bien que plus difficile à quantifi e r, est
le changement de comportements des usagers
dont témoigne la baisse des contaminations par
sida (soit actuellement 4 % des taux de conta-
minations, contre 30 % au début des années
1990). L’injection pratiquée par quelques 90 %
des héroïnomanes français des années 1980,
persiste, même si le pourcentage de la réduc-
tion de l’injection sous bu p r é n o r phine haut
dosage est discuté. Pour cette ex p e rte et pion-
nière de ces traitements et de la politique de
réduction des risques, ces résultats incroy a b l e s
sont imputables essentiellement à l’accès larg e
aux traitements de substitution grâce à la possi-
bilité off e r te aux usagers d’être traités en ville,
donc d’être considérés comme des patients qui,
mieux stabilisés, ont pu de ce fait “être mieux
acceptés dans les hôpitaux”. Et, en fait, le bilan
du dispositif de “réduction des risques”, essen-
tiellement définis comme étant les risques
infectieux, a été bien au-delà de la diminution
de ceux-ci. “La lutte contre le sida a abouti à
une baisse de la mortalité par surdoses, comme
à celle des interpellations pour usage”, disait-
elle.
Un bilan positif partagé par Je a n - M i c h e l
C o s t e s , directeur de l’Observatoire français
des drogues et des toxicomanies. Selon les éva-
luations émanant de diverses études (OFDT,
SIAMOIS…) : 51 000 à 58 000 pa-tients
étaient en processus de traitement par la bu p r é -
n o rphine haut dosage au moins pour 6 mois
( d e r nier trimestre 2002), “de 16 000 à 23 0 0 0 ,
soit entre 20 et 30 % ayant reçu une prescrip-
tion au cours du semestre, pouvaient être des
‘intermittents de la substitution’ ou bien débu-
taient ou finissaient un traitement, 6 %, soit
e nviron 5 000 sont à considérer comme per-
sonnes ayant une activité de revente import a n-
te”, disait-il. En ce qui concerne la méthadone,
le nombre des patients était évalué en juin
2003, entre 11 000 et 15 200. Au total, entre
6 0 000 et 75 000 personnes seraient sous trai-
tement de substitution dont 20 % par la métha-
done. Autour d’eux “gr aviterait une import a n-
te population recevant des prescriptions de
produits substitutifs de manière irrégulière ou
consommant sans prescription”. “Leur impact
a été clairement positif ”, commentait-il tant en
ce qui concerne la chute des surdoses mor-
telles, des cas de sida, que la mortalité globale
( “ d i visée par cinq entre 1994 et le début des
années 2000”), que l’amélioration du recours
aux soins, le meilleur suivi des grossesses, le
moindre recours à l’injection, la diminution de
la délinquance, de la consommation de sub-
stances illicites, l’amélioration de l’insert i o n
sociale et professionnelle.
De nouvelles difficultés
En revanche, d’autres difficultés sont appa-
rues comme le recours à d’autres substances
(persistance d’une consommation import a n t e
de benzodiazépines, d’alcool). “L’ e n q u ê t e
AIDES menée en 2001 auprès des patients
r e c e vant un traitement de substitution en
centre ou en médecine de ville, méthadone ou
bu p r é n o r phine haut dosage, montre la persis-
tance de consommations occasionnelles d’hé-
roïne chez environ un quart des patients, tan-
dis que 26 % consomment quotidiennement
des benzodiazépines et 72 % de l’alcool. De
même l’enquête SPESUB montre que la
dépendance à l’alcool déclarée initialement
par 20 % des patients concerne, après deux
ans, 32 % d’entre eux”, tempérait J. M . C o s t e s .
La consommation de buprénorphine haut
dosage hors protocole thérapeutique,
comme autosubstitution, ou comme
d r ogue, concernerait, selon une étude
TREND/OFDT en 2002 menée auprès de
571 usagers pour l’usage non substitutif au
cours de la vie et 407 au cours du dernier
mois, respectivement 24,7 et 25,1 %. Ces
usages concernent des tranches d’âge assez
larges (de 15 à 51 ans dans cette étude) et
des profils sociodémographiques variés :
de très jeunes usagers au début de leur
“carrière” ; des consommateurs plus âgés
qui n’avaient pas développé de dépendance
à un opiacé ; des sujets parfois très éloignés
des usages de drogues ; des usagers de l’es-
pace festif qui régulent leurs consomma-
tions de psychostimulants ou l’utilisent à
des fins de défonce ; des délinquants non
toxicomanes à l’occasion d’une incarcéra-
tion ; des personnes très précarisées vivant
dans la rue, en squat ou en institution, et

123
même des publics mieux insérés sociale-
ment (étudiants, stagiaires en formation,
artisans…). “Cette utilisation non substitu-
tive répond à trois grandes catégories d’ef-
fets recherchés, qui s’imbriquent ou se suc-
cèdent parfois chez un même sujet, disait-il :
la défonce (coût et disponibilité attractifs) ;
le recours pour pouvoir agir, pour pouvoir
rencontrer les autres et leur parler ; l’effet
tranquillisant.” À ces usages, il faut ajouter
ceux à visée d’autosubstitution parfois dif-
ficile à dissocier de l’usage tox i c o m a-
niaque, tant ces deux utilisations peuvent
être concomitantes ou successives, comme
on le remarque dans les structures d’accueil
“bas seuil”.
Pour finir, la persistance de l’injection de
buprénorphine haut dosage (et de la préva-
lence de l’hépatite C) reste importante : elle
va de 8 % après un an et demi de suivi dans
l’enquête SUBTARES (300 patients en
1997) à 65 % des sujets de l’enquête
ASUD/OFDT (51 patients en 2000). Mais
attention ! “Cette prévalence dépend de la
population considérée et des modalités de
l’enquête, plus ou moins favorables à la
déclaration des pratiques”, précisait Jean-
Michel Costes. Elle est forcément plus
m a s s ive chez les sujets, désocialisés,
“ r e c r utés” dans les structures bas seuil
(c’est une tautologie : lorsque l’on s’adres-
se à des injecteurs, on rencontre forcément
des injecteurs… de bu p r é n o r phine haut
dosage, entre autres !), qui ne sont pas
entrés dans un processus de soins, que
parmi ceux qui sont suivis dans un CSST et
traités par de la méthadone.
Au total, malgré un bilan globalement posi-
tif et une amélioration certaine de la vie de
nombreux usagers de drogues, “les traite-
ments de substitution ne constituent pas, à
eux seuls, une réponse aux difficultés des
toxicomanes. Ainsi, malgré le raccourcisse-
ment des parcours toxicomaniaques et une
meilleure proximité entre usagers et systè-
me de soins, la contamination par l’hépati-
te C persiste à un niveau important. Il
s e m ble, par ailleurs, que beaucoup de
patients ne bénéficient pas du suivi social
ou psychologique qui leur serait nécessaire.
Surtout, les conséquences du mésusage en
termes sanitaires, économiques et éthiques,
ré-interroge le cadre de prescription actuel
des traitements de substitution”, concluait
J.M. Costes.
C’est rentable :
595 millions d’euros d’économie
Sur le plan économique aussi, le bilan est net-
tement favo r a ble, a démontré P i e r r e Ko p p , de
l ’ u n iversité Panthéon-Sorbonne. En huit ans,
de 1996 à 2003, les traitements de substitution
auraient sauvé 3 481 vies pour un coût de
1,6 milliard d’euros de soins. Soit un coût
annuel compris entre 336 000 et 668 0 0 0
euros, ou encore entre 11 200 et 22 266 euros
par année de vie sauvée. Le coût des traite-
ments par bu p r é n o r phine haut dosage serait
de 145 millions d’euros par an, celui par
méthadone, de 113 millions (total : 258 mil-
lions). Mais le coût social des drogues pour la
c o l l e c t ivité (traitements, décès, absentéisme,
p e r te de productivité, répression…) est de 2,2
milliards d’euros, soit 0,18 % du PIB (dont
2 2 , 3 8 % pour l’application de la loi, 10,38 %
pour les soins, 6,45 % seulement pour la pré-
vention et la recherche…). Au total, les traite-
ments de substitution ont permis de réduire le
coût social de la toxicomanie de quelques 595
millions d’euros, soit plus du quart (26,74 % )
du coût social, “le bu rd e n ” (fléau) des dro-
gues. “La politique française de traitement de
la toxicomanie constitue indéniablement un
succès dont l’efficacité économique et sani-
taire est démontrée. Pa r a d o xalement, la ‘rou-
t i n i s a t i o n ’ des succès obtenus conduit à des
remises en cause qui prennent les résultats,
p o u r tant fragiles pour acquis, concluait Pierr e
Kopp. Il est certain que l’usage de rue qui est
fait des produits de substitution, reflète des
pratiques de “dépannage” des dépendants.
Toutefois, la facilité d’accès aux soins est telle
que la revente des produits illustre éga l e m e n t
l ’ e xistence d’une toxicomanie centrée sur le
mésusage des produits de substitution. Or, le
coût du remboursement de ces médicaments
est important (10esur la liste de la CNA M T S )
et justifie de vérifier que les dépenses ne
recouvrent pas des pratiques délictueuses et
que les patients ne sont pas encouragés à pra-
tiquer le nomadisme médical.”
Les faiblesses du système
Pa r a d o xal : l’accès aux traitements est deve n u ,
en France, large et pourtant insuffisant : la
l i b e r té de choix du patient n’existe pas part o u t
sur le territoire puisqu’en 2002 huit départ e-
ments n’avaient pas de CSST et 11 pas de
centres spécialisés proposant un traitement
méthadone.
Le travail en réseau est encore insuffisant et, à
ce propos, “la partie communautaire de la
médecine de ville devrait être rémunérée”,
demandait le Dr Jean Vi g n a u de Lille. Les
t r o u b les psychiatriques sont encore mal dia-
gnostiqués et pris en charge, comme le souli-
gnaient les D r s Je a n - P i e r r e Daulouede e t
X avier Laqueille. Les contraintes administra-
t i ves pesant sur les pharmaciens (de stockage,
de classement, de copies d’ordonnances…), et
l’impossibilité de primoprescription de la
méthadone en ville sont des freins comme
l ’ e xpliquait Stéphane Robinet, pharm a c i e n
de Strasbourg. Autres griefs : la non-mise à
disposition d’une gamme complète de
dosages de méthadone appropriés, notamment
pour les patients en fin de traitement (1, 2,
3 mg…), ainsi que l’expliquait Pa t r i c k
B e a u v e r i e, pharmacien chef de l’hôpital Pa u l -
Guiraud ; la palette incomplète des traitements
(qui pourraient intégrer la méthadone en
gélules, injectable, la combinaison métha-
d o n e -n a l t r exone, le LAAM, l’héroïne injec-
t a b le…) évoquée par le Dr Pierre Goisset d e
Montreuil, mais aussi par Christine Caldéro n
d ’ A I D E S ; l’insuffisance des formations de
personnels et souvent des modes d’accompa-
gnement psychosocial des patients. Et aussi,
les insuffisances du système d’inform a t i o n ,
l’imprécision des indicateurs et l’absence de
prise en compte de ceux qui ont trait à la qua-
lité de vie, problème exposé par X a v i e r
T h i r i o n ; la pauvreté des travaux scientifi q u e s
dans le domaine des pratiques profession-
nelles de substitution, comme le déve l o p p a i t
Dominique Vu i l l a u m e, de la MILDT…
À la sortie de la conférence, les recommanda-
tions du jury, dont la publication a été diff é r é e
à plus de deux mois, vont devoir aborder en
premier lieu les bonnes pratiques profession-
nelles. Elles ont été développées en détail in
situ, notamment en ce qui concerne : l’éva l u a -
tion d’un patient préalablement à la prescrip-
tion par Je a n - P i e r re Daulouède ; les modali-
tés du traitement par Didier Bry ; en cas de
comorbidité somatique par S y l v ain Dally ;
l’accompagnement psychologique par Je a n -
P i e r r e Coutro n ; les sorties de traitements par
Sylvie Wi evo r k a ; en cas de comorbidité psy-
chiatrique par X avier Laqueille ; dans le
cadre de la prison par L a u rent Michel ; dans
celui de la médecine du travail par B e r n a r d
Fo n t a i n e ; des populations très désocialisées
par Je a n - P i e r r e Lhomme.
Elles devront aussi aborder la question de l’or-
ganisation du système de soins, de la
recherche, de la form a t i o n …
1
/
3
100%