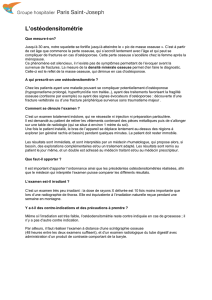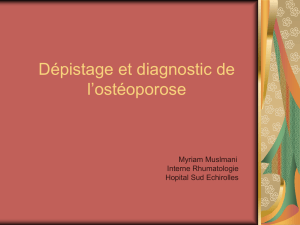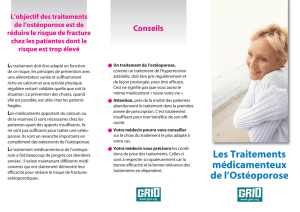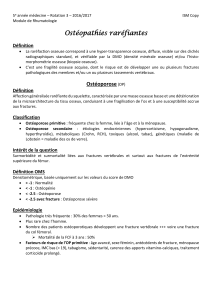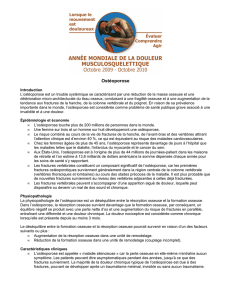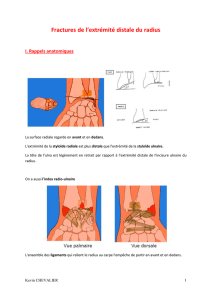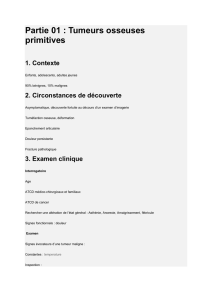4-l-osteoporose-et-l-osteomalacie

Kevin CHEVALIER 1
L'OSTEOPOROSE ET L'OSTEOMALACIE
I. Structure osseuse : rappel
A. Rappel sur l'os
Le calcium est apporté par l'alimentation. Le taux de calcium est constant dans le sang et donc si le
calcium diminue dans le sang on puisera dans l'os, pouvant entraîner des maladies comme
l'ostéoporose.
L'os est une structure complexe mais aussi un tissu vivant. Il est remodelé en permanence. 10% de
l'os est en remodelage constamment.
B. Echelle chronologique des évènements
L'homéostasie se joue en quelques secondes et met en jeu :
La calcémie
La phosphorémie
La calciurie
La PTH
La vitamine D
Cette homéostasie joue sur le remodelage osseux et donc sur la masse osseuse qui dépend de la
densité minérale osseuse.
Si cette masse osseuse diminue, la résistance osseuse diminue, entraînant des fractures de basses
énergies en particulier au niveau du col du fémur et des vertèbres.

Kevin CHEVALIER 2
C. Rappel physiopathologique
L'os est un organe complexe, dur, avec du calcium déposé sur une trame protéique. Tout ceci est
géré par 3 cellules :
L'ostéoblaste qui fabrique l'os
L'ostéoclaste qui détruit l'os
L'ostéocyte qui régule.
Ces 3 cellules agissent en concertation pour ce remodelage osseux, ainsi celui-ci est du à un
couplage résorption/formation.
D. Définition de l'OMS de l'ostéoporose
C'est une maladie de l'ensemble du squelette caractérisée par une masse osseuse basse et des
altérations micro-architecturales, conduisant à une augmentation de la fragilité osseuse et à un
risque accru de fractures.
Cette définition de l'ostéoporose n'entraîne pas forcément un traitement
II. L'os et ses pathologies
A. La quantité d'os
1. La perte osseuse à l'âge adulte

Kevin CHEVALIER 3
Jusqu'à 20-25 voire 30 ans, on fabrique son squelette, on accumule de l'os jusqu'au pic de masse
osseuse. Cela est variable selon des conditions génétiques, la pratique de conduites à risques ou
bien la prise de cortisol par exemple.
Pendant la phase adulte il ne se passe pas grand-chose
Chez la femme, à l'âge de la ménopause, vers 50 ans, on a une perte osseuse accélérée avec une
perte osseuse de l'ordre de 35 à 50% du squelette.
Au même âge, les hommes perdent eux aussi un peu d'os. Néanmoins, l'homme a toujours une
masse osseuse supérieure à celle de la femme ce qui explique que l'ostéoporose et ses conséquences
sont surtout propre à la femme.
2. Ostéoporose secondaires de la femme (différentes de l'ostéoporose post-ménopause)
Il existe des ostéoporoses qui peuvent être augmentées par des facteurs de risque.
Tout état inflammatoire chronique a un effet sur l'os, augmentant la résorption osseuse.
L'activité physique est indispensable pour une bonne activité de l'os. En effet, l'ostéocyte quand il
n'est plus soumis à une contrainte sécrète une molécule : la sclérostine qui diminue la formation
osseuse.
La cortisone est la première cause d'ostéoporose secondaire. C’est pourquoi elle doit être prescrite
aux doses les plus basses pendant des durées brèves. Il existe d'autres médicaments mis en cause
comme les traitements anti-œstrogènes c’est-à-dire des anti-aromatases pour les cancers hormono-
dépendants comme pour les femmes ayant fait un cancer du sein. Dans ce cas, il y a carence totale
en œstrogènes.

Kevin CHEVALIER 4
3. L'ostéodensitométrie (absorptiométrie aux rayons X)
a. Généralités
C'est une machine qui permet de mesurer la quantité d’os mais pas sa qualité architecturale. Cet
examen est prédicateur des fractures ostéoporotiques.
On allonge le ou la patiente dessus. Un bras passe au dessus du patient et émet des rayons X qui sont
captés par un capteur. Plus on a d'os, moins on a de rayons X qui passent.
On va faire cette mesure au niveau :
Le fémur avec le col du fémur et la hanche totale
Du rachis lombaire entre L1 et L4
b. Densitométrie
Pour chacun des trois sites on va avoir une valeur le T-score qui est le résultat du sujet traité en écart
type par rapport à la moyenne de la densité des sujets en bonne santé (de 20 à 30 ans) du même
sexe. Plus on perd d'écart type, plus on s'éloigne de cette moyenne.
C'est le T-score le plus bas qui donne le résultat.
c. Définition densitométrique de l'ostéoporose
T-score (DS)
Normale
> -1
Ostéopénie
<-1 >-2,5
Ostéoporose
< 2,5
Ostéoporose grave
(confirmée, fracturaire)
< 2,5 et ≥ 1 fracture
Chaque fois que l'on perd un écart type, on multiplie par deux le risque de fracture.
A partir de -2,5 on a une ostéoporose densitomérique

Kevin CHEVALIER 5
d. La VFA ou IVA
On réalise un balayage rapide dorsolombaire qui peut être simple ou en double énergie.
On a une analyse automatique de T8 à L4 permettant le suivi possible des déformations vertébrales.
L'évaluation radiographique ou VFA se fera lors de rachialgies ou lors d'un des critères suivants :
Age > 70 ans
Perte de taille historique ≥ 4 cm par rapport à l'âge de 20 ans
Perte de taille prospective ≥ 2 cm
Antécédents de fractures vertébrales
Maladies chroniques avec risque de fracture vertébrale.
B. La qualité de l'os
1. Qualité de l'os et résistance osseuse
a. Propriétés structurales
Les fibres de collagène sont altérées par le vieillissement ou la glycolation chez le diabétique.
Il existe des propriétés structurales macro-architecturales comme la taille : Plus on est grand, plus on
tombe de haut, et donc plus on se fait de fractures. Chaque femme qui fait 5 cm de plus que 1,60 m
augmente de 50% le risque de fracture de fémur.
Plus on est grand plus le fémur est grand, et donc plus le bras de levier est grand.
Au niveau micro architectural on a une influence de l'architecture trabéculaire.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%