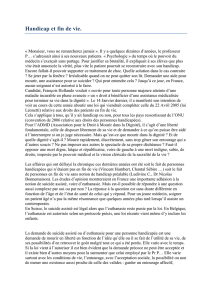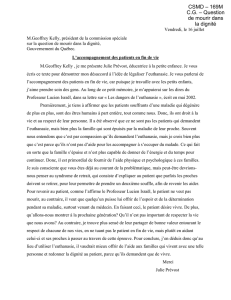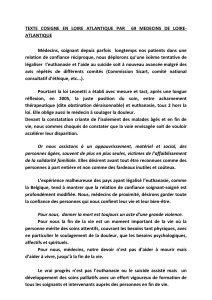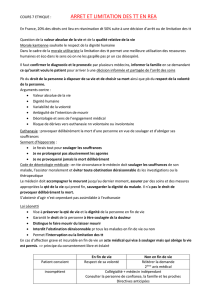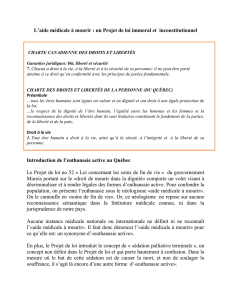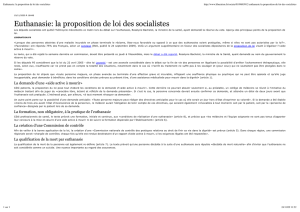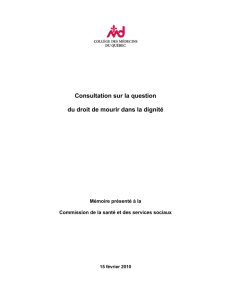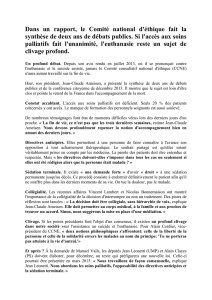L`euthanasie

Régis Aubry, André Comte-Sponville. Euthanasie, une question de vie ou de mort
http://www.philomag.com/lepoque/dialogues/regis-aubry-andre-comte-sponville-
euthanasie-une-question-de-vie-ou-de-mort-8778
© Stéphane Lavoué pour PM
La légalisation de l’euthanasie divise. Si Régis Aubry et André Comte-Sponville défendent le
droit de mourir dans la dignité, ces deux membres du Comité consultatif national d’éthique –
récemment saisi de cette question par François Hollande – ont des positions diamétralement
opposées. Pour le médecin, l’interdiction de donner la mort à un tiers doit être maintenue,
pour le philosophe, la liberté de décider de sa propre mort doit l’emporter.
ANDRE COMTE-SPONVILLE
Né en 1952, philosophe, maître de conférences à la Sorbonne jusqu’en 1998, il a récemment
publié Le Sexe ni la mort. Trois essais sur l’amour et la sexualité (Albin Michel, 2012). Il a
contribué à élargir l’audience de la philosophie avec des livres comme Le Petit Traité des
grandes vertus (PUF, 1995) ou le Dictionnaire philosophique (PUF, 2013). Fin lecteur
d’Épicure et de Montaigne, il inscrit sa réflexion dans le courant du matérialisme

philosophique, qu’il cherche à réconcilier avec la quête d’une vie spirituelle (mais sans Dieu).
Il siège au Comité consultatif national d'éthique.
REGIS AUBRY
Ce médecin et chef du département regroupant les soins palliatifs, le centre d’évaluation et de
traitement de la douleur du centre hospitalier universitaire de Besançon est aussi diplômé de
Sciences-Po et titulaire d’une maîtrise de philosophie. Il est membre du Comité consultatif
national d’éthique, préside l’Observatoire national de la fin de vie et a participé à l’élaboration
de la loi Leonetti en 2005.
Publié dans
n°76
C’était l’un des soixante engagements de campagne du candidat François Hollande :
ouvrir pour « toute personne majeure en phase avancée d’une maladie incurable » un droit à
« bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité ». Autrement
dit : légaliser l’euthanasie. Saisi par le président de la République au début de l’année 2013, le
Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a récemment rendu son avis – consultable en
ligne sur ccne-ethique.fr. Sans surprise, sa réponse est sur l’essentiel négative : le CCNE
préconise le maintien de l’interdiction de « provoquer délibérément la mort » en laissant
seulement la possibilité d’endormir ou de laisser mourir le patient. Mais, signe d’une inédite
intensité des discussions, l’avis officiel – corédigé par le médecin Régis Aubry – est cette
fois-ci suivi de deux contre-avis appelant à une claire dépénalisation et signés par huit des
quarante membres du Comité, dont le philosophe André Comte-Sponville. Les deux hommes
ont accepté de rejouer pour nous ce débat crucial, urgent, et qui cependant ne supporte que le
sens de la nuance.
André Comte-Sponville : Le débat sur l’euthanasie est très différent des questions
bioéthiques qui nous ont été posées ces dernières années. Avec les tests génétiques prénataux,
la recherche sur les embryons, les mères porteuses, le CCNE était confronté à des questions
neuves, techniquement compliquées, sur lesquelles la plupart d’entre nous n’avions aucun
avis préconçu. Nous nous informions longuement avant de délibérer et parvenions en général
à un consensus. Mais s’agissant du débat sur la fin de vie, ce n’est pas un problème nouveau,

il est techniquement relativement simple, et nous savions dès le début que nous ne
parviendrions pas à nous mettre d’accord. Ceci explique que le CCNE ait décidé de publier
deux avis divergents. Or, dès lors qu’il n’y a pas de consensus éthique entre personnes
honnêtes, informées et de bonne foi, c’est au politique de trancher. Le bon modèle, c’est la loi
Veil sur l’avortement. Cette loi n’a pas résolu le problème éthique : l’avortement est-il
moralement acceptable et dans quelles conditions ? Elle n’a pas dit le bien et le mal, mais le
légal et l’illégal : l’avortement est autorisé dans les douze premières semaines de grossesse. Si
le CCNE avait existé alors et avait dû se prononcer, je crains que, pour les mêmes raisons que
sur la fin de vie – la forte représentation des courants religieux et du monde médical –, il eût
répondu par la négative.
Régis Aubry : Je suis d’accord. In fine, en démocratie, c’est au Parlement de trancher sur ces
questions. Il reste que la mission du CCNE n’est pas seulement de donner son avis mais
d’éclairer la complexité des questions posées. Montrer que l’essentiel est dans la nuance et la
subtilité. Éviter cette tendance un peu populiste à vouloir des réponses simples à des
problèmes complexes. Bref, sortir le débat public des affrontements entre « pour » et
« contre ».
A. C.-S. : Ce n’est pas tant un conflit de valeurs qui nous oppose, qu’un conflit entre deux
hiérarchies de valeurs. Tout le monde considère que la vie est une valeur, comme tout le
monde considère que la liberté est une valeur. Mais certains mettent le respect de la vie encore
plus haut que la liberté, et donc sont amenés à s’opposer à l’interruption volontaire de
grossesse hier ou à l’euthanasie aujourd’hui. Et d’autres, au contraire, mettent le respect de la
liberté au sommet. Ce qui est mon cas : je suis un libéral, de gauche certes, mais libéral. De
quel droit l’État prétend-il m’interdire de décider de ma propre vie ?
R. A. : Mais pouvons-nous affirmer qu’un acte est libre lorsqu’il se situe dans une situation de
très grande vulnérabilité ? La réponse ne peut pas être simple. Nous avons ainsi beaucoup
discuté de « la pente glissante » sur laquelle pourrait nous engager la légalisation de
l’euthanasie. Quel usage pourrait-il être fait de cette loi, en période de restriction budgétaire,
dans une société où l’idée que chacun doit être « rentable » est devenue si primordiale ? Car le
paradoxe est que les progrès de la médecine tendent à favoriser l’acharnement thérapeutique
et à créer, notamment dans les unités de soins palliatifs, des situations qui n’ont pas, ou peu,
de sens. Plutôt que la liberté, fragile dans ces situations, j’ai le souci de l’atteinte à la dignité
que peut entraîner l’acharnement thérapeutique.

«Il ne faut pas revendiquer un droit de mourir dans la dignité, mais un droit de mourir dans la
liberté»
André Comte-Sponville
A. C.-S. : Le concept de « dignité » est revendiqué par les deux camps, mais selon des sens
très différents. Il y a ceux qui revendiquent « un droit à mourir dans la dignité » – c’est le
nom d’une association que par ailleurs je soutiens –, laissant donc entendre que l’on peut
mourir de façon indigne. C’est ce que nous appelons dans le rapport la dignité « subjective »
ou « normative » : on est plus ou moins digne. Mais une telle affirmation pose problème dans
la mesure où, par ailleurs, nous pensons que « tous les êtres humains sont égaux en droits et
en dignité ». Le grabataire paralytique et délirant, sur son lit de mort, a la même dignité
qu’Einstein, Mozart ou Victor Hugo. Il s’agit ici d’une dignité « ontologique » ou « absolue »,
qui n’est pas susceptible de degrés. Il y a donc là une équivoque qu’il s’agit de lever. Je suis
partisan de l’euthanasie, mais je considère avec ceux qui s’y opposent que la dignité
ontologique est la plus importante. J’en conclus qu’il ne faut pas revendiquer un droit de
mourir dans la dignité, mais un droit de mourir dans la liberté. Est-ce à l’État de décider si j’ai
le droit de mourir ? Bien sûr que non ! Alors, évidemment, j’ai le droit de me suicider. Mais si
je suis un vieillard de 95 ans, sourd, incontinent, perclus de douleurs, qui s’ennuie atrocement,
et que je me retrouve dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(qui sont de véritables lieux de privation de liberté), comment je fais pour me suicider ? Je ne
le peux pas. Là, j’ai besoin d’une assistance au suicide.
R. A. : Deux constats sur la dignité. Premièrement, il est certaines personnes qui éprouvent un
sentiment d’indignité. Des personnes atteintes de maladies graves, évoluées, mais qui ne
meurent pas. Quel regard la société porte-t-elle sur ces personnes ? Car, en pratique, nous
sommes confrontés à des gens qui nous disent : « je ne sers plus à rien », « je suis un poids
pour mes proches » ; ou encore, je n’invente rien : « je suis un poids pour la Sécurité sociale ».
Cela renvoie à ce sentiment utilitariste de la vie qui s’est généralisé. Deuxièmement, il existe
non pas des sentiments, mais des situations d’indignité. Il y a aujourd’hui encore des
personnes qui ne sont pas accompagnées alors qu’elles se trouvent dans des situations de très
grandes douleurs, d’inconfort, de solitude. D’où cette absolue nécessité qui devrait être un
préalable à toute discussion : que toute personne souffrant, moralement ou dans sa chair,
puisse bénéficier des soins palliatifs. Il ne faudrait pas qu’au motif de défendre la liberté
individuelle, on en oublie nos devoirs collectifs à l’égard de ces personnes.
A. C.-S. : Depuis 2005, la situation a cessé d’être scandaleuse, puisque la loi Leonetti
reconnaît au patient le droit de demander l’arrêt des soins et impose au médecin de respecter
cette demande. L’avis du CCNE propose de reconnaître au patient en phase terminale un droit
à la sédation profonde jusqu’au décès s’il le demande. Et contre les situations d’acharnement

thérapeutique, nous proposons de donner aux directives anticipées concernant le décès un
poids plus fort. Mais il reste des cas que ni la loi Leonetti ni l’avis du CCNE ne couvrent.
L’individu paralysé des quatre membres, par exemple (on pense au jeune Vincent Humbert,
mais il y en a des milliers). S’il souhaite vivre, j’ai pour lui la plus grande admiration, et il va
de soi que la société doit lui donner les moyens de vivre le mieux possible. Mais s’il souhaite
mourir, qui oserait lui faire la leçon ? Et de quel droit condamner le médecin ou le proche qui
accéderait à sa demande ? La mère de Vincent Humbert a considéré qu’il était de son devoir
de mère de satisfaire la demande expresse de son fils paralysé – j’aurais agi pareillement si ça
avait été mon enfant – et je ne reconnais pas à l’État le droit de la condamner.
R. A. : État qui ne l’a pas condamnée.
A. C.-S. : Mais il en avait le droit. En toute rigueur, il faudrait un procès à chaque cas
d’euthanasie. Or, en France, alors que c’est interdit, cela concerne 0,6 % des décès, soit
quelque 1 200 par an. Et surtout, proscrivant le « faire mourir » mais autorisant le « laisser
mourir », la loi crée des distinctions véritablement jésuitiques. D’une part, contrairement à ce
qu’on croit souvent, les cas les plus difficiles ne concernent pas les cancéreux ou les vieillards
en fin de vie mais des nourrissons qui naissent totalement paralysés, sourds et aveugles. Avant
la loi Leonetti, il arrivait qu’on les euthanasie sans le dire. Maintenant que la loi interdit
formellement le « faire mourir » mais autorise l’arrêt des soins, on prive ces enfants
d’alimentation pour un « laisser mourir » qui dure des jours, parfois des semaines, créant ainsi
des agonies insupportables pour leurs parents. D’autre part, éteindre un respirateur artificiel
qui maintient quelqu’un en vie, c’est un acte létal qu’il est difficile de distinguer de
l’euthanasie.
R. A. : La question n’est donc pas de dire si l’on a le droit de donner la mort à quelqu’un,
puisque la loi le permet pour des personnes qui sont dépendantes du respirateur. Reste que le
« laisser mourir » ouvre un temps qui peut être celui de l’accompagnement. Face la violente
rapidité de l’euthanasie, c’est un argument qu’il faut entendre. Car il faut que nous pensions
ce qu’il advient à ceux qui survivent aux personnes qui meurent. Or le travail de deuil peut
s’opérer plus aisément quand la fin de vie a été une occasion de pacification – à condition,
comme c’est le cas pour ces nouveau-nés qui font montre d’une incroyable énergie vitale, que
la situation ne s’éternise pas.
A. C.-S. : L’idée que l’illégalité de l’euthanasie permet de maintenir un interdit « structurant »
est l’un des points qui nous a le plus opposés. D’abord, quel interdit ? Le « Tu ne tueras
 6
6
 7
7
1
/
7
100%