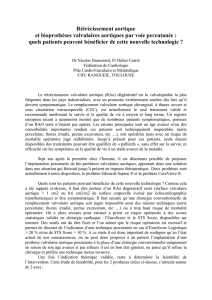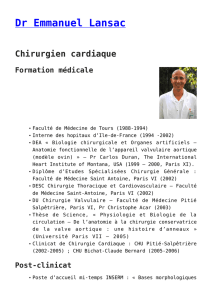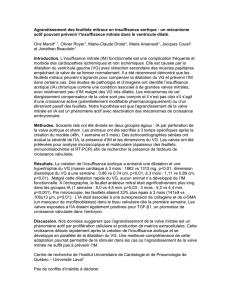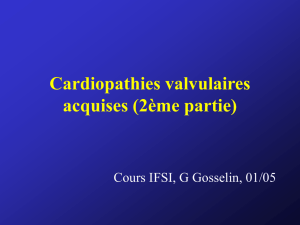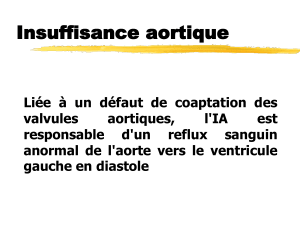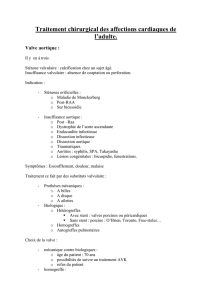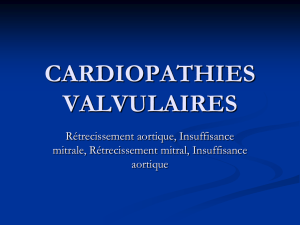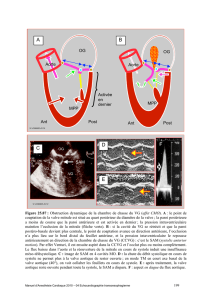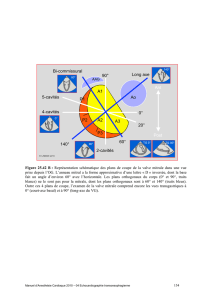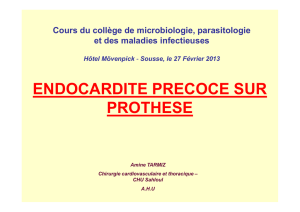Endocardite à Coxiella Burnetii sur valve native aortique

118 CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2014 ; 18(2) : 118-120
Endocardite à Coxiella Burnetii sur valve native
aortique chez un patient d’origine marocaine
porteur de prothèse valvulaire mitrale
Ghita Saghi1*, Loubna Salaheddine1, Diae Mahjoubi1, Hicham Benyoussef2,
Rochdi Sayeh2, Jamila Zarzur1, Mohamed Cherti1
RÉSUMÉ Mots clés : Coxiella Burnetii, prothèse valvulaire cardiaque, endocardite.
L’endocardite infectieuse à Coxiella Burnetii est extrêmement rare et représente le chef de file des endocardites infectieuses à hémocultures négatives.
Nous rapportons le cas d’un patient d’origine marocaine porteur d’une prothèse mécanique en position mitrale et d’une insuffisance aortique odérée,
et chez qui le diagnostic d’une endocardite infectieuse à fièvre Q sur valve native aortique a été posé. Il a été mis sous hydroxychloroquine et doxycy-
cline et a bénéficié une année plus tard, devant l’aggravation de la fuite aortique, d’un remplacement valvulaire aortique. Ce cas clinique est pertinent
de par l’absence d’atteinte de la prothèse mécanique.
ABSTRACT Keywords: Coxiella Burnetii, heart valve prosthesis, endocarditis.
Q fever endocarditis is rare but is considered the most important infective endocarditis with negative blood cultures. We report the case of a
Moroccan patient with moderate aortic insufficiency who carried a mechanical prosthesis in the mitral position and was hospitalized for conges-
tive heart failure with fever. The diagnosis of Q fever endocarditis of the native aortic valve was made, and the patient was put on doxycycline
and hydroxychloroquine. He underwent aortic valve replacement one year later, due to worsening aortic regurgitation. This case is relevant
because the mechanical prosthesis was not affected.
1. Service de cardiologie B, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc.
2. Service de cardiologie A, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc.
* Auteur correspondant : [email protected]
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.
1. INTRODUCTION
La fièvre Q (FQ) est une zoonose ubiquitaire [1] causée par
Coxiella Burnetii, petite bactérie intracellulaire gram néga-
tif dotée d’une infectiosité majeure [2]. Son réservoir est très
vaste [1] et les humains sont des hôtes accidentels.
La fièvre Q provoque le plus souvent une primo-infection
asymptomatique et évolue vers la chronicité dans 1 à 5 % des
cas (infection durant plus de 6 mois). Ceci se voit particu-
lièrement chez les valvulaires ou les porteurs d’une anoma-
lie vasculaire, les immunodéprimés ou encore les femmes
enceintes [3,4]. La forme chronique se manifeste sous forme
d’endocardite infectieuse dans 73 % des cas. Cette dernière
est mortelle en absence de traitement et sa présentation cli-
nique est caractérisée par un grand polymorphisme [5], d’où
l’intérêt de l’évoquer de principe.
Nous rapportons l’observation d’un patient porteur d’une pro-
thèse mécanique en position mitrale, et qui a présenté une
endocardite à Coxiella Burnetii sur valve native aortique,
épargnant la prothèse mécanique.
2. OBSERVATION
Un patient de 37 ans était hospitalisé au service de cardiolo-
gie pour dyspnée de repos et fièvre intermittente à 38,5 °C
depuis 5 mois. Il est porteur d’une prothèse mécanique en
position mitrale depuis 3 ans et d’une fuite aortique modé-
rée d’origine rhumatismale. L’examen cardiaque objectivait
un souffle diastolique d’insuffisance aortique tandis que les
bruits d’ouverture et de fermeture de la prothèse mitrale
étaient normaux. On notait par ailleurs une hépatomégalie,
une splénomégalie, un purpura pétéchial aux jambes et un
hippocratisme digital.
Sur le plan biologique, on avait rapporté un syndrome inflam-
matoire franc avec un taux de leucocytes normal et pas de
lymphopénie. De plus, le bilan rénal était perturbé : protéi-
nurie positive à 1 g/jour, une hématurie microscopique et une
clairance de la créatinine à 40 mL/min. Les hémocultures ré-
alisées (y compris sur milieu de Sabouraud) étaient négatives.
L’échocardiographie transthoracique avait mis en évidence
une végétation sur le versant ventriculaire de la sigmoïde

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2014 ; 18(2) : 118-120 119
c a s c l i n i q u e
aortique postérieure [figure 1], une insuffisance aortique modé-
rée et un ventricule gauche dilaté mais de bonne fonction
systolique. Par ailleurs, la prothèse mitrale fonctionnait cor-
rectement et l’échocardiographie transœsophagienne (ETO)
n’avait pas retrouvé d’argument en faveur d’une endocardite
sur prothèse mécanique [figure 2].
Devant ce tableau d’endocardite infectieuse sur valve native,
à hémocultures négatives, plusieurs sérologies (HIV, HVC,
HVB, Brucellose, typhoïde…) étaient réalisées, dont celle de
Coxiella Burnetii qui était très positive avec un titrage à 4 000
des IgG anti-phase I par la technique d’immunofluorescence
indirecte. Un traitement à base de doxycycline (200 mg/jour)
et d’hydroxychloroquine (600 mg/jour) était alors instauré.
Le contrôle sérologique à 12 mois avait noté une baisse de la
dilution d’Ig G à 2048, en faveur d’une bonne réponse aux
antibiotiques. Cependant, l’aggravation de la fuite aortique,
et la survenue d’une dysfonction ventriculaire gauche avaient
motivé la réalisation d’un remplacement valvulaire aortique
par prothèse mécanique.
L’intervention chirurgicale s’était déroulée sous circulation ex-
tracorporelle après sternotomie médiane. L’exploration peropé-
ratoire de la valve aortique retrouvait une végétation de 4 mm [fi-
gure 3]. La valve aortique native était alors réséquée en monobloc.
L’exploration de la prothèse valvulaire mitrale confirmait
l’absence de signe d’endocardite infectieuse sur celle-ci et
l’absence de fuites paraprothétiques mitrales [figure 4]. Une
prothèse mécanique à double ailette avait été implantée en
position aortique. Les suites opératoires étaient simples, et
l’évolution clinique satisfaisante. Le contrôle échocardiogra-
phique postopératoire immédiat était favorable. Le patient est
toujours sous biantibiothérapie.
3. DISCUSSION
L’endocardite infectieuse à FQ est rare : on dépiste 1 nouveau
cas par an et par million d’habitants. Elle représente 8 % de
l’ensemble des endocardites à hémocultures négatives, dont
plus de 50 % surviennent sur une prothèse valvulaire [6].
Le tableau clinique habituel est celui d’un patient porteur
d’une valvulopathie avec des anomalies cliniques aspéci-
fiques : altération de l’état général, frissons, sueurs nocturnes.
Les formes diagnostiquées tardivement comprennent une
insuffisance cardiaque, une hépatomégalie, une splénoméga-
lie, un purpura des extrémités et un hippocratisme digital [7].
Tous ces signes ont été retrouvés chez notre patient où le dia-
gnostic a été porté avec plusieurs mois de retard.
Figure 4. Vue chirurgicale de la prothèse valvulaire mitrale en place
qui est sans anomalie.
Figure 1. Coupe parasternale grand axe transthoracique montrant
une végétation volumineuse sur la sigmoïde aortique postérieure.
Figure 2. ETO : coupe apicale 4 cavités montrant l’absence
de végétation sur la prothèse mitrale.
Figure 3. Vue chirurgicale de la valve aortique montrant
une végétation de 4 mm à travers l’aortotomie.

120 CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2014 ; 18(2) : 118-120
endocardite à coxiella burnetii
Sur le plan échocardiographique, les végétations peuvent
manquer totalement à l’ETT, imposant le recours à l’ETO.
Quand elles sont présentes, leur taille n’est pas corrélée à la
durée d’évolution. La curiosité de notre observation tient à
l’atteinte exclusive de la valve native, épargnant la prothèse
mécanique.
Le diagnostic biologique de certitude repose sur l’immuno-
fluorescence indirecte : un titre d’IgG supérieur ou égal à 800
contre les antigènes de la phase I suffit à faire évoquer une in-
fection chronique [8]. Par ailleurs, Coxiella Burneti peut être
isolée en culture ou mise en évidence par PCR sur sérum.
La meilleure thérapeutique actuelle est l’association doxycy-
cline (200 mg/jour) et hydroxychloroquine (600 mg/jour). La
durée du traitement est au moins de 18 mois sur valve native
et de 24 mois sur prothèse valvulaire. Elle est conditionnée
par l’évolution de la sérologie.
L’indication du traitement chirurgical est la même que pour
les autres EI. On y a recours dans 45 % des cas selon les der-
nières études [9]. Le remplacement valvulaire ne sera effec-
tué qu’après 3 semaines d’antibiothérapie. Une surveillance
rigoureuse et prolongée après l’arrêt du traitement s’impose
car une récidive est toujours possible.
4. CONCLUSION
L’endocardite infectieuse à FQ est une maladie rare mais grave
en l’absence de traitement. Son expression clinique est peu spé-
cifique. Ainsi, il faut savoir l’évoquer de principe devant tout
tableau de maladie systémique chez un valvulaire et a fortiori
si les hémocultures conventionnelles sont négatives. Son dia-
gnostic repose sur l’IFI et son traitement se base sur une bianti-
biothérapie prolongée comprenant l’hydroxychloroquine et la
doxycycline, associée parfois à la chirurgie. Enfin, elle nécessite
un long suivi clinique, sérologique et échocardiographique afin
de guetter une éventuelle rechute, toujours possible plusieurs
années après un traitement bien conduit.
n
1. Million M, Lepidi H, Raoult D. Fièvre Q: actualités diagnostiques et théra-
peutiques. Médecine et maladies infectieuses 2009;39(2):82-94.
2. Maurin M, Raoult D. Q fever. Clin Microbiol Rev 1999;12:518-53.
3. Raoult D, Tissot-Dupont H, Foucault C et al. Q fever 1985-1998. Clini-
cal and epidemiologic features of 1,383 infections. Medecine (Baltimore)
2000;79(2):109-23.
4. Fenollar F, Thuny F, Xeridat B, Lepidi H, Raoult D. Endocarditis after Q fever
in patients with previously undiagnosed valvulopathies. Clin Infect Dis 2006;
42(6):818-21.
5. Landais C, Aletti M, Soureau JB et al. Mental confusion and fever in a
77-year-old patient. Rev Med Interne 2010;31(2):153-6.
6. Auzary C, Pinganaud C, Launay O et al. Endocardites à Coxiella Burnetii
sur prothèse : 6 observations. Rev Med Interne 2001;22(10):948-58.
7. Tissot Dupont H, Raoult D, Brouqui P et al. Epidemiologic features and
clinical presentation of acute Q fever in hospitalized patients: 323french cases.
Am J Med 1992;93(4):427-34.
8. Fournier PE, Marrie TJ, Raoult D. Diagnostic of Q fever. J Clin Microbiol
1998;36(7):1823-34.
9. Gunn TM, Raz GM, Turek JW, Farivar RS. Cardiac Manifestations of
Q Fever Infection: Case Series and a Review of the Literature. J Card Surg
2013;28(3):233-7.
RÉFÉRENCES
1
/
3
100%