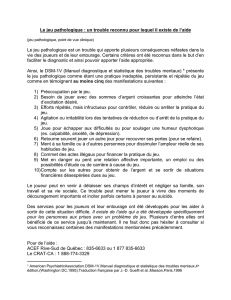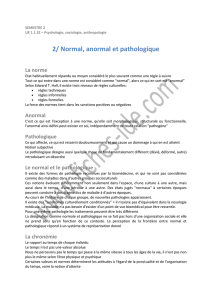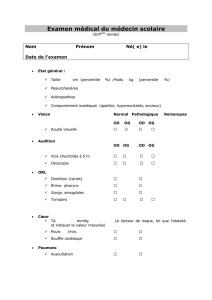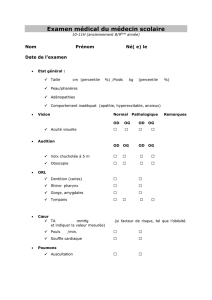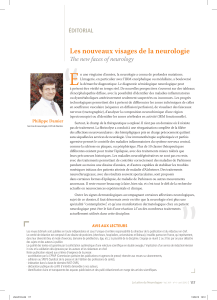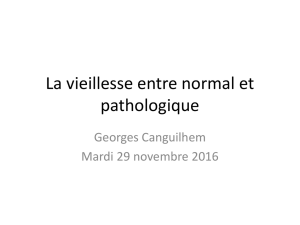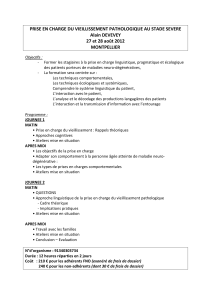Lire l'article complet

Act. Méd. Int. - Neurologie (2) n° 1-2, janvier/février 2001
30
Il n’est pas certain qu’en
cela nos patients nous
donnent raison. Ils sem-
blent vouloir témoigner
d’un sens qui lie le pro-
cessus à leur histoire sin-
gulière, nous livrant les
clés de leur subjectivité ;
mais à cette demande
d’histoire, nous répon-
dons peut-être trop sou-
vent par la géographie
anatomo-physiologique.
Il est possible que l’on
puisse y voir l’une des
inadéquations entre une
pratique biomédicale
objectivante, quantifiante
et généralisante et une
demande de soins sub-
jective, contingente et
profondément individuelle.
Diversité des représentations
du pathologique au sein
de l’imaginaire du patient
L’histoire et l’ethnologie nous appren-
nent à quel point les représentations et
le sens attachés au pathologique sont
variables dans l’espace et le temps.
L’expérience clinique montre qu’ils
peuvent varier et être déclinés à l’infi-
ni dans un même lieu et en un même
temps, soulignant bien ainsi leur carac-
tère individuel. F. Laplantine, faisant
une étude anthropologique des repré-
sentations de la maladie telles qu’elles
apparaissent dans la littérature, nous
dit qu’“aucune période historique n’était
susceptible en elle-même de sécréter
une conception univoque de la maladie,
pas plus d’ailleurs que la spécificité
d’une pathologie donnée ne détermine
ipso facto un mode de représentation
qui lui correspondrait (1)”. Ainsi,
Flaubert et Dostoïevski rigoureuse-
ment contemporains, entretiennent
avec l’épilepsie dont ils sont tous deux
atteints, des relations radicalement dif-
férentes. Kafka meurt de la tuberculo-
se, dont il avait une vision exogène et
maléfique, l’année où paraît La monta-
gne magique où Thomas Mann en
donne une vision endogène et adorcis-
te : il considère d’ailleurs que “les
grands malades sont des crucifiés et
des victimes, offerts à l’humanité et à
son ascension, à l’extension de sa sen-
sibilité et de son savoir, bref à sa santé
supérieure” et que “le génie de la maladie
est plus humain que le
génie de la santé”. Plus
près de nous, Zorn et
Diggelman, tous deux
zurichois, meurent à
deux années d’intervalle
du cancer dont ils
avaient une appréhen-
sion diamétralement
opposée. Mieux encore,
des représentions diffé-
rentes voire antagonistes
peuvent coexister à un
même moment et chez
un même patient, géné-
rant alors une ambiva-
lence fréquemment obs-
ervée chez le sujet
malade.
Nécessité thérapeutique
d’une représentation
extériorisée et simplifiée
Face à cette complexité et cette hétéro-
généité, le soignant (qu’il soit médecin
ou non) souhaite toujours tirer à lui des
interprétations lui permettant une
représentation simplifiée et extériori-
sée, soumise à la fois à son savoir et à
sa “sensibilité” (dans des proportions
extrêmement variables), afin d’élaborer
un projet de soin plus ou moins concerté.
La maladie devient donc souvent l’oc-
casion d’une relation duelle unique, où
les représentations du soigné et du soi-
gnant (médecin, guérisseur populaire
ou religieux, exorciste...) se confron-
tent et aboutissent à un compromis qui
permet l’élaboration d’un projet théra-
peutique. Si le soigné fait état d’une
perception intime avec la maladie afin
La maladie, ce n’est pas à nous, médecins, qui la
côtoyons tous les jours, que l’on va apprendre ce
que c’est ! Parfois, lorsque nous sommes face à un de
nos patients et que nous venons de lui expliquer, le plus
clairement possible, ce que nous savons du processus qui
le touche, il nous questionne sur le sens de sa maladie,
souvent par une formulation comme : “Pourquoi moi ?”
“Pourquoi maintenant ?” Nous répondons qu’il s’agit
d’une absurdité biologique dont la source pourrait être
dans les gènes ou dans des causes environnementales.
Nous ne faisons, en somme, que rejeter l’absurdité un
peu plus loin, mais on ne peut pas dire que nous
répondions à la question autrement qu’en disant
que la maladie n’a pas de sens.
* Neurologue, Arpajon.
h
ors-
j
eux
Hors-Jeux
Un lien entre
la neurologie
et les sciences
humaines
Sens et non-sens
de la maladie (Ire partie)
L. Chia*

31
de faire valoir sa représentation, le soi-
gnant en général dévalorise cette sub-
jectivité et met en avant son savoir et
son expérience, issus de la prise en
charge d’“autres malades” ayant la
“même” maladie. Plus la représenta-
tion du soignant est l’objet d’un
consensus social, plus elle aura de
poids face à la subjectivité du soigné.
Imposition de la biomédecine
comme représentation
consensuelle
Si, depuis Hippocrate et la médecine
humorale, d’innombrables interpréta-
tions médicales de la maladie se sont
succédé, affrontées ou complétées,
sans jamais parvenir à donner une
image consensuelle, la médecine, en se
proclamant expérimentale, donne à
penser que les représentations qu’elle
se fait du pathologique n’en sont plus,
et que son statut de science expérimen-
tale lui donne accès au réel. L’immense
succès social remporté par cette nou-
velle ontologie médicale – la micro-
biologie pastorienne élaborée par un
biologiste non médecin et dans des
laboratoires éloignés des patients – se
comprend en partie par le fait de la
visualisation du microbe au travers des
lentilles grossissantes du microscope,
qui semble montrer que le mal-maladie
est une chose différente du sujet por-
teur, dont le narcissisme se trouve ainsi
restauré et les espoirs de guérison net-
tement renforcés. Même si Pasteur lui-
même acceptera par la suite dans ses
travaux scientifiques l’importance du
terrain dans la pathologie infectieuse,
la compréhension de son apport, qu’elle
soit sociale ou même médicale, reste
essentiellement ontologique. Par
ailleurs, Claude Bernard, au même
moment, travaille à établir une norma-
tivité biologique qui permet de rendre
compte des états de dysfonctionnement
de l’organisme (la maladie) comme
d’un état d’éloignement par rapport à
la norme physiologique (la santé) et, ce
faisant, établit une autre localisation
(fonctionnelle) de la maladie, complé-
mentaire de celle de Pasteur.
L’adhésion, tant médicale que sociale,
fut si grande que Bernard et Pasteur
furent considérés de leur vivant même
comme les pères fondateurs d’une nou-
velle médecine, rejetant les autres
représentations médicales comme pré-
ou a-scientifiques, et donc fausses ou
au mieux approximatives. À partir de
là, l’expression pathologique (qu’elle
soit symptomatique ou émanant du dis-
cours du patient) est immédiatement
traduite par le médecin, à l’aide d’un
savoir essentiellement biologique et en
en privilégiant les éléments objectifs,
afin d’en faire un objet classifiable au
sein de la nosologie en vigueur, d’en
avoir une approche physiologique et
d’établir une stratégie thérapeutique
validée par des études cliniques ras-
semblant un nombre important de
patients ayant la “même” pathologie.
La biomédecine tend à privilégier une
représentation spatiale (anatomique)
de la maladie plutôt que temporelle
(historique), peut-être en partie parce
que la perspective de la mort n’est pas
inclusive de la première et qu’elle l’est
de la seconde. Cette localisation géo-
graphique du pathologique en un lieu
purement biologique perd de vue les
dimensions psychologique et sociale
attachées au sujet dont l’irréalité “des
mots” est opposée par Claude Bernard
à la “réalité des faits expérimentaux”.
“Dans cette rencontre entre la maladie
telle qu’elle est subjectivement éprou-
vée (illness) et telle qu’elle est scientifi-
quement observée et objectivée (disease),
la pratique biomédicale consiste à
ramener intégralement la première à la
seconde (1).” Cette traduction biomé-
dicale du pathologique, qui laisse sou-
vent le malade insatisfait dans son
désir de sens, s’explique et éventuelle-
ment se justifie par un pragmatisme
thérapeutique qui présuppose le patho-
logique comme anormal et maléfique
et donc propose d’en faire une localisa-
tion pour le désigner, le comprendre et
enfin le combattre afin d’en débarras-
ser le sujet qui était antérieurement
sain et qui évidemment souhaite le
devenir à nouveau.
Consolidation
par l’économisme
Cette prise de pouvoir du savoir bio-
médical se comprenait bien à la fin du
XIXesiècle et dans la première moitié
du XXe, grâce au contexte de positivisme
scientifique. “La médecine est, dit
Sigerist, des plus étroitement liée à la
culture, toute transformation dans les
conceptions médicales étant condi-
tionnée par des transformations dans
les idées de l’époque (2).”
Aujourd’hui, alors que ce positivisme
fait l’objet d’un soupçon justifié,
même au sein de sciences autrement
plus “dures” que la nôtre (physique,
mathématique...), il peut paraître
étrange, qu’il soit moins ébranlé au
sein de la biomédecine. Cette persis-
tance – même s’il est incontestable que
des voix y compris médicales s’élè-
vent depuis longtemps contre cette
représentation hégémonique – sera
certainement et est déjà un objet d’étude
intéressant pour les sciences humaines
touchant au fait pathologique et théra-
peutique : histoire de la médecine,
sociologie, ethnologie, épistémologie
et économie. Pour ma part, j’émets
l’hypothèse – certes fragile, puisqu’elle
n’est que ressentie de l’intérieur d’une
pratique clinique – que si notre scien-
h
ors-
j
eux
Hors-Jeux

Act. Méd. Int. - Neurologie (2) n° 1-2, janvier/février 2001
32
tisme, à nous médecins, en venait à être lui aussi ébranlé, il
ne tarderait pas à être “renarcissisé” par nos fournisseurs de
procédures de soins/biens de consommation. L’industrie
des biotechnologies, qui s’est greffée avec le succès que
nous savons, sur la pratique médicale, se satisfait fort bien
de la loi des grands nombres et finance actuellement de
façon nettement majoritaire la recherche clinique, dont l’in-
dépendance en tant qu’outil d’évalution scientifique peut,
de ce fait, paraître remis en question. La croissance écono-
mique de ce secteur industriel étant sous-tendue par l’ex-
pansion du savoir scientifique, on peut imaginer que positi-
visme scientifique et volonté de croissance économique se
relaient l’un l’autre, afin de communiquer que la santé est
exclusivement liée à l’approfondissement du savoir scienti-
fique et l’amélioration des outils de soins/produits de
consommation, dont le prix évidemment ne cesse de croître,
entraînant fatalement une inégalité sociale grandissante
dans la prise en charge des malades. Ce cadre économique
oblige la médecine à abandonner peu à peu son humanisme
hippocratique fondateur pour devenir le marché de la distri-
bution de soins ; le médecin clinicien étant de plus en plus
remplacé par le médecin prescripteur. Le temps nécessaire à
l’abord clinique, considéré à la fois comme localisation
géographique du mal mais également comme événement de
l’histoire singulière du patient est remplacé par la prescrip-
tion/consommation.
Références
1. Laplantine F. Anthropologie de la maladie. Paris : Bibliothèque
scientifique Payot, 1992. (Cet ouvrage a été une source importante
pour l’élaboration de cet article).
2. Sigerist H. Introduction à la médecine. Paris : Payot, 1932.
LISTE DES ANNONCEURS
ASTRA ZENACA (Zomigoro), P. 10-11 –
SANOFI-SYNTHÉLABO (DÉPAKINE), P. 2 –
SCHERING (Bêtaféron), P. 36.
Imprimé en France - Differdange S.A. - 95110 Sannois - Dépôt légal
1er trimestre 2001 - © en cours - Médica-Press International S.A.
hors-jeux
Hors-Jeux
Groupe HOPALE
BERCK-SUR-MER
P.S.P.H.
RECHERCHE
NEUROLOGUE
temps plein
Convention C.C.N. 51
Renseignements et candidatures :
Docteur DANZE
Tél. : 03 21 89 41 17 – Fax : 03 21 89 41 19
E-mail : [email protected]
62
◗
PAS-DE-CALAIS
Retrouvez la suite de ce volet
en trois parties dans les
Actualités en Neurologie
des mois de mars et avril 2001
Annonce professionnelle
1
/
3
100%