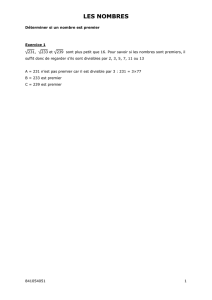MATHÉMATIQUES DE BASE - Institut de Mathématiques de Bordeaux

MATHÉMATIQUES DE BASE (MIS 101, cours 2007-2008)
Alain Yger
30 mai 2012


Table des matières
1 Bases de logique et théorie des ensembles 1
1.1 Opérationslogiques....................................... 1
1.1.1 Objets, assertions, relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.2 Vraietfaux....................................... 2
1.1.3 Quelques opérations entre assertions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.4 Règlesdelogique.................................... 4
1.2 Ensembles et parties d’un ensemble ; quantificateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 Quelques mots de l’axiomatique de la théorie des ensembles . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.4 Produitdedeuxensembles .................................. 9
1.5 Union et intersection d’une famille de parties d’un même ensemble . . . . . . . . . . . . 9
1.6 Apprendre à raisonner : le raisonnement par l’absurde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.7 Apprendre à raisonner : le principe de contraposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.8 Compter, calculer, ordonner, raisonner par récurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.8.1 L’axiomatique de N.................................. 11
1.8.2 Deux opérations sur N................................. 11
1.8.3 Un ordre total sur N.................................. 12
1.8.4 Le principe du raisonnement par récurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.8.5 La division dans Net l’algorithme d’Euclide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.8.6 Un autre algorithme issu de la division euclidienne : écrire en base b....... 15
1.8.7 Le développement d’une fraction en fraction continue . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.9 Notion de fonction ; éléments de combinatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.9.1 Fonction d’un ensemble Edans un ensemble F; exemples . . . . . . . . . . . . . 17
1.9.2 Injection, surjection, bijection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.9.3 Image directe, image réciproque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.9.4 Composition des applications, inverses à gauche et à droite . . . . . . . . . . . . 19
1.9.5 Applications d’un ensemble fini dans un autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.9.6 Éléments de combinatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2 Nombres entiers, rationnels, réels et complexes 23
2.1 L’anneau Zdesentiersrelatifs................................. 23
2.1.1 Construction de l’anneau ordonné (Z,+,×)..................... 23
2.1.2 Un exemple de calcul algébrique dans Z: l’identité de Bézout . . . . . . . . . . . 25
2.2 Nombres rationnels et nombres réels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2.1 Fractions et développements décimaux périodiques : deux approches des rationnels 27
2.2.2 Une approche de l’ensemble des nombres réels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2.3 Suitesdenombresréels ................................ 31
2.2.4 Les opérations sur R.................................. 32
2.2.5 Le lemme des “gendarmes” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
i

ii TABLE DES MATIÈRES
2.2.6 Borne supérieure, borne inférieure d’un sous-ensemble de R............ 34
2.2.7 Intervalles de R; la propriété des segments emboîtés ; non dénombrabilité de R. 37
2.2.8 La droite numérique achevée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.3 Le plan R2etlesnombrescomplexes............................. 40
2.3.1 Le plan R2....................................... 40
2.3.2 Le corps (C,+,×)................................... 43
2.3.3 Moduleetargument .................................. 44
2.3.4 La fonction exponentielle complexe et les formules de Moivre et d’Euler . . . . . 45
2.3.5 Résolution dans Cde l’équation algébrique zn=A................. 50
2.3.6 Résolution des équations du second degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3 Fonctions numériques et modélisation 57
3.1 Limite d’une fonction en un point de Rou de R∪ {−∞,+∞} ............... 57
3.2 Continuité d’une fonction en un point et sur un ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.3 Opérations sur les fonctions continues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.4 Fonctions strictement monotones sur un intervalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.5 Dérivabilité en un point et sur un intervalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.6 Quelques fonctions classiques et leurs inverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.6.1 La fonction exponentielle et le logarithme népérien . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.6.2 Fonctions trigonométriques et leurs inverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.6.3 Les fonctions hyperboliques et leurs inverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.7 Fonctions de deux ou trois variables : une initiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.7.1 Le plan R2et l’espace R3............................... 87
3.7.2 Produit scalaire, produit vectoriel, angles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.7.3 Continuité et différentiabilité en un point d’une fonction de deux ou trois va-
riables;grapheetgradient............................... 95
3.7.4 La « chain rule » du calcul différentiel : quelques exemples . . . . . . . . . . . . . 99
3.7.5 Dérivées d’ordre supérieur ; laplacien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
3.7.6 Champs de vecteurs dans un ouvert du plan ou de l’espace . . . . . . . . . . . . 104
3.8 Aires, intégration, primitives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
3.8.1 La notion d’aire d’un domaine plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
3.8.2 Primitive d’une fonction continue sur un intervalle ouvert de R.......... 111
3.8.3 Calcul d’intégrales et calcul de primitives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
3.8.4 Primitives de fractions rationnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
3.9 Équationsdifférentielles .................................... 118
3.9.1 Équations linéaires du premier ordre et problème de Cauchy associé . . . . . . . 119
3.9.2 Un exemple de problème de Cauchy du premier ordre non linéaire se ramenant
aucaslinéaire ..................................... 121
3.9.3 Les équations différentielles du second ordre à coefficients constants . . . . . . . 122

Chapitre 1
Bases de logique et théorie des
ensembles
1.1 Opérations logiques
1.1.1 Objets, assertions, relations
En mathématiques, on travaille sur des objets (on dit aussi êtres) entre lesquels on vérifie des
relations.
On commence par définir les objets, en indiquant avec des illustrations :
– les nombres : N(quand on a du apprendre à compter), Z(quand il a fallu apprendre à calculer des
gains, des pertes et des dettes depuis la fin du Moyen-âge) Q, puis R(le nombre √2sortant du
cadre des fractions), puis C(pour résoudre x2+ 1 = 0 et répondre aux exigences de la Physique
du XIX-ème siècle), puis ensuite pour enrichir la boîte à outils nécessaire à l’algèbre, à la physique
et à l’informatique, les quaternions, les octaves de Cayley...
– les objets géométriques : la sphère, la chambre à air (peut on dénouer un noeud sur une sphère,
peut on le dénouer sur une chambre à air ?), le ruban ou le ruban de Mœbius (peut on s’orienter
sur un ruban, le peut on sur un ruban de Mœbius ?), où la notion de forme (on dit topologie) joue
un rôle majeur ;
– les transformations physiques (comme la transformation de Fourier, incarnation mathématique
de la diffraction en optique) peuvent aussi être considérées comme des objets mathématiques.
Une relation est une assertion concernant divers objets mathématiques, assertion qui se doit d’être
VRAIE ou FAUSSE. Par exemple :
n2≥nquand n≥1
est une assertion VRAIE, tandis que
n2< n quand n > 1
est une assertion fausse (nest ici nombre entier positif). Par contre
i≤2i+ 1
(iétant le nombre complexe correspondant à (0,1)) n’est pas une relation car il n’y a pas d’ordre dans
C; ce n’est ni vrai, ni faux, mais simplement vide de sens.
1
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
1
/
135
100%