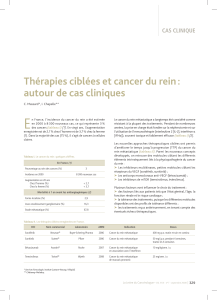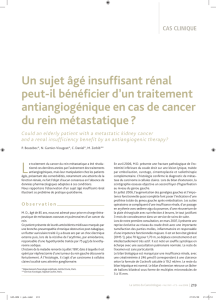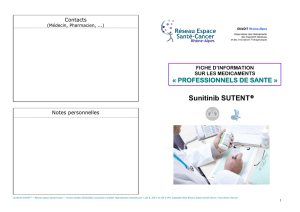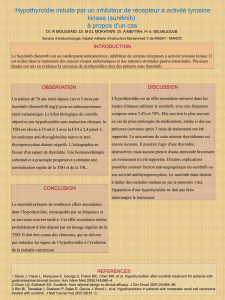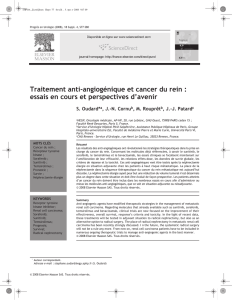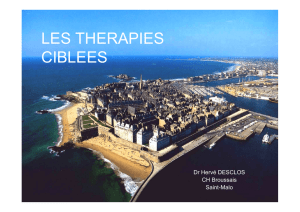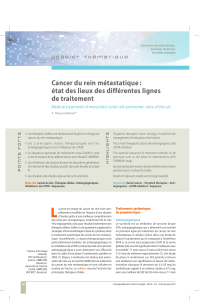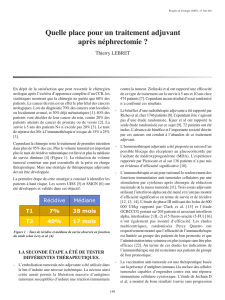Q Cancer du rein DOSSIER THÉMATIQUE Kidney cancer

54 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XIX - n° 1 - janvier 2010
DOSSIER THÉMATIQUE
Rétrospective 2009
Cancer du rein
Kidney cancer
P. Beuzeboc1
1
Département d’oncologie médicale,
Institut Curie, Paris.
Q
uand on a la chance de disposer d’une
remarquable synthèse comme celle publiée
par B.I. Rini, S.C. Campbell et B. Escudier
dans le Lancet (1), autant commencer la
lecture de la rétrospective de l’année par là…
Formes familiales
Cancer du rein bilatéral
Il est estimé que 5 à 10 % des cancers du rein sont
héréditaires (2).
L’étude de F. Wiklund et al. (3) a montré que les
patients jeunes ont un risque plus élevé de cancer
ipsi- ou controlatéral (multiplié par 17 en cas de
cancer avant 40 ans). Ils doivent faire l’objet d’une
surveillance toute particulière et d’une recherche
de syndrome héréditaire. Le tableau I rassemble
les syndromes héréditaires actuellement bien indi-
vidualisés.
L’augmentation de l’incidence du cancer controla-
téral représente un argument supplémentaire pour
réaliser des néphrectomies partielles quand cela
est possible.
Antiangiogéniques
et croissance tumorale
Phénomène paradoxal de facilitation
de la croissance tumorale avec des
traitements antiangiogéniques courts
J.M. Ebos et al., dans un article assez “provocateur”
publié dans Cancer Cell (4), ont rapporté que le suni-
tinib pouvait accélérer la croissance des métastases
et diminuer la survie de souris ayant reçu des traite-
ments de courte durée dans certains modèles expéri-
mentaux ; notamment, ils ont observé ce phénomène
chez des souris recevant du sunitinib avant implan-
tation intraveineuse de cellules tumorales.
Chirurgie
Indication de surrénalectomie
en cas de néphrectomie
ou de néphrectomie partielle
➤
R.L. O’ Malley (5) a fait une revue systématique
de la littérature sur la place (l’intérêt, les indica-
tions) de la surrénalectomie en cas de néphrectomie
radicale afi n de défi nir une approche pragmatique
se fondant sur la tumeur primitive et les caracté-
ristiques de la maladie. L’incidence de l’atteinte
surrénalienne solitaire, synchrone, homolatérale
Tableau I. Syndromes héréditaires et gènes responsables (2).
Syndrome Histologie Gène
Von Hippel-Lindau Kystes rénaux à cellules claires VHL
Cancer du rein papillaire héréditaire Papillaire de type 1 MET
Birt-Hogg-Dubé Chromophobe
Oncocytique hybride
Cellules claires
Oncocytome
Kystes rénaux
BHD
Carcinome rénal
Léiomyomatose héréditaire
Papillaire de type 2
Kystes rénaux
Fumarate hydratase
(FH)
Sclérose tubéreuse de Bourneville Angiomyolipome
Cellules claires
Oncocytome
TSC1
TSC2
Cancer du rein associé à succinate
déshydrogénase B
Cellules claires
Chromophobe
Papillaire de type 2
Oncocytome
SDHB

La Lettre du Cancérologue • Vol. XIX - n° 1 - janvier 2010 | 55
Résumé
L’actualisation et les données de survie des principales études de phase III du sunitinib, du sorafénib et
du bévacizumab dans le cancer du rein métastatique ont été publiées cette année.
Les
crossover
à la progression ont diminué la possibilité de détecter une différence significative en survie
globale (SG). Cependant, la comparaison avec les contrôles historiques montre que ces traitements ciblés
ont permis de prolonger la vie des patients. Le développement clinique d’autres inhibiteurs de VEGF et
de mTOR, comme le pazopanib, l’axitinib et l’évérolimus, se termine et ils devraient donc faire bientôt
partie de l’arsenal thérapeutique. Des traitements séquentiels ont montré leur intérêt clinique. Jusqu’à
maintenant, les combinaisons restent du domaine de l’investigation.
Mots-clés
Cancer du rein
Inhibiteurs de VEGF
Inhibiteurs de mTOR
Inhibiteurs d’Akt
Highlights
Overall survival and updated
results have been published
this year for sunitinib,
sorafenib, and bevacizumab
phase 3 studies in metastatic
renal cell carcinoma. Cross-
over at progression under-
powered the trials’ ability to
detect a signifi cant difference
in overall survival. Neverthe-
less, comparison with historical
controls support that targeted
treatment has extended the
lives of patients. Other agents
which target VEGF and mTOR
pathways, such as pazopanib,
axitinib and everolimus, have
entered the last-stage clinical
testing and likely will join the
therapeutic armamentarium.
Sequencial treatments have
emerged as clinically relevant.
To date, combinations of
targeted therapy remain inves-
tigational.
Keywords
Renal cell carcinoma
VEGF inhibitors
mTOR inhibitors
Akt inhibitors
est faible, étant en effet comprise entre 1 % et 5 %.
La taille, le stade T, la multifocalité, la localisation au
pôle supérieur, la thrombose veineuse représentent
des facteurs de risque. La morbidité de la surrénalec-
tomie est minimale, sauf dans le cas des atteintes
bilatérales. Les survies globales et spécifi ques, avec
ou sans surrénalectomies, sont identiques. Il existe
un bénéfi ce en survie chez les patients présentant
une métastase surrénalienne isolée (même si ce cas
ne représente pas plus de 2 % des tumeurs rénales).
➤
Les indications en cas de néphrectomie partielle
ne sont pas clairement défi nies. L’étude de l’équipe
de Cleveland (6) menée sur 2 065 néphrectomies
partielles a révélé qu’une surrénalectomie conco-
mitante n’avait été réalisée que dans 48 cas (2,3 %).
L’analyse histologique n’avait montré que du tissu
bénin dans 42 cas (87 %). Dans un cas, un envahis-
sement par le carcinome rénal avait été retrouvé,
dans 2 cas, des métastases de ce cancer, et dans
3 cas, une autre histologie…
Données à long terme de la chirurgie
partielle pour les carcinomes
de plus de 4 cm
Une étude rétrospective française (7) de 61 patients
traités entre 1980 et 2005 et faisant l’objet d’un
suivi médian de 70,7 mois a montré que les taux
de survie spécifi que à 5 et 10 ans étaient de 81 % et
78 %. En analyse univariée, apparaissaient comme
facteurs pronostiques signifi catifs de survie la taille
supérieure à 7 cm (p = 0,002), le stade pathologique
(p = 0,001) et le grade de Fuhrman (p = 0,004). En
analyse multivariée, seuls le stade et le grade étaient
signifi catifs (p < 0,0001 et 0,007 respectivement).
Les facteurs pronostiques
L’atteinte de la graisse sinusale
dans les tumeurs à cellules claires pT3
Selon la classification 2002 de l’American Joint
Committee (AJC), les tumeurs avec envahissement
de la graisse périrénale ou du sinus du rein sont
classées pT3. Une étude rétrospective italienne (8)
de 115 tumeurs pT3a a montré que l’atteinte de la
graisse sinusale réduisait signifi cativement la survie
spécifi que chez les patients sans atteinte ganglion-
naire ou métastatique.
L’âge est-il un facteur de risque
indépendant dans les tumeurs
localisées ?
L’analyse à partir des données SEER (Surveillance,
Epidemiology, and End Results) sur un ensemble de
8 578 patients traités chirurgicalement pour une
tumeur localisée n’a pas montré que l’âge repré-
sentait un facteur prédictif de survie, que ce soit
pour les tumeurs inférieures à 4 cm ou pour celles
supérieures à 7 cm (9). Seule était retrouvée, pour les
tumeurs de taille intermédiaire, une tendance à une
diminution de la survie avec l’augmentation de l’âge.
Survie globale des patients
métastatiques traités par anti-
angiogéniques
L’analyse d’une large étude multicentrique améri-
caine et canadienne (10) à partir des données de
645 patients traités par sunitinib (n = 396), sorafénib
(n = 200) ou bévacizumab (n = 49) a confi rmé que
4 des 5 facteurs du MSKCC pour les formes méta-
statiques étaient des facteurs de mauvais pronostic :
un taux d’hémoglobine anormal (p < 0,0001), un
IK < 80 % (p < 0,0001), une calcémie corrigée supé-
rieure à la normale (p = 0,0006) et un intervalle de
temps par rapport au diagnostic initial de moins
de un an (p = 0,01). Une élévation au-dessus de la
normale des leucocytes (p < 0,001) et des plaquettes
(p = 0,01) était aussi un paramètre pronostique indé-
pendant. Pour le groupe favorable (aucun facteur de
mauvais pronostic, n = 133), la médiane de survie
n’était pas atteinte et le taux de survie à 2 ans était
de 75 %. Pour le groupe intermédiaire (1 à 2 facteurs,
n = 301), la médiane de survie était de 27 mois et
le taux de survivants à 2 ans de 53 %, alors que,
dans le groupe mauvais pronostic (3 à 6 facteurs,
n = 152), la médiane de SG était de 8,8 mois et le
taux de survivants à 2 ans de 7 %.

0,6
Survie (%)
0,8
1,0
0,4
0,2
0,0 01224 4836
Mois 60
Médiane SG : 18,3 versus 17,4 mois
HR = 0,86 ; p = 0,069
SG estimée à 3 ans (BEV/IFN) 31 %
0,6
Survie (%)
0,8
1,0
0,4
0,2
0,0 0126182430
21,3 23,3
36
Mois 42
Médiane SG : 23,3 versus 21,3 mois
HR = 0,86 ; p = 0,1291
SG estimée à 3 ans (BEV/IFN) 34 %
IFN
Bévacizumab/IFN
IFN
Bévacizumab/IFN
Figure 1. Études AVOREN et CALGB 90206 : comparaison des courbes de survie (12, 13).
56 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XIX - n° 1 - janvier 2010
Cancer du rein
DOSSIER THÉMATIQUE
Rétrospective 2009
Actualisation des données
de survie globale
Résultats fi naux de l’étude de phase III
TARGET (11)
TARGET a évalué le sorafénib après traitement par
cytokines et a inclus 903 patients. Cette actualisa-
tion a montré que, en intention de traitement, la SG
était comparable dans les bras sorafénib et placebo
(17,8 mois versus 15,2 mois, HR = 0,88, p = 0,146).
Cependant, la différence était signifi cative quand
les données post-crossover du bras placebo étaient
censurées (17,8 mois versus 14,3 mois, HR = 0,78,
p = 0,029).
Données en survie des études AVOREN
et CALGB 90206
Ces deux larges essais randomisés européen
(649 patients) [12] et américain (732 patients)
[13], qui comparaient IFNα versus IFNα + bévaci-
zumab, ont montré une amélioration signifi cative
du taux de réponse et de la survie sans progression
(SSP) dans le bras combiné avec le bévacizumab :
HR = 0,63, 10,2 versus 5,4 mois, p = 0,001 dans
l’étude AVOREN, et HR = 0,71, 8,4 versus 4,9 mois
dans l’étude CALGB 90206.
Cependant, les résultats en termes de SG ne sont
signifi catifs dans aucune des deux études, comme le
montrent les courbes ci-dessous (fi gure 1).
Les patients ayant reçu un traitement complémentaire
(notamment par un anti-angiogénique) sont plus
nombreux dans le bras IFN. Cela a pu jouer pour la SG.
Mise à jour des données de l’étude
sunitinib versus IFN
Dans cette étude ayant inclus 750 patients (14),
la médiane de SG était supérieure dans le groupe
sunitinib (26,4 mois versus 21,8 mois respective-
ment), avec un HR à 0,818 (IC95 : 0,669-1,001), lors
de l’analyse primaire par log-rank test non stratifi é.
Avec un log-rank test stratifi é, l’HR était à 0,818
(0,669-0,999, p = 0,049). Dans le bras IFN, 33 %
des patients ont reçu du sunitinib et 32 % un autre
inhibiteur de la voie VEGF.
Étude de phase II d’une administration
continue de sunitinib
Les patients, réfractaires à une immunothérapie
(15), étaient randomisés en deux groupes “prise
unique”, d’une dose de 37,5 mg le premier groupe
prenant celle-ci le matin (n = 54) et l’autre, le soir
(n = 53). Le suivi médian était de 8,3 mois. La dose
a été réduite à 25 mg/j chez 46 patients (43 %) en
raison de la survenue d’une toxicité de grade 3 ou 4.
Les toxicités de grade 3 les plus fréquentes ont été
la fatigue (16 %), les diarrhées (11 %), l’hypertension
artérielle (11 %), les syndromes mains-pieds (9 %) et
l’anorexie (8 %). Le taux de réponse était de 20 %,
avec une médiane de durée de réponse de 7,2 mois.
Les médianes de SSP et de SG étaient respectivement
de 8,2 mois et de 19,8 mois. Aucune différence n’a
été retrouvée entre prise matinale et vespérale.
Étude de phase II comparant sorafénib
versus IFN (16)
Cent quatre-vingt-neuf patients ont été rando-
misés entre sorafénib (400 mg × 2/j) et IFN
(9 000 000 UI × 3/sem.) [période 1]. Les patients
progressant sous sorafénib recevaient une dose
augmentée à 600 mg × 2/j, alors que ceux sous IFN
étaient traités par sorafénib (400 mg × 2/j) [période 2].
Pour la période 1, la SSP était similaire (5,7 mois
versus 5,6 mois), mais il y avait plus de régression
tumorale avec le sorafénib (68,2 % versus 39 %).
Pour la période 2, 41,9 % des patients ayant reçu le
sorafénib à plus fortes doses ont eu une régression

0,6
0,8
1,0
0,4
0,2
0,0 0 5 10 15 20
HR : 0,40 ; p < 0,001
HR = 0,40
IC95 : 0,27-0,60
p < 0,0000001
Médiane SSP
Pazopanib : 11,1 mois
Placebo : 2,8 mois
Pazopanib versus placebo
Phase III (n = 233)
Pazopanib
Placebo
0,6
0,8
1,0
0,4
0,2
0,0 0 5 10 15 20
HR : 0,519 ; p < 0,001
HR = 0,519
IC95 : 0,435-0,618
p < 0,000001
Sunitinib versus IFN
Phase III (n = 750)
Sunitinib
Médiane : 10,8 mois
IC95 : 10,6-12,6
IFN
α
Médiane : 4,1 mois
IC95 : 3,8-5,3
Figure 2. Essai randomisé pazopanib versus placebo chez des patients naïfs de trai-
tement : la SSP est assez comparable à celle du sunitinib (20).
La Lettre du Cancérologue • Vol. XIX - n° 1 - janvier 2010 | 57
DOSSIER THÉMATIQUE
tumorale (médiane de SSP = 3,6 mois) versus 76 %
des patients ayant eu un switch pour le sorafénib
dans le bras IFN (médiane de SSP = 5,3 mois).
Sunitinib dans la “vraie vie”
Impact du sunitinib sur la survie
des patients métastatiques (17)
Il s’agit ici de données collectées dans un registre
canadien identifi ant 131 patients traités par IFN
(entre 2000 et 2005) et 69 traités par sunitinib
(d’octobre 2005 à septembre 2007).
La répartition selon les groupes pronostiques du
MSKCC était identique. Les médianes de SG des
2 groupes ont été, respectivement, de 8,7 mois et de
17,3 mois (p = 0,004). L’introduction du sunitinib est
associée à un doublement de la médiane de survie et
s’assortit d’un bénéfi ce pour les différents groupes
pronostiques.
Effi cacité et tolérance du sunitinib
M.E. Gore et al. (18) les ont analysées dans les
conditions courantes de prescription. L’analyse
des données de 4 564 patients de 52 pays, dont
321 (7 %) avaient des métastases cérébrales et
582 (13 %) avaient un PS ECOG ≥ 2, a montré
que les 2 effets indésirables les plus fréquents
étaient les diarrhées (44 %) et la fatigue (37 %).
Les toxicités de grade 3-4 étaient la fatigue (8 %)
et les thrombopénies (8 %). Sur les 3 464 patients
évaluables, le taux de réponse objective (RO) était
de 17 %, identique avant et après 65 ans ; il était de
12 % pour les métastases cérébrales, de 11 % pour
les tumeurs non à cellules claires et de 9 % en cas
d’ECOG ≥ 2. La médiane de SSP était de 10,9 mois
(IC95 : 10,3-11,2) et la médiane de SG de 18,4 mois
(17,4-19,2).
Risque hémorragique lié au sunitinib
et au sorafénib (19)
Une méta-analyse de 23 essais de phases II et III
regroupant 6 779 patients a évalué le risque de
saignement de tout grade à 16,7 % (IC
95
: 12,7-21,5)
et celui des grades élevés, à 2,4 % (IC95 : 1,14-3,49).
Le risque hémorragique de tout grade enregistré dans
les essais randomisés de phase III était seulement
de 2 % (IC95 : 1,14-3,49).
Les nouveaux venus
Pazopanib versus placebo
Cette étude multicentrique internationale de
phase III a randomisé (2:1) 435 patients, entre
pazopanib (800 mg/j), un inhibiteur oral ciblant
VEGFR, PDGFR, c-Kit, et un placebo (20). Les
patients du bras placebo (n = 145) pouvaient rece-
voir du pazopanib lors de la progression. L’objectif
primaire était la SSP, les objectifs secondaires, la
SG, la durée de réponse, la tolérance et la qualité
de vie. La SSP obtenue était très signifi cativement
augmentée, avec une médiane à 9,2 mois versus
4,2 mois (HR = 0,46, IC95 : 0,34-0,62, p = 0000001)
[fi gure 2].
Les toxicités ont été assez semblables à celles
rencontrées avec le sunitinib. Il n’y avait pas de
différence signifi cative en termes de qualité de vie
entre les 2 bras. Le pazopanib vient de recevoir aux
États-Unis l’agrément de la Food and Drug Admi-
nistration.
L’axitinib
➤
O. Rixe (21) avait rapporté, après échec d’un trai-
tement par cytokine dans une première étude de
phase II ayant inclus 52 patients, un taux de réponse
de 44,2 % (IC95 : 30,5-58,7), la médiane de durée
de réponse étant de 23 mois.
➤B.I. Rini (22) vient de rapporter les résultats de
l’axitinib chez des patients réfractaires au sorafénib.

58 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XIX - n° 1 - janvier 2010
Cancer du rein
DOSSIER THÉMATIQUE
Rétrospective 2009
Dans cette étude ouverte multicentrique de phase II
qui a recruté 62 patients ayant tous reçu du sorafénib
et traités à la dose de 5 mg 2 fois par jour, le taux
de réponse a été de 22,6 %, la médiane de durée de
réponse étant de 17,5 mois. Les médianes de SSP
et de SG ont été respectivement de 7,4 mois (IC95 :
6,7-11) et de 13,6 mois (IC95 : 8,4-18,8). Les princi-
pales toxicités de grades 3 et 4 ont été les syndromes
mains-pieds (16,1 %), la fatigue (16,1 %), l’hyperten-
sion artérielle (16,1 %), la dyspnée (14,5 %) et les
diarrhées (14,5 %). Une étude de phase III comparant
l’axitinib au sorafénib après l’échec d’un traitement
de première ligne est en cours.
Nouveaux agents ciblant le VEGF
Parmi ces nouveaux agents, l’AV-951 (23) et le BAY
73-4506 (24) ont montré une effi cacité proche de
celle du sunitinib (tableaux II et III) [25].
Les traitements séquentiels
Étude multicentrique de phase II
du sorafénib chez 52 patients
réfractaires au sunitinib (26)
Le taux de réponse partielle était de 9,6 % (IC95 :
5-17) après 2 cycles. La toxicité de grade 3 la plus
fréquente a été la diarrhée (11,5 %). Le temps jusqu’à
progression (TTP) médian était de 16 semaines
(8 à 40 semaines) et la médiane de survie de
32 semaines (16 à 64 semaines).
Traitement séquentiel par sorafénib
et sunitinib (27)
L’analyse multicentrique française (4 sites) de
90 patients consécutifs a montré, dans le groupe
sorafénib suivi de sunitinib (68 patients), que les
médianes de TTP et de survie étaient de 22 semaines
et de 135 semaines, alors qu’elles étaient de
17 semaines et de 82 semaines dans le groupe suni-
tinib suivi de sorafénib (22 patients). Les durées de
traitement séquentiel étaient de 61 et 49 semaines
respectivement.
Traitement séquentiel. Que peut-on
en attendre en termes de SSP et de SG ?
Les traitements séquentiels sont entrés dans la
pratique courante. B. Escudier et al., dans un article
de Cancer (27), ont fait l’hypothèse que l’on pour-
rait en attendre une médiane de SSP de l’ordre de
Tableau III. Les données des différents inhibiteurs de VEGFR chez des patients vierges de trai-
tement anti-angiogénique varient en termes de réponse objective et de SSP.
Traitement RO SSP
Sunitinib 30-45 % 11 mois (naïfs)
8,4 mois (réfractaires aux cytokines)
Sorafénib 2-10 % 5,5-5,7 mois
Pazopanib 30 % 11,1 mois
Axitinib 47 % 15,7 mois
AV-951 24 % 8,9-11,8 mois
BAY 73-4506 27 % NR
Tableau II. Comparaison avec les données des autres inhibiteurs de VEGFR : le spectre et le potentiel des inhibiteurs
de VEGFR ne sont pas identiques.
VEGF
R1
VEGF
R2
VEGF
R3
PDGFRαPDGFRβKIT FLT3 RET
Sorafénib NA 90 100 50-60 80 68 46 100-150
Sunitinib 10 4 10 5-10 10 13 1-10 100-200
Pazopanib 10 30 47 71 84 72 > 1 000 > 1 000
Axitinib 1,2 0,2 0,3 5 1,6 1,7 > 1 000 > 1 000
AV-951 0,21 0,16 0,24 1,7 1,6
BAY 73-4506 16 5 46 NR 74 7 400 1
ABT-869 3 3 35 31 48 13
Concentrations inhibitrices (kinase IC50 en nanomoles) pour les cibles relevantes.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%