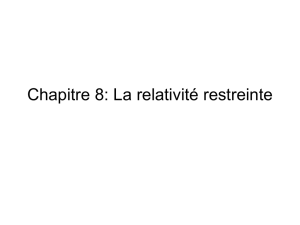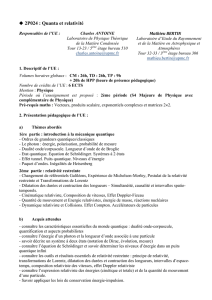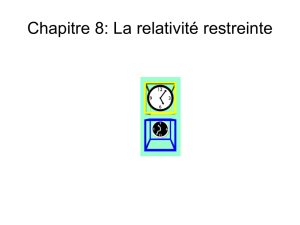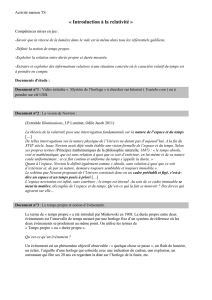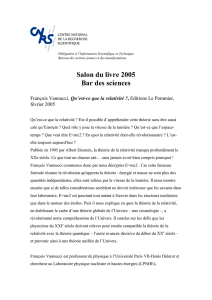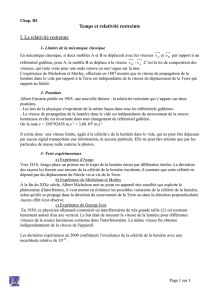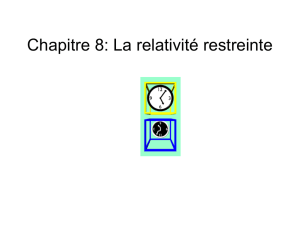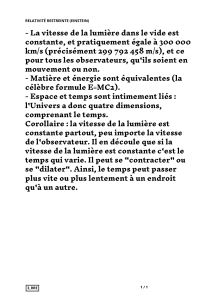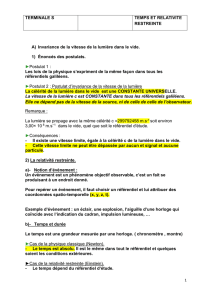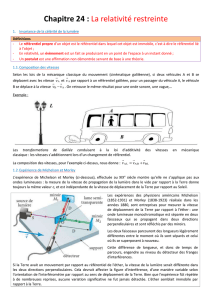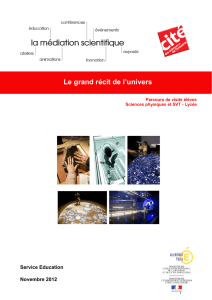Théorie de la relativité - Lycée technique du Centre

THÉORIE DE LA RELATIVITÉ

Table de matière
Mouvements relatifs ……………………………………...….. R1
Référentiels d’inertie ………………………………………..... R2
Principes fondamentaux ................................................................. R2
Dilatation du temps ................................................................. R3
Contraction des longueurs .................................................... R7
Masse relativiste ................................................................. R9
Loi fondamentale de la dynamique ....................................... R11
Énergie cinétique relativiste .................................................... R13
Équivalence de la masse et de l’énergie ....................................... R14
Quantité de mouvement relativiste ....................................... R16
Formulaire .............................................................................. R18
Exercices .............................................................................. R20
Liens internet ……….................................................................. R21

Théorie de la relativité 13GE − 2013/14 R1
Théorie de la relativité
Peu de théories en physique sont aussi étroitement liées au nom d’un seul
découvreur que la théorie de la relativité. Avec cet ensemble de
réflexions, Albert Einstein (1879-1955) a créé pour la physique moderne
un outil indispensable, qui a jusqu’à présent résisté à tous les tests
expérimentaux. Alors que la théorie de la relativité générale (formulée
vers 1915) décrit la gravitation comme la conséquence d’une courbure de
l’espace-temps quadridimensionnel, la théorie de la relativité restreinte
(1905) bouleverse des notions considérées comme évidentes de la
mécanique de Newton telles que l’espace et le temps. Nous voulons
montrer dans la suite certains aspects de cette théorie.
Principe de relativité
Mouvements relatifs
Le mouvement d’un corps signifie le changement de position du corps. La
position d’un corps est toujours donnée relativement à quelque chose.
Les mouvements sont ainsi relatifs, ils dépendent du référentiel par
rapport auquel les mouvements sont indiqués.
On explique à l’aide d’un exemple que les indications de vitesse sont
uniquement pertinentes si on indique en même temps le référentiel. Trois
observateurs respectivement au bord de la route, dans une auto qui roule
et dans un train en marche effectuent des mesures de vitesse. Le train et
l’auto roulent dans la même direction par rapport au bord de la route, à la
figure 2 de la droite vers la gauche. Le tableau contient les vitesses qui
ont été mesurées respectivement par les trois observateurs, chacun se
considérant comme au repos :
Indication de vitesse de
l’observateur en km/h
pour le bord
de la route
pour l’auto
pour le train
depuis le bord de la route
0
50
120
depuis l’auto
-50
0
70
depuis le train
-120
-70
0
Chaque observateur mesure une autre vitesse par rapport à un autre
observateur. Il en découle le principe de relativité suivant, que Galileo
Galilei (1564-1642) avait déjà découvert :
Ancien principe de relativité :
Chaque mouvement se déroule dans tous les référentiels comme si ceux-ci
étaient au repos. Dès lors, chaque mouvement est relatif, le référentiel au
repos respectif pouvant être choisi librement.
On peut observer des processus à partir d’un référentiel librement choisi.
On en tire :
Il n’existe pas d’état de repos absolu.
Il s’est avéré que ce principe de relativité est valable pour des vitesses qui
sont beaucoup plus petites que la vitesse de la lumière.
1. Albert Einstein (1879-1955) a
développé la théorie de la relativité
pendant qu’il travaillait comme
employé à l’office des brevets de Bern
en Suisse. Il a obtenu le prix Nobel en
1921, non pas pour la théorie de la
relativité apparaissant comme trop
révolutionnaire, mais pour l’expli-
cation de l’effet photoélectrique. La
photo date de 1906.
2. Des observateurs différents
mesurent des vitesses relatives
différentes, chacun dans un référentiel
différent.
3. Galileo Galilei (1564-1642)

Théorie de la relativité 13GE − 2013/14 R2
Référentiels d’inertie
Pour la description de phénomènes physiques, on a besoin de référentiels
pour l’espace et le temps. Un référentiel est en cela constitué de points
matériels auxquels nous rapportons le mouvement des corps. Au
référentiel est relié de manière rigide un système de coordonnées, de
sorte que la position de tout point du corps en mouvement est déterminée
de manière univoque par trois coordonnées spatiales.
Le référentiel peut être choisi librement. Cependant, dans la relativité
restreinte, on utilise uniquement ce qu’on appelle des référentiels
d’inertie.
Les référentiels d’inertie sont des référentiels spatiaux dans lesquels un
corps qui n’est soumis à aucune force reste au repos ou en mouvement
rectiligne uniforme.
Chaque référentiel qui se déplace selon un mouvement rectiligne
uniforme par rapport à un référentiel d’inertie est lui-même également un
référentiel d’inertie. Il existe dès lors une infinité de référentiels d’inertie
qui sont équivalents entre eux.
Le référentiel S avec les coordonnées (x, y, z) est lié au quai de gare,
tandis que le référentiel S’ avec les coordonnées (x’, y’, z’) est porté par le
train de marchandises. Les deux référentiels sont en mouvement rectiligne
uniforme l’un par rapport à l’autre. On s’attend à ce que les lois physiques
aient la même forme dans les deux référentiels.
Enfermé dans une boîte noire, aucune expérience ne permet de déterminer
si on se trouve dans le référentiel S ou dans le référentiel S’. En
particulier, on ne peut pas déterminer lequel de ces référentiels est au
repos. Il n’existe que des référentiels au repos relativement l’un à l’autre.
Même lorsqu’on regarde par la fenêtre et qu’on voit un deuxième train, il
est souvent très difficile de juger si c’est le train dans lequel on se trouve
ou l’autre qui est en mouvement.
Les référentiels non inertiels font intervenir des forces d’inertie
supplémentaires. Seule la théorie de la relativité générale permet de
considérer des référentiels accélérés par rapport à un référentiel d’inertie.
Postulats de la théorie de la relativité
Einstein a postulé que tous les référentiels d’inertie conviennent de
manière équivalente à l’élaboration de la physique. Ceci est le contenu du
principe de relativité qu’Einstein a sélectionné comme base pour sa
relativité restreinte :
Postulat 1 : Principe de relativité
Les lois physiques ont la même forme dans tous les référentiels d’inertie.
Les lois physiques générales ont la même forme dans deux référentiels en
mouvement relatif et sont indépendantes de la vitesse relative entre les
deux référentiels. Ceci a de grandes conséquences dans la théorie de
l’électromagnétisme, dans laquelle la vitesse de la lumière dans le vide
apparaît explicitement dans les équations.
1. Des référentiels différents sont
équivalents entre eux s’ils sont en
mouvement rectiligne uniforme l’un
par rapport à l’autre. Les mêmes lois
physiques sont alors valables sous la
même forme dans le train comme sur
le quai.
Un postulat en physique ne peut pas
être mis en question. Il constitue le
fondement d’une théorie physique. Des
expériences peuvent confirmer ou
réfuter des postulats; dans ce dernier
cas, les postulats sont eux-mêmes
réfutés et donc caducs.
c
e

Théorie de la relativité 13GE − 2013/14 R3
Si tous les référentiels d’inertie ont la même valeur, un signal lumineux
dans le vide doit manifestement se propager dans chacun de ces
référentiels avec la même vitesse dans toutes les directions. Ceci est le
principe de la constance de la vitesse de la lumière. Pour un mouvement
rectiligne uniforme entre la source de la lumière et l’observateur, on
mesure la même valeur c de la vitesse de la lumière dans le vide,
indépendamment de la vitesse relative v.
Postulat 2 : Principe de la constance de la vitesse de la lumière
La vitesse de la lumière est indépendante du mouvement de la source de
lumière et de l’observateur. La vitesse de la lumière dans le vide est dans
tout référentiel d’inertie c = 300 000 km/s.
Le principe de relativité (selon Einstein) et le principe de la constance de
la vitesse de la lumière découlent de l’expérience et ne sont à proprement
parler pas démontrables; mais uniquement réfutables; ce sont des postu-
lats. On peut uniquement en déduire des conclusions et vérifier les
connaissances ainsi obtenues par l’expérience.
L’ensemble de notions liées reposant sur ces deux principes de base et
l’ensemble des résultats en découlant constituent le contenu de la théorie
de la relativité restreinte.
Cinématique relativiste
Dilatation du temps
Nous voulons examiner la marche d’une horloge en mouvement. Afin de
faciliter ces considérations, nous construisons d’abord en esprit une
horloge la plus simple possible, l’horloge à photons. Elle a l’avantage
que le comportement des horloges au repos aussi bien que celui des
horloges en mouvement sont entièrement décrits selon les deux postulats
de la théorie de la relativité.
L’horloge à photons (figure 2) est constituée d’un cylindre dont à
l’extrémité supérieure se trouve une lampe à éclair. Un éclair envoyé par
la lampe parcourt le cylindre et est réfléchi à l’extrémité inférieure par un
miroir. Lorsque l’impulsion lumineuse revient à l’extrémité supérieure, la
lampe doit immédiatement envoyer un nouvel éclair. En outre, l’affichage
de l’horloge avance d’une unité de temps.
1. La lumière nous atteint toujours
avec la même vitesse c = 300 000
km/s. Ce faisant, il ne joue aucun rôle
que nous soyons au repos ou que nous
nous rapprochions ou nous écartions
d’une source de lumière. Ce principe
contredit l’expérience de la vie de tous
les jours.
2. Une impulsion lumineuse est en-
voyée à l’extrémité supérieure et elle
est ensuite réfléchie par le miroir dans
la partie inférieure. Au retour de
l’éclair en haut, l’horloge avance d’une
unité de temps.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%