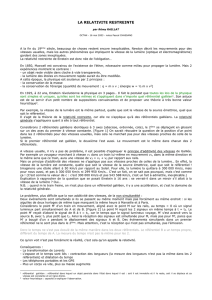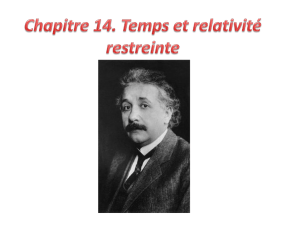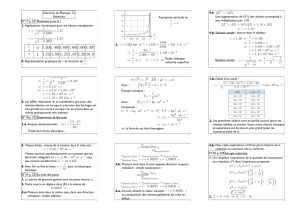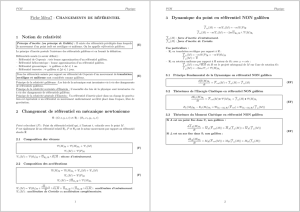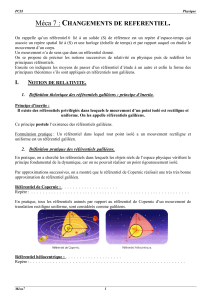Word 2007

Chapitre 24 : La relativité restreinte
1. Invariance de la célérité de la lumière
Définitions
- Le référentiel propre d’un objet est le référentiel dans lequel cet objet est immobile, c’est à dire le référentiel lié
à l’objet ;
- En relativité, un évènement est un fait se produisant en un point de l’espace à un instant donné ;
- Un postulat est une affirmation non démontrée servant de base à une théorie.
1.1. Composition des vitesses
Selon les lois de la mécanique classique du mouvement (cinématique galiléenne), si deux véhicules A et B se
déplacent avec les vitesse
A
v
et
A
v
par rapport à un référentiel galiléen, pour un passager du véhicule A, le véhicule
B se déplace à la vitesse
BA
vv
. On retrouve le même résultat pour une onde sonore, une vague,…
Exemple :
Les transformations de Galilée conduisent à la loi d’additivité des vitesses en mécanique
classique : les vitesses s’additionnent lors d’un changement de référentiel.
La composition des vitesses, pour l’exemple ci-dessus, nous donne :
A/L A/B B/L
v v v
1.2. Expérience de Michelson et Morley
L’expérience de Michelson et Morley (ci-dessous), effectuée au XIXe siècle montre qu’elle ne s’applique pas aux
ondes lumineuses : la mesure de la vitesse de propagation de la lumière dans le vide par rapport à la Terre donne
toujours la même valeur c, et est indépendante de la vitesse de déplacement de la Terre par rapport au Soleil.
Les expériences des physiciens américains Michelson
(1852-1931) et Morley (1838-1923) réalisée dans les
années 1880, sont entreprises pour mesurer la vitesse
de déplacement de la Terre par rapport à l'éther : une
onde lumineuse monochromatique est séparée en deux
faisceaux qui se propagent dans deux directions
perpendiculaires et sont réfléchis par des miroirs.
Les deux faisceaux parcourent des longueurs légèrement
différentes entre le moment où ils sont séparés et celui
où ils se superposent à nouveau.
Cette différence de longueur, et donc de temps de
parcours, engendre au niveau du détecteur des franges
d'interférences.
Si la Terre avait un mouvement par rapport au référentiel de l'éther, la vitesse de la lumière serait différente dans
les deux directions perpendiculaires. Cela devrait affecter la figure d'interférence, d'une manière variable selon
l'orientation de l'interféromètre par rapport au sens de déplacement de la Terre. Bien que l'expérience fût répétée
à de nombreuses reprises, aucune variation significative ne fut jamais détectée. L'éther semblait immobile par
rapport à la Terre.

Remarque : il y a eu bien d’autres expériences que celles de Michelson et Morley pour vérifier directement
l’invariance de la vitesse de la lumière dans le vide (Hall et Brillet, Alväger, Arago,…)
1.3. Postulats d’Einstein
En tenant compte des observations expérimentales (cf. §1.1 et 1.2) concernant la vitesse de propagation de la
lumière, Albert Einstein publie, en 1905, une nouvelle théorie connue sous le nom de « théorie de la relativité
restreinte ».
Cette théorie repose sur deux postulats :
Postulat n°1 :
Les lois de la physique s’expriment de la même façon dans tous les référentiels galiléens.
Deux expériences identiques réalisées dans deux référentiels galiléens différents donnent exactement le même
résultat ; la vitesse des référentiels les uns par rapport aux autres n’a aucun effet.
Postulat n°2 :
La vitesse de propagation (célérité) de la lumière dans le vide est indépendante du mouvement de la source
lumineuse et elle est invariante dans tout changement de référentiel galiléen.
La célérité de la lumière dans le vide est une limite de vitesse limite qu’aucune particule ou signal ne peut
dépasser. Cette vitesse ne peut être atteinte que par des particules de masse nulle (photon, neutrino, …).
2. Théorie de la relativité restreinte
2.1. Relativité du temps
Définitions
- La durée propre (ou temps propre) tp entre deux évènements est une durée mesurée par une horloge
immobile dans le référentiel propre où se déroule l’évènement.
- La durée mesurée (ou temps mesuré) tm entre deux évènements est la durée mesurée par une horloge fixe
dans un référentiel galiléen () en mouvement par rapport au référentiel galiléen (P) dans lequel on mesure la
durée propre.
Le temps n’est pas absolu : deux évènements simultanés dans un référentiel ne le sont pas dans un autre
référentiel en mouvement par rapport au premier.
A RETENIR :
La durée entre deux évènements dépend du référentiel dans lequel est effectuée la mesure.
2.2. Dilatation des durées
wagon
h2
ct
gare AA'
tv
gare
AA' vt
gare
AM A'M 2
t
c
et
2
2AA'
AM A'M h 2

2
gare 2AA'
h
22
t
c
22
gare wagon gare
2 2 2
t c t v t
c
...
wagon
gare 2
2
1
t
tv
c
Autre méthode :
Théorème de Pythagore : (AA’/2)² + h² = D² on retrouve le résultat ci-dessus.
2
2
1
γ
1v
c
= facteur de Lorentz (coefficient de dilatation temporelle)
A RETENIR :
Dans deux référentiels et P galiléens, la durée tm d’un phénomène mesurée dans et sa durée propre tP
mesurée dans P sont liées par l’expression :
P
2
2
P
1
PP
vitesse de propagation de par rapport à
célérité de la lumière dans le vide (en m.s )
durée propre de l'évènement dans (en s)
durée mesurée de l'évènement dans
1 (en
m
m
t
tv
v
c
c
t
t
s)
La durée mesurée tm dans est toujours supérieure à la durée propre tP : on dit qu’il y a dilatation des durées.
3. Preuves expérimentales
Pour des vitesses relativistes (proches de c)
L’expérience des physiciens Bruno Rossi et David Hall, en
1941, est la première preuve expérimentale de la
dilatation des durées : elle consiste à compter le nombre
de muons détectés en une heure au sommet d’une
montagne ainsi qu’au niveau de la mer.
Les muons sont des particules produites dans la haute
atmosphère, dues au bombardement par des protons
cosmiques (à environ 10 km d’altitude), qui se
désintègrent spontanément pour donner d’autres
particules.
Voir activité 2 p211 du livre.
wagon 2h
tc
gare 2D
tc
AA'
22
gare
vt

Pour des vitesses non relativistes (très faibles devant c)
Un autre cas observé de dilatation temporelle est le décalage entre horloges atomiques au sol et en vol. Cette
expérience a été initiée en 1971, mais pour comprendre tous les résultats, il faut faire appel à la relativité
générale.
Remarque : le mot « restreinte » signifie que la théorie s’applique uniquement à des référentiels dont le mouvement
est rectiligne et uniforme.
1
/
4
100%