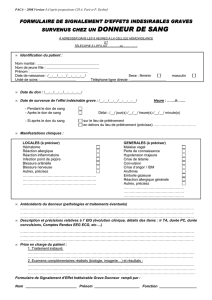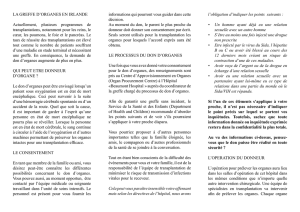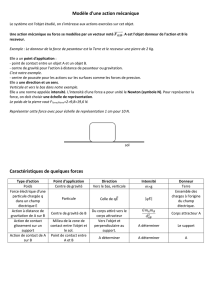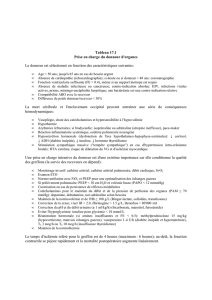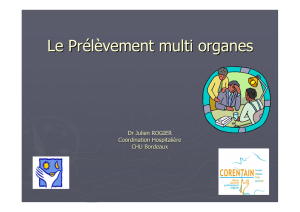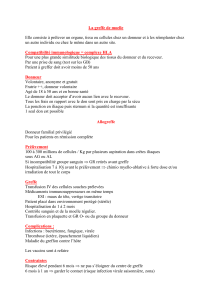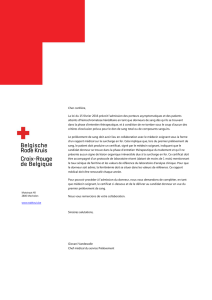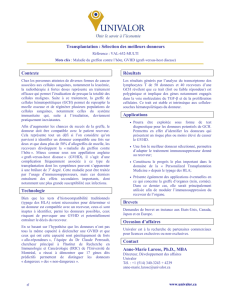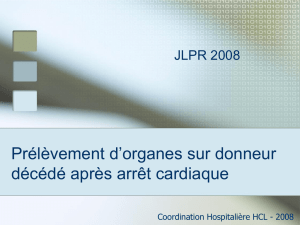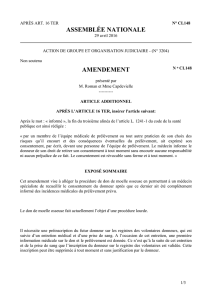Avis n° 50 - modifications à la loi transplantation d`organes

Avis n°50 du 9 mai 2011 concernant
certains aspects éthiques des
modifications apportées par la loi du
25 février 2007 à la loi du 13 juin 1986
relative au prélèvement et à la
transplantation d'organes
Demande d'avis du 12 février 2010,
de Madame L. Onkelinx, Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, relatif au prélèvement d'organes

Avis N° 50 du 09 mai 2011- Version définitive
2
Contenu de l'avis
1. Délimitation de l'objet de l'avis
A. Demande d'avis initiale
B. Indications liminaires quant aux dispositions légales visées par la demande
d'avis
C. Précisions issues du complément d'information transmis au Comité
D. Objet de l'avis, tel qu'il a été reformulé par le Comité
2. Aspects médicaux
A. Introduction
B. Qu'enseigne la littérature scientifique actuelle à propos des risques lors d'un
prélèvement d'organe à partir d'un donneur vivant?
1. Don de rein du vivant
2. Don de foie du vivant
3. Cadre juridique
A. Considérations générales – Règles et principes supranationaux
B. Analyse du droit belge
1. Les règles de droit médical général relatives aux personnes incapables de
consentir
a) Les incapables de droit
b) Les incapables de fait
2. Les textes spécifiques relatifs au prélèvement d'organes
a) Prélèvements in vivo
b) Prélèvements post mortem
3. Analyse des travaux préparatoires de la loi du 25 février 2007
4. Les règles générales de droit civil
C. Comparaison du droit belge avec les droits français et néerlandais
1. Droit français
2. Droit néerlandais : loi du 24 mai 1996, modifiée par la loi du 23 juin 2006
contenant les règles relatives à la mise à disposition d'organes (loi sur le
don d'organes)
3. Synthèse : bilan comparatif (limité au prélèvement en vue d'une
transplantation)
a) Prélèvements in vivo
b) Prélèvements post mortem
D. Conclusion sur le plan juridique
4. Considérations éthiques
A. Considérations introductives générales
B. Arguments éthiques en présence
C. Illustrations tirées de la jurisprudence américaine
D. Discussion des différents points de vue sur l'acceptabilité éthique du
prélèvement d'organes chez les majeurs incapables et les mineurs
1. Prélèvement d'organes chez les majeurs incapables
2. Prélèvement d'organes chez les mineurs
a) Position du problème
b) Quels organes ?
c) Existe-t-il un « devoir » de don d’organe, induit par des
responsabilités morales particulières au sein de la famille ?
d) Qui peut être receveur ?
e) La norme des meilleurs intérêts et les avantages/inconvénients

Avis N° 50 du 09 mai 2011- Version définitive
3
possibles pour le donneur
f) Peut-on imposer l’altruisme ?
g) L’assentiment de l’enfant est-il nécessaire ?
h) Quelle procédure pour la prise de décision ?
i) Conclusions
E. Considérations éthiques concernant la question de savoir si les proches d'une
personne décédée doivent pouvoir s'opposer au prélèvement d'organes sur
son cadavre
1. Quelle est la pratique actuelle en Belgique en matière de prélèvement
d'organes post mortem?
2. Principes éthiques dans la pratique
a) Considérations générales
b) Prélèvement d'organes chez les mineurs
c) Prélèvement d'organes chez les majeurs
d) Communication d'informations et opting out
5. Conclusions et recommandations

Avis N° 50 du 09 mai 2011- Version définitive
4
1. Délimitation de l'objet de l'avis
A. Demande d'avis initiale
Par courrier du 12 février 2010, Mme la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
demande l'avis du Comité sur deux aspects du prélèvement d'organes :
- d'une part, les articles 6, § 2, et 7, § 2, 3°, de la loi du 13 juin 1986 relative au
prélèvement et à la transplantation d'organes, ainsi que la suppression de l'article 10, § 4,
3°, de cette même loi par la loi du 25 février 2007 modifiant la loi du 13 juin 1986.
Comme l'indique Mme la Ministre, l'article 6, § 2, de la loi de 1986, inséré par la loi du 25
février 2007, prévoit que des prélèvements portant sur des organes qui ne se régénèrent
pas, ou des prélèvements d'organes qui peuvent avoir des conséquences pour le donneur,
peuvent être effectués sur des personnes vivantes majeures, incapables d'exprimer leur
volonté en raison de leur état mental; tandis que l'article 7, § 2, 3°, de la loi de 1986,
inséré par la loi du 25 février 2007, rend quant à lui possible le prélèvement d'organe sur
un mineur incapable de manifester sa volonté en raison de son état mental. Finalement, la
loi du 25 février 2007 a supprimé l'article 10, § 4, 3°, qui stipulait qu'à défaut de volonté
expresse du donneur, un médecin ne pouvait pas procéder à un prélèvement si un proche
lui communiquait son opposition;
- d'autre part, la portée de l'article 12 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention
et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales
humaines ou à des fins de recherche scientifique, qui prévoit que les articles 10 à 14 de
la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes ("opting out")
s'appliquent dans le cadre de prélèvements d'organes après le décès destinés à la
recherche scientifique, ou de prélèvements de tissus et cellules après le décès destinés à
des applications médicales humaines ou à la recherche scientifique. Mme la Ministre
souhaite connaître l'avis du Comité sur l'existence d'un consentement présumé dans le
cadre de la recherche scientifique, et sur le fait de lier le consentement/l'opposition à un
prélèvement d'organes à but thérapeutique au consentement/à l'opposition à un
prélèvement d'organes pour la recherche scientifique.
Le Comité a estimé que ces deux aspects sont nettement distincts et que chacun d'eux
appelle une réflexion éthique spécifique. Il a en conséquence jugé opportun de les scinder et
de répondre à la demande de Mme la Ministre en deux avis séparés. Le présent avis ne
concerne dès lors que la loi du 13 juin 1986 relative au prélèvement et à la transplantation
d'organes. Cette loi est applicable au prélèvement d'organes du corps d'une personne,
appelée "donneur", en vue de la transplantation de ces organes à des fins thérapeutiques sur
le corps de la même personne ou d'une autre personne, appelée "receveur". Au sens de cette
loi, on entend par "organe" une partie différenciée et vitale du corps humain, constituée de

Avis N° 50 du 09 mai 2011- Version définitive
5
différents tissus, et qui maintient de façon largement autonome sa structure, sa
vascularisation et sa capacité à exercer des fonctions physiologiques. Cette définition a été
insérée dans la loi du 13 juin 1986 par la loi du 19 décembre 2008. Il convient de préciser
qu'"une partie d'organe est également considérée comme un organe si elle est destinée à
être utilisée aux mêmes fins que l'organe entier dans le corps humain"
1
. Le transfert
d'embryon, le prélèvement et la transplantation de testicules et ovaires, et l'utilisation des
ovules et du sperme, ne sont pas visés par cette loi (art. 1er, § 1er). Les opérations effectuées
avec du matériel corporel humain qui ne répond pas à la définition précitée des organes sont
désormais régies par la loi du 19 décembre 2008 qui s'applique "au don, au prélèvement, à
l'obtention, au contrôle, au traitement, à la conservation, au stockage, à la distribution et à
l'utilisation du matériel corporel destiné à des applications humaines ou à des fins de
recherche scientifique" (art. 3, § 1er, alinéa 1er). Celle loi définit le matériel corporel humain
comme "tout matériel biologique humain, y compris les tissus et les cellules humains, les
gamètes, les embryons, les fœtus, ainsi que les substances qui en sont extraites, et quel
qu'en soit leur degré de transformation", les cellules comme les "cellules d'origine humaine
isolées ou ensemble de cellules d'origine humaine non reliées entre elles par un tissu
conjonctif", et les tissus comme "toute partie constitutive du corps humain constituée de
cellules". Les "application médicale humaine" qui sont visées sont conçues très largement
comme "l'utilisation de matériel corporel humain sur ou dans un receveur humain, y compris
l'application extracorporelle" (art. 2, 1°, 2°,3° et 20°).
En d'autres termes, il convient d'opérer une séparation nette entre les organes prélevés à des
fins thérapeutiques, visés par la loi du 13 juin 1986, et les tissus et cellules prélevés à
quelque fin que ce soit ou les organes prélevés à des fins de recherche scientifique qui sont,
eux, visés par la loi du 19 décembre 2008. Le Comité tient à souligner que cette distinction
des champs d'application respectifs des lois des 13 juin 1986 et 19 décembre 2008 n'est
parfois pas perçue en pratique. Ainsi, par exemple, la moelle osseuse n'est pas un organe au
sens de la loi du 13 juin 1986; son utilisation est régie par la loi du 19 décembre 2008.
Certains ont pourtant soulevé que, dans la mesure où elle se régénère, il serait plus adéquat
de faire entrer la moelle osseuse dans le champ d'application de la loi du 13 juin 1986, sous
peine de laisser lettre morte l'expression "organe qui peut se régénérer", qui apparaît dans
cette législation. Le foie répond en revanche à cette définition (voir toutefois les précisions
indiquées plus loin au chapitre 2.B.2). Dans le présent avis, il ne sera donc bien question
que des organes, définis de la manière exposée ci-dessus, prélevés à des fins
thérapeutiques. Néanmoins, étant donné le caractère régénérable de la moelle osseuse, il
1
Dir. (UE) n° 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes
de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation, art. 3, h), J.O.U.E. n° L.
207 du 6 août 2010, pp. 14-29. Cette directive doit être transposée pour le 27 août 2012.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
1
/
109
100%