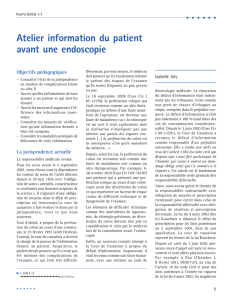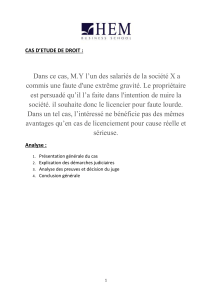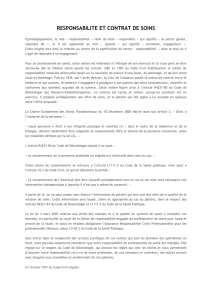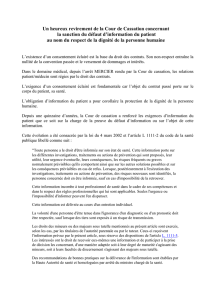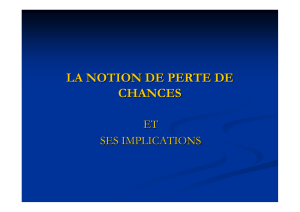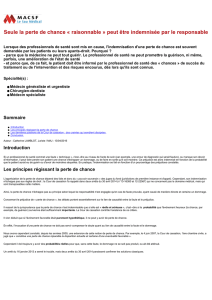06 /2010 Jean VILANOVA – Juriste j

LE DEFAUT D’INFORMATION DU MEDECIN ENVERS SON PATIENT CONSTITUE-T-IL UNE FAUTE AUTONOME ?
06 /2010
Jean VILANOVA – Juriste

Avant même d’être une obligation légale, informer un patient sur les risques qu’il encourt en relation avec les soins proposés
constitue un devoir moral pour tout médecin. Car la médecine est un humanisme. Et, depuis son arrêt fondateur du 25 /02 1997, la
Cour de cassation n’a eu de cesse de préciser les contours de cette obligation : que dire au patient ? Comment rapporter la preuve
de ce qui a été dit ? Comment faire face au refus de soins ?... Mais qu’en est-il lorsque n’ayant pas informé le patient, le médecin a
néanmoins conduit le geste technique dans les règles de l’art ? En d’autres termes, le défaut d’information en tant que tel peut-il être
sanctionné tandis que l’accomplissement du geste technique n’a été entaché d’aucune faute ?
1. Faits et décisions de justice
En avril 2001, un médecin urologue pratique une adénomectomie prostatique sur un patient souffrant de rétention d’urine. A la suite de
l’intervention, ce patient demeure atteint d’une impuissance sexuelle complète et définitive. Il recherche la responsabilité du praticien sur deux
motifs : la faute technique et le défaut d’information sur le risque d’impuissance sexuelle lié à l’opération.
Pour le tribunal de grande instance, le médecin n’a commis de faute ni dans le choix de la stratégie thérapeutique, ni dans la conduite du geste.
En revanche, il considère que le médecin a violé son obligation d’information. Il aurait dû sensibiliser le patient sur la nature du possible
préjudice induit par un tel geste opératoire (risque ici évalué à moins de 5 % par la littérature). Conformément à la jurisprudence bien arrêtée en
la matière, le tribunal estime que cette violation ouvre droit à réparation au titre de la perte de chance (réparation partielle à hauteur de 30 % du
préjudice).
Insatisfait de ce jugement, le patient fait appel.
Par arrêt rendu le 9 /04 /2008, la cour d’appel de Bordeaux le déboute de l’ensemble de ses demandes. Les juges du fond retiennent le
caractère nécessaire et sans alternative de l’intervention réalisée, sauf à exposer le patient à un risque grave d’infection. De surcroît, ils
considèrent que le geste a été réalisé dans les règles de l’art tout en reconnaissant le lien direct entre l’opération et l’impuissance sexuelle.
La cour pointe le manquement du médecin à son devoir régalien d’information mais elle écarte sa responsabilité au motif… « qu’il n’existait pas
d’alternative à l’adénomectomie pratiquée eu égard au danger d’infection que faisait courir la sonde vésicale, qu’il est peu probable que M. X (le
patient) dûment averti des troubles érectiles qu’il encourait du fait de l’intervention, aurait renoncé à celle-ci et aurait continué à porter une
sonde qui lui faisait courir des risques d’infections graves… »
A ce stade, l’arrêt suscite peu de commentaires. La cour d’appel de Bordeaux ne fait qu’appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation,
jurisprudence qui semble à ce moment bien établie et au titre de laquelle… « Il n’y a pas de responsabilité du médecin pour défaut
d’information s’’il apparaît que même informé, le patient n’aurait pas refusé l’opération… » (Cour de Cass. – 1ère ch. civ. – Arrêt H. du
2 /06 /2000).
2

Le patient forme un pourvoi devant la Cour de Cassation sur plusieurs branches : le geste, le suivi post-opératoire et le défaut d’information.
2. Cour de cassation – 1ère ch. civ. – Arrêt du 3 /06 /2010
Sans surprise, les deux premières branches du pourvoi sont rejetées. Reste la question du défaut d’information.
Même si le geste opératoire était nécessaire à la santé et peut-être à la survie du patient ne devait-il être précédé d’une information « claire,
loyale et appropriée » (art. 35 du Code de déontologie médicale) sur les risques encourus, notamment le risque d’impuissance sexuelle
complète et définitive ? Et, en l’absence de faute médicale prouvée, ce seul manquement induit-il à lui seul un préjudice indemnisable ?
En référence aux articles 16, 16-3 et 1382 du Code civil, la Cour de cassation répond par l’affirmative à ce questionnement estimant ainsi
recevable cette troisième branche du moyen dans les termes suivants :
« Attendu… que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des
risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention
thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel
l’information était légalement due, un préjudice… que le juge ne peut laisser sans réparation… »
3. Commentaires
Contrairement à d’autres observateurs, nous ne voyons rien de réellement surprenant dans le rendu de l’arrêt du 3 /06 /2010. Cet arrêt ne
constitue pas une inflexion de la jurisprudence. Il n’est que le logique prolongement à la construction jurisprudentielle entreprise depuis le
25 /02 /1997. Il prend naturellement en compte les principes de notre droit en matière de protection de la personne humaine.
La Haute cour fait tout d’abord référence aux principes régis au livre I – Chapitre 2 du Code civil « Du respect de la personne humaine ».
- Article 16 : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être
humain. »
- Article 16-3 : « Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention
thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. »
Elle en appelle ensuite à l’article 1382 tiré du livre III – Chapitre 2 « Des délits et des quasi-délits » qui stipule que « Tout fait quelconque de
l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Et cet article n’est que la traduction du
fameux principe du primum non nocere.
3

Ainsi la Cour de cassation n’invente rien (ce qui échapperait à ses prérogatives par ailleurs !)
Depuis fort longtemps, notre droit traite de façon autonome de la question éthique et du respect du corps. Nombre de textes internationaux
comme, parmi d’autres, La Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme (UNESCO – 19 /10 /2005) font de même. Il est
naturel qu’au bout du compte, cette autonomie en matière de traitement se prolonge d’une autonomie en matière de responsabilité – on parlera
alors de « responsabilité éthique » ou de « responsabilité morale » – et d’une autonomie en matière de faute avec obligation de réparer cette
faute éthique ou cette faute morale. Reste à définir comment mais en lui-même le principe est acquis.
En parallèle, la force considérable conférée au consentement par la loi du 4 /03 /2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système
de santé, loi qui régit aujourd’hui la responsabilité médicale relève d’une préoccupation identique du législateur.
Il n’est pas possible au praticien d’intervenir sans le consentement « libre et éclairé » du patient et ce consentement peut être retiré à tout
moment (art. L. 1111-4-3). Or ce consentement naît, nous l’avons énoncé plus haut, d’une information claire, loyale et appropriée sur les
risques propres à la stratégie thérapeutique proposée.
L’absence de consentement est d’évidence fautive au sens de ce texte. Même si l’intervention est médicalement justifiée, voire indispensable à
la santé du patient, dès lors qu’en état de donner son consentement celui-ci n’a pas été recherché par l’homme de l’art, la faute est là, patente,
autonome.
C’est le message que nous adresse la Cour de cassation dans son arrêt du 3 /06 /2010. La Haute juridiction poursuit donc son travail
d’appréhension globale de la délicate question légale et déontologique de l’information due au patient. Elle enrichit aujourd’hui sa construction
jurisprudentielle d’éléments éthiques et moraux inhérents au respect du corps.
Qui l’en blâmera ?
4
1
/
4
100%