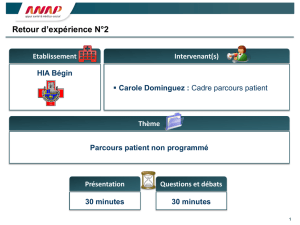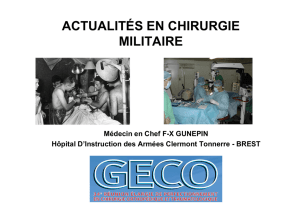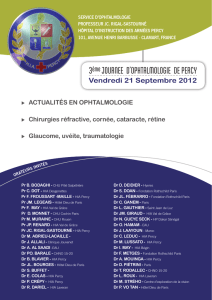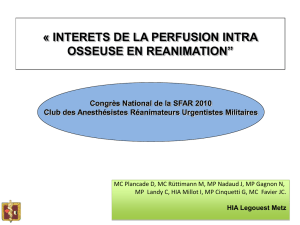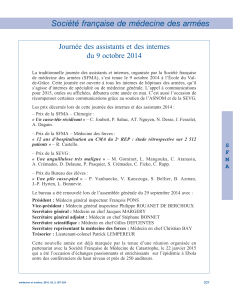Journée des internes et des assistants du 14 octobre 2010.

Sociéte française de médecine des armées
médecine et armées, 2011, 39, 3, xx-xx 263
Journée des internes et des assistants
du 14 octobre 2010.
Communications orales
Médecine
Radiologie interventionnelle diagnostique en
sénologie : résultats de six mois d’activité à l’HIA
Bégin et revue de la littérature.
E. PÉROUX, C. HÉLISEY, S. MASSE, A. CRÉMADES,
B. FRABOULET, V. CLAUDE, C. CARTRY, S. CRÉMADES.
Service d’anatomopathologie, HIA Bégin.
Service de radiologie, HIA Bégin.
Service de Médecine Interne et Oncologie, HIA Bégin.
Objectif : le cancer du sein est un véritable problème
de santé publique, il est la 1re cause de décès par cancer
chez la femme (18,9 %). Le taux de mortalité est en
décroissance depuis 2000, en grande partie amélioré
par la généralisation du dépistage du cancer du sein.
L’HIA Bégin s’est doté des infrastructures et du matériel
nécessaires aux prélèvements à visée diagnostique
des lésions mammaires suspectes. Nous avons étudié, sur
six mois, l’activité radiologique interventionnelle
diagnostique en sénologie à l’HIA Bégin et comparé nos
résultats aux données de la littérature.
Matériel et Méthodes : 118 biopsies percutanées
de lésions mammaires classées ACR 4 ou 5 ont été
réalisées dans le service de radiologie de l’HIA Bégin
du 1er janvier au 30 juin 2010 dont 68 microbiopsies
échoguidées de masses et 50 macrobiopsies stéréo-
taxiques de foyers de microcalcifications (49) ou de
masses non visibles en échographie (1).
Résultats : concernant les microbiopsies, une
pathologie maligne a été confirmée dans 56 % des cas
avec principalement des carcinomes canalaires infiltrant
(76,3 %), puis des carcinomes intracanalaires (15,8 %)
et des carcinomes lobulaires (13,1 %), plus rarement
un lymphome (2,6 %) et un carcinome mucineux
infiltrant (2,6 %). Les lésions bénignes représentaient
51,5 % dont 42,8 % d’adénofibrome et 14 % de
mastopathie fibrokystique. Concernant les macro-
biopsies, les lésions malignes représentaient 65 % des
prélèvements: les carcinomes intracanalaires (87,5 %)
étaient très majoritaires avant les carcinomes canalaires
infiltrant (12,5 %), aucun autre type histologique malin
n’était retrouvé. Les lésions bénignes représentaient
35 % dont 60 % de mastopathie fibrokystique,
14 % d’adénofibrome et 20 % d’adénose.
Discussion: depuis la généralisation du dépistage du
cancer du sein, l’incidence de celui-ci ne cesse de croître,
mais avec un taux de mortalité en décroissance. La
réalisation de biopsies de lésions suspectes détectées
par l’imagerie permet de diagnostiquer des tumeurs
souvent localisées et donc de meilleur pronostic. Nos
résultats sont conformes aux données de la littérature ce
qui confirme la place importante de la radiologie
interventionnelle dans la stratégie diagnostique et
thérapeutique en sénologie du fait de la qualité de la
technique, des biopsies réalisées et la collaboration
étroite anatomo-radio-clinique. En effet, les biopsies
obtenues par cette technique apportent les données
nécessaires, type histologique, grade histo-pronostique,
analyse de biologie moléculaire (récepteurs hormonaux,
Her2) pour une prise en charge thérapeutique adaptée en
cas de lésion maligne.
Migration secondaire des cathéters de chambre
implantable : mécanismes, prise en charge
thérapeutique et moyens de prévention.
C. HÉLISSEY, C. CHARGARI, L. MANGOUKA, M. FONDIN,
B. DE LA VILLÉON, L. MONTAGLIANI, V. DUVERGER,
S. CRÉMADES.
Service de médecine interne et oncologie, HIA Bégin.
Service de chirurgie viscérale et vasculaire, HIA Bégin.
Service d’oncologie radiothérapie, HIA Val-de-Grâce.
Objectifs : la migration secondaire de l’extrémité
distale du cathéter de site implantable intraveineux (SIV)
est un événement rare, seules quelques observations
isolées sont rapportées dans la littérature, mais source de
morbidité et des retards thérapeutiques. À travers trois
observations où cette complication est observée malgré
un contrôle radiographique initial satisfaisant, nous
discutons des différentes hypothèses sur le mécanisme de
cette complication, d’une prise en charge adaptée et des
moyens de prévention.
Observations : le patient n° 1 (pt 1), suivi pour un cancer
du colon métastatique, était hospitalisé à J47 de la pose du
SIV pour un syndrome cave supérieur. Le patient n° 2 (pt
2), suivi pour un cancer de la sphère ORL, présentait à J8
de la pose un hématome indolore en regard du point
d’injection. Le patient n° 3 (pt 3), suivi pour un cancer
S
F
M
A

colique de stade III, était hospitalisé à J15 de la pose, mais
aucun reflux n’était alors retrouvé au niveau du SIV. Pour
les trois patients, un contrôle radiologique était alors
effectué, montrant une extrémité distale du cathéter
située en région latérocervicale droite. Une échographie
doppler était réalisée, confirmant la migration
intrajugulaire interne droite du cathéter, mais objectivant
une thrombose jugulaire associée en regarde de
l’extrémité du SIV chez le pt 1 et pt 3 uniquement et
imposant chez eux une anticoagulation à dose efficace.
L’ablation du SIV était réalisée chez le pt 1 et pt 3; elle
est en attente chez le pt 3. Chez le pt 2, le cathéter était
replacé par radiologie interventionnelle via un guide,
permettant ainsi la reprise de la chimiothérapie.
Discussion : le SIV est constitué d’une partie intra
et extravasculaire, toutes deux mobiles et sujettes à
des forces physiques pouvant entrainer la migration
secondaire de l’extrémité distale de la chambre
implantable. Les facteurs intervenant dans cet événement
incluent certains mouvements du corps (rotation de la
tête), les chocs brutaux, les variations de pression
intrathoracique et du flux sanguins. Il n’existe pas de
consensus pour la prise en charge d’une migration
secondaire non compliquée, mais le repositionnement
radiologique constitue une option efficace. En présence
d’une complication, telle que la thrombose, un traitement
anticoagulant à dose efficace doit être instauré, suivi de la
dépose du SIV. La prévention primaire pourrait reposer
sur l’identification des patients à risque. Ainsi, lors de la
pose du SIV, il pourrait être demandé au patient de
tousser sous contrôle scopique pour dépister une
éventuelle ascension de l’extrémité distale du SIV. Dans
ce cas, une radiographie thoracique à J8 de la pose ou
avant chaque utilisation du SIV semble devoir être
considérée. La prévention secondaire repose sur la
dépose puis la pose d’un nouveau cathéter plus long et le
contrôle des facteurs de risque.
Conclusion: évènement rare, la migration secondaire
de l’extrémité des SIV expose à des complications
potentiellement sérieuses. Sa prise en charge dépend de
l’existence d’une thrombose associée. Des travaux sont
en cours sur des séries plus conséquentes afin de mieux
déterminer la stratégie thérapeutique et les moyens de
prévention optimaux.
Dépistage de la carence en vitamine D chez
la personne âgée hospitalisée.
A TRIGNOL, P LE BOUGEANT, M. OLIVER,
C. MARIMOUTOU.
Service de médecine interne, HIA Laveran.
Laboratoire de biochimie, HIA Laveran.
DESP Sud, IRBA antenne de Marseille.
Si le rôle fondamental de la vitamine D sur
l’homéostasie calcique et la prévention des maladies
osseuses (rachitisme, ostéomalacie et ostéoporose) est
connu de longue date, ses effets extra-osseux sur de
nombreux organes et tissus sont de découverte plus
récente. La vitamine D est une véritable hormone qui
réduit les chutes, agit sur la douleur, les maladies auto-
immunes, cardiovasculaires, les fonctions cognitives et
potentiellement certains cancers. Or l’insuffisance en
vitamine D est un problème majeur de santé publique
qui affecte particulièrement les sujets âgés.
Nous avons réalisé à l’HIA Laveran une étude
prospective d’une durée de six mois (de mai à
octobre 2009) avec comme objectif de déterminer
la prévalence et le degré d’insuffisance en vitamine D
chez 489 sujets âgés de plus de 75 ans hospitalisés
pour une courte durée.
Dans notre population à majorité féminine (58 %
de femmes), âgée en moyenne de 84 ans (écart type=
1,46), la prévalence de la carence en vitamine était de
91,4 % (n=448).
Une carence sévère (250HD inférieure à 10 nmol/l)
était retrouvée chez 11 % des patients (n=54). La
prévalence de la carence en vitamine D variait de 94 % en
juin à 84 % en juillet pour remonter à 96 % en septembre.
La carence en vitamine D de la personne âgée est
donc très fréquente tout au long de l’année dans le Sud
de la France avec un creux aux mois de juillet et août.
Un dosage systématique de la 250HD au cours de
l’hospitalisation et la mise en place d’une supplé-
mentation serait souhaitable chez les patients âgés de
plus de 75 ans.
Idées suicidaires aux urgences psychiatriques :
étude prospective aux urgences du Pôle
psychiatrique Centre de Marseille.
S. MOROGE, M. PILARD.
Service de psychiatrie, HIA Laveran.
Une enquête épidémiologique descriptive de
type prospectif portant sur l’idéation suicidaire aux
urgences psychiatrique a été réalisée à Marseille.
La population source était constituée par l’ensemble
des patients admis dans le service des urgences du Pôle
psychiatrique Centre.
L’enquête se présentait sous la forme d’un fascicule
comportant trois questionnaires : « Infirmier »,
« Psychiatre » et « Patient ».
L’estimation du risque suicidaire se faisait d’une part
par une échelle visuelle analogique (EVA) similaire pour
les patients et les soignants, d’autre part par des échelles
validées dans la littérature (échelle de suicidalité SBQ-R
et échelle du désespoir de Beck).
Au total, 112 questionnaires ont étés distribués et 84
se sont révélés interprétables.
Selon l’évaluation du psychiatre des urgences, le motif
de consultation principal était : en premier lieu
l’angoisse/anxiété (dans 33,3 % des cas), puis la prise en
charge d’une tentative de suicide (dans 20,2 % des cas),
puis des symptômes de la lignée psychotique
hallucinations/délire/dissociation (dans 10,7 % des cas).
Les pathologies psychiatriques préexistantes étaient
principalement des troubles de l’humeur (dans 25 % des
cas), on retrouvait 19 % de psychose et 16,7 % d’addiction.
Six pourcent des patients déclaraient venir pour
des idées suicidaires, mais 59,8 % étaient à risque
suicidaire selon le score SBQ-R, ce qui est très
supérieur aux données de la littérature (13 % dans
la population générale).
264 société française de médecine des armées

Concernant l’évaluation du risque suicidaire les
résultats de l’EVA des patients étaient bien corrélés à
ceux des soignants, ils étaient également bien corrélés
aux échelles SBQ-R et de Beck. L’échelle que nous avons
crée semble donc un bon outil pour estimer le risque
suicidaire des patients de façon simple et rapide.
BNP, vous avez dit BNP ? Étude sur la pertinence
de prescription du Brain Natriuretic Peptide
à l’HIA Percy.
S. BISCONTE, S. DAVID, J. DEROCHE, P. CLAPSON,
P. VEST, P. HENO.
Service de cardiologie et médecine aéronautique, HIA Percy.
Service de réanimation, HIA Percy.
Laboratoire de biochimie, HIA Percy.
Le Brain Natriuretic Peptide (BNP) est un marqueur
biologique très utile dans le diagnostic des dyspnées et le
suivi de l’insuffisance cardiaque. En aucun cas, il ne
permet de suivre le remplissage d’un patient. Ainsi, sauf
cas exceptionnel, il ne devrait pas être dosé plus de deux
fois par hospitalisation.
Malheureusement, il est souvent prescrit de façon
excessive ou inadaptée ce qui représente un surcoût pour
l’hôpital. Il a donc été décidé de réaliser une étude sur la
pertinence de prescription du BNP avant et après la
diffusion d’une information spécifique aux équipes
médicales et paramédicales. Cette étude s’inscrit dans
l’évaluation des pratiques professionnelles.
Matériel et méthode: une première phase d’étude a été
réalisée sur 75 jours en 2008-2009 et a permis l’analyse
quantitative de 371 prescriptions de BNP et qualitative de
55 dossiers. En se basant sur les données de la littérature,
nous avons diffusé une fiche d’information sur la
« bonne » utilisation du BNP. Celle-ci a été validée par le
conseil d’examens de laboratoire, publiée sur le site
qualité d’hôpital et présentée individuellement aux
équipes médicales et paramédicales. La seconde phase
d’étude, identique à la première et réalisée un an plus tard,
a permis de mesurer l’impact de cette formation (288
BNP et 51 dossiers analysés).
Résultats : on observe une diminution de 22 % du
nombre de BNP prescrit entre les deux phases d’étude.
Cette diminution prédomine sur les prescriptions du
service des urgences (-36 %). Dans les services
d’hospitalisation, le nombre de patient ayant bénéficié
plus de trois BNP au cours de la même hospitalisation
passe de 18 % à 8 %. Au niveau qualitatif, les BNP
prescrit de façon inadaptée (hors répétition inutile)
représentent 27 % des BNP lors de la première phase
d’étude, contre 19 % lors de la seconde mais cette
différence n’est pas significative (p < 0,01). Les éléments
les plus souvent retrouvés limitant la pertinence de ce
dosage sont la prise de poids récente et la majoration
brutale d’une anémie connue.
Conclusion : notre action de formation a permis de
réduire la prescription inutile de BNP principalement
d’un point de vue quantitatif en diminuant sa répétions
inutiles aux cours d’une même hospitalisation. Même si
les résultats ne sont pas significatifs, la proportion de
prescription inadaptée de BNP semble avoir diminué
entre les deux phases d’étude. Ces résultats restent
perfectibles et il parait indispensable de renforcer
la diffusion de cette fiche d’information.
Recrudescence de la rougeole en France.
M. MILLET-LUFT, V. SCHOEN, M. NGUYEN,
M. BOURSIER, B. AUGUSTE, S. BELLIER, N. YASSIN,
O. NESPOULOUS, X. MICHEL, J.-P. HYRIEN.
Service d’accueil des urgences, HIA Percy.
Le Centre national de référence de la rougeole a
observé depuis 2 ans une recrudescence des cas de
rougeole en France. Un plan d’éradication de la rougeole
avait été mis en place entre 2005 avec comme objectifs
pour 2010 une couverture vaccinale supérieure à 95 % et
une incidence inférieure à 0,1 cas/100000 habitants.
La couverture vaccinale actuelle de 87 % chez les
enfants âgés de 2 ans est considérée comme insuffisante
pour éradiquer la maladie et entraîne une accumulation de
sujets réceptifs à la maladie. En effet, au cours des cinq
premiers mois de l’année 2010, 1972 cas ont été déclarés
en France contre 45 cas en 2007, dont près de 40 % des cas
chez des adultes de plus de 20 ans.
La rougeole est une maladie très contagieuse, qui
peut être mortelle du fait de ses complications
(pneumopathie et encéphalite), et qui peut être prévenue
par un vaccin. La vaccination comprend deux injections
de vaccin trivalent (rougeole-oreillons-rubéole) à
12 mois et entre 13 et 24 mois.
En cas de suspicion de rougeole, il faut tout d’abord
confirmer le diagnostic (par sérologie sanguine
ou prélèvement salivaire), isoler le patient et faire
une déclaration à la DDASS. La prise en charge des
cas contacts se fera en fonction de leur âge et de leur
statut vaccinal.
Il convient donc de sensibiliser les médecins sur cette
réapparition de la rougeole, de rappeler la conduite à tenir
en cas de suspicion d’un cas et de favoriser la promotion
de la vaccination pour tous.
Accidents d’exposition aux liquides biologiques
humains en urgence pré-hospitalière.
E. PETIT, H. SAVINI, C. MARIMOUTOU, V. HEYER,
F. SIMON.
Service de médecine interne, HIA Laveran. IMTSSA. BMPMarseille.
Introduction : les accidents aux liquides biologiques
humains (AELBH), dominés par les accidents d’ex-
position au sang (AES), sont un motif de consultation
fréquent dans les services d’urgence à l’hôpital. Le profil
épidémiologique des AELBH survenus en urgence
pré-hospitalière est mal connu.
Méthode : une enquête descriptive des AELBH
survenus lors d’interventions d’urgence pré-hospitalière
a été conduite dans une unité d’intervention sur 43 mois
par analyse rétrospective des dossiers médicaux des
personnels exposés (hôpital, médecine du travail).
Résultats: sur 88 consultations pour AELBH, un AES
était avéré pour 51 patients. Les AELBH pré-hospitaliers
se caractérisaient par le statut de secouriste (97 %), un
contact secondaire à une projection de liquide (92 %) lors
d’un ramassage de blessés (72 %), une exposition
265
S
F
M
A

collective (49 %) et un potentiel infectant minime (60 %)
ou nul (40 %). Le visage et les membres supérieurs étaient
impliqués dans plus de la moitié des cas. La consultation a
eu lieu à l’hôpital et dans les 4 heures après l’exposition
dans 86 % des cas. Un bilan biologique a été prescrit
par excès pour les 37 « non AES ».
Discussion : le profil des AELBH des secouristes
pré-hospitaliers diffère nettement de celui des AES
des soignants de l’hôpital. Il reflète une activité très
différente, dominé par les projections de liquides lors
du ramassage de terrain. L’optimisation de la prévention
semble possible par renforcement de mesures barrières
mécaniques (lunettes, tenues longues). Le risque
infectieux est plus faible qu’à l’hôpital, mais la
prescription systématique de prise de sang de référence
est excessive et anxiogène. Il serait utile de mieux
définir la prise en charge de ces « non AES » dans les
recommandations nationales.
Apprentissage et pose de voie veineuse centrale
sous-clavière sous échoguidage : un geste à la
portée de tous.
V. MULLER, C. DUBOST, C. HOFFMANN, B. DEBIEN,
B. LENOIR.
Département d'anesthésie et réanimation, HIA Percy.
Introduction: la pose de voie veineuse centrale (VVC)
est préférable en territoire cave supérieur même si elle
expose à un risque de complication non négligeable. La
voie sous-clavière présente des avantages mais est
réputée difficile. Nous avons étudié l’impact de
l’échoguidage pour la pose de voie centrale sous-clavière
en termes d’apprentissage, de durée de pose et de
technique de ponction.
Matériels et Méthodes : les patients ont été inclus de
novembre 2009 à avril 2010. L’échoguidage était réalisé
avec un appareil portable de type Sonosite©et une sonde
haute fréquence (7,5 MHertz). Les données recueillies
étaient : l’expérience « échographique » du praticien,
les données morphologiques du patient, le temps de pose
et les éventuelles complications. Toutes les ponctions
étaient réalisées en utilisant la coupe transversale. Les
praticiens débutants ont bénéficié d’un enseignement
théorique suivi d’exemples pratiques avant d’être inclus
dans l’étude.
Résultats : 55 voies centrales sous-clavières ont été
incluses. Les résultats en termes d’apprentissage, de
réussite et de complication sont présentés dans le tableau.
L’apprentissage était rapide : après la pose de trois
cathéters, un débutant était capable de réussir la pose
d’une voie veineuse centrale dès la première ponction en
un temps similaire aux autres praticiens.
La veineuse voie centrale a pu être mise en place dès la
première ponction dans 55 % des cas. Le site de ponction
se situait en moyenne à 43 mm sous la clavicule et à
104 mm en dehors du manubrium sternal. Ce point de
ponction est beaucoup plus externe que celui utilisé pour
la pose à l’aveugle.
Les complications rencontrées ont été une ponction du
canal collatéral, un cas de trajet aberrant (rétrograde) et
des inadéquations de longueur du cathéter.
Conclusion : l’apprentissage de la pose de voie
veineuse centrale sous-clavière sous échoguidage est
rapide, de l’ordre de trois cathéters. La mise en place du
dispositif d’échoguidage rallonge la durée de préparation
mais doit être mis en balance avec le taux important de
succès dès la première ponction (55 % dans notre étude).
L’échoguidage permet de ponctionner la veine sous-
clavière plus latéralement, à distance du dôme pleural
diminuant considérablement le risque de pneumothorax.
La complication la plus fréquente était une inadéquation
de longueur du cathéter.
Atteinte vasculaire d’une maladie d’Erdheim
Chester.
M.-C. CHENILLEAU, A. CAMBON, S. LECOULES,
T. CARMOI, J.-P. ALGAYRES.
Service de médecin interne, HIA du Val-de-Grâce.
Introduction : la maladie d’Erdheim-Chester (MEC)
est une histiocytose non langheransienne (HNL)
systémique dont certaines localisations font la gravité
du pronostic.
Observation: un patient, âgé de 45 ans, a présenté en
1995 une histiocytose langheransienne (HL) osseuse
(marquages CD1 et protéine S100 positifs) associée à un
diabète insipide. L’atteinte osseuse est sévère et traitée par
Vinblastine. En 2004, la survenue d’une hypertension
artérielle sévère révèle une sténose bilatérale des artères
rénales et nécessite une angioplastie. En 2009 le patient
décrit une claudication intermittente, révélant une
subocclusion des deux artères iliaques primitives
nécessitant la pose de stents bilatéraux. Il existe une
atteinte coronaire multifocale silencieuse mais
menaçante sur la coronaire droite (stent) et un
engainement global de l’aorte avec une sténose serrée du
tronc cœliaque et de l’artère mésentérique supérieure à
leurs origines. Cette atteinte vasculaire explosive et
additive dans le temps, associée à des lésions osseuses
radiologiques et scintigraphiques typiques, conduit à
demander une relecture des prélèvements histologiques
initiaux qui confirme la coexistence de l’HL et de la
maladie d’EC dès le début.
Discussion : la MEC est une HNL grave à tropisme
osseux mais aussi dans la moitié des cas, systémique :
diabète insipide, exophtalmie, fibrose rétropéritonéale.
266 société française de médecine des armées
Niveau
d’expertise en
échographie
du praticien
Taux
de
succès
Taux
d’échec
Nombre
moyen
de
ponction
Taux de
complications
Temps
moyen de
montée de
guide
(minutes)
Débutant 26 % 60 % 40 % 2,2 11 % 9,94
Entraîné 36 % 89 % 89 % 2,1 5 % 9,09
Expert 38 % 90 % 10 % 1,3 0 5,98
Au total 100 % 82 % 18 % 1,8 16 % 7,27

Son expression sur un mode vasculaire exclusif et diffus
est exceptionnelle. Il existe classiquement une fibrose
péri-aortique, l’hypertension artérielle réno-vasculaire
est souvent décrite mais nécessite exceptionnellement la
pose de stent. Le seul traitement potentiellement actif sur
l’atteinte vasculaire est l’Interféron. Les manifestations
vasculaires sont à l’origine de 30 % des décès.
Conclusion : l’atteinte vasculaire dans la MEC est
rare et grave. Tous les territoires peuvent être atteints,
y compris comme dans ce cas, les artères coronaires.
L’efficacité de l’IFN n’est pas constante, le taux de
mortalité reste élevé.
Syndrome de Guillain Barré et hépatite à
Campylobacter: une association rarement décrite.
C. ROCHE, N.-C. ROCHE, M. BREGIGEON, E. SAGUI,
E. GARNOTEL, C. BROSSET.
Fédération de biologie clinique, HIA Laveran.
Cas clinique : une femme, âgée de 54 ans, d’origine
vietnamienne, est hospitalisée pour un déficit moteur des
quatre membres évoluant depuis quatre jours, date à
laquelle elle rapporte un épisode de diarrhée fébrile.
Outre une fébricule, l’examen clinique retrouve une
parésie des membres supérieurs et inférieurs rendant
impossible toute station debout ainsi qu’une abolition des
réflexes ostéo-tendineux des membres inférieurs.
L’électromyogramme objective une atteinte motrice pure
avec dénervation de l’ensemble des muscles explorés.
Les coprocultures resteront négatives ainsi que les
sérologies à l’exception des anticorps contre
Campylobacter jejuni et anti-GM1.
Devant ce tableau clinico-biologique, un syndrome de
Guillain-Barré est évoqué et la patiente traitée par
immunoglobulines intra-veineuses. L’évolution sous
traitement est marquée par une récupération progressive
de la motricité mais surtout par une cytolyse hépatique au
5ejour dont l’enquête étiologique restera infructueuse.
Discussion : cette observation relate une forme peu
commune du syndrome de Guillain-Barré qu’est
l’atteinte axonale pure. Elle permet de souligner d’une
part l’association fréquente de ce syndrome à une
infection à Campylobacter jejuni et à la présence
d’anticorps anti-GM1 (association souvent rapportée
comme étant de mauvais pronostic) ; et d’autre
part l’atteinte hépatique exceptionnellement retrouvée
dans la littérature.
Évaluation de l’incidence et de la prise en charge
des évènements de santé sur les théâtres
d’opérations extérieures: Étude ESOPE.
F. DUTASTA, O. AOUN, C. ROQUEPLO, C. RAPP.
Service des maladies infectieuses, HIA Bégin.
Introduction: l’armée française compte plus de 10 000
hommes engagés en permanence sur les théâtres
d’opérations extérieures. À côté des blessures liées au
combat, tous ces militaires sont exposés à des maladies
non liées aux combats dont le poids est sous estimée.
Méthode: étude prospective multicentrique de tous les
militaires français consultant dans six postes de secours
répartis sur trois théâtres d’opérations (Liban, Côte
d’Ivoire, Afghanistan) de juillet-à septembre 2008.
Résultats : 4 065 militaires (H/F = 14), d’âge médian
28 ans (18-61) ont présenté 4293 évènements de santé.
Les motifs de consultation étaient les suivants :
traumatologie 20,5 %, diarrhées 19 %, dermatoses
17,5 %, infections respiratoires hautes et basses 10,3 %,
lombalgies 6,5 %, troubles psychiatriques 2,3 %,
blessures de guerre 1 %, paludisme 0,2 %. Une fièvre était
au premier plan dans 6 % des cas. Les pathologies
infectieuses représentaient 44 % de l’ensemble des motifs
de recours aux soins. La prise en charge était ambulatoire.
Dans 90 % des cas. L’indisponibilité partielle ou totale
était estimée à 652 jours/1000 hommes/mois. Soixante
huit (2,2 %) évacuations médicales à destination de la
métropole ont été effectuées (psychiatrie 28,
traumatologie 26). Dix décès liés aux combats ont été
observés en Afghanistan. Le spectre étiologique des
évènements de santé était comparable sur les trois
théâtres. En Afghanistan, le délai médian de recours aux
soins était plus précoce (45 vs 61 jours) et l’incidence des
diarrhées plus élevée (p < 0,05).
Commentaires : ce travail dresse un vaste panorama des
événements de santé survenant en OPEX. Il souligne
l’importance des infections cosmopolites et le poids des
pathologies non liées aux combats dans la perte de
capacité opérationnelle.
Infection sévère au virus grippal A H1N1: existe-t-il
des complications cardio-vasculaires ? À propos
d’une série de 17 cas.
N.-C. ROCHE, P. PAULE, E. SALAÜN, S. KEREBEL,
J.-M. GIL, L. FOURCADE.
Service de cardiologie, HIA Laveran.
Introduction : la pandémie liée au virus grippal A H1N1
s’est manifestée par de nombreux cas d’infections
respiratoires sévères. Tout comme les autres virus
grippaux, ce virus possède un potentiel tropisme
cardiaque; le diagnostic de péricardite ou de myocardite
est difficile notamment du fait d’une clinique
protéiforme, et certains patients peuvent même demeurer
asymptomatiques en présentant seulement des anomalies
électriques isolées.
Méthodes et résultats : les auteurs rapportent une
série prospective de 17 patients consécutifs hospitalisés
entre octobre 2009 et janvier 2010 en unité de soins
intensifs pour grippe grave à virus H1N1 confirmée
sérologiquement. L’examen clinique, complété par un
ECG, un dosage de la troponine, et en cas de doute par une
échocardiographie et une IRM cardiaque n’ont pas
permis d’observer d’atteinte myocardique ni de
décompensation de cardiopathie sous-jacente. Aucun
des patients n’est décédé.
Discussion : durant les épidémies grippales, il a été
décrit jusqu’à 10 % de manifestations cardiaques avec
une augmentation de la mortalité cardiovasculaire.
Différents mécanismes peuvent expliquer cette situation :
une myocardite aiguë de survenue précoce, une
exacerbation d’une maladie coronaire ou l’aggravation
d’une insuffisance cardiaque. Les anomalies électriques
267
journée des internes et des assistants
S
F
M
A
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%