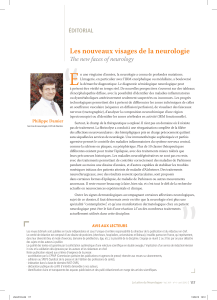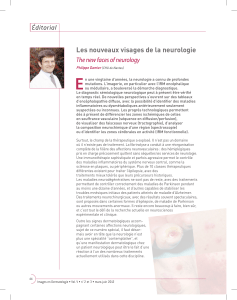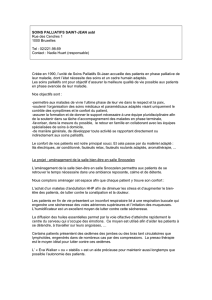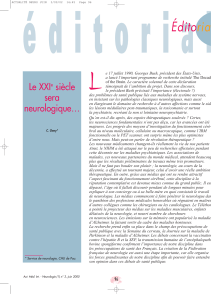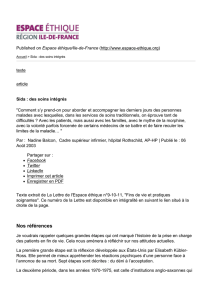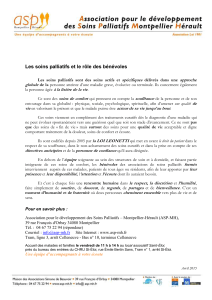Soins palliatifs en neurologie

C
et article est une somme de réflexions issues d’une
pratique de neurologie en hôpital général (CHG) et
d’échanges entre médecins et infirmières. On n’y
trouvera ni recette médicamenteuse, ni littérature médicale,
mais le témoignage après expérience que les soins palliatifs
(SP) font partie des soins quotidiens de la neurologie hospita-
lière et concernent tous les intervenants. Seront exclues les
situations propres à la réanimation, aux unités neurovasculaires
ou aux unités de soins palliatifs (USP) en tant que telles.
DÉFINITIONS ET LIMITES
Les principes et la pratique des SP sont les mêmes en neurologie
que dans les autres disciplines: ils passent au premier rang
quand on fait le constat d’une aggravation irrévocable, phy-
sique et/ou intellectuelle d’un malade.
“Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche
globale de la personne atteinte d’une maladie grave évolutive
et terminale. Leur objectif est de soulager les douleurs phy-
siques ainsi que les autres symptômes et de prendre en charge
la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. Les soins
palliatifs et l’accompagnement sont interdisciplinaires. Ils
s’adressent au malade en tant que personne, à sa famille et à
ses proches, à domicile et en institution. La formation et le sou-
tien des soignants et des bénévoles font partie de cette
démarche.” (Société française d’accompagnement et de soins
palliatifs)
Le temps des SP se situe classiquement en phase d’aggrava-
tion d’une affection chronique, quand elle échappe aux dif-
férents traitements. En neurologie, les traitements sont par-
fois d’emblée palliatifs – notion de “soins continus” –
(SLA, Huntington, etc.), des années avant le décès, et il
arrive qu’on doive anticiper un échec du curatif dès la pre-
mière consultation.
Une limite majeure en hôpital est l’insuffisante disponibilité de
l’équipe auprès de l’entourage et du malade dont l’état s’ag-
grave, du fait de la surcharge de travail et de la variété des
maladies prises en charge. Cette diversité peut générer chez les
soignants un sentiment de tiraillement entre attitudes et émo-
tions contradictoires.
Les décès en neurologie sont fréquents (7% des entrées), et
dans un hôpital général un décès sur cinq est associé à un dia-
gnostic neurologique (DIM), mais la mort est rarement
imprévue, brutale. La maladie nous laisse souvent un temps
d’anticipation, période difficile pour les soignants, mettant en
cause la cohésion et le professionnalisme des équipes (burn-
out) s’il n’est pas donné une possibilité suffisante d’échanges,
puis, après le décès, de “relecture” de ces événements. Cette
présence du handicap et de la mort est lourde à porter pour
les soignants en neurologie ; mais en même temps, l’implica-
tion dans les SP est aussi une part gratifiante de nos métiers
par le sentiment bien réel d’apporter une aide à un moment
capital. Les témoignages des familles sont unanimes à cet
égard.
VIE PROFESSIONNELLE
La Lettre du Neurologue - n° 5 - vol. VI - mai 2002
184
Soins palliatifs en neurologie
●J. d’Anglejan 1*, C. Wu 2*, I. Masquelier 3*, M. Sulpice 4*
* Hôpital Mignot, Le Chesnay.
1neurologue, 2infirmière, 3médecin, soins palliatifs, 4interne de spécialité.
■ Les soins palliatifs (SP) commencent souvent tôt en
neurologie; dès la phase de diagnostic, une logique d’ac-
compagnement professionnelle et en équipe doit parfois se
mettre en place.
■ L’expérience acquise dans d’autres spécialités (oncologie,
unités de traitement de la douleur, gériatrie, psychiatrie,
réanimation, etc.) peut être utile aux médecins et para-
médicaux des services de neurologie pour mieux assumer
leur rôle thérapeutique et minimiser l’impact psycho-
logique.
■ L’enseignement et la pratique des SP méritent d’être
développés dans chaque service: les médecins y ont beau-
coup à apprendre des autres soignants.
POINTS FORTS
POINTS FORTS
Quand elle se sentit à la veille
et seule avec sa peur de mourir,
son regard disait doucement :
adieu, adieu, tu ne me verras plus jamais.
L.R. des Forêts, Ostinato

La Lettre du Neurologue - n° 5 - vol. VI - mai 2002 185
L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE EN NEUROLOGIE
Le médecin
L’annonce du diagnostic par le neurologue d’une maladie grave,
peut-être incurable, se prépare; elle doit être honnête, progres-
sive, permettant à la personne puis à son entourage de com-
prendre et d’accepter la nouvelle, parfois en plusieurs rencontres
rapprochées: elle pose déjà des jalons pour l’avenir. Puis, quand
la situation s’aggrave, la présence du médecin reste indispensable
pour gérer les rôles dans l’équipe, les interventions extérieures.
Son rôle est diversifié:
– prescrire clairement les traitements, en évaluer l’efficacité,
adapter les posologies, limiter leur nombre. Prévoir un traite-
ment à appliquer par l’équipe “en cas de…” (douleur, angoisse,
insomnie, etc.);
– choisir dans les examens et la surveillance ce qui est superflu
et ce qui peut aider à améliorer le confort;
– avertir l’équipe des objectifs médicaux et de la progression
de la maladie, des éventuelles complications;
– rechercher par l’examen médical les causes d’un l’inconfort
(exemple: globe vésical).
L’équipe soignante (infirmières et aides-soignantes)
Elle établit un projet global et personnalisé de soins en partant
des données médicales et de la demande de la personne, puis
des proches. Qu’est-ce qui est attendu des soignants? Qu’est-ce
que nous pouvons ou ne pouvons pas donner?
Il reste ensuite à appliquer la prescription, évaluer quotidienne-
ment l’efficacité, la tolérance des traitements, suppléer à la
perte d’autonomie physique et mentale, attirer par des trans-
missions écrites et ciblées l’attention du médecin sur les
symptômes gênants non soulagés.
Le kinésithérapeute
Alors même que le mot de “rééducation” n’a plus de sens, il
contribue au confort physique du malade par:
– l’entretien des mobilisations actives conservées (prolongeant
la durée de l’autonomie) et des mobilisations passives (qui per-
mettent à la personne de sentir l’ensemble de son corps);
– des soins respiratoires, des massages lymphatiques des
œdèmes, etc.
Le travail d’équipe
L’ambition des équipes devrait être d’assurer des “soins conti-
nus”, c’est-à-dire une prise en charge homogène depuis l’an-
nonce du diagnostic jusqu’à la fin de vie, impliquant d’em-
blée les infirmières et la famille. C’est donc “en équipe” qu’il
convient de prendre conscience de l’aggravation chez un malade
pour répondre aux questions suivantes (tableau I).
D’autres acteurs extérieurs participent au cheminement d’un
malade au stade de soins palliatifs: bénévoles, religieux, mais
aussi l’équipe soignante à domicile (généraliste ou neurologue
libéral), d’autant que, dans des maladies longues et suscep-
tibles de phases de plateau ou d’aggravation, les allers et
retours entre le domicile et l’hôpital seront fréquents. L’équipe
hospitalière doit rester en relation avec ces soignants pour faire
face à l’urgence d’une admission imprévue, en chambre seule,
évitant si possible le passage par les urgences.
Une fois validé, cet objectif d’équipe doit être poursuivi de
manière professionnelle, avec des priorités “sur mesure”
établies pour chaque malade, pour chaque phase, et une
évaluation du soin donné pour en tirer un enseignement.
La réflexion individuelle
•Soigner des personnes jusqu’à la fin de leur vie entraîne une
remise en question personnelle et peut susciter le besoin d’un
accompagnement psychologique au cours du cursus profes-
sionnel.
•Mais il faut surtout trouver (et parfois exiger!) pendant le tra-
vail des temps suffisants d’échanges entre soignants et méde-
cins pour comprendre, analyser les situations, mettre des mots
sur ses difficultés et ses émotions, toutes choses qui aident à
progresser en diminuant l’épuisement professionnel, l’usure et
la rotation des équipes soignantes – a contrario, l’absence d’un
tel espace de parole est une véritable frustration et un facteur
de surmenage. La réticence à cet échange d’émotions vient
souvent des médecins et trouve en partie ses racines dans
un enseignement médical exclusivement technique.
PRISE EN CHARGE DES SYMPTÔMES EN SP
D’AFFECTIONS NEUROLOGIQUES
Nutrition-hydratation
L’objectif est de limiter la fatigue, l’infection, les escarres, de
conserver un plaisir sensoriel. On privilégie la voie orale, on
soigne l’hygiène buccale, mais, en cas de besoin, la gastro-
stomie percutanée endoscopique (GPE) à faible débit est la
meilleure méthode si l’espérance de vie dépasse quelques
semaines; elle limite les fausses routes et les reflux gastriques.
•Pour l’hydratation, on peut utiliser des épaississants, puis
l’apport d’eau par la sonde gastrique, et en dernier recours la
voie parentérale. On peut alors choisir la voie sous-cutanée en
discontinu la nuit (1 litre de perfusion isotonique sur
12 heures). On perfuse sur l’abdomen ou à l’intérieur des
cuisses par un cathlon ou une épicrânienne. Le dispositif est
fixé avec un Opsite®et peut être laissé en place dans la journée
avec un bouchon.
•De quel délai dispose-t-on ?
•Quelles complications sont attendues
et quels sont les moyens à mettre en œuvre ?
•La fin de vie aura-t-elle lieu dans le service ?
•Où en est la personne dans sa maladie ?
•Quels seront les obstacles
à une bonne communication verbale ?
•Où en sont ses proches ?
Tableau I.

•Dans la phase terminale, la soif disparaît et se corrige par
l’utilisation d’aérosols. En outre, une légère déshydratation
permet de diminuer les râles et l’encombrement bron-
chique. Les différentes anomalies ioniques ont alors moins
d’importance et les contrôles sanguins du ionogramme sont
limités.
Douleurs
Juger de la douleur du malade en neurologie est difficile du fait
de l’altération de la communication ou des troubles de la
conscience. Les échelles visuelles (EVA) sont difficiles à utiliser.
C’est donc surtout l’observation par les intervenants du visage
et des réactions du malade lors des soins qui va nous guider et
nous informer de la cause et de l’intensité de la douleur.
L’utilisation de morphiniques ne pose aucun problème particu-
lier. La voie d’administration est adaptée à chaque cas (orale,
entérale, parentérale i.v. ou S/C en seringue électrique sur
24heures, ou transcutanée).
Remarque: la morphine à petites doses apporte d’ailleurs une
aide respiratoire au patient et permet de contrôler le rythme
respiratoire.
Le traitement le plus adapté de la douleur est celui de la cause
de la douleur quand il est possible (tableau II).
Les bains que permettent des brancards adaptés procurent une
détente physique incomparable après une nuit difficile et font
partie des soins de confort.
Ventilation, dyspnée
Quand la dyspnée est liée à une infection bronchique, à une
insuffisance cardiaque ou à une embolie pulmonaire, elle doit
être traitée selon la cause. Quand elle est liée à une atteinte neu-
rologique, c’est d’abord un syndrome restrictif (SEP, SLA).
Les différents traitements symptomatiques peuvent s’associer;
citons la morphine à petites doses en vue de combattre la gêne
respiratoire et la polypnée, les anxiolytiques pour diminuer la
polypnée, les atropiniques (Scopoderm®,scopolamine, atro-
pine sublinguale, etc.) en cas d’hypersalivation ou d’encombre-
ment pour limiter le râle respiratoire, l’humidification de l’air
et des lèvres (aérosol, nébuliseur).
Au stade des SP, ces traitements ne visent pas à prolonger la
vie mais à améliorer le confort respiratoire. Il est particuliè-
rement important d’expliquer cela à la famille, car la dyspnée
est un élément mal ressenti par l’entourage. La perception de l’ef-
fort inspiratoire, de son rythme, des bruits associés (aspirations,
etc.) est toujours impressionnante.
La ventilation assistée non invasive au masque permet un
repos relatif du diaphragme pendant la nuit et peut améliorer
l’état général. Mais tous les malades ne la supportent pas.
L’aspiration doit être limitée aux encombrements ORL et tra-
chéaux. Si le patient manifeste son refus pour être aspiré, on
doit le respecter et déduire que l’encombrement était plus
gênant pour nous que pour lui.
Remarque: signalons qu’en phase terminale, l’hypercapnie
agit comme un anesthésique et doit être respectée.
L’angoisse
L’angoisse empêche la communication, elle doit être exprimée,
reconnue, traitée. Elle peut toucher le malade, son entourage mais
aussi le soignant. Quand elle déborde le soignant, elle fausse la
qualité des soins, le dialogue et la prise en charge. L’angoisse
plus ou moins dissimulée de la famille ou du patient altère une
communication de qualité.
•Il faut trouver le temps de parler, d’échanger, comme on
trouve le temps d’effectuer un soin. C’est certainement là que
les unités de SP sont le plus performantes. Être disponible dans
un service de neurologie générale est beaucoup plus difficile du
fait de la surcharge de travail.
•Face à la personne angoissée, les traitements médicamenteux
sont les mêmes qu’ailleurs: benzodiazépines (BZD) à doses
progressives par voie orale, sublinguale ou sous-cutanée, neu-
roleptiques sédatifs. À cet égard, l’utilisation de BZD en
infusion continue (Midazolam) peut être extrêmement utile
dans certaines douleurs ou dyspnées terminales. Ces molé-
cules apaisent l’angoisse du patient, limitent la sensation de
dyspnée ressentie sans abolir le contact verbal si la titration
a été bonne. Leurs inconvénients sont connus afin d’être
maîtrisés: somnolence, hypopnée, arrêt respiratoire.
L’angoisse de la famille peut se traiter ainsi:
– identifier le ou les interlocuteurs privilégiés pour l’équipe,
pour être disponibles puis organiser et planifier des rencontres
VIE PROFESSIONNELLE
La Lettre du Neurologue - n° 5 - vol. VI - mai 2002
186
Causes Traitements
Immobilité Mobilisation active/passive
Lits médicalisés
Algoneurodystrophie Kinésithérapie
Phlébite, Anticoagulants
embolie pulmonaire
Escarres Prévention (massages, matelas
antiescarres : Cliniplot ou matelas
à eau, nutrition)
morphine
Hypertonie, contractures Antispastiques
Globe vésical Sonde urinaire, surveillance
de la diurèse
Fécalome Laxatifs
Céphalée d’hypertension Corticoïdes
intracrânienne
Compressions nerveuses Corticoïdes
Envahissement nerveux Antidépresseurs, anticonvulsivants,
morphine, blocs neurologiques
Dépression Entretien d’aide, antidépresseurs
Tableau II. Douleurs en neurologie.

d’accueil et d’information, si possible en binôme médecin-
infirmière ou surveillante;
– clarifier ce qu’ils savent, veulent savoir, veulent entendre et
prendre le temps d’aller à leur rythme, anticiper légèrement
l’évolution de la maladie;
– mettre au point des règles de visites en fonction des souhaits
et de la fatigabilité du malade et de la disponibilité du service;
– rencontrer la famille après le décès quand c’est possible, pour
initier le processus de deuil, orienter vers des groupes de parole.
Les patients déments posent des problèmes difficiles à la phase
palliative, du fait des troubles du comportement, de la perte du
contact verbal et des difficultés pour apprécier leur inconfort:
ils nécessitent parfois une sédation qui doit être progressive, uti-
lisant des BZD de manière empirique, puis des neuroleptiques à
doses progressives qui sont dans tous les cas préférables aux
mesures de contention physiques par sangles et attaches. Une
valorisation du travail de l’équipe est particulièrement impor-
tante pour soutenir les soignants. Enfin, chez ces malades, la
question de la pose d’une GPE ne se pose pas en pratique car,
hormis les cas de M. Huntington, le décès survient en général
avant que la situation nutritionnelle ne devienne critique.
Fièvre et infection
La plupart des malades neurologiques meurent d’une infection
pulmonaire terminale. Les règles de traitement des infections
sont les mêmes qu’ailleurs:
– prévention dans les situations de décubitus (kinésithérapie,
verticalisation, prévention des fausses routes alimentaires);
– traitement précoce en cas d’infection déclarée.
Mais en phase palliative, les buts du traitement anti-infectieux
sont modestes:
– limiter la dyspnée;
– combattre les odeurs fétides (métronidazole);
– améliorer le confort par des antipyrétiques car la fièvre
aggrave l’état neurologique (vessie de glace, paracétamol, etc.).
Communication
Discipline du handicap physique (perte de mouvement), la neu-
rologie est aussi plus généralement une discipline du handicap
de la relation, de la communication. Celle-ci est essentielle pour
ajuster les traitements, même si la personne ne peut plus s’exprimer
(troubles de conscience, aphasie, démence) ; il reste important de
parler pour maintenir la dignité, d’expliquer et négocier les soins
(une injection faite sans explication peut devenir potentiellement
une source de peur: peur de l’euthanasie, par exemple) car le
malade continue d’avoir besoin d’informations pour comprendre ce
qui se passe. Le langage est une marque de respect.
Quand la communication devient plus difficile, c’est à nous
d’adapter notre langage, par des explications simples, en face
à face, en posant des questions “fermées”.
Pallier les difficultés de communication avec un malade coma-
teux ou dément est une tâche difficile. Ces situations suscitent
chez le soignant rejet, frustration et sentiment d’inutilité, ou désir
de mort et risque de maltraitance. On doit à cet égard recomman-
der les soins à deux intervenants pour permettre dans la chambre
la poursuite d’un dialogue dont le malade est le centre. Et puis
on ne saurait assez rappeler l’importance et l’enjeu du toucher:
prendre, saisir, frôler, etc., c’est être relié, c’est consentir à être
atteint, “touché”. La main tenue, le bras ou la joue caressés sont
autant de messages dont le malade qui ne parle plus a besoin
pour garder un sentiment d’intégrité corporelle et psychique.
CONCLUSION
Comme dans toute autre spécialité, les SP en neurologie visent
le confort: on ne saurait les réduire à des recettes mais inciter
chacun à en expérimenter l’esprit dès le début de sa pratique
professionnelle. C’est un euphémisme de dire que l’enseigne-
ment académique a peu abordé ces notions, mais les choses
changent; et les neurologues sont de plus en plus nombreux à
s’impliquer en soins palliatifs, avec parfois des surspécialisations
qui, telles la SLA ou la neuro-oncologie, offrent des occasions
remarquables de formation.
Soulignons ce qui restera vrai en dépit des progrès des
traitements:
– le confort et la dignité de la personne malade peuvent et
doivent être assurés jusqu’au bout, avec un apprentissage,
ce qui est la meilleure réponse aux dérives euthanasiques;
– il faut y passer du temps, donc se rendre disponible;
– il faut dialoguer en équipe, sur ces situations éprouvantes;
– la famille est un partenaire majeur;
– l’hôpital est actuellement le “principal” lieu d’accompagne-
ment de fin de vie. ■
La Lettre du Neurologue - n° 5 - vol. VI - mai 2002 187
I. Le traitement de la douleur chez une personne
démente en fin de vie repose avant tout sur :
a. les BZD.
b. la morphine.
c. le traitement de la cause.
d. la rispéridone.
II. La formation en SP :
a. est spécifique à la neurologie.
b. est multidisciplinaire.
c. peut s’acquérir via certaines surspécialisations.
III. Les principales causes de décès dans notre
spécialité sont :
a. les embolies pulmonaires.
b. les bronchopneumopathies.
c. les escarres.
d. les troubles dysautonomiques.
AUTO-ÉVALUATION
AUTO-ÉVALUATION
Résultats : I : c ; II : b, c ; III : b.
1
/
4
100%