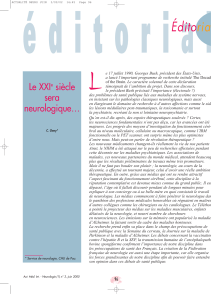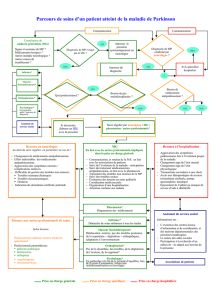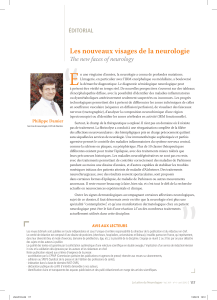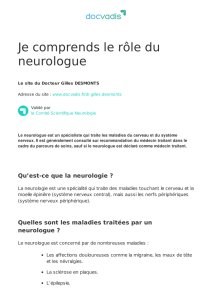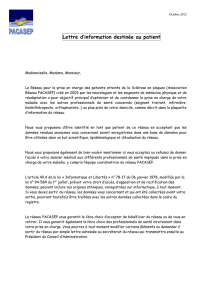S Éditorial

197
Soigner reste l’un des enjeux les
plus exaltants de notre époque
mais aussi des plus périlleux. En
effet, depuis 50 ans, les progrès de
la science médicale sont tels que la relation
médecin-malade a beaucoup évolué. D’un
côté, le médecin cherche la juste place de
son pouvoir découlant de son savoir,
éclairé ou malheureusement parfois aveu-
glé par le flot des publications scientifiques
aux conclusions parfois contradictoires. De
l’autre, le patient souhaite, à juste titre,
voir son identité et ses droits de plus en
plus reconnus.
Selon que le médecin se considère comme
exerçant une science ou pratiquant un art,
son comportement vis-à-vis du patient n’est
pas du tout le même. Mais tout comporte-
ment humain n’est-il pas fondé sur ses
croyances, ses connaissances, sa culture ?
Il en va ainsi de son attitude vis-à-vis des
patients présentant une sclérose en
plaques. Maladie chronique, elle reste pour
lui, malgré l’évolution récente des connais-
sances, d’étiologie inconnue et d’évolution
imprévisible de par ses incertitudes tempo-
relles (imprévisibilité des poussées) et spa-
tiales (le handicap). Malgré les progrès
thérapeutiques de ces dix dernières années,
elle demeure pour une majorité de patients
invalidante. Le comportement du médecin
vis-à-vis de ces formes évoluées est assez
démonstratif à cet égard. Si sa culture est
fondée de manière exclusive sur la science
et ses progrès, elles le pousseront naturel-
lement à prendre plus “soin” des formes
débutantes, offrant interférons, informa-
tions, parfois éducation mais surtout pres-
cription. Cette orientation se fera au détri-
ment des formes plus anciennes,
invalidantes, au stade où les interférons ou
les immunosuppresseurs n’ont plus aucune
utilité. Le comble n’est-il pas que le temps
de la consultation soit inversement pro-
portionnel au chiffre de l’EDSS ! Son
impuissance à prescrire dans ces formes de
Charcot et Vulpian explique naturellement
cette attitude de “je ne peux rien pour
vous”... Si, au contraire, le même neuro-
logue estime devoir d’abord et avant tout
jouer son rôle de médecin – à savoir rendre
service en priorité au patient qui vient lui
demander assistance et ne pas jouer uni-
quement le rôle de prescripteur –, son com-
portement sera bien différent. N’est-ce pas
légitime pour ces patients qui, in fine,
représentent la majorité ? Cinquante pour
cent passent en forme secondairement pro-
gressive après 10 ans d’évolution, 90 %
après 25 ans. Souvent les mieux informés
sur leur maladie, ils ne sont toujours pas
candidats aux thérapeutiques novatrices.
Et du côté du malade ? Son comportement
est également fondé sur sa culture et ses
croyances, résultant des informations dis-
cordantes données par le neurologue mais
aussi les médias , les revues, les associa-
tions, etc. Cela génère des doutes, des
ambiguïtés, des craintes. Sa perception de
la maladie, telle qu’il l’imagine et non telle
qu’elle est réellement, est souvent très éloi-
gnée de celle du neurologue, surtout si ce
dernier raisonne sur le principe de “la
médecine fondée sur les preuves”. Les
divergences conduisent à l’incompréhen-
sion et poussent naturellement les patients
Act. Méd. Int. - Neurologie (3) n° 9, novembre 2002
Éditorial
Éditorial
*Patrick Hautecœur est professeur de neuro-
logie à la faculté libre de médecine de Lille et
chef de service de neurologie à l’hôpital Saint-
Philibert. Ce service est notamment spécialisé
dans la prise en charge pluridisciplinaire de la
SEP. Il participe activement au réseau G-SEP. Il
travaille principalement sur les aspects bio-
logiques (isoélectrophorèse des larmes, protéine
Mxa) et socio-économiques de la sclérose en
plaques.
Croyances médicales et relation
médecin-malade
P. Hautecœur*

198
vers d’autres horizons, dont les buts sont
hélas ! éloignés de la mission de soins…
Le médecin – technicien par excellence,
devoir d’exigence oblige – se doit, par
conséquent, d’être un soignant convaincant
et à l’écoute des plaintes des patients,
notamment dans les formes évoluées. Les
patients ne doivent pas être résumés à l’al-
chimie des interrelations entre une
empreinte génétique et des facteurs envi-
ronnementaux responsables d’une dérégu-
lation d’un microcosme cytokinique par-
tiellement modulable par des molécules
salvatrices n’agissant qu’au premier stade
de la maladie. Le neurologue, éloigné des
principes d’éthique dépassés du paterna-
lisme (souvent sous l’influence exclusive de
la science) ou, à l’inverse, de l’autonomie
totale du patient, animé des principes de
bienfaisance et de bienveillance (ne pas
nuire et vouloir positivement le bien pour
son patient), soucieux de la liberté et du
libre choix du patient, respectueux de son
identité et de sa temporalité, se doit de faire
“alliance thérapeutique” avec lui et de le
faire participer activement à sa prise en
charge. Il doit lui donner le maximum d’in-
formations pour lui permettre de réfléchir
sur sa maladie et sur les possibilités théra-
peutiques.
Mais cela demande une grande disponibi-
lité de temps et une ouverture sur les autres
acteurs dans le cadre d’une approche plu-
ridisciplinaire. Les problèmes sont en effet
trop complexes pour que le neurologue seul
puisse y répondre.
Le neurologue se doit d’utiliser à bon
escient son savoir issu de la rigueur sémio-
logique qu’il détient plus que tout autre et
de se tenir informé des progrès scienti-
fiques sans en faire une nouvelle religion. Il
se doit aussi de passer alternativement
d’un rôle d’interventionniste à celui
d’écoutant et d’éducateur. Il doit informer
le patient de manière à le faire participer
activement à la prise en charge de ses
symptômes.
Éditorial
Merci d’écrire nom et adresse en lettres majuscules
❏Collectivité ...............................................................................
à l’attention de ............................................................................
❏Particulier ou étudiant
M., Mme, Mlle ..............................................................................
Prénom ........................................................................................
Pratique : ❏hospitalière ❏libérale ❏autre ........................
Adresse e-mail .............................................................................
Adresse postale ...........................................................................
....................................................................................................
Code postal ........................Ville ……………………………………
Pays..............................................................................................
Tél. ...............................................................................................
Merci de joindre votre dernière étiquette-adresse en cas de réabonnement,
changement d’adresse ou demande de renseignements.
ÉTRANGER (AUTRE QU’EUROPE)
FRANCE/DOM-TOM/EUROPE ❐110
€collectivités
❐92
€particuliers
❐65
ێtudiants*
*joindre la photocopie de la carte
❐90
€collectivités
❐72
€particuliers
❐45
ێtudiants*
*joindre la photocopie de la carte
Actu Neuro - Vol. 3 - No9
OUI, JE M’ABONNE AU MENSUEL Les Actualités en Neurologie
Total à régler .......... €
À remplir par le souscripteur
À remplir par le souscripteur
À découper ou à photocopier
✂
❐
ABONNEMENT : 1 an
+
ETPOUR 10 €DE PLUS !
10
€
, accès illimité aux 26 revues de notre groupe de presse disponibles
sur notre site vivactis-media.com (adresse e-mail gratuite)
+
R
RELIURE
ELIURE
❐10
€
avec un abonnement ou un réabonnement
MODE DE PAIEMENT
❐
carte Visa, Eurocard Mastercard
N°
Signature : Date d’expiration
❐
chèque
(à établir à l’ordre de Les Actualités en Neurologie)
❐
virement bancaire à réception de facture
(réservé aux collectivités)
Médica Press - 62-64, rue Jean-Jaurès - 92800 Puteaux
Tél. : 01 41 45 80 00 - Fax : 01 41 45 80 25
E-mail : [email protected]
Act. Méd. Int. - Neurologie (3) n° 9, novembre 2002
1
/
2
100%