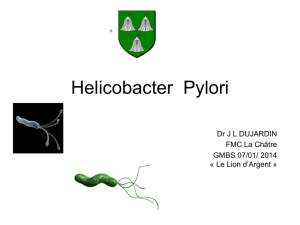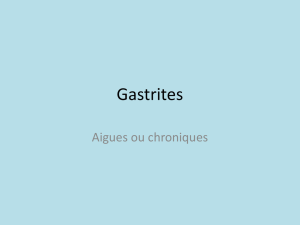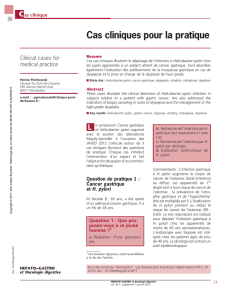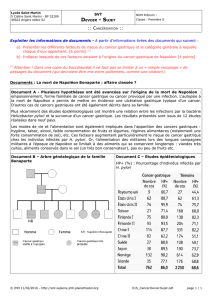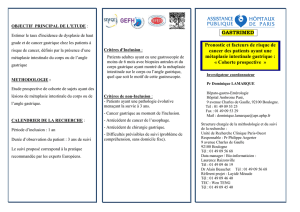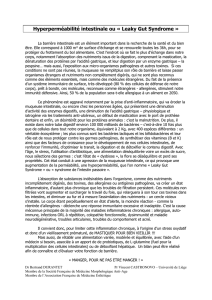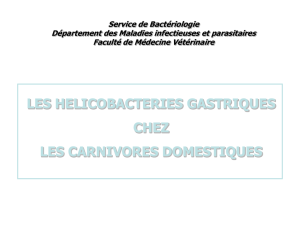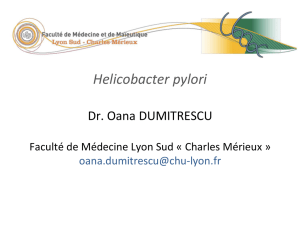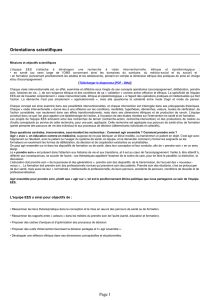Faut-il biopsier un patient souffrant de dyspepsie

Faut-il biopsier un patient
souffrant de dyspepsie ?
Que faire en cas de
de´couverte d’une
me´taplasie intestinale ?
R
esum
e
La strat
egie du traitement empirique de la dyspepsie est la plus utilis
ee. Soit en
commenc¸ant par un anti-acide puis un anti-H2 et finalement un IPP selon la
r
eponse symptomatique, soit en utilisant un IPP d’embl
ee. En cas de non-r
eponse
ou de r
eponse partielle au traitement, l’endoscopie est justifi
ee. L’endoscopie
doit rechercher une infection
aH. pylori et des l
esions induites par cette infection.
Tous les patients chez qui une infection
aH. pylori est d
etect
ee doivent recevoir
un traitement d’
eradication afin de pr
evenir l’apparition de l
esions de dysplasie et
d’un cancer. Les l
esions pr
ecanc
ereuses planes sont difficiles
ad
etecter.
L’utilisation des vid
eoendoscopes haute d
efinition am
eliore la caract
erisation des
l
esions planes, avec l’aide des techniques de grossissement, des proc
ed
es
electroniques de traitement de l’image et par la chromoscopie qui permettent
une description plus pr
ecise du relief muqueux de l’architecture des cryptes et du
r
eseau capillaire. Les recommandations europ
eennes MAPS indiquent que les
patients qui ont une atrophie s
ev
ere ou une m
etaplasie intestinale du corps
gastrique ou
etendue
a tout l’estomac doivent ^
etre surveill
es tous les 3 ans en
endoscopie, en l’absence de dysplasie. En cas de dysplasie, si l’endoscopie ne met
pas en
evidence de l
esion visible, une r
e
evaluation endoscopique avec biopsies
multiples doit ^
etre r
ealis
ee imm
ediatement puis selon un rythme semestriel voire
annuel en cas de dysplasie de haut grade et annuel en cas de dysplasie de bas
grade. En cas de dysplasie de haut grade ou de cancer au sein d’une l
esion
endoscopique visible, une r
esection endoscopique doit ^
etre envisag
ee en
premi
ere intention afin de r
ealiser un staging pr
ecis de l’extension pari
etale de la
n
eoplasie.
nMots cl
es : dyspepsie, H. pylori, gastrite, cancer gastrique
Abstract
The strategy of empirical treatment of dyspepsia is most commonly used either
by starting with an antacid and anti-H2 and then eventually a PPI or by using PPI
in first line . In case of no response or partial response to treatment, endoscopy is
required. Endoscopy should detect H. pylori infection and lesions induced by this
infection. All patients infected with H. pylori should receive eradication therapy
to prevent the development of dysplasia and cancer. Precancerous lesions are
difficult to detect if they are flat. The use of high definition video endoscopes
improved the characterization of these lesions, with the aid of magnification
techniques, methods of electronic image processing and chromoscopy which
Should biopsies be
performed in dyspeptic
patients? Management of
intestinal metaplasia
Michel Robaszkiewicz
CHU de la Cavale Blanche,
Service d’H
epato-Gastroent
erologie,
29609 Brest cedex,
France
e-mail : <michel.robaszkiewicz@chu-
brest.fr>
HEPATO
y
GASTRO
et Oncologie digestive
Tir
es
a part : M. Robaszkiewicz
Pour citer cet article : Robaszkiewicz M. Faut-il biopsier un patient souffrant de dyspepsie ?
Que faire en cas de d
ecouverte d’une m
etaplasie intestinale ? H
epato Gastro 2013 ; 20 :
10-16. doi : 10.1684/hpg.2012.0812
doi: 10.1684/hpg.2012.0812
10 HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive
vol. 20 n8suppl
ement 1, janvier 2013
ini-revueM
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

La prise en charge d’un patient dyspeptique est
difficile ; elle comporte des enjeux m
edico-
economiques en raison de la pr
evalence et de la chronicit
e
des sympt^
omes. La place de l’endoscopie dans la strat
egie
d’exploration d’un patient dyspeptique est actuellement
bien d
efinie, l’un des enjeux
etant de ne pas m
econnaı
ˆtre
une l
esion organique en proposant un traitement
empirique de premi
ere intention. La conduite
atenir
en cas de d
ecouverte d’une l
esion pr
ecanc
ereuse de
l’estomac a
egalement fait l’objet de recommandations
r
ecentes.
Ainsi seront successivement envisag
ees dans cette partie
les questions suivantes :
a) Dans quelles circonstances faut-il r
ealiser une endosco-
pie digestive chez un sujet qui pr
esente des troubles
dyspeptiques ?
b) Que doit-on rechercher lors de l’endoscopie ?
c) Faut-il faire des biopsies ? Pourquoi ? Combien de
biopsies et
a quel endroit ?
d) Comment interpr
eter le r
esultat de l’examen anatomo-
pathologique des biopsies ?
e) Quelles sont les l
esions de GCA et de MI
a risque de
cancer ?
f) Quand faut-il proposer une surveillance endoscopique ?
Dans quelles circonstances faut-il
re´aliser une endoscopie digestive chez
un sujet pre´sentant des troubles
dyspeptiques ?
Lors de la prise en charge initiale d’un patient souffrant de
dyspepsie, il est n
ecessaire de s’assurer de l’absence d’une
pathologie organique. Le premier niveau de d
ecision
dans la d
emarche diagnostique est fond
e sur l’^
age et/ou
la pr
esence de sympt^
omes d’alarme. Compte tenu de
l’accroissement du risque de l
esion n
eoplasique digestive
haute
a partir de 50-55 ans, la plupart des soci
et
es savantes
recommandent l’endoscopie en premi
ere intention au-del
a
de cet ^
age. Dans les pays
a forte incidence du cancer
gastrique, ce seuil est plus bas. De m^
eme, la pr
esence de
sympt^
omes d’alarme (perte de poids non intentionnelle,
dysphagie, h
emorragie digestive haute, an
emie ferriprive,
vomissements, masse
epigastrique) fait logiquement
pratiquer une endoscopie premi
ere, bien qu’une m
eta-
analyse ait montr
e une faible valeur pr
edictive positive de
ces sympt^
omes [1].
Dans les autres situations, les strat
egies restent discut
ees.
Plusieurs
etudes ont
evalu
e et compar
e diff
erentes
strat
egies appel
ees « test and treat », « test and scope »
ou « traitement antis
ecr
etoire empirique ». Les strat
egies
fond
ees sur le « test » initial, signifient que l’on recherche
en premier lieu une infection
aH. pylori par une m
ethode
non invasive et que l’on propose une endoscopie « scope »
ou un traitement « treat » uniquement aux sujets H. pylori
positifs.
La strat
egie « test and treat » est recommand
ee par la
conf
erence de Maastricht IV [2] chez les patients de moins
de 50 ans sans signe d’alarme qui ont un faible risque de
cancer gastrique ; elle est pr
ef
erable au traitement
empirique lorsque la pr
evalence de l’infection
aH. pylori
est sup
erieure
a20%.Leb
en
efice de cette strat
egie est
controvers
e dans les pays
a faible pr
evalence de l’infection
aH. pylori. C’est une des raisons pour lesquelles elle n’est
pas recommand
ee en France chez les sujets jeunes. La
strat
egie du traitement empirique est la plus utilis
ee ; des
etudes ont montr
e qu’elle
etait
equivalente
a la strat
egie
«test and treat » en termes de soulagement des symp-
t^
omes et de co^
ut. C’est une strat
egie « s^
ure » car le risque
de tumeur est faible chez les sujets jeunes sans signe
d’alarme ou facteurs de risque. L’
etude DIAMOND a
montr
e que la strat
egie croissante en commenc¸ant par un
antiacide puis un anti-H2 et finalement un IPP selon la
r
eponse symptomatique
etait
equivalente et l
eg
erement
moins co^
uteuse que la strat
egie descendante utilisant un
allow a more accurate description of the mucosal architecture crypts and the
capillary network. MAPS European recommendations suggest that patients who
have severe atrophy or intestinal metaplasia of the gastric body or extended
throughout the stomach should be monitored every 3 years in endoscopy, in the
absence of dysplasia. In case of dysplasia, if endoscopy does not show visible
lesions, endoscopic re-evaluation with multiple biopsies should be performed
immediately and then every year in case of low grade dysplasia. In case of high-
grade dysplasia or cancer within a lesion endoscopically visible, endoscopic
resection should be considered first in order to grade the parietal extension of the
neoplasia.
nKey words: dyspepsia, H. pylori, gastritis, gastric cancer
11
HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive
vol. 20 n8suppl
ement 1, janvier 2013
Faut-il biopsier un patient souffrant de dyspepsie ?
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

IPP d’embl
ee et essayant de trouver la classe th
erapeutique
minimale assurant le maintien du contr^
ole symptomatique
[3]. En pratique, le gastroent
erologue est donc le plus
souvent amen
e
a voir ces patients en cas de non-r
eponse
ou de r
eponse partielle au traitement. L’endoscopie est
alors justifi
ee.
Le risque de cancer gastrique est multipli
e par 2
a 3 chez les
apparent
es au premier degr
e de patients ayant un cancer
gastrique ; s’il existe deux cas de cancer gastrique dans la
m^
eme famille, ce risque est multipli
e par 10. En cas
d’ant
ec
edent familial de cancer gastrique, la strat
egie
«test and treat » doit ^
etre propos
ee aux apparent
es au
premier degr
e^
ag
es de moins de 40 ans m^
eme en
l’absence de troubles dyspeptiques ; l’objectif du traite-
ment est double : soulager les sympt^
omes lorsqu’ils
existent et pr
evenir le cancer gastrique. La strat
egie
«scope and treat » doit ^
etre propos
ee aux apparent
es
^
ag
es de plus 40 ans et avant 40 ans si le cas index
etait ^
ag
e
de moins de 50 ans au moment du diagnostic de cancer.
L’objectif de l’endoscopie est de rechercher des l
esions
pr
ecanc
ereuses qui peuvent n
ecessiter une surveillance
endoscopique.
Que doit-on rechercher lors
de l’endoscopie ?
L’endoscopie doit rechercher une infection
aH. pylori et
des l
esions induites par cette infection, en particulier celles
qui sont susceptibles d’
evoluer avec le temps vers un
cancer de l’estomac. H. pylori a
et
e reconnu comme
facteur
etiologique du cancer de l’estomac en 1994 par
l’OMS qui l’a class
e parmi les carcinog
enes de type 1. Pr
es
de 80 % des cancers de l’estomac sont li
es
alabact
erie. Le
processus de transformation maligne s’
etale sur plusieurs
dizaines d’ann
ees ; la premi
ere
etape est la gastrite
chronique induite par l’infection. Pour le cancer de type
intestinal, la gastrite chronique va progressivement
evoluer vers l’atrophie puis vers l’apparition de foyers
de m
etaplasie intestinale et de l
esions de dysplasie. La
gastrite atrophique et la m
etaplasie intestinale d
ebutent le
plus souvent dans la r
egion angulaire puis s’
etendent
progressivement vers l’estomac proximal. Les traitements
prolong
es par inhibiteurs de la pompe
a protons (IPP)
favorisent l’extension de la gastrite atrophique et de la
m
etaplasie intestinale vers l’estomac proximal. Le cancer
de type diffus survient lui aussi sur une gastrite chronique
inflammatoire li
ee
aH. pylori mais il n’est pas associ
eaux
l
esions pr
ecanc
ereuses d’atrophie et de m
etaplasie
intestinale. Environ 1 % des patients infect
es par H. pylori
d
eveloppent un cancer de l’estomac. L’infection
aH. pylori
qui intervient
a un stade pr
ecocedelacanc
erogen
ese n’est
donc pas suffisante
a elle seule pour induire un cancer ;
d’autres facteurs de risque, environnementaux ou li
es
a
l’h^
ote, sont n
ecessaires.
La gastrite chronique provoqu
ee par l’infection
aH. pylori
ne s’accompagne habituellement d’aucune modification
macroscopique de la muqueuse en endoscopie. La
topographie de la gastrite est li
ee aux modifications de
la s
ecr
etion acide induites par l’infection. La gastrite antrale
s’accompagne d’une s
ecr
etion acide normale ou
augment
ee et est associ
ee
a l’ulc
ere duod
enal alors que
la pangastrite ou l‘atteinte fundique pr
edominante
s’accompagne d’une diminution de la s
ecr
etion acide et
est associ
ee
a l’ulc
ere gastrique et au cancer.
Il existe une grande variabilit
e inter-observateurs dans
l’
evaluation endoscopique de l
esions pr
ecanc
ereuses et
une faible corr
elation avec les r
esultats histologiques. Le
diagnostic endoscopique d’une l
esion pr
ecanc
ereuse
comporte deux
etapes qui sont la d
etection d’une zone
suspecte, suivie de sa caract
erisation. La premi
ere
etape de
d
etection est habituellement r
ealis
ee en lumi
ere blanche,
sans recourir au traitement de l’image ni aux colorations.
Alors que les anomalies de relief telles que les l
esions
polypoı¨des ou les l
esions ulc
er
ees sont facilement rep
er
ees,
les l
esions planes sont le plus souvent m
econnues. L’
etape
de caract
erisation d’une zone suspecte consiste
a
en analyser la morphologie et les limites. M^
eme si
l’utilisation des vid
eoendoscopes haute d
efinition am
eliore
la caract
erisation des l
esions planes, cette
etape est facilit
ee
par les techniques de grossissement, les proc
ed
es
electroniques de traitement de l’image et par la chromos-
copie qui permettent une description plus pr
ecise du relief
muqueux de l’architecture des cryptes et du r
eseau
capillaire.
La m
etaplasie intestinale peut ^
etre visualis
ee en endoscopie
notamment gr^
ace
a l’apport de colorations vitales et de la
chromoscopie virtuelle. L’imagerie en bande spectrale
etroite (NBI) semble une approche prometteuse pour le
diagnostic de la m
etaplasie intestinale et de la dysplasie ;
c’est la technique la plus
etudi
ee au niveau de l’estomac.
Plusieurs
equipes asiatiques ont montr
e que la m
etaplasie
intestinale
etait caract
eris
ee par un relief muqueux
particulier en endoscopie grossissante coupl
ee au NBI : il
s’agit de l’aspect de cr^
etes bleut
ees (light blue crest). Ces
etudes ont montr
e que la sensibilit
e et la VPP de l’aspect
des cr^
etes bleut
ees pour le diagnostic de m
etaplasie
intestinale
etaient voisines de 90 % [4]. En Europe, l’
equipe
de Kuipers a montr
e que m^
eme sans grossissement le NBI
est utile pour la d
etection des l
esions de m
etaplasie
intestinale ou de dysplasie [5] : dans cette
etude, les
performances diagnostiques du NBI
etaient sup
erieures
a
celles de l’endoscopie en lumi
ere blanche surtout en
termes de sensibilit
e (71 %), mais toutefois inf
erieures aux
r
esultats des
etudes japonaises. Les recommandations
europ
eennes MAPS sur les l
esions pr
ecanc
ereuses de
l’estomac soulignent que le NBI am
eliore la d
etection des
12 HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive
vol. 20 n8suppl
ement 1, janvier 2013
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

l
esions pr
ecanc
ereuses gastriques et qu’il devrait ^
etre mis
en œuvre dans les programmes de surveillance pour les
patients
a risque
elev
e de cancer gastrique.
Faut-il faire des biopsies ? Pourquoi ?
Combien de biopsies et a` quel endroit ?
Malgr
el’am
elioration des techniques de d
etection des
l
esions pr
ecanc
ereuses en endoscopie, le gold standard pour
le diagnostic d’atrophie gastrique et de la m
etaplasie
intestinale reste l’histologie. La topographie des l
esions de
gastrite atrophique ou de m
etaplasie intestinale est variable
selon les sujets ; ces l
esions ont une distribution h
et
erog
ene
et multifocale au niveau de l’estomac et leur diagnostic est
donc soumis
al’
echantillonnage biopsique. L’erreur
d’
echantillonnage d
epend du niveau de risque de cancer :
plus ce risque est faible et plus les l
esions pr
ecanc
ereuses
sont
eparses au sein de l’estomac, ce qui a pour effet
d’augmenter in
evitablement ce risque d’erreur.
Les recommandations europ
eennes MAPS indiquent qu’il
convient de r
ealiser au minimum 4 biopsies non cibl
ees et
des biopsies cibl
ees sur des l
esions visibles en endoscopie ;
les biopsies non cibl
ees doivent ^
etre r
ealis
ees sur la petite et
la grande courbure gastrique au niveau de l’estomac
proximal et de l’estomac distal, et ^
etre plac
ees dans deux
flacons s
epar
es [6]. Ces recommandations sont
a rappro-
cher de celles propos
ees pour le classement des l
esions de
gastrite selon le syst
eme de Sydney dans sa version r
evis
ee
[7]. Ce syst
eme a
et
e
elabor
e afin d’uniformiser la
description histologique des l
esions de gastrite, d’en
pr
eciser la topographie et l’
etiopathog
enie. La r
evision
de la classification recommande de r
ealiser 5 biopsies, 2 de
l’antre sur la petite et la grande courbure gastrique, 2 au
niveau du corps gastrique et une biopsie au niveau de la
petite courbure angulaire, l’argument en faveur de ce site
de biopsie suppl
ementaire
etant la plus grande fr
equence
des l
esions de gastrite atrophique et de m
etaplasie
intestinale au niveau de l’angulus. Bien que ce protocole
permette de diagnostiquer la gastrite chronique et d’
etablir
correctement le statut H. pylori, le nombre de biopsies
n
ecessaires pour
evaluer ou d
etecter les l
esions
pr
ecanc
ereuses demeure d
ebattu. Il a
et
e montr
e que le
protocole recommand
e par le syst
eme de Sydney sous-
estime la pr
esence de la m
etaplasie intestinale dans plus de
50 % des cas [8]. La valeur ajout
ee de la biopsie de la petite
courbure angulaire est
egalement d
ebattue. Cette zone est
consid
er
ee comme la zone d’extension de la gastrite
atrophique et d’apparition de la m
etaplasie. En utilisant un
protocole normalis
e de biopsies, de Vries et al. ont montr
e
que les biopsies non cibl
ees de la petite courbure angulaire
avaient un rendement diagnostique plus
elev
e que celles de
la grande courbure gastrique [9]. Une autre
etude a montr
e
que l’apport des biopsies de l’angulus
etait limit
e [10].
En conclusion, il faut syst
ematiquement r
ealiser un
minimum de 4 biopsies
a vis
ee histologique m^
eme lorsque
l’endoscopie ne montre pas de l
esion muqueuse : 2
biopsies au niveau de l’antre, 2 au niveau du corps
de l’estomac. Bien que son int
er^
et ne soit pas clairement
etabli dans la litt
erature, la r
ealisation d’une biopsie
suppl
ementaire au niveau de l’angle de la petite courbure
est utile. Les biopsies doivent ^
etre plac
ees dans deux
flacons diff
erents correctement
etiquet
es ; les 2 biopsies
antrales et celle de l’angulus doivent ^
etre regroup
ees dans
le m^
eme flacon. S’il existe des l
esions focales visibles en
endoscopie, des biopsies cibl
ees doivent ^
etre r
ealis
ees sur
ces l
esions focales et les biopsies non cibl
ees doivent ^
etre
multipli
ees afin de rechercher des l
esions pr
ecanc
ereuses
sans traduction endoscopique en pr
ecisant la topographie
des sites de pr
el
evement sur les flacons biopsiques, eu
egard aux cons
equences th
erapeutiques qui d
ependent de
l’extension et de la topographie de ces l
esions.
Quelles sont les le´sions de gastrite
atrophique et de me´ taplasie intestinale a`
risque de cancer ? Comment interpre´ter
le re´sultat de l’examen anatomo-
pathologique des biopsies ?
Le risque de cancer gastrique est accru en cas de gastrite
atrophique et de m
etaplasie intestinale lorsque ces l
esions
pr
edominent sur le corps gastrique [11]. La pr
esence d’une
gastrite atrophique dans le corps de l’estomac induit une
hypochlorhydrie qui favorise l’apparition de l
esions multi-
focales de m
etaplasie intestinale qui conduisent au cancer
de type intestinal. Bien que le syst
eme de Sydney
ait contribu
e
a uniformiser la description des l
esions
pr
ecanc
ereuses gastriques, il ne fournit pas d’informations
pr
edictives directes sur le risque de cancer gastrique. La
classification de Sydney est semi-quantitative ; elle
evalue
s
epar
ement l’atrophie sur le fundus et l’antre, mais ne
permet pas d’
etablir un score global d’atrophie.
Des scores histologiques ont
et
e propos
es afin de stratifier
le niveau de risque de cancer en fonction de la s
ev
erit
eet
de la topographie des l
esions de gastrite chronique
atrophique et de m
etaplasie intestinale. La classification
OLGA (Operative Link for Gastritis Assessment) tient
compte de la s
ev
erit
e et de la localisation de l’atrophie
dans l’antre et le corps gastrique (figure 1). Elle permet de
d
efinir 4 stades selon les scores d’atrophie au niveau de
l’antre et du corps de l’estomac ; les stades III et IV
etant
consid
er
es comme des scores pr
edictifs de la survenue de
dysplasie et de cancer. Deux
etudes ont montr
e une bonne
corr
elation entre les stades III et IV et la pr
esence de l
esions
dysplasiques ou de cancer superficiel [12, 13]. Dans une
cohorte de 93 patients avec des l
esions pr
ecanc
ereuses
13
HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive
vol. 20 n8suppl
ement 1, janvier 2013
Faut-il biopsier un patient souffrant de dyspepsie ?
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

suivis pendant 12 ans, Rugge et al. [14] ont montr
e
que le stade OLGA lors de l’endoscopie initiale
etait
pr
edictif du stade ult
erieur et de la survenue d’un cancer ;
dans cette
etude, le cancer n’apparaissait que chez les
patients ayant une atrophie s
ev
ere (stades III et IV) avec un
risque relatif de 18,5.
L’utilisation de la s
ev
erit
e de la gastrite atrophique comme
crit
ere principal d’
evaluation du risque est critiquable, en
raison de la reproductibilit
e limit
ee du diagnostic histolo-
gique. Le diagnostic de m
etaplasie intestinale est moins
sujet aux variations d’interpr
etations inter-observateurs.
Pour cette raison, Capelle et al. [15] ont propos
e une
classification modifi
ee qui prend en compte la s
ev
erit
eetla
topographie de la m
etaplasie intestinale en lieu et place de
la gastrite atrophique (figure 2). Ces auteurs ont montr
e
que la reproductibilit
e de cette classification appel
ee
OLGIM (operative link on gastric intestinal metaplasia
assessment)
etait excellente avec un coefficient kappa de
0,9 et que 86 % des patients avec une dysplasie avaient un
stade OLGIM III ou IV.
Au total, ces nouvelles classifications OLGA et OLGIM
semblent performantes pour s
electionner les malades
qui doivent ^
etre surveill
es par endoscopie ; elles doivent
toutefois ^
etre valid
ees par d’autres
etudes dans des
contextes
epid
emiologiques diff
erents.
Quand faut-il proposer une surveillance
endoscopique ?
Le pronostic du cancer de l’estomac d
epend du stade au
diagnostic. Les taux de survie apr
es traitement de l
esions de
Absence d’atrophie
(score 0)
Atrophie légère
(score 1)
Atrophie modérée
(score 2)
Atrophie sévère
(score 3)
Stade I Stade II Stade II
Stade I Stade I Stade II Stade III
Stade II Stade II Stade III Stade IV
Stade III Stade III Stade IV Stade IV
Stade 0
Région angulaire
incluse
Score d’atrophie
Antre gastrique
Corps gastrique
Absence
d’atrophie
(score 0)
Atrophie
légère
(score 1)
Atrophie
modérée
(score 2)
Atrophie
sévère
(score 3)
Figure 1. Score OLGA (operative link on gastritis assessment).
Absence de MI
(score 0)
MI légère
(score 1)
MI modérée
(score 2)
MI sévère
(score 3)
Stade I Stade II Stade II
Stade I Stade I Stade II Stade III
Stade II Stade II Stade III Stade IV
Stade III Stade III Stade IV Stade IV
Stade 0
Région angulaire
incluse
Score de métaplasie intestinale (MI)
Antre gastrique
Corps gastrique
Absence
de MI
(score 0)
MI
légère
(score 1)
MI
modérée
(score 2)
MI
sévère
(score 3)
Figure 2. Score OLGIM (operative link on gastric intestinal metaplasia assessment).
14 HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive
vol. 20 n8suppl
ement 1, janvier 2013
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%