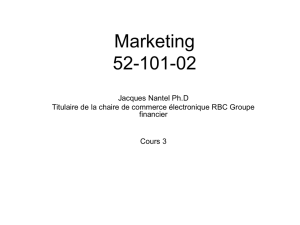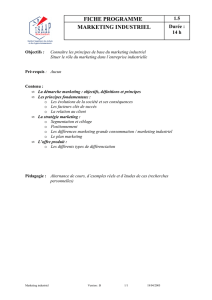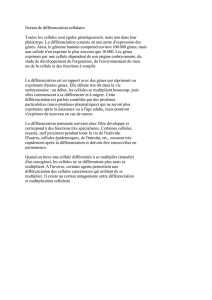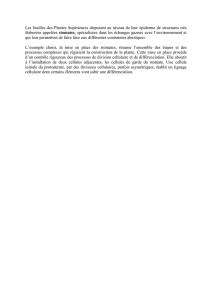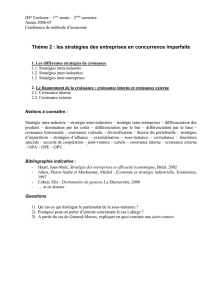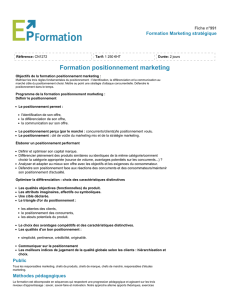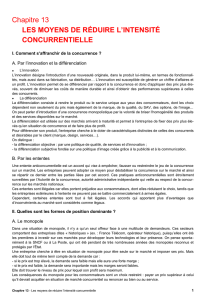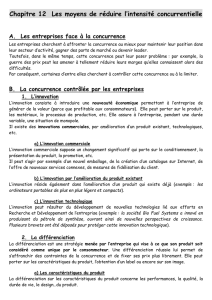LA DIFFERENCIATION STRUCTURELLE EN CONTEXTE

LA DIFFERENCIATION STRUCTURELLE
EN
CONTEXTE AFRICAIN
Sur
un
enjeu des transformations en cours
dans les champs économique et politique(*)
Yves-André
FAUm
Deux imposants chantiers paraissent remplir l’agenda de
l’Afrique subsaharienne contemporaine.
Au
plan économique tout
d’abord
où
les problèmes actuels, pour n’avoir pas été totalement
imprévisibles, sont
nés
de la confluence d‘évolutions éminemment
néfastes et
non
maîtrisées par les gouvernements.
En
schématisant leur
genèse il est permis d’identifier en premier lieu la montée cumulative de
déséquilibres extérieurs, manifestés entre autres par la survenance, quasi
simultanée -et par là même constitutive d’une conjoncture
particulièrement critique-, entre la
fin
de la décennie soixante-dix et le
début des années quatre-vingt, des effets d‘un endettement devenu
exponentiel, d’une chute des recettes d‘exportation,
d‘un
mouvement de
désinflation en Occident et
d‘un
relèvement des taux d’intérêt. La
profonde dégradation des balances des paiements de tous les pays
africains qui en a résulté porte témoignage comptable de cette première
évolution. Le second volet, interne, de cette périlleuse situation, s’est
signalé par la forte progression des déficits internes
-
finances publiques
au sens large: administrations et secteurs parapublics
-,
par
l’accroissement des arriérés de paiements, la faillite des systèmes
bancaires nationaux, l’essoufflement du processus d’industrialisation, le
repli de l’investissement.
Un
peu partout d’importants trains de réformes et de mesures
d‘austérité ont été mis en oeuvre dans le cadre de programmes
d‘ajustement structurel
(PAS)
arrêtés peu
ou
prou avec l’aide, quand ce
n’était pas directement par le FMI (Fonds Monétaire International) et la
BIRD (Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement dite Banque mondiale). Ces
PAS
ont globalement visé la
restauration des grands équilibres financiers, l’assainissement des
comptes publics, le désengagement économique des Etats, la réduction
des importations, la libéralisation des prix et, théoriquement au moins,
l’instauration d’un environnement incitatif de nature
à
assurer la relance
des appareils productifs et
à
développer les exportations dans le cadre
d’économies ouvertes
à
la concurrence internationale(1).
(*)
Inédit
(1)
Dans une littbrature, devenue
fort
abondante, consacrée aux ro rammes d‘ajustement
structurel
on
signalera l’ouvrage désormais “classique” de
Durufl%
19% et les divers articles
garus
dans plusieurs livraisons -notamment dans les
no
3
B
7-
de la revue
Chroniques
du
UD,
Paris,
ORSTOM,
qui
renvoient eux-mêmes
à
des références bibliographiques
nombreuses.
153

On
a pu naturellement douter de la réalité de l’ajustement visé en
principe par les programmes de restructuration et s’interroger sur
l’adaptation véritable des
PAS
aux causes et composantes des crises
auxquelles ils sont censés remédier;
on
peut encore, comme le fait
subtilement Jean-François Bayart (Bayart 1992) soupçonner
à
présent
un
déplacement de l’objet des
PAS
et avancer qu’ils répondent désormais,
pour les organisations multilatérales de Bretton Woods,
à
la double
préoccupation de perpétuation de leur être bureaucratique et de maintien
de leur “rating” bancaire, condition, comme
on
sait, de leur crédibilité
pour lever des fonds
à
très faible intérêt sur le marché financier
international
;
toutes ces critiques et questions sont parfaitement
légitimes et fécondes car elles rendent compte du décalage constant entre
objectifs apparents visés et résultats réellement atteints
;
cependant elles
ne sauraient suggérer
-
et il semble même préférable d’affirmer
explicitement le contraire
-
que l’absence d’ajustement des économies et
de relance des activités résulteraient
d‘un
manque réel de rigueur;
notamment elles ne doivent pas masquer ce fait majeur que les sociétés
africaines ont été soumises depuis plus d’une décennie
à
des politiques
d‘austérité mettant
à
mal, par leurs effets sociaux, les conditions de vie
du plus grand nombre, générant, par leurs effets économiques, la
récession dans de nombreux secteurs d’activité et entamant enfin les
moyens d‘intervention de la puissance publique par quoi tenaient encore,
tant bien que mal, maintes scrciétés
au
sud du Sahara. Sans doute faut-il
voir plutôt dans une rigueur persistante
non
suivie d‘avantages visibles
par tous et dans des répartitions inégalitaires des fardeaux de
l’ajustement certains des facteurs premiers des révoltes surgies dans de
nombreux pays africains au détour de l’année 1990.
Car, dans le même temps
où
les politiques dconomiques de
rigueur, pourtant bien concrètes depuis une dizaine d’années, tardaient
à
remettre les pays africains sur les chemins d’une nouvelle croissance,
promise mais apparemment inaccessible
-
la diminution, en termes réels,
du produit par habitant au Sud et l’amplification des transferts financiers
nets vers le Nord montrent les limites de cet objectif
-,
leurs gouvernants,
alertés par les bailleurs de fonds et débordés soudain par des
mouvements sociaux de grande ampleur ont été sommés d’ouvrir le jeu
politique, d’accepter le passage au multipartisme, d’organiser des
élections ”libres et sincères”. Dans plusieurs cas ils ont été contraints de
respecter le verdict des urnes en s’effaçant devant de nouvelles équipes
dirigeantes incarnant l’alternance des idées et des générations et censées
assurer, dans
un
bouillonnement confus d’attentes et d’aspirations
quelquefois peu compatibles entre elles, aussi bien l’assainissement des
gestions publiques que la “moralisation” de la vie politique et
l’amélioration des conditions d’existence d’une population ayant payé
un
lourd tribut
à
une
décennie d‘ajustement structurel (réduction des
dépenses sociales de l’Etat, suppression des subventions, augmentation
des tarifs de services publics, licenciements, etc.).
154

Sur le versant économique et financier des réformes en cours
l’orientation générale et logique est claire et résumable en une courte
formule
;
les mesures dites d’ajustement prises
çà
et là pour contenir les
plus forts déséquilibres extérieurs et diminuer les déficits internes tendent
à
modifier des régimes extensifs de production qui ont prévalu jusque-là
en maints domaines, et pas seulement dans le secteur agricole mais aussi
en matière industrielle et d’administration publique
;
sont également
at-
taqués les divers monopoles économiques et financiers et toutes sortes de
situations de rente (par exemple en matière
d’importatiodexportation,
dans les circuits commerciaux intérieurs, etc.) dont certains, déjà an-
ciens, n’avaient guère été affectés par l’accession des ex-pays colonisés
à
la souveraineté juridique, et dont beaucoup d’autres, créés depuis les an-
nées soixante, étaient le résultat de la régulation politique que devait ser-
vir impérieusement l’allocation des ressources économiques. Quant
aux
changements, imposés
ou
négociés, qu’on peut observer depuis peu sur
les scènes politiques, ils ont pour effet, en poussant au démantèlement
des régimes de confusion partatat, voire en congédiant
-
avec les dWi-
cultés et les incertitudes qu’on sait
-
des leaders qui s’étaient appropriés
à
titre viager le pouvoir gouvernemental, d’ouvrir l’espace de l’expression
et de la représentation politiques
A
une pluralité d’intérêts, d’idéologies
et d’organisations.
Ces mouvements et ces changements qui affectent la sphère
économique et la sphère politique, au-delà bien entendu de la diversité
des formes par lesquelles ils s’expriment et des objectifs qu’ils servent et
tenant justement
à
la spécificité de chacun de ces deux secteurs
d’activité, ne sont cependant pas sans présenter certaines affinités
fondamentales. I1 ne s’agit pas ici de faire allusion aux relations
d’influence réciproque où s’inscrivent en permanence l’économique et le
politique
ni
même d’évoquer, plus particulièrement
à
propos de
la
conjoncture présente, les conditionnements mutuels de I’état du jeu
politique et de la situation d’ajustement structurel
où
se trouvent tels et
tels pays. Une homologie discrète relie les processus de transformation
dans les deux sphères: en chacune ce ne sont pas seulement les
ressources qui sont passibles d’une répartition différente d‘hier, ce sont
aussi, surtout, les conditions du jeu et de participation au jeu qui sont en
voie de changement important
-
loin d‘être acquis certes,
on
conviendra
aisément de cela. Aussi il n’est pas interdit de voir dans les
bouleversements présents
un
enjeu, implicite mais transversal et peut-
être décisif
à
terme, qui serait celui d‘une plus grande différenciation et
autonomisation acquise par un certain nombre de sphères de l’activité
sociale, au premier rang desquelles la vie économique et la vie politique.
Telle est en tout cas l’hypothèse qui sous-tend le présent texte et
qui propose de lire les tensions, les ruptures et les transformations que
connaît l’Afrique noire du début de la décennie quatre-vingt dix en ayant
recours
à
des pistes théoriques et des cadres interprétatifs légués par des
155

approches
-
du développement et de la modernisation
-
ayant eu cours,
naguère, dans les sciences sociales, en économie, sociologie et science
politique principalement. A condition de les débarrasser de leurs scories
épistémologiquement critiquables et de les compléter par les apports
d’écoles plus récentes
-
de la structuration et de l’analyse des champs en
l’occurrence
-,
ces ouvertures compréhensives sur la dynamique sociale
paraissent encore susceptibles de mettre en lumière
un
des enjeux, que
l’on pense majeurs même s’il n’est appréhendable que sur le long terme,
des changements économiques et politiques actuels en Afrique
subsaharienne.
Différenciations structurelles et changements sociaux
Si
l’on
tient pour exactes mais marginales les premières références
historiques
à
la question de la division du travail que l’on trouve
sous
la
plume de Boisguilbert dès
1695
(Perrot et
Wolf€
1986)’
on
peut
raisonnablement faire remonter la généalogie de la pensée autour du
thème de la spécialisation des tâches au célèbre ouvrage d’Adam Smith,
An
Inquiry
into the Nature
and
Causes
of
the Wealth of Nations
de
1776.
Les trois premiers chapitres du livre
I
de la
Richesse des Nations
y sont en
effet consacrés. Dans sa somme relative
à
l’Histoire de l’analyse
économique
Joseph A. Schumpeter (Schumpeter
1954/1983,
tome
I,
pp.
258-275),
tout en paraissant quelque peu injuste
à
l’égard du précurseur
frangais(2) a pu, non sans arguments, voir dans l’ouvrage de 1’Ecossais la
première solide réflexion sur le sujet
à
la fois pour l’insistance avec
laquelle le penseur développait ce point mais aussi pour avoir, le
premier, assimilé la division du travail au progrès économique.
L’amélioration des techniques de production, la croissance du
machinisme sont appréhendés par Adam Smith comme la conséquence
de cette division. Celle-ci apparaît dans
son
oeuvre
à
la fois comme le
résultat du développement des échanges et de l’expansion des marchés et
à
la fois comme l’instrument permettant de mesurer les effets de cette
évolution (le progrès économique). Mais, comme
on
a pu par ailleurs le
faire remarquer, cette division du travail, dans la même oeuvre, n’est pas
expurgée de toute conception immanente et téléologique de l’activité
sociale
:
Schumpeter lui-même accordait que la spécialisation dans
l’oeuvre d‘A. Smith relevait d’une propension innée
à
l’échange”
(Schumpeter
1954A983,
tome
I,
p.
267).
(2)
I1 est signifcatif que dans sa formidable
Hisfoire
Joseph Schumpeter,
ui
n’oublie aucun
des fondateurs de la pensée économique, présente et évalue les nomBreux travaux de
Boisguilbert sans faire allusion au thème de la division du travail -dont Perrot et
Wolf€
disent pourtant qu’il est le oint de départ des analyses de ceFeur (Perrot et
Wolff
1986 p.
5)-
et en remette ye mérite pionnier exclusif au pro esseur écossais. De même
n’omettons pas l’influence qu’a pu exercer sur les premiers penseurs du libéralisme
économi ue le fameux ouwa e que le médecin hollandais étabh Londres Bernard de
Mandede, publia en 1714
:
fa fable des abeilles
ou
Vicesprivés, bénéflcespubiics,
première
véritable analyse des effets de com osition dont certams, baptisés “pervers”, ont
été
rendus célèbres auprès
d‘un
large pubic par tel sociologue françm contemporain.
156

Des pionniers de l'analyse économique aux fondateurs de la
sociologie: inspiré
par
les travaux d'H. Spencer et son
Traité de
philosophie,
Emile Durkheim, dans sa thèse
De
la
division
du
travail
social
de
1893
s'était intéressé
à
la question des causes et du sens du
passage
à
une différenciation sociale croissante dans les sociétés
modernes (Durkheim
1893/1973).
L'évolution de formes sociales
"simples" vers des formes sociales "complexes" sur la base de processus
de différenciation et d'agrégation était présentée comme liée
à
l'accroissement de la densité sociale (croît démographique,
augmentation du volume et de la densité des relations et communications
etc
.).
Ces perspectives apparaissaient épistémologiquement assainies par
rapport
à
des conceptions antérieures rapportant la division du travail
social
à
la pression des consciences utilitaristes
ou
à
la mise en
oeuvre
du
pacte social sur une base volontariste. Mais si l'explication s'annonçait
moins ambitieuse au plan du finalisme et de facture plus mécaniste, car
la différenciation dans l'analyse durkheimienne était conçue comme
générée par des transformations d'ordre morphologique affectant les
relations sociales, elle n'était pas épargnée par une tonalité
évolutionniste.
On
sait que le schéma de la différenciation sociale se trouvait,
chez Durkheim, corrélé
à
la constitution de deux types idéaux de
solidarité
:
soit une solidarité
à
fondement mécanique correspondant
à
des ensembles sociaux de faible volume
où
l'organisation est peu
différenciée, le droit de type répressif et l'individu intégré dans une
conscience collective très vivace
;
soit une solidarité
à
fondement
organique correspondant
à
des sociétés de volume et densité élevés, dans
lesquelles les fonctions sociales sont nettement différenciées, le droit de
type coopératif et l'individu émancipé. Durkheim montrait en outre que
la division qu'il examinait était
à
l'oeuvre dans tous les domaines de
l'activité sociale (religion, politique, économie etc.)
:
elle générait en
conséquence et spécialisation des rôles et apparition de la solidarité
organique.
Plus près de
nous
le sociologue américain Talcott Parsons
(Parsons
1951
et
1973)
a érigé les processus de différenciation sociale en
une forme essentielle du changement social. Ses derniers travaux, comme
l'a noté
-
pour mieux en critiquer la tendance
-
Anthony Giddens
(Giddens
1987)
sont eux aussi clairement marqués par la pensée
évolutionniste. L'évolution sociale y est cernée en tant que processus
progressif de différenciation reposant sur des "fonctions" de
spécialisation, d'adaptation, de segmentation de sous-systèmes sociaux,
d'intégration et de socialisation ("pattern maintenance"). La
démultiplication en sous-systèmes apparaît dans ce cadre conceptuel
comme synonyme d'une complexité sociale croissante et la
différenciation y est présentée comme étant de nature parfaitement
fonctionnelle. Le sociologue américain met en place le tableau
157
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
1
/
30
100%