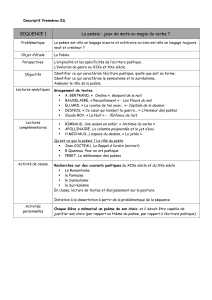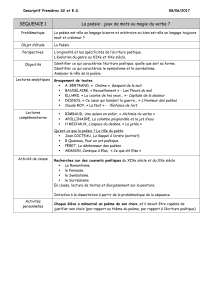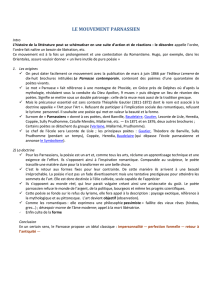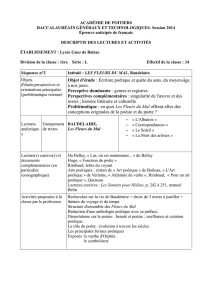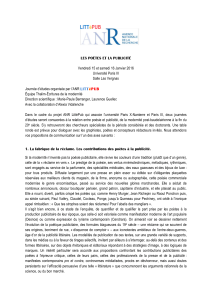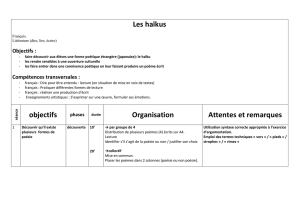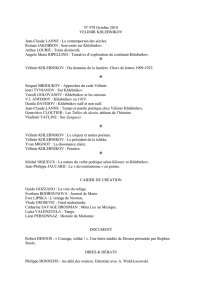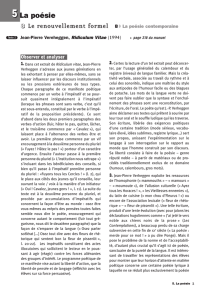Télécharger le pdf - Festival d`Avignon

Votre œuvre va du côté de l’histoire, de la grande histoire, et de l’autre du côté de l’intime et du poétique.
Comment conjoignez-vous les deux ?
Adel Abdessemed:J’aitoujoursditquel’histoireétaitaussiunefalsication:ilyaenelleunemorale
réductrice.Jesuisfascinépardesœuvresquimettentenscènel’éthique,lapolitique,quiparlentd’undevenir,
maiscequimetoucheleplusestcequiremonte:la«Surface»,çaveutdirelelieu,l’espaceoùleschoses
remontent.Onesttémoin;dansmonœuvreShopping,onvoitcejeunehomme,cetétudiant,quisortaitavecses
courses,sessacsenplastique,etaffronteungéant,telquelestanks.Cejeunehommenesavaitpasque,àce
moment,ilestdevenuletémoin,lamémoiredetoutelaChine.Ilestentrédansl’Histoire–lui-même.Jelefais
remonter,commeuntémoin;ilétaitsurlelieuducrimeet,entantqu’artiste,jesuissurlelieuducrime.L’œuvre
d’artnepeutpasêtreréduiteàl’Histoire.Cequej’aimedel’œuvrepoétique,c'estl’instinct.Ilyaaussidel’erreur.
L’œuvren’estpasintellectuelle.Elleestd’ordreprimitif:c’estpourcelaqu’elleestpoétique.Lapoésieestau-delà
del’analyse;ilyal’erreur,ilyal’ignorancepossible.Maisonsent.Danslapoésie,ilyal’élan,etladécoration
entantquematièresonore.Ilyaaussil’inévitabilitédel’ambiguïté,l’auxiliaireavoir,l’auxiliaireêtre.Dansl’œuvre
d’art,ilyadessignesbiensûr,maisilyaaussilamatière.Tudislemot«métal»,tul’asdanslaboucheetdans
latête,maisl’imageetlaprésencematériellenesontpaslà,enface,surplace.Lapoésie,c’estcequilibère:un
malaise,etlavie.
Parmi les textes qui comptent pour vous, il me semble qu’un grand nombre touche au désespoir humain
– Dostoïevski, Nietzsche – et en même temps à la joie. Quel est leur rapport ?
Àl’intérieurdudésespoir,ilyalaforcedecrier.Cecriestunecréation:làestlavraiejoie.Siondit«joie»,sion
dit«désespoir»,onestencoredansl’inévitabilitédel’individualitéetdel’individu.Celaramèneàl’énergie:joie,
désespoir,cesontdesénergies.Uncri:cepeutêtrelasouffrancedeladouleur,delaculpabilité;cepeutêtreun
criextatique,cepeutêtrepourselibérerdequelquechose.Là,ilyaunejouissancequilielesdeux.
Quandonfaitundessin,onrate,onrecommence,onrate,onrecommenceencore,onestdésespéré,parce
qu’onpensequ’onnevajamaisyarriver.Onn’abandonnerienaumonde.Onestdésespéré.Onsaitqu’onneva
jamaisyarriver.Lajoie,onpeutaussilalieraucourage.Dansledessin,onsemoquedutalent:cequicompte,
c’estlecourage,derefaire,derecommencer,mêmesionaraté.Làestlajoie.Nietzscheestunspéléologuedes
profondeurs;sapuissanceestsa«volonté»,maisl’élanchezlui,au-delàdesonécriturephilosophique,c’estle
butpassionnédeparlerdel’homme,desamort,desafoliesociale.L’artisteauneseuleresponsabilité,envers
l’œuvre.Aucunartistenecroit,mêmeàuninstant,àl’artpourl’art:c’estdéjàunprogramme,unemorale,pour
justieruncertainart,etendétruireunautre;unartengagé:unephraseestnéepourattaquerBaudelaire,
etattaquerFlaubert;unartauxprises.L’artnepeutêtreréduitàcesformulesquinemènentnullepartet
produisentplutôtdesenfermementsclaustrophobiques.TolstoïetDostoïevskiontmisdansleursœuvresledestin
d’unpeuple,cequiallaitadvenir.
Vous vivez entre poésie et philosophie. Comment voyez-vous la relation entre les deux ? Comment
nourrit-elle votre œuvre ?
Lespoètesmententtrop,ilstroublenttoutesleurseauxpourqu’ellesparaissentprofondes,commedisait
Zarathoustra.BaudelaireadédiéLes Fleurs du MalàThéophileGautier,quin’estpascomparableàEdgar
AllanPoe,qu’ilapourtanttraduit.Laphilosophienousaideàpenserlemonde,àrééchir,àlecomprendre.
Lepoètechercheàtransformerlemonde.Quandlephilosophe,lui,chercheàtransformerlemonde,comme
KarlMarx,onpeutdirequ’ilappauvritl’histoire.Sursatombe,ilestécrit:«Travailleursdetouspaysunissez-
vous.Lesphilosophesn’ontfaitqu’interpréterlemondededifférentesfaçons.Cequ’ilfautnéanmoins,c’estle
changer.»Mais,c’estunepenséedefourmi,d’abeille:legroupe.Jecroisenl’individu,pasdanslegroupe:plus
onestnombreux,plusondevientimbécile.Jesuisducôtédespoètes:ducôtéd’AntoninArtaud,quidonneen
mêmetempslapoésieetlaphilosophie.Ceuxquim’intéressentsonttousdesgureségalementpoétiqueet
philosophique:Nietzsche,etRimbaud,etMallarmé,etJoyce,etBeckett,etPasolini,etKatebYacinequi,entre
autreschoses,disaitquelepoèteestcommeunboxeur;ildonneetilreçoit...Certainsremplissent,d’autres
vident.
SURFACES
ENTRETIEN AVEC ADEL ABDESSEMED

6 AU 24 JUILLET 2016
ToutleFestivalsurfestival-avignon.com
#FDA16
Quel rapport avez-vous à la lecture ? Quelle en est l’expérience pour vous ?
HélèneCixous,jenelalispascommeuneromancière:ellenem’invitepastantàlireensoiqu’àpenser.Son
écritureestàlafoiscomplexeetsimple,maiselleselitavecgrandplaisir.
Quandj’étaisenAlgérie,j’ailuHomère,Shakespeare,etévidemmentlalittératurerusse,Gogol,lesNouvelles de
Pétersbourg,«LeManteau».Shakespeareapprendàpenserlajalousie,lepouvoir,lamémoireetl’oubli.
C’étaitundé:jeneconnaissaispastrèsbienlalangue.Lesmots,jelesinterprèteàmafaçon:jelesprends,et
j’enfaisdesbriques.DansLa Divine Comédie,DanteachoisiVirgilepournousguiderdanssonvoyage.Jene
suispasunlecteur;jesuisunprofessionnelàtournerlespages,quandcelam’arrive.Jeliscequimedonneà
penseretm’aideàcomprendrequelquechosesurmoi-même:pascommeunmiroirquireèteraitmonimage–
ceseraitêtrecommeNarcisse–maispourautrechose,pourl’autrechose.
Vous aimez le dialogue avec les auteurs de poésie, de philosophie et de littérature. Quel rapport
entretenez-vous avec eux ?
Beckettn’aimaitpascetteententeentreartistesetpoètes.Genet,lecontraire:ilétaittrèsprochedeGiacometti,
dedanseurs,d'équilibristes,devoyous.J’aimelespoètes,lesécrivainsquidonnentàpenser,quitouchentà
quelquechose.Ilsapportentunenouvellepierreàl’édice.Cézanneaessayédetrouverdeladifférencedansla
répétition.Deleuzedisait:«Ilfautpenserlarépétitionaupronominal,trouverleSoidelarépétition,lasingularité
danscequiserépète.Cariln’yapasderépétitionsansunrépétiteur,rienderépétésansâmerépétitrice.»
Cézanneaessayédefairecela.Dansmestitres,ilyaunepartpoétique,uneintention/inventionlittéraire:
CommedansHistoire de la folie,oùjesuisendialogueavecFoucault;ouquandjeprendsunephrased’Adonis,
«D’unhorizonàunautre»commetitrepouruneautreœuvre.Criestenivoire,Travelling Playersestenmarbre:
lematériauestduretraconteencoreautrechose.Iln’arienàvoiravecletitremaisdansmonapprochelittéraire
enmêmetempsjenem’enpréoccupepas:jesuisdanslafoliedel’histoireetdansl’autrehorizon,oujesuis
restédanslemême,dansl’horizoninitial,commeunvoyagedemusiciensdansla«terrevaine»dutemps.
ProposrecueillisparDonatienGrau
1
/
2
100%