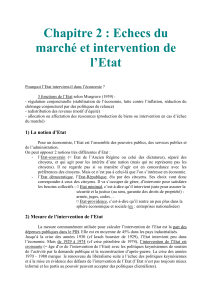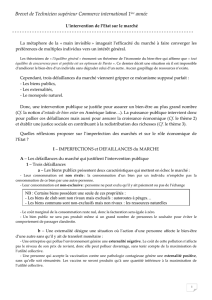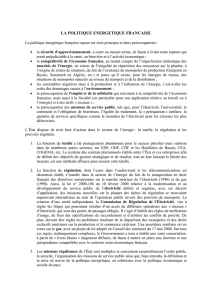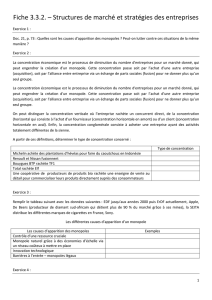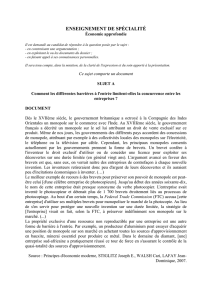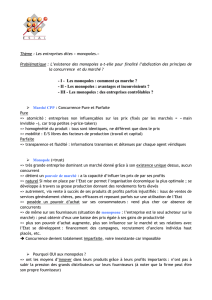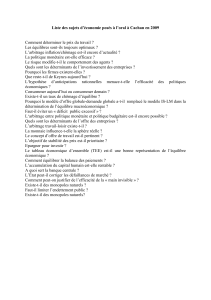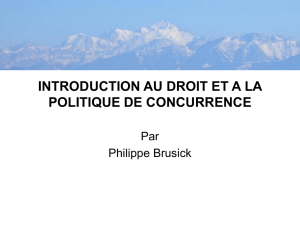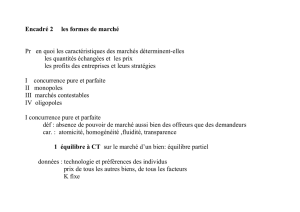laisser faire ou regulation ? une synthese des theories

1
LAISSER FAIRE OU REGULATION ? UNE SYNTHESE DES
THEORIES ECONOMIQUES.
Etienne LEHMANN
ERMES – Université Panthéon Assas Paris 2
IRES Université Catholique de Louvain et IZA – Bonn
12 place du Panthéon 75 012 Paris Cedex 05
elehmann@u-paris2.fr 1
Le rôle que doit jouer l’Etat dans l’économie est sans doute l’une des questions les
plus fondamentales dans les débats politiques contemporains. Ainsi, le XXeme siècle a vu la
plus forte opposition à ce sujet au moment de la Guerre Froide avec d’un côté, l’Union
Soviétique dont l’économie était organisée selon une planification obligatoire et centralisée, et
de l’autre les Etats-Unis qui se revendiquaient les défenseurs de la liberté du marché et des
bienfaits de la concurrence. Aujourd’hui, il ne fait plus guère de doutes que le système
soviétique a échoué dans l’organisation de l’économie. Mais assiste-t-on pour autant au
triomphe du Marché sur l’Etat ? En réalité non, car aucune économie de par le monde n’a
réussi à se passer d’un Etat qui établit des lois fiscales ou des règlements régissant l’activité
économique.
Aussi, si les positions sur le rôle de l’Etat dans l’économie sont devenues moins
tranchées qu’au moment de la guerre Froide, la question reste essentielle. Il me semble
toutefois que le problème n’est plus :
Faut-il laisser une place au Marché ?
L’échec de l’expérience Soviétique nous montre clairement que la réponse est positive.
Le problème n’est plus non plus :
Faut-il laisser une place à L’Etat ?
Puisqu’ aucune économie de part le monde n’a pu fonctionner sans un Etat minimal.
Les bonnes questions à se poser me semblent plutôt être :
1) Que doit faire l’Etat pour améliorer le fonctionnement de l’économie ?
2) Que peut faire l’Etat pour améliorer le fonctionnement de l’économie ?
3) Comment l’Etat doit-il intervenir de façon optimale ?
Ces questions définissent ce que je considère comme étant le problème de la
régulation de l’économie. De ce point de vue, j’accorde à ce terme une signification beaucoup
plus générale que la seule régulation des services publics puisque j’y inclus l’ensemble des
modalités d’intervention de l’Etat dans l’économie. En particulier, je considère également des
1 Je remercie Christine Halmenschlager, Dominique Meurs, Emmanuelle Taugourdeau et Jean Pierre
Taugourdeau pour leurs remarques constructives sur une version préliminaire de ce texte.

2
aspects aussi variés que la fiscalité, les prestations sociales, les privatisations, ou l’emploi
public.
Mon but sera d’apporter un regard d’économiste sur le problème de la Régulation de
l’économie ainsi redéfini et de déterminer la meilleure combinaison entre interventionnisme
de l’Etat et libéralisme. Par Marché j’entends une institution dans lesquels s’opèrent librement
des échanges économiques. Par Etat, j’entends une organisation collective et politique
contraignant les actions individuelles des agents économiques. De ce point de vue, ma
définition de l’Etat se veut suffisamment large pour englober des entités juridiques aussi
différentes que l’Etat central, les collectivités locales ou mêmes des administrations privées
telles que les différentes caisses de Sécurité Sociale. L’Etat est donc entendu dans son sens
générique et non dans le sens habituellement retenu par les Juristes.
Mon exposé se fera en trois temps. Tout d’abord, j’expliquerai la portée et la logique
de la théorie de la « main invisible » chère à Adam Smith. Les développements de l’Economie
mathématique dans les années 50 et 60 ont donné à ce résultat le statut de « premier théorème
de l’économie du bien-être ». Je donnerai l’intuition de ce théorème dont une lecture trop
rapide conduit à recommander le désengagement de l’Etat dans l’Economie.
Ma deuxième partie s’intéressera à la remise en cause de ce théorème. Le premier
théorème de l’économie du bien-être repose en effet sur des hypothèses qui sont rarement
vérifiées dans la réalité. C’est le point de départ de l’Economie Publique que d’expliciter ce
que doit faire l’Etat lorsque l’on ne se situe pas dans le cadre idyllique de la concurrence pure
et parfaite sans externalités ni monopole naturel ni préoccupation redistributive. Le
vocabulaire utilisé pour décrire ces situations est à cet égard très explicite puisque les
économistes ont pris l’habitude de décrire ces situations comme des défaillances de marché
(market failures).
Enfin, il me semble essentiel de rappeler que l’Etat ne peut pas tout. Comprendre à la
fois quelles sont les limites de l’intervention de l’Etat et les limites du marché me semble
alors essentiel pour espérer arriver à un compromis acceptable entre le laisser faire et
l’interventionnisme. C’est de plus en prenant explicitement en compte les limites à
l’intervention de l’Etat que l’on peut théoriser les contours des modalités d’une intervention
optimale de l’Etat.
I ) Les avantages du marché.
Pour Edmond Malinvaud, la science économique est 2
« La science qui étudie comment des ressources rares sont employées pour la
satisfaction des besoins des hommes vivant en société ; elle s’intéresse d’une
part aux opérations essentielles que sont la production, la distribution et la
consommation des biens, d’autre part aux institutions et aux activités ayant
pour objet de faciliter ces opérations. ».
2 Edmond Malinvaud, Leçons de théories économiques, Dunod, 1969.

3
A la lumière de cette citation, nous nous rendons compte que l’économie normative se
doit de résoudre des questions incroyablement difficiles. Il faudrait en effet déterminer qui
doit produire quoi et en quelle quantité et qui doit consommer quoi et en quelle quantité.
Lorsque l’on considère à la fois le nombre d’individus et le nombre de biens (et services)
différents qui composent une économie, on se rend compte de toute la complexité et de toute
la difficulté du problème d’allocation optimal des ressources.
Que doit donc faire l’Etat pour s’assurer que le fonctionnement de l’économie
aboutisse à une situation optimale ? Une première réponse a été proposée par Adam Smith.
Elle a le mérite de la simplicité. Il ne faut rien faire du tout, ou plutôt, il faut « laisser faire »
l’économie de marché. C’est la fameuse théorie de la main invisible selon laquelle, le marché
permet de coordonner de façon idéale les actions égoïstes des agents économiques, bien que
ces derniers ne recherchent que leurs intérêts personnels.
Adam Smith a davantage postuler cette prééminence du laisser faire qu’il n’en a
démontré la validité. Ce sont les développements de la théorie de l’équilibre général qui ont
permis d’avancer dans la formalisation de cette question. Les travaux du français Léon Walras
dans les années 1870 puis du Prix Nobel américain Kenneth Arrow et du prix Nobel français
Gérard Debreu dans les années 1950 ont contribué à donner des conditions nécessaires à la
validité de ce résultat. L’exercice de la formalisation mathématique a été poussé si loin que
les économistes parlent aujourd’hui du « premier théorème de l’Economie du Bien-être » pour
dénommer ce résultat.
Que dit ce théorème ? Que le bon fonctionnement d’une économie parfaitement
concurrentielle aboutit à une allocation des ressources telles que l’on ne peut augmenter le
bien-être d’un individu sans que cela ne se fasse au détriment d’au moins un autre. En
simplifiant quelque peu cet énoncé, cela revient à dire que l’économie de marché permet de
rendre maximale la taille du gâteau que constituent les biens et services produits dans
l’Economie et que les agents doivent se partager. A ce titre ce théorème constitue une
formalisation de la théorie de la main invisible. Le mieux que l’Etat puisse faire, du moins s’il
ne cherche qu’à rendre maximal la « taille du gâteau » que se partagent les agents
économiques sans se préoccuper de la répartition de ce gâteau, c’est de laisser faire
l’économie de marché.
Quelle est l’intuition de ce résultat ? Je vais être un peu technique à cet endroit. Cela
me permettra de mieux discuter par la suite des limites de ce théorème. Pour bien comprendre
les choses, caricaturons l’économie en la résumant à un seul bien de production et à la
détention de monnaie. Il y a d’un côté des entrepreneurs qui produisent ce bien pour obtenir
de la monnaie moyennant un coût de production. Les entrepreneurs agissent de manière à
rendre maximal leur profit, c'est-à-dire la monnaie acquise par la vente des biens produits
moins le coût de production. Il y a d’un autre côté des consommateurs qui retirent une
certaine satisfaction de la consommation de ce bien moyennant le fait de devoir se priver de
monnaie. Les consommateurs agissent de manière à maximiser leur surplus, c'est-à-dire la
différence entre la satisfaction apportée par la consommation des biens moins le montant de
monnaie dépensée.
Comment se comportent ces entrepreneurs et ces consommateurs dans un univers
parfaitement concurrentiel ? La théorie marginaliste Walrassienne nous dit que le
comportement des producteurs dépend de la comparaison entre ce que leur coûte la
production d’une unité supplémentaire de bien et ce que leur rapporte cette production
supplémentaire. Le premier de ces termes correspond au coût marginal de production. L’une
des hypothèses du théorème est que ce coût marginal est d’autant plus élevé que la production

4
est elle-même élevée. Le deuxième de ces termes correspond au nombre d’unité de monnaie
obtenu par la vente d’une unité de bien, c'est-à-dire au prix du bien.
Une fois définis ces termes, le raisonnement marginaliste décrit que les producteurs
vont produire la quantité de biens qui va égaliser le prix au coût marginal de production.
Pourquoi ? Parce que si les producteurs produisaient moins, le prix serait supérieur au coût
marginal et ils gagneraient à accroître leur production. Si au contraire le prix était inférieur au
coût marginal de production, les entrepreneurs gagneraient à réduire leur production.
Qu’en est-il maintenant des consommateurs ? Le raisonnement est alors parfaitement
symétrique. La quantité de biens qu’ils consomment égalise leur satisfaction marginale au
prix du bien. Autrement dit le bon fonctionnement d’une économie de marché aboutit à une
situation où la satisfaction marginale de chaque consommateur est égale au coût marginal de
chaque entreprise, toutes ces grandeurs étant rendues égales au prix par les comportements
individuels de chaque agent.
Est-ce une situation optimale au sens de la maximisation des ressources à se partager ?
La réponse est oui. En effet, ce qui compte en terme de bien-être agrégé, c’est de maximiser la
satisfaction totale que chaque consommateur retire de la consommation du bien moins le total
des coûts de production subit par chaque producteur. Or pour maximiser cette quantité il faut
et il suffit que les satisfactions marginales soient égales entre elles, que les coûts marginaux
soient égaux entre eux, et que les deux coïncident. Or, dans une économie concurrentielle,
toutes ces grandeurs sont égales aux prix.
Aussi, le marché et la concurrence garantissent une allocation optimale des ressources.
Il faut toutefois bien comprendre les raisons de ce résultat. L’argument en jeu n’est pas celui
que l’on entend souvent selon lequel la concurrence serait souhaitable parce qu’elle
favoriserait une émulation « saine » entre les entreprises ce qui les stimuleraient. Le bon
argument est tout autre. Pour garantir une bonne allocation des ressources, il faut qu’existe un
mécanisme qui incite les consommateurs à révéler l’intensité de leur satisfaction et qui incite
les entreprises à révéler la structure de leurs coûts. Or laisser faire l’économie de marché
permettrait d’obtenir un système de prix qui fournirait à chaque consommateur et à chaque
entreprise les bonnes incitations pour fournir les bonnes informations concernant la rentabilité
de différentes actions économiques des différents acteurs de l’économie. Si en plus de son
effet informationnel, la concurrence avait un effet émulateur, alors cet effet conduirait à trop
d’effort productif par rapport à ce qui serait socialement souhaitable.
II ) Les limites du marché: pourquoi l’Economie a-t-elle besoin de la régulation de l’Etat ?
Il faut toutefois garder à l’esprit que le premier théorème de l’Economie du Bien-être
repose sur des hypothèses précises qui sont souvent irréalistes. Que se passe-t-il lorsque ces
hypothèses ne sont pas satisfaites ? En général, laisser faire les marchés n’aboutit plus à une
allocation optimale des ressources. On se retrouve alors dans ce que les économistes appellent
les défaillances de marchés (market failures) qui requièrent la mise en place d’une régulation
adéquate de l’économie.
Je parlerai d’abord du problème d’externalité (II.1), puis des problèmes liés à
l’existence des biens collectifs (II.2). J’évoquerai ensuite les problèmes soulevés par
l’imperfection de la concurrence (II.3). Je parlerai alors des monopoles naturels, et plus

5
généralement des problèmes posés par l’existence d’économie d’échelle (II.4). Enfin,
j’évoquerai les difficultés posées par l’économie de la redistribution (II.5).
1) Les externalités.
Le premier échec de marché réside dans l’existence d’externalité. La définition de
cette notion est assez technique. Pour le Français Pierre Picard, les externalités désigne
des « situations où des décisions de consommation ou de production d’un agent affectent
directement la satisfaction ou le profit d’un autre agent, sans que le marché évalue et fasse
payer ou rétribue l’agent pour cette action ».3
Les exemples d’externalités sont nombreux. Prenons le cas de la consommation de
cigarettes. On s’attend à ce que les fumeurs retirent une certaine satisfaction de la
consommation de leurs cigarettes. Mais qu’en est-il de leurs voisins, collègues à qui ils font
subir du tabagisme passif ? On voit bien à travers cet exemple qu’il y a alors une externalité
négative puisque la consommation de cigarette par un fumeur détériore le bien-être de ses
voisins non fumeurs sans que ce dernier effet ne rentre a priori en ligne du compte dans la
décision du fumeur de fumer une cigarette. Un autre exemple important tient aux processus de
recherche et développement4 « Lorsqu’une entreprise met au point un nouveau procédé de
fabrication, d’autres entreprises sont également susceptibles de bénéficier de ce progrès
technique, même si elles le font avec un décalage dans le temps. L’avantage apporté par
l’innovation à l’ensemble de l’Economie sera alors bien supérieur » aux gains enregistrés par
l’innovateur. Il y a alors une externalité positive.
Pourquoi la présence d’externalités remet-elle en cause la désirabilité du laissez faire ?
Parce que d’après la théorie économique, le laisser faire va aboutir à ce que les gains
marginaux privés soient égaux aux coûts marginaux privés par l’intermédiaire du système des
prix. Au contraire, l’optimum social requiert l’égalité des marges sociales. Dans le premier
exemple, le fumeur va consommer une quantité de cigarette telle que sa satisfaction marginale
personnelle à consommer une cigarette supplémentaire soit égale au prix de la cigarette. Or
l’optimum social demande l’égalité du prix avec la satisfaction marginale du fumeur moins le
désagrément marginale de ses voisins. C’est cette différence en terme de valorisation des
activités économiques qui explique la sous optimalité du laisser faire.
Dans le deuxième exemple, le bien produit est un bien immatériel concernant le savoir
et le progrès technique. Lorsqu’une entreprise doit décider du montant de ses investissements
en recherche et développement, elle ne tient compte que des gains que la recherche peut lui
fournir à elle, négligeant les gains pour les autres entreprises. Une économie de laisser faire
serait alors caractérisée par une trop faible valorisation de la recherche et développement, et
donc par trop peu d’investissements en recherche et développement.
Comment alors réguler l’économie en présence d’externalités ? On peut distinguer
trois types d’instruments : les instruments réglementaires, la fiscalité et la redéfinition des
droits de propriété. Chacun de ses instruments présente ses avantages et ses inconvénients.
3 Picard, Pierre, 1987, Eléments de Microéconomie, Edition Montchrestien.
4 Cet exemple est tiré littéralement de Picard, Pierre, 1987, Eléments de Microéconomie, Edition Montchrestien.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%