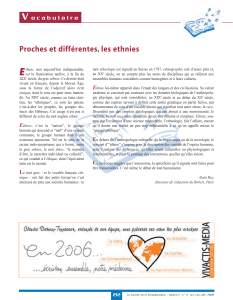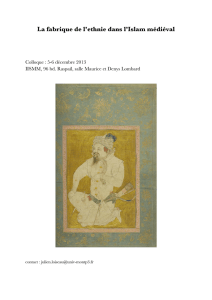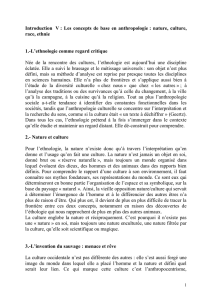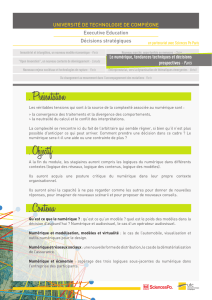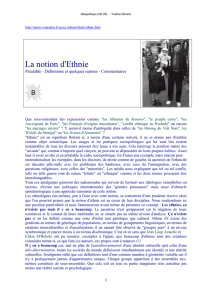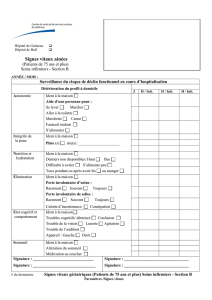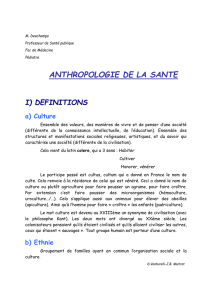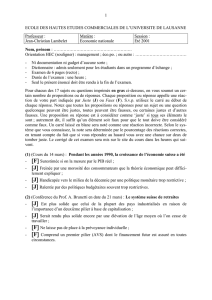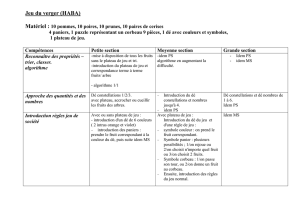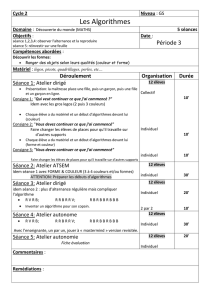L`ethnie : les vicissitudes d`un concept

L'ethnie : les vicissitudes d'un concept
Author(s): LUC DE HEUSCH
Source:
European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie / Europäisches
Archiv für Soziologie
, Vol. 38, No. 2, Interdits comparés (1997), pp. 185-206
Published by: Cambridge University Press
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23997497
Accessed: 27-11-2016 18:20 UTC
REFERENCES
Linked references are available on JSTOR for this article:
http://www.jstor.org/stable/23997497?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents
You may need to log in to JSTOR to access the linked references.
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted
digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about
JSTOR, please contact [email protected].
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
http://about.jstor.org/terms
Cambridge University Press
is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to
European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie / Europäisches
Archiv für Soziologie
This content downloaded from 193.54.110.56 on Sun, 27 Nov 2016 18:20:58 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

LUC DE HEUSCH
L!ethnie : les vicissitudes d'un concept
Le mot e t h n i e a un passé équivoque dans la langue française.
Vacher de Lapouge est le premier à l'utiliser en 1896 pour désigner de
prétendues « races » distinctes, notion dont la biologie des populations a
fait justice. Le terme ne s'appliquait pas seulement aux « primitifs » ; il
contribua à hérisser des barrières entre les « races » dites inférieures et les
« races » dites supérieures. En 1935, G. Montandon, qui se fera l'apôtre
d'une certaine conception nazie de l'homme, consacre un livre à « l'eth
nie française ». Les administrateurs coloniaux utiliseront, quant à eux, le
terme ethnie comme substitut de « tribu » ou « peuplade » avec souvent la
conviction, fallacieuse, que des caractères anatomiques particuliers
entrent dans les particularités du groupe ainsi qualifié. Mais Franz Boas,
le fondateur de l'anthropologie culturelle aux États-Unis, réagit avec
vigueur. Il déclare fermement dès 1932 : « Les résultats des matériaux
extensifs amassés au cours des cinquante dernières années ne justifient
pas l'hypothèse d'une quelconque relation entre types biologiques et
forme de culture » (Boas, 1932, cité par Condominas, 1980, p. 89). Cette
conviction sera largement partagée par la majorité des ethnologues, sauf
en Allemagne. Dérivé du grec ethnos (peuple) le terme ethnie entre dans
le vocabulaire scientifique avec une connotation exclusivement cultu
relle. Mais ce concept se voit attaqué depuis une dizaine d'années sur le
terrain même de l'ethnologie où il s'est développé. Quelques chercheurs
français s'ingénient à démontrer que leurs prédécesseurs, travaillant
principalement en Afrique, ont eu le tort de donner consistance à de
fausses entités. L'ethnie X ou Y ne désignerait qu'une fiction adminis
trative : le découpage, arbitrairement statique, inventé par l'Adminis
tration coloniale pour des raisons strictement politiques ; le contrôle de
populations en perpétuel devenir.
Le ton de la polémique est souvent inutilement agressif et les pièces
du procès méritent d'être réexaminées. En 1985 Jean-Loup Amselle et
Elikia M'Bokolo jettent l'anathème sur « le silence éloquent et compro
mettant » qu'une longue tradition africaniste entretient autour de la
notion d'« ethnie » (p. 7), comme si la science (fausse ou dépassée) des
ethnies était de mèche avec le colonialisme. Surgie à l'époque coloniale,
185
Luc De Heusch, Université libre de Bruxelles (Bruxelles).
Arch.europ.sociol. XXXVIII, 2(1997), 185-206—0003-9756/97/0000-680 807.50 per art + $0. ioper page© 1997 A. E.S.
This content downloaded from 193.54.110.56 on Sun, 27 Nov 2016 18:20:58 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

L. DE HEUSCH
l'ethnie aurait servi à « classer à part » les peuples colonisés « en leur
ôtant ce par quoi elles pouvaient participer d'une commune humanité »
(Amstelle, 1985, p. 14). La faute majeure des générations précédentes
serait d'avoir évacué l'histoire. La définition de l'ethnie deviendrait donc
l'interrogation épistémologique fondamentale de toute étude monogra
phique » {idem, p. 11). Quatre ans plus tard, J.-P. Chrétien et G. Prunier
reprennent le même thème. Ils intitulent l'ouvrage collectif dont ils sont
les éditeurs Les ethnies ont une histoire (1989). Chrétien recommande de
suivre dans leur dynamisme historique « ces communautés, susceptibles
de s'agrandir, de se défaire et de se transformer » (p. 9).
Effectivement, les ethnologues, longtemps persuadés que le passé des
sociétés sans écriture leur était inaccessible, ont trop souvent négligé de
prendre en compte la dimension diachronique des sociétés qu'ils étu
diaient du seul point de vue synchronique. Rebaptisée anthropologie
sociale sous l'influence anglo-saxonne, l'ethnologie s'était efforcée, non
sans succès, de définir au sein d'« ethnies » aux contours rarement pré
cisés des systèmes socio-culturels relativement stables. Pour compren
dre ce choix il importe de se souvenir que les ethnologues, qui se mirent à
travailler sérieusement sur le terrain dans cet état d'esprit après la Pre
mière Guerre mondiale à la suite de Malinowski, rompaient fort heu
reusement avec leurs prédécesseurs. Ceux-ci leur suggéraient soit
d'adopter la perspective évolutionniste (alors dominante dans la nais
sante anthropologie sociale en Angleterre), soit de travailler à la recons
titution conjecturale d'une vaste histoire planétaire des sociétés dites
primitives, imaginée de toutes pièces par des savants allemands ou
autrichiens. On ne dira jamais assez combien le souci nouveau de Mali
nowski d'étudier en profondeur, grâce à une longue intimité, le fonc
tionnement actuel des institutions d'une petite communauté mélané
sienne, fut salutaire du point de vue méthodologique. Sans doute
peut-on faire aujourd'hui à cette école fonctionnaliste le reproche de
n'avoir envisagé comme seul changement social que celui dont ils étaient
les témoins : les bouleversements suscités par les contacts avec la colo
nisation. La constitution d'une ethnohistoire dans les cours des années
soixante — une histoire du passé des sociétés sans écriture (et donc sans
archives écrites) — marqua, à cet égard, une étape importante de l'évo
lution de la discipline. Mais faut-il s'acharner à dissoudre l'anthropolo
gie dans l'histoire, comme certains le proposent ? L'histoire a bénéficié,
en France, des acquis de l'anthropologie, précisément parce que celle-ci
privilégiait la synchronie, le temps long, les systèmes de pensée impli
cites ou explicites, inséparables de l'économique, du politique, du reli
gieux. Les champs de recherches de l'histoire et de l'anthropologie
186
This content downloaded from 193.54.110.56 on Sun, 27 Nov 2016 18:20:58 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

L ETHNIE
sont complémentaires et Lévi-Strauss a pu dire que la première étudiait
les sociétés autres dans le temps, la seconde les sociétés autres dans
l'espace. On ne peut que se réjouir de voir des historiens professionnels
se joindre aujourd'hui aux anthropologues sur des terrains exotiques en
utilisant les mêmes méthodes qu'eux. Inversement, on ne peut que se
féliciter de voir l'anthropologue Michel Izard, se passionner pour la
formation historique d'un royaume africain — celui du Yatenga au
Burkina Faso — pour mieux en saisir le fonctionnement et l'idéologie.
Réconcilier l'histoire et l'anthropologie, telle est bien, me semble-t-il, la
seule façon d'empêcher celle-ci de dépérir et celle-là de sombrer dans
l'historicisme, comme le fait trop souvent l'ethnohistoire. Écoutons une
historienne de l'Antiquité, Nicole Loraux : « ...si l'anthropologue pâtit
d'éviter l'événement, il n'est pas d'événement que l'historien puisse
traiter en lui-même, sans l'ouvrir sur la temporalité latente des réseaux
de signification qui lui donnent son sens » (Loraux, 1996).
Mais, ignorant ces considérations, Catherine Coquery-Vidrovitch
vient de dénoncer en termes virulents, au nom d'une certaine vision
« historique » des sociétés humaines « l'impasse anthropologique ». Elle
félicite une nouvelle génération de chercheurs d'avoir renoncé à
« l'intelligence conceptuelle des systèmes sociaux » (Coquery
Vidrovitch, 1996). Ce n'est là, souhaitons-le, qu'une situation provisoire,
qui traduit peut-être davantage les hésitations d'un certain nombre
de projets actuels qualifiés un peu hâtivement d'anthropologiques. Il
faut évoquer ici l'abandon généralisé des terrains lointains au profit
d'une micro-ethnographie des villes, villages ou régions de la civilisation
occidentale, conduite, non sans hésitation, sur le terrain traditionnelle
ment dévolu aux sociologues, eux-mêmes fort désorientés, oscillant
entre Dürkheim, Marx et Weber. Catherine Coquery-Vidrovitch a beau
jeu dès lors de proclamer la fin de l'anthropologie puisque bien des
chercheurs français, à la recherche d'un terrain à la fois quelconque et
original ne savent plus très bien ce qu'ils vont faire de la discipline que
Marcel Mauss leur a léguée. Mais lorsque ces recherches nouvelles sont
menées dans un village de Bourgogne avec la rigueur de l'anthropologie
classique par Yvonne Verdier, Françoise Zonabend, Tina Jolas et
Marie-Claire Pingaud, elles débouchent sur des œuvres majeures qui
s'inscrivent dans la lignée des grandes monographies africanistes.
Ce détour polémique ne nous a pas éloignés autant qu'il peut le
paraître du problème de l'ethnie. Car, au moment même où les mass
media font un usage abondant — et excessif — du terme à propos de nos
propres sociétés européennes, voilà l'ethnie présentée par des spécialis
tes comme le faux objet d'une fausse science. Catherine Coquery
187
This content downloaded from 193.54.110.56 on Sun, 27 Nov 2016 18:20:58 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

L. DE HEUSCH
Vidrovitch en réclame impérativement la dissolution, tout en recon
naissant qu'elle a contribué malgré tout à « rendre à ces peuples
marginalisés et ignorés leur dignité » {idem, p. 119). Il faudrait tout de
même s'entendre : l'anthropologie fut-elle ou non une science coloniale ?
La critique moderne du concept d'ethnie a commencé en Norvège
lorsqu'une poignée d'ethnologues Scandinaves publient en 1969 un
ouvrage qui fera grand bruit : Ethnie Groups and Boundaries. The Social
Organization of Culture Difference. Frederik Barth, éditeur du livre et
organisateur du colloque qui l'avait précédé en 1967 à l'université de
Bergen, s'en prend à la conception courante selon laquelle il existerait
« des groupes discrets de peuples, c'est-à-dire des unités ethniques, cor
respondant à chaque culture » (Barth, 1969, p. 9). La langue anglaise
désignait du terme ethnies, tombé en désuétude, « les paiens, les idolâtres,
les gentils » à la fin du XIXe siècle (Fleming et Tibbings, 1875). La tra
dition anglo-saxonne moderne utilise le vocable ethnie uniquement sous
sa forme adjective : ethnie group a soudain remplacé l'ancien tribe, dont la
connotation primitiviste était périmée.
Barth ne met pas en cause les distinctions ethniques {ethnie distinc
tions) en tant que telles. Il estime même qu'elles sont souvent « le fon
dement sur lequel de vastes systèmes sociaux sont bâtis » {idem, p. 10).
Mais il propose une définition subjective : « ethnie groups are categories
of ascription and identification by the actors themselves » (les groupes
ethniques sont des catégories d'attribution et d'identification effectués
par les acteurs eux-mêmes). Seuls doivent être considérés comme
signaux (signais) ou emblèmes (emblems) de la différence ethnique les
traits culturels que les intéressés retiennent comme significatifs. Ces
signes sont soit visibles (tels le costume, le langage, le type d'habitation,
etc.), soit invisibles (il s'agit alors de valeurs). Pas question donc de se
substituer à la conscience individuelle en dressant une liste prétendu
ment objective des traits caractéristiques d'un groupe dépourvu, en fait,
de substance culturelle. L'ethnie ne serait qu'une forme particulière
d'organisation sociale au sein de la société globale.
Barth constate que les frontières entre les groupes ethniques, fonde
ments d'un certain ordre social, subsistent malgré le flot continuel de
personnes qui les traversent. Il attire l'attention sur le fait que ces
groupes, porteurs d'une certaine identité culturelle, sont dans un état
d'interdépendance et ne se maintiennent que par les frontières mêmes
qui les séparent.
Le travail de F. Barth a été salué comme « un apport novateur et
fondamental à l'étude de l'ethnicité » (Martinello, 1995, p. 48). On se
This content downloaded from 193.54.110.56 on Sun, 27 Nov 2016 18:20:58 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%