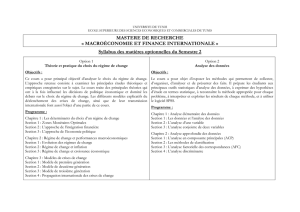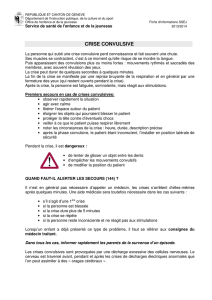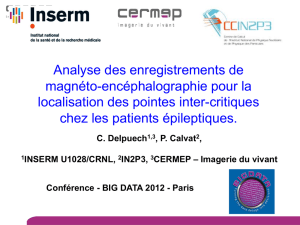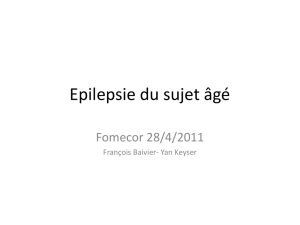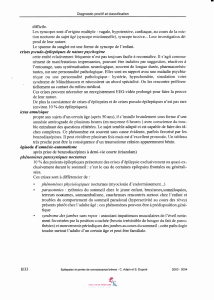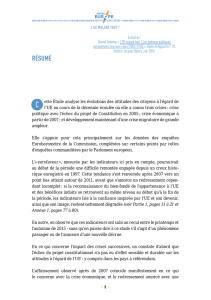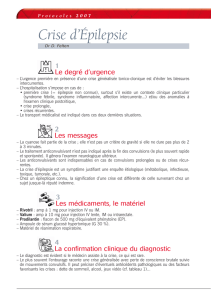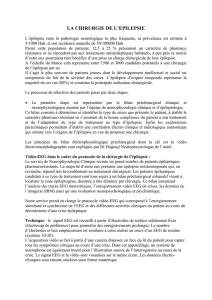Prise en charge des encéphalopathies épileptiques de l`enfance

244 | La Lettre du Neurologue • Vol. XII - n° 8 - octobre 2008
MISE AU POINT
Prise en charge
des encéphalopathies
épileptiques de l’enfance
passées à l’âge adulte
Late management at adulthood of early-onset in infant,
child or teenager epileptic encephalopathies
C. Remy*
* Service de neurologie, hôpitaux
Drome Nord, Romans-sur-Isère, et
centre médical de la Teppe, Tain-
l’Hermitage.
L
es encéphalopathies épileptiques (EE) commen-
çant dans l’enfance ou à l’adolescence ont une
place à part parmi les épilepsies en raison de
leur rareté et de leur gravité. Elles entraînent des
handicaps multiples, physiques et surtout psychi-
ques, liés aux conséquences cérébrales et parfois
systémiques de l’épilepsie elle-même, habituel-
lement pharmacorésistante et non chirurgicale,
mais aussi de l’affection sous-jacente à l’origine de
l’épilepsie. À l’âge adulte, l’encéphalopathie initiale
peut avoir disparu mais laisser des séquelles parfois
elles-mêmes évolutives. Le caractère plurifonctionnel
du handicap qui en résulte nécessite une prise en
charge pluridisciplinaire justifiant le recours à des
consultations très spécialisées qui, dans certains
cas, ne peuvent se trouver que dans des structures
d’accueil spécifiques.
Principales caractéristiques
communes
Les EE sont la traduction d’épilepsies multifocales ou
généralisées lésionnelles (symptomatiques ou cryp-
togéniques selon la terminologie actuelle). La distinc-
tion entre ces deux entités est théorique. La liste
des encéphalopathies susceptibles de commencer
ou de persister à l’âge adulte est résumée dans le
tableau (1). Pour certaines d’entre elles, débutant
précocement et décrites depuis peu de temps, nous
ne disposons pas encore d'informations sur l’évolu-
tion tardive. Il n’y a pas de données épidémiologiques
spécifiques aux EE, mais on peut se référer à celles
relatives aux épilepsies partielles réfractaires, dont
le profil épileptologique semble proche.
Les crises
Les crises sont invalidantes de par leur type, leur
intensité et leur fréquence. Il existe souvent plusieurs
types de crises, convulsives ou non. Elles peuvent
être intenses, responsables de chutes brutales
traumatisantes. Elles sont souvent fréquentes,
pluri-hebdomadaires ou pluriquotidiennes, parfois
même incalculables, à tel point qu’il est difficile de
différencier l’état intercritique de l’état critique.
Elles peuvent s’enchaîner de manière subintrante,
en “série” (en général 4 à 5 crises immédiatement
successives), ou progresser vers un état de mal
épileptique. La fréquence des états de mal épilep-
tique est importante ; ils prennent la forme d’états de
mal généralisés convulsifs, mais aussi (et surtout ?)
d’états de mal non convulsivants, d’allure confu-
sionnelle, limités à un ralentissement idéomoteur,
une aggravation de la marche avec des chutes plus
fréquentes ou, indirectement, une aggravation du
comportement ou de l’état général (hypersialorrhée
et troubles de la déglutition avec encombrement
bronchique, par exemple). Ils peuvent survenir de
manière apparemment inopinée ou être déclenchés
par des causes multiples : modification du traitement

La Lettre du Neurologue • Vol. XII - n° 8 - octobre 2008 | 245
Points forts
Les encéphalopathies épileptiques commençant dans l’enfance ou à l’adolescence sont des affections rares qui se »
différencient des autres formes d’épilepsie par leur gravité. Leur caractère évolutif est à l’origine de handicaps multiples,
physiques et surtout psychiques.
À l’âge adulte, les séquelles persistent et sont parfois évolutives. »
Le caractère plurifonctionnel du handicap qui en résulte nécessite une prise en charge pluridisciplinaire justifiant le »
recours à des consultations très spécialisées et qui, dans certains cas, ne peuvent se trouver que dans des structures
d’accueil spécifiques.
Il faut retenir le principe que toute pathologie intercurrente, quelle qu’elle soit, fonctionnelle et/ou organique, peut »
déstabiliser un équilibre toujours fragile chez ces patients.
Le traitement doit toujours être modifié avec une grande prudence. »
Dans certaines situations très spécifiques seulement, un traitement intermittent par benzodiazépines est possible
»
pour prévenir ou bloquer les crises.
À côté de l’imagerie et de la biologie, la vidéo-EEG est indispensable pour interpréter certaines modifications
»
comportementales.
Il ne faut pas "s’endormir" sur le caractère chronique et a priori inéluctable de l’affection ni relâcher la surveillance »
de ces patients, mais il ne faut pas non plus s’alarmer de manière inappropriée, ni prévoir des examens systématiques
non justifiés. Cette attitude intermédiaire est difficile à acquérir.
Mots-clés
Encéphalopathie
épileptique
Vidéo-EEG
Complications
psychiques
Prise en charge
pluridisciplinaire
Highlights
The early-onset epileptic
encephalopathies are rare
deseases which differ from
the other types of epilepsies
due to their severity. They
involve multiple physical but
above all psychic disabilities.
At adulthood, sequels persist
and are sometimes evolutive.
The multiple features of the
resulting handicap need a
pluridisciplinary management
only possible in some centres
specialized in epilepsy. It is
essential to remember that all
kinds of organic and/or func-
tional intercurrent pathologies
can disturb a still unstable situ-
ation in such patients. The treat-
ment must always be changed
with great caution. An inter-
mittent treatment by benzo-
diazepine can be proposed
to prevent or to stop seizures,
but only in some very specific
situations. Imaging and labo-
ratory investigations, but first
of all a video-EEG recording
must be required to diagnose
some behavioural changes. In
spite of the chronic and appar-
ently inescapable nature of the
disease, a negligent attitude is
prohibited, but useless agres-
sive investigations are too. Such
a "middle attitude" is difficult
to obtain.
Tableau. Liste et caractéristiques principales des EE (1).
Maladie ou syndrome Âge de début Particularités Fréquence
Encéphalopathies épileptiques
– Ohtahara
– Encéphalopathie myoclonique
néonatale
Premières
semaines
Spasmes
Suppression burst
à l’EEG
Quelques centaines
– Crises partielles migrantes Nourrisson Crises subcontinues à foyer variable Quelques dizaines
– West Nourrisson Lésions cérébrales identifiables ou non,
importance de la précocité du traitement
1/5 000 naissances
– Dravet : épilepsie myoclonique
sévère du nourrisson
Nourrisson États de mal, déterminisme génétique 1/20 000
– Pointes-ondes continues (POCS)
– Landau-Kleffner
4-15 ans Activité épileptique subcontinue
Aphasie progressive (Landau-Kleffner)
1/10 000
Quelques dizaines
– Lennox-Gastaut 4-8 ans Crises toniques nocturnes, chutes, troubles
psychiques
< 1/10 000
Épilepsie myoclono-astatique 2-5 ans Chutes 1/5 000
Chromosome 20 en anneau 6 mois
à l’adolescence
Crises prolongées, états confusionnels ± 50 cas en France
Angelman 2 premières
années de vie
Dysmorphie
Génétique
1/10 000
Encéphalopathies progressives à expression épileptique
Épilepsie myocloniques
progressives
2 ans
à l’âge adulte
< 1/20 000
Unverricht-Lundborg 6 ans
à l’âge adulte
Gène de la cystatine B,
hétérogénéité génétique
Lafora 6 à 19 ans Fatal < 10 ans d’évolution
Génétique
MERRF 3 à 65 ans Surdité, myopathie, mutations de l’ADN
mitochondrial
Céroïde-lipofuscinose 3 mois
à l’âge adulte
Atteinte visuelle chez l’enfant
Démence chez l’adulte
X gènes identifiés
Sialidoses
Gaucher
Neuroserpine
Autres
Rasmussen 2 à 15 ans Crises motrices continues,
hémiplégie progressive, lésions inflammatoires
Quelques centaines
Encéphalites limbiques
inflammatoires
non paranéoplasiques
Adulte Crises lobe temporal, troubles psychiques,
anomalies immunologiques
Quelques dizaines

246 | La Lettre du Neurologue • Vol. XII - n° 8 - octobre 2008
Prise en charge des encéphalopathies épileptiques
de l’enfance passées à l’âge adulte
MISE AU POINT
ou causes d’ordre général (affection intercurrente,
complication traumatique intracérébrale, trouble
métabolique, etc.). Ils peuvent être précédés par un
“syndrome de menace d’état de mal”, avec des crises
en série plus fréquentes et qui réagissent moins bien
au traitement habituel (2).
Électroencéphalogramme (EEG)
Les crises enregistrées par EEG sont souvent difficiles
à identifier : elles se limitent à une désynchronisa-
tion brutale du tracé, avec ou sans activité rapide
tonique de bas voltage, apparemment diffuse sur
le scalp et très souvent masquée par des artéfacts
musculaires. En l’absence de vidéo-EEG, ce type
de crise peut passer totalement inaperçu. C’est
particulièrement vrai au cours du sommeil. L’EEG
intercritique peut paraître normal, même dans
certaines formes sévères d’EE. La réalisation d’EEG
du sommeil est indispensable, même à l’âge adulte :
les anomalies peuvent n’apparaître qu’au cours du
sommeil, évoquant parfois de véritables états de
mal “électriques” durant toute la nuit, perturbant
le rythme nycthéméral et très probablement l’état
cognitif.
Difficultés thérapeutiques
La gravité des crises et leur pharmacorésistance habi-
tuelles expliquent l’importante polythérapie (jusqu’à
4 ou 5 médicaments au moins) dont les patients
sont souvent les “victimes”. Les conduites peuvent
parfois se révéler contradictoires : essai systématique
des nouvelles molécules (des difficultés méthodo-
logiques étant constatées dans certains protocoles
d’essais thérapeutiques) avec une accumulation des
premiers médicaments, ou, à l’inverse, abandon
des essais thérapeutiques sans remettre en cause
le maintien de traitements antérieurs, diversement
associés à des posologies variables (tout peut se voir,
des doses chroniquement toxiques aux doses a priori
infrathérapeutiques, avec maintien de traitements
qui théoriquement semblent pourtant inactifs et
potentiellement délétères sur l’état général et même
sur l’épilepsie…). Paradoxalement, il est souvent
très difficile de changer le traitement : toute modi-
fication, même mineure et théoriquement justi-
fiée, peut altérer un équilibre fragile, ce qui n’est
généralement pas compris et est mal accepté par
l’entourage du patient. Il apparaît néanmoins légi-
time de tenter de réduire prudemment le nombre de
molécules ou de limiter la posologie des traitements
à la dose minimale afin de permettre un équilibre
satisfaisant, surtout quand l’augmentation n’a pas
apporté d’amélioration clinique à terme. Avant toute
modification thérapeutique, il est cependant indis-
pensable d’obtenir la participation de l’entourage
(famille et milieu psycho-éducatif), parfois à l’issue
de longues discussions… Après avoir obtenu un équi-
libre relativement satisfaisant entre l’épilepsie et le
comportement, avec une qualité de vie définie par
l’entourage comme “plutôt bonne”, il faut savoir ne
rien changer malgré la persistance des crises.
Certains médicaments antiépileptiques (AE) peuvent
aggraver l’EE (3, 4) ; il s’agit généralement des
mêmes que pour l’épilepsie idiopathique. Les AE
réservés a priori uniquement à l’épilepsie focale
lésionnelle doivent être prescrits avec prudence.
Néanmoins, en pratique, tous les AE, mais égale-
ment les surdosages thérapeutiques, sont suscep-
tibles d’aggraver l’épilepsie et surtout l’état général
du patient. La prescription de benzodiazépines au
long cours est souvent utilisée – parfois même en
associant plusieurs molécules de cette famille –
compte tenu de leur efficacité initiale. Malgré
le risque de tolérance, les doses sont parfois
très importantes, finalement inefficaces, et elles
induisent de réelles difficultés pour le sevrage. En
revanche, le traitement intermittent par benzodia-
zépines (dans notre expérience : clobazam 20 mg,
1 à 2 fois par jour pendant 1 à 3 jours, 1 à 2 fois par
mois chez l’adulte de poids moyen) est utile pour
passer les périodes difficiles de recrudescence des
crises, ou même à titre préventif, pour éviter les
crises avant un événement important comme une
fête ou un voyage, par exemple (5). Les crises en
série, lorsqu’elles sont intenses ou prolongées (en
théorie dès la deuxième crise généralisée lorsqu’elles
sont immédiatement successives ou très rappro-
chées, ou dès 20 minutes de crises partielles subin-
trantes, c’est-à-dire environ dès la quatrième ou la
cinquième crise), justifient plutôt l’administration
de diazépam intrarectal (2 à 3 ampoules de 10 mg
pour un adulte de poids moyen), dont l’action est
plus rapide que celle de l’administration per os ou
en suppositoire (15 minutes environ au lieu d’une
heure au moins) [6]. En milieu institutionnel, le
personnel apprend à connaître les patients pour
lesquels l’injection peut attendre (crises en série peu
intenses et habituellement spontanément résolu-
tives en moins de 30 minutes) et ceux pour lesquels
la prescription doit être systématique, parfois dès la
première crise, en raison du risque d’état de mal. La
voie intramusculaire est à éviter (toxicité locale et

La Lettre du Neurologue • Vol. XII - n° 8 - octobre 2008 | 247
MISE AU POINT
absorption trop lente). La voie intraveineuse n’est
possible qu’en milieu hospitalier. Faute de produit
Lyoc®, il semble que l’administration sublinguale de
clonazépam en solution injectable (une ampoule)
soit efficace, mais cela n’est pas validé. Le syndrome
de menace nécessite le même protocole thérapeu-
tique que celui observé pour un état de mal.
Crises psychogènes
Elles ne sont pas rares (20 % des patients en insti-
tution) au cours de la maladie (parfois alors que
l’évolution semblait plutôt meilleure, mais parfois
aussi concomitamment à des crises épileptiques
inchangées). Seule l’observation vidéo-EEG permet
d’affirmer ce diagnostic. Leur prise en charge reste
décevante, sans protocole déterminé. Les patients
doivent bénéficier d’un soutien psychologique, dont
l’efficacité dépend du niveau psychique. La visua-
lisation par les patients des crises enregistrées en
vidéo peut se faire dans des conditions précises. Dans
notre expérience cependant, elle n’entraîne pas de
bons résultats, contrairement à ce qui a été publié
dans certains pays anglo-saxons.
Surveillance
des crises nocturnes
Plusieurs moyens existent, en particulier chez les
patients à risque présentant des crises nocturnes
intenses : détecteurs mécaniques (détecteurs de type
Epicare®, fondés sur la détection des vibrations du
matelas pendant les crises), détecteurs sonores (de
type baby phone), ou exceptionnellement détecteurs
vidéo dans certaines chambres dédiées. Dans tous
les cas, il est recommandé de dormir sans oreiller
ou bien avec un oreiller alvéolé et de ne pas dormir
sur le ventre. Cependant, jusqu’à présent, aucune
de ces méthodes n’a prouvé son efficacité.
Conséquences physiques
Elles sont constantes, dues à des mécanismes multi-
ples et liées en particulier aux crises et au traitement.
Les crises peuvent entraîner de multiples fractures
favorisées par l’ostéoporose que les AE et la sédenta-
rité accentuent (8). Des lésions intracérébrales sont
également observées, qui aggravent le pronostic
fonctionnel et vital, et qui peuvent modifier l’épi-
lepsie. Les chocs répétés entraînent des cals osseux
et cutanés qui, au niveau du visage et du crâne,
constituent un véritable casque protecteur, mais
au prix de déformations esthétiques progressives,
avec un aspect léonin caractéristique. Les compli-
cations esthétiques sont accentuées par certains AE
(phénobarbital et phénytoïne surtout). En pratique,
il est parfois nécessaire d’envisager le port préventif
d’un casque, qui présente cependant une efficacité
très relative.
L’espérance de vie est raccourcie, avec une évolution
progressivement péjorative vers un état grabataire.
À un stade évolué de la maladie, la prise en charge
s’apparente à des soins palliatifs. L’intervention de
rééducateurs ayant des compétences différentes
mais complémentaires (kinésithérapeute, ortho-
phoniste, psychomotricien et ergothérapeute) est
indispensable au long cours pour ralentir la progres-
sion des différents handicaps.
Le taux de mortalité est élevé (bien supérieur à la
mortalité observée chez les patients épileptiques
en général, qui est déjà le double de celle relevée
dans la population générale). Les raisons multiples
sont représentées en particulier par le traumatisme,
l’état de mal ou la mort subite (SUDEP [sudden
unexpected death in epilepsy]). Les EE conjuguent
tous les risques connus de SUDEP : début précoce
de l’épilepsie, persistance des crises avec pharma-
corésistance, sévérité des crises, handicap associé,
etc. Le risque de SUDEP est particulièrement élevé
en institution (8).
Conséquences psychiques
Elles sont constantes, se manifestant à des degrés
variables suivant le type d’EE, en particulier suivant
l’étiologie et l’âge de début de la maladie.
Les troubles du comportement ne demandent pas
de traitement spécifique, mais il est préférable de
privilégier les mesures d’encadrement psycho-social
plutôt que les médicaments sédatifs, qui risquent
d’aggraver la situation en réduisant la vigilance.
Néanmoins, il n’y a pas de contre-indications à
la prescription, si nécessaire, de médicaments
psychotropes, neuroleptiques et antidépresseurs
notamment.
Les troubles anxio-dépressifs sont mal connus et la
présence d’un trouble thymique est très probable-
ment sous-estimée. Les troubles anxieux (se mani-
festant par l’anxiété, mais aussi indirectement par la
peur, l’euphorie, l’irritabilité) sont particulièrement
marqués dans l’EE. L’adjonction d’un traitement
antidépresseur est possible, généralement sans

248 | La Lettre du Neurologue • Vol. XII - n° 8 - octobre 2008
Prise en charge des encéphalopathies épileptiques
de l’enfance passées à l’âge adulte
MISE AU POINT
aggravation de l’épilepsie (parfois même avec une
amélioration des crises ; des études sont en cours
pour étayer cette hypothèse).
La survenue d’une psychose n’est pas spécifique aux
EE, mais elle est fréquente. Elle concerne 19 % des
patients en institution, ces établissements comptant
un nombre important d’encéphalopathes. La séméio-
logie n’est pas différente de celle des autres types
de psychoses dans l’épilepsie. Les psychoses ictales
et perictales semblent les plus fréquentes dans l’EE.
Elles peuvent être l’expression clinique d’états de
mal non convulsivants, d’absences atypiques ou
toniques. Ces états de mal (états de mal toniques
surtout) peuvent durer plusieurs jours ou plusieurs
semaines. Seul l’enregistrement vidéo-EEG permet
leur diagnostic. Leur traitement est difficile, avec une
aggravation possible par les benzodiazépines. En l’ab-
sence de facteur favorisant (affection intercurrente)
ou de conséquences systémiques (crises généralisées
tonico-cloniques), l’abstention thérapeutique est
souvent justifiée, malgré le risque cognitif potentiel,
et à condition d’instaurer une surveillance attentive à
la fois de l’EEG clinique et des constantes biologiques
(pendant cette période, des troubles alimentaires
peuvent survenir, avec un risque de déshydratation
et de complications infectieuses).
Des complications psychiatriques dues aux AE sont
fréquentes : il faut constamment garder à l’esprit le rôle
possible du traitement, qui doit être suspecté devant
tout trouble psychiatrique survenant chez un épilep-
tique, quels que soient les symptômes (9). En contre-
partie, il est indispensable de tenir compte d’éventuels
troubles psychiques dans le choix des AE.
Conséquences sociales
La gravité de la maladie et la nécessité d’une prise en
charge pluridisciplinaire justifient des aides à domi-
cile ou le placement du patient en institution.
Les mesures de soutien social, inscrites dans la loi
du 11 février 2005, sont accessibles en détails sur
le site Internet www.handicap.gouv.fr
On peut trouver sur le site de la Ligue française
contre l’épilepsie (www.lfce-epilepsies.fr/) des
renseignements concernant les établissements
spécialisés qui accueillent ces patients.
Conclusion
En pratique, les patients atteints d’EE, même à l’âge
adulte, restent fragiles. Un rien peut les déstabiliser…
Il ne faut pas relâcher la surveillance, mais il ne faut
pas non plus s’alarmer de manière inappropriée, ni
prévoir des examens systématiques non justifiés.
Chaque chute et chaque recrudescence des crises
ne peut justifier un contrôle radiographique ou un
EEG, de même que le traitement ne peut pas être
modifié à chaque nouvelle période de crises. Mais il
est difficile d’atteindre le “juste milieu” : cette atti-
tude peut s’acquérir avec l’expérience, les différents
intervenants dans la prise en charge de la maladie
apprenant à bien connaître le patient pour mieux
reconnaître les symptômes qui chez lui doivent
inquiéter… C’est probablement au sein de struc-
tures très spécialisées qu’une telle attitude peut le
mieux s’exprimer. ■
1. Dulac O. Epileptic encephalopathy. Epilepsia 2001;42(Suppl. 3): 23-6.
2. Remy C, Favel P. Essai d’identification d’un syndrome de menace des états de mal épileptiques
chez les épileptiques chroniques en institution. Rev EEG Neurophysiol 1984;14:181-5.
3. Genton P, McMenamin J. Aggravation of seizures by antiepileptic drugs: what to do in
clinical practice? Epilepsia 1998;39(Suppl. 3):S26-S29.
4. Genton P. When antiepileptic drugs aggravate epilepsy. Brain Dev 2000;22(2):75-80.
5. Remy C. Clobazam in the treatment of epilepsy: a review of the literature. Epilepsia
1994;35(Suppl. 5):S88-S91.
6. Remy C, Jourdil N, Villemain D et al. Intra-rectal diazepam in epileptic adults. Epilepsia
1992;33(2):353-8.
7. Tourniaire D, Hélias M. Traumatologie en centre spécialisé pour l’épilepsie. Epilepsies
2003;15(2):83-9.
8. Tourniaire D, Remy C, Favel P. Épilepsie et décès en milieu institutionnel. Epilepsies
1996;8:325-8.
9. De Toffol B. Syndromes épileptiques et troubles psychotiques. Paris: John Libbey, 2001:
201 pages.
Références bibliographiques
1
/
5
100%