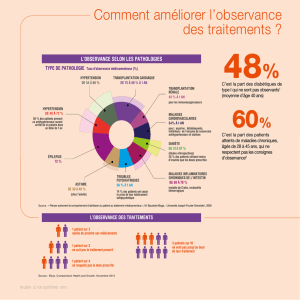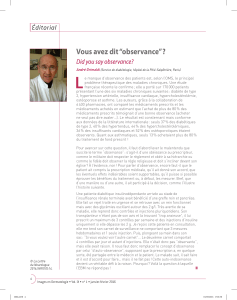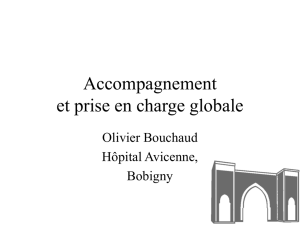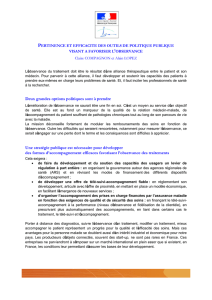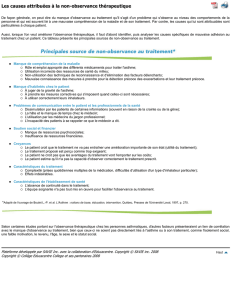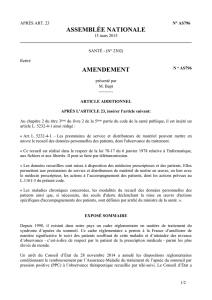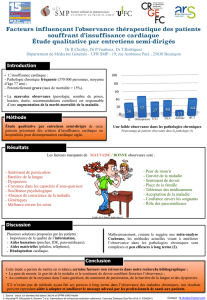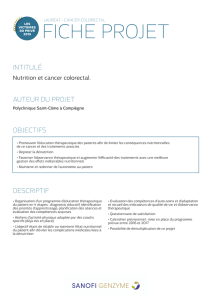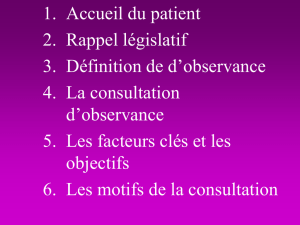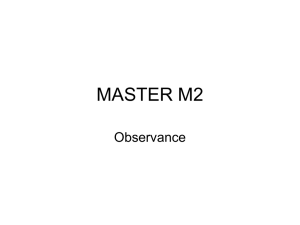L`observance au cours des traitements antirétroviraux de l`infection à

L’observance au cours
des traitements antirétroviraux
de l’infection à VIH
Dossier documentaire
Avril 2003
Marseille
: 18, rue Stanislas torrents 13006 Marseille – Tél. : 04 91 59 83 83 – Fax : 04 91 59 83 99
Nice : 6, rue de Suisse 06000 Nice – Tél. : 04 92 14 41 20 – Fax : 04 92 14 41 22
Code APE : 913 E – N° SIRET : 391 262 508 00032 – Association Loi 1901

1
SOMMAIRE
Introduction......................................................................................................... 02
Problématique..................................................................................................... 02
Enquêtes et études sur l’observance ............................................................... 03
AIDES .......................................................................................................... 03
APROCO...................................................................................................... 04
MANIF 2000................................................................................................. 05
IPPOTHES................................................................................................... 05
Les résultats et leurs limites ............................................................................. 06
La mesure de l’observance................................................................................ 06
Les difficultés de l’observance ......................................................................... 08
Les causes externes .................................................................................... 08
Les causes internes ..................................................................................... 08
Ebauche de solutions ........................................................................................ 09
Stratégies axées sur le patient : .................................................................. 09
Stratégies axées sur l'équipe soignante : .................................................... 10
Stratégies axées sur le schéma thérapeutique : ......................................... 10
L’observance dans les pays du sud ................................................................. 11
Conclusion.......................................................................................................... 12
Bibliographie....................................................................................................... 13

2
Introduction
Initialement désignée par les mots anglo-saxons de « compliance » qui signifie
soumission, puis « d’adhérence », l’observance ou adhésion à un traitement peut
être définie comme le suivi exact par un patient des modalités de prise d’un
traitement. Les chercheurs en sciences sociales en rejetant le mot de compliance et
en préférant adhérence (adhésion thérapeutique) ont voulu rompre avec le
stéréotype du mauvais patient qui ne veut pas ou ne peut se soumettre aux
prescriptions médicales. Ils ont voulu redonner leur place aux processus
d’interaction, aux attitudes et actions de patients dont la désobéissance est parfois
rationnelle et fondée sur des données pertinentes. C’est également la position des
praticiens français qui veulent jeter les bases d’une clinique de l’observance en
établissant un dispositif d’écoute et de repérage de la place que le sujet vient
occuper dans une relation thérapeutique.
L’observance se rapporte avant tout au respect des prescriptions, à l’application
dépouillée de toute dimension subjective des consignes du traitement. Avec la
compliance, l’accent se porte beaucoup plus sur le rapport intersubjectif, c’est à dire
qu’il s’agit presque de se plier aux exigences et aux consignes du médecin afin de lui
complaire. Avec le terme d’adhésion, on insiste sur la capacité du patient à adopter
une démarche active, à faire sien le traitement.
Les termes utilisés suscitent donc un premier débat et montrent une évolution
sensible des concepts de référence en témoignant d’un infléchissement sinon d’une
rupture dans les représentations sociales et médicales des processus en cause.
Problématique
Dans le cadre de l'infection à VIH, ces dernières années ont été marquées par des
progrès dans l'efficacité des thérapeutiques avec des traitements antirétroviraux
hautement actifs visant la suppression profonde et durable de la réplication virale.
Pour agir de façon optimale sur le plan virologique et clinique, un médicament anti-
VIH doit être absorbé au niveau digestif et correctement métabolisé de façon à
atteindre et maintenir des concentrations plasmatiques et intracellulaires de sa forme
active suffisantes pour inhiber le virus. Une défaillance de l’une de ces étapes peut
entraîner des concentrations sous-inhibitrices de médicament et donc permettre une
réplication virale persistante.
La poursuite de la réplication virale sous un traitement insuffisant provoque
invariablement une sélection de virus mutants résistants. Les traitements
antirétroviraux sont complexes et difficiles à prendre et on comprend alors tout
l’enjeu que représente l’observance dans cette pathologie devenue chronique. L’effet
thérapeutique peut donc être compromis lorsque le patient ne prend pas
régulièrement ses médicaments, ne respecte pas les doses prescrites, l’horaire de la
prise ou la nécessité de les absorber avant ou pendant les repas. L'horaire et
l'espacement des prises peuvent être particulièrement importants pour les inhibiteurs
de protéases dont la concentration intracellulaire est très liée à la concentration
plasmatique et qui ont une demi-vie plasmatique relativement courte. La non-

3
observance concerne aussi bien la réduction de fréquence des prises, la réduction
du nombre de médicaments pris, la mauvaise répartition des doses dans le temps
que la non-observation des directives d’administration. Les enquêtes révèlent que le
pourcentage d’observance des prescriptions pour toute maladie est en moyenne de
60 à 70 %.
La version 2002 du rapport Delfraissy consacre un chapitre entier à l’observance en
rappelant que 95 à 100% d’observance sont nécessaires pour garantir une efficacité
maximale des traitements au plan virologique. Il existe plusieurs définitions de
l’échappement thérapeutique : échappement virologique, soit parce que le virus
indétectable redevient détectable, soit par augmentation de la charge virale,
échappement clinique ou échappement immunologique. Face à l’échec
thérapeutique et aux abandons de traitement, il est recommandé aux équipes
médicales de mettre en place des programmes spécifiques d’écoute et d’aide aux
patients autour de l’observance. Compte tenu de la multiplicité des facteurs influant
sur l’observance et l’importance de ce facteur sur l’efficacité du traitement
antirétroviral, les prescriptions et recommandations de traitement devraient être
individualisées, en tenant compte des attentes des patients et de leur capacité à
gérer les modalités de prise d’un traitement.
Enquêtes et études sur l'observance
L’observance aux traitements antirétroviraux a tout d’abord été une préoccupation
réservée aux essais thérapeutiques dont les résultats pouvaient être influencés par
ce facteur. Lors de l’apparition des traitements antirétroviraux hautement actifs
(HAART) comprenant notamment les inhibiteurs de protéase, la prise en charge des
personnes infectées par le VIH a été considérablement bouleversée. C’est dans ce
contexte d’une réelle efficacité réduisant l’impact du VIH en terme de mortalité et de
morbidité que le problème de l’observance a pris toute son importance et suscité un
regain d’intérêt des chercheurs en sciences sociales.
L’observance est un phénomène multifactoriel et évolutif dans le temps. L’ensemble
des travaux réalisés sur cette question montre que l’observance est influencée par
des facteurs tenant à la maladie concernée et à son traitement mais aussi à
l’environnement social et à la vulnérabilité de la personne. Il existe des formes très
variées de non-observance allant de l’oubli occasionnel plus ou moins fréquent, à
l’arrêt momentané voire définitif d’un ou de plusieurs produits de la multithérapie
prescrite. De nombreux patients « adaptent » également les prescriptions en terme
de répartition des doses dans la journée et de modalités de prise, en fonction de leur
mode de vie mais aussi des effets indésirables des traitements.
AIDES
En 1997, AIDES a réalisé une enquête sur le vécu des personnes en traitement : sur
887 réponses analysées, 81 % des répondants se plaignaient d’au moins un effet
secondaire. Les personnes interrogées ont en moyenne coché trois effets
secondaires. Cela souligne l’accumulation des désagréments quotidiens dus au
traitement, facteur de rejet éventuel du traitement, qui doit être pris en charge pour
améliorer le confort et la qualité de vie des personnes et favoriser l’adhésion au
traitement. Il est intéressant de noter que la prise de médicaments du matin, bien

4
qu'elle soit très respectée, semble la plus difficile à vivre ou à accepter car elle
renvoie à la maladie et/ou à un sentiment de dépendance.
Dans cette enquête, une personne sur deux se plaignait de ne pas pouvoir arrêter,
ce qui s’accompagne d’un sentiment de dépendance, de perte d’autonomie et de
liberté. La compréhension du traitement est alors un facteur primordial pour avoir à
nouveau le sentiment de reprendre le contrôle de sa vie. Les autres difficultés citées
sont : les prises à intervalles réguliers, les effets secondaires, le nombre de gélules,
les prises à distance des repas, la difficulté d’intégrer le traitement dans la vie
quotidienne, le fait de devoir «se cacher» pour prendre les médicaments, le renvoi à
la maladie.
Cette enquête a été renouvelée fin 1998. Pour 89 % des personnes (1600 réponses
analysées), les traitements ont un effet positif sur leur vie et 77 % affichent une forte
motivation pour les continuer. 58 % déclarent n’avoir jamais arrêté leur traitement et
parmi celles qui l’ont interrompu au moins une fois, les causes avancées sont
principalement la lassitude et les effets secondaires. Les personnes déclarent
respecter globalement, avec méthode, les horaires et le nombre de prises. Elles
s’estiment également bien informées sur leur traitement et la façon de le prendre.
Ces deux enquêtes présentent toutefois un biais de recrutement car elles concernent
des personnes en traitement soit prises en charge par une association de soutien
aux personnes infectées, soit des patients lecteurs de la revue REMAIDES. Cet
échantillon de la population séropositive peut être considéré comme mieux informé
et plus vigilant quant à ses traitements que la globalité des patients.
APROCO
L’étude longitudinale de mesure de l’observance des patients de la cohorte
APROCO, qui concerne des patients initiant un traitement par inhibiteurs de
protéases en 1997, a clairement montré que l’observance est un processus
dynamique qui évolue au cours du temps et des événements du suivi médical mais
aussi de la vie personnelle du patient.
Après 20 mois de suivi, 31 % des patients maintiennent une observance élevée tout
au long du suivi, 52 % d’entre eux à certains moments seulement, et 17 % des
patients ne sont jamais totalement observants à aucun moment.
La cohorte APROCO a permis une approche prédictive entre l’observance à court
terme, les caractéristiques des patients avant la mise sous traitement et les facteurs
associés au vécu des patients pendant le traitement. Les conditions socio-
économiques précaires, le jeune âge, le manque de soutien social, familial et affectif
et les problèmes d’addiction sont liés à une mauvaise observance dans l’analyse
plurifactorielle.
Les patients déclarant un nombre important d’effets secondaires juste après le début
du traitement de type HAART, ont un risque élevé de non-observance dans le futur
et constituent un groupe à surveiller et à accompagner dans leur démarche de
traitement. De même, la perception de son état de santé, la croyance dans l’efficacité
du traitement, l’état psychologique du patient et ses relations avec le personnel
soignant influencent le niveau d’observance.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%