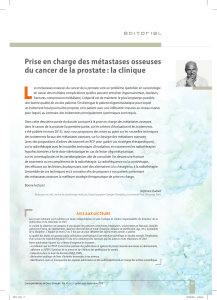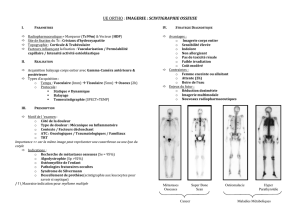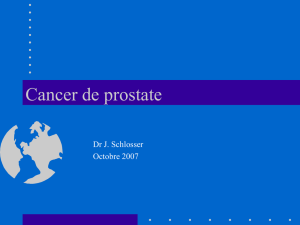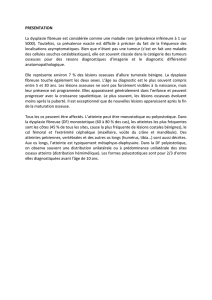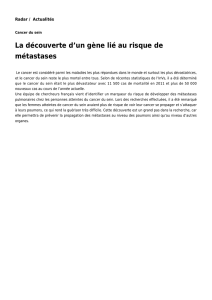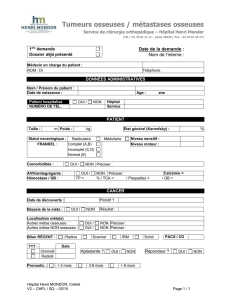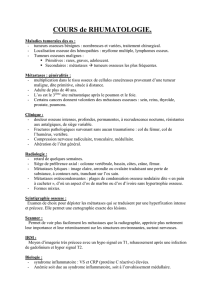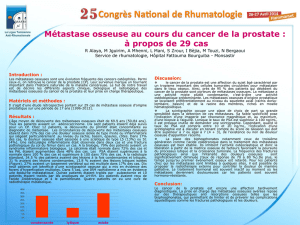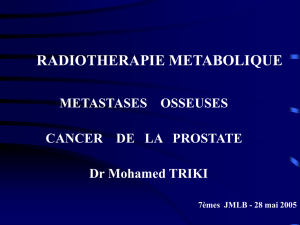Nouvelles techniques interventionnelles et métaboliques dans la

8S94 Rev Mal Respir 2005 ; 22 : 8S94-8S100
Doi : 10.1019/200530101
Cours du GOLF 2005
Résumé
Les métastases osseuses sont la cause la plus fré-
quente de douleur chez les patients atteints de can-
cer. Leur prise en charge sur le plan antalgique est
un challenge thérapeutique. La composante dou-
loureuse ne répond pas toujours aux antalgiques
majeurs, à la chimiothérapie et à la radiothérapie.
Quand ces traitements sont dépassés, la verté-
broplastie, la cimentoplastie et la radiofréquence
par voie percutanée et la radiothérapie métabo-
lique sont des méthodes élégantes et efficaces
venant en complément des traitement classiques.
Mots-clés : Métastase osseuse • Vertébroplastie •
Cimentoplastie • Radiofréquence • Radiothérapie
interne.
Nouvelles techniques interventionnelles et métaboliques
dans la prise en charge des métastases osseuses
B. Kastler1,2, H. Boulahdour3, F.-G. Barral4, J.-M. Lerais1, P. Manzoni1, M. Jacamon1, A. Pousse2, P. Jacoulet5,
M. Parmentier2, A. Depierre5
1Radiologie A et C CHU Besançon
2Laboratoire d’imagerie et d’ingénierie pour la santé, Université de Franche-
Comté (LE2i UMR 5158 CNRS)
3Médecine Nucléaire CHU Besançon
4Radiologie CHU St Etienne
5 Pneumologie CHU Besançon
Correspondance : B. Kastler,
Radiologie A et C CHU Besançon, Hôpital Jean Minjoz, Bd Fleming,
25030 Besançon.

8S95
Traitement antalgique des métastases osseuses d’origine pulmonaire
© 2005 SPLF, tous droits réservés
Introduction
Les lésions secondaires sont les tumeurs les plus fré-
quemment rencontrées au niveau du squelette. Les lésions pri-
mitives se situent principalement au niveau du sein, des pou-
mons et de la prostate (80 % des métastases osseuses) [1]. Les
douleurs osseuses représentent le mode de révélation le plus
fréquent des métastases osseuses, à côté de l'atteinte neurolo-
gique, de la fracture pathologique, de la tuméfaction osseuse
ou de l'hypercalcémie.
L'impact de la douleur en cancérologie est extrêmement
négatif, car dans l’esprit des patients et de la famille, il existe
souvent une association entre la gravité de leur maladie et la
douleur. La prévalence de la douleur est estimée entre 40 à 50
% des patients atteints de cancer tous stades confondus.
La nature individuelle de la douleur justifie un abord cli-
nique de la douleur cancéreuse basé sur une évaluation globale
du malade et pas uniquement de la maladie. Il s'agira de recher-
cher si la douleur est liée à la tumeur, aux thérapeutiques ou inter-
currente. Bien souvent, l’approche médicale du malade cancéreux
à un stade avancé de la maladie se résume à l’évaluation et la prise
en charge de la composante douloureuse qui est alors au premier
plan. De multiples études montrent que ces douleurs sont insuf-
fisamment traitées dans plus de 30 % des cas.
L’arsenal thérapeutique habituel fait appel à la chimio-
thérapie, la radiothérapie et plus rarement la chirurgie. Ces
méthodes demeurent souvent inefficaces devant les douleurs
majeures engendrées dont les mécanismes sont variés (com-
pression de terminaisons nerveuses, fractures pathologiques,
libération d’agents chimiques…). Il en est de même des antal-
giques majeurs.
L’objectif de cet article est de présenter un panel de tech-
niques interventionnelles d’apparition récente pour lesquelles
les auteurs ont une expertise. Elles viennent en complément
des méthodes thérapeutiques classiques souvent après leur
échec. Leur but est de traiter la douleur, mais aussi de prévenir
les fractures, de maintenir l’activité et la mobilité afin, si pos-
sible, de prolonger la vie ou du moins d'améliorer la qualité de
la survie de ces patients.
Vertébroplasties et cimentoplasties
Les vertébroplasties et cimentoplasties consistent en l’in-
jection percutanée de ciment acrylique dans une lésion osseuse
ostéolytique. Le but initial est antalgique par effet de consoli-
dation d'une pièce osseuse fragilisée.
Ces techniques découlent de celles mises au point initia-
lement en 1987 par Galibert et Deramond à Amiens sur sept
vertèbres angiomateuses [2, 3]. Les indications se sont ensuite
étendues aux vertèbres métastatiques, aux lésions myéloma-
teuses et aux tassements ostéoporotiques.
Le guidage du geste peut être réalisé sous contrôle scopique
et/ou tomodensitométrique ou les deux [4].
Pain management in bone metastasis of pulmonary
origin: New interventional and metabolic techniques
B. Kastler, H. Boulahdour, F.-G. Barral, J.-M. Lerais,
P. Manzoni, M. Jacamon, A. Pousse, P. Jacoulet, M.
Parmentier, A. Depierre
Summary
lIntroduction
Survival of patients after surgery for
non-small cell lung cancer is significantly limited
because of frequent fatal recurrences of the disease.
Logically, follow-up should detect recurrences early,
thus increasing chances of cure.
State of the art
Only non-randomised studies have
been published. These suggest that thoracic recur-
rences are the most frequent and the most frequently
treated with curative intent; and that diagnosis of
recurrences while patients are still asymptomatic
might improve survival. Several guidelines have been
published, with follow-up programs of varying inten-
sity and with a recent tendency to reduce follow-up
procedures to clinical assessment only (American
Society of Clinical Oncology 2004).
Perspectives
All guidelines agree that there is a need
for randomised data. Only one randomised trial is
ongoing, conducted by the Intergroupe Francophone
de Cancérologie Thoracique (IFCT). This study com-
pares a minimal follow-up with physical examination
and chest X-ray alone to a more intensive follow-up
program reflecting routine French practice which in
addition includes thoracic CT scan and fibre optic
bronchoscopy.
Conclusions
As it is not yet possible to define the opti-
mal follow-up after surgery for non-small cell lung
cancer from existing data, the IFCT randomised study
represents for pulmonologists, oncologists and tho-
racic surgeons a good opportunity to rationalise post-
operative follow-up and to defend their practice from
minimalist recommendations.
Key-words: Bone metastasis • Vertebroplasty •
Cementoplasty • Radiofrequency • Internal
radiotherapy.
Rev Mal Respir 2005 ; 22 : 8S94-8S100

8S96 Rev Mal Respir 2005 ; 22 : 8S94-8S100
Maladies respiratoires : Cours du GOLF 2005
Vertébroplasties (
fig. 1
)
Indications
La décision du geste est prise de façon multidisciplinaire
pour évaluer la place respective de la chirurgie, de la radiothéra-
pie, des traitements médicaux et de leur association possible, et
en tenant compte de l’état général du patient, de son espérance de
vie, de l’extension locale ou générale de la maladie et du nombre
de niveaux rachidiens atteints.
L’effet antalgique s'explique par la consolidation des pièces
osseuses fragilisées, fracturaires ou pré-fracturaires mais également
par effet toxique, chimique et thermique du ciment [3, 4] . La
sédations des douleurs apparaît dans les 48 premières heures et
permet de supprimer les antalgiques majeurs alors que la radio-
thérapie nécessite une ou deux semaines pour être efficace (la
contre-indication majeure est dans ces indications la destruction
complète du mur postérieur de la vertèbre avec un risque majeur
de créer ou d’aggraver une compression médullaire). Si, pour la
prise en charge du patient, une biopsie de la vertèbre atteinte est
nécessaire, il est logique de la réaliser dans le même temps opéra-
toire. Il devient judicieux d’utiliser un système co-axial afin d’évi-
ter plusieurs perforations de la corticale, ces perforations étant en
général responsables des fuites extra-rachidiennes du ciment.
Complications et effets secondaires
Les principales complications sont représentées par les
fuites de ciment en dehors du corps vertébral [5].
Les fuites postérieures vers l'espace épidural sont les plus
redoutables car elles peuvent être responsables d’une com-
pression médullaire et/ou radiculaire et nécessiter parfois
un geste chirurgical de décompression. Toutes ces fuites se font
part de larges solutions de continuité du mur postérieur ou par les
veines basi-vertébrales et peuvent se limiter par le respect des
contre-indications, une bonne technique (injection en profil
strict, en particulier) et par la possibilité de modifier la viscosité du
ciment injecté.
Les fuites veineuses dans le foramen peuvent être respon-
sables d’irritation ou de compression radiculaire qui sont sensibles
aux anti-inflammatoires et peuvent être traitées par infiltrations
radio-guidées, xylocortisonées.
Les fuites dans les parties molles péri-vertébrales sont relati-
vement fréquentes mais rarement responsables de complication.
Les cimentoplasties percutanées (fig. 2 et 3)
Les techniques de cimentoplasties percutanées découlent
directement de celles des vertébroplasties et peuvent être appli-
quées à une grande majorité des lésions osseuses fragilisantes
Fig. 1.
Patient de 62 ans présentant une métastase de D8 (poumon).
Matérialisation du trajet de l’aiguille. Mise en place du trocard à
biopsie (Cook) de 14 G (b). Injection de ciment sous contrôle
tomodensitométrique (c).et reconstruction en sagittal (d).
Fig. 2.
Métastase ostéolytique du tibia. Mise en place de trois aiguilles
de 18 G (a). Injection de ciment qui diffuse dans la médullaire
sous contrôle fluoroscopique (c).

du squelette.
Indications
Elles reposent sensiblement sur deux buts principaux :
apporter un effet antalgique rapide pour les affections hyper-
algiques d’une pièce osseuse résistante au traitement médi-
cal et proposer un effet de consolidation pour les localisa-
tions responsables d'impotence fonctionnelle, d'un risque
fracturaire important avec destruction d'une zone portante,
pour lesquelles une prise en charge chirurgicale est souvent
lourde chez les patients en état précaire. Ces indications
concernent principalement les pathologies néoplasiques en
particulier les métastases [6-9].
Résultats
L'efficacité de la cimentation sera appréciée par la
diminution des douleurs (évaluée par l'échelle visuelle ana-
logique). Cet effet antalgique assez précoce, entre la 16ème et
la 72ème heure (36 heures en moyenne), permet dans la
majorité des cas une reprise de la station debout, dimi-
nuant d'autant les complications du décubitus. Ce dernier
point est particulièrement intéressant dans cette popula-
tion de patients en mauvais état général et dont l'espérance
de vie est, dans la majorité des cas, assez réduite. Cet effet
antalgique est objectivé par la diminution progressive puis
l'arrêt des antalgiques. L'étude de la littérature montre que
la disparition ou la réduction très importante des douleurs
intéresse 70 % des patients porteurs de métastases verté-
brales ou de myélome [5, 9].
Ils sont très bons en termes d’antalgie pour les patho-
logies néoplasiques : trente six patients sur trente sept avec
ont bénéficié d’une réduction partielle ou complète de la
douleur [5].
Ablation tumorale par radiofréquence (RF) (fig. 4,
5 et 6)
Les premiers traitements percutanés de métastases
osseuses sous contrôle TDM que nous avons proposés à visée
antalgique, il y a déjà plus d’une dizaine d’années, faisaient
appel à des injections d’alcool absolu au sein de la tumeur avec
de très bonnes réponses sur la composante douloureuse [10,
12]. Cependant à cause de problèmes de diffusion avec risque
d’atteinte de nerf moteurs en proximité notre préférence va
actuellement nettement à l’ablation par radiofréquence.
La radiofréquence est un procédé ancien dont le principe
est déjà appliqué depuis de nombreuses années pour les bis-
touris électriques et les neurolyses lorsque l’on veut une ther-
molyse très localisée sans risque de lésion de structures ner-
veuses en proximité. Elle consiste en l’introduction d’une
aiguille par voie percutanée au sein d’une lésion. Par induction
d’un courant alternatif RF (haute fréquence 400 KHz) à la
pointe de l’aiguille qui circule dans les tissus avoisinants, un
8S97
Traitement antalgique des métastases osseuses d’origine pulmonaire
© 2005 SPLF, tous droits réservés
Fig. 3.
Métastase ostéolytique du pubis (a). Mise en place de deux
aiguilles de 18 G (à droite et à gauche) et injection de ciment sous
contrôle tomodensitométrique (b).
Fig. 4.
Patiente de 60 ans présentant une localisation métastatique au
niveau des arcs costaux postérieurs des 7e et 8e côtes (a). La lésion
est traitée par RF par aiguille bipolaire simple (b) accompagnée
d’une infiltration intercostale en regard (c). Reconstruction 3D
montrant les deux aiguilles (d).

8S98 Rev Mal Respir 2005 ; 22 : 8S94-8S100
Maladies respiratoires : Cours du GOLF 2005
échauffement tissulaire est provoqué par agitation ohmique.
Lorsque la température tissulaire à proximité de l’aiguille
dépasse 50-60°, apparaît une lésion thermique autour de la
pointe conductrice. L’obtention de lésion de petites tailles (mil-
limétriques) étant plus facile sur le plan technique, la RF
osseuse a dans un premier temps été évaluée dans le traitement
des ostéomes ostéoïdes [12-14]. Pour induire des lésions de
plus grande taille, différentes approche techniques sont propo-
sées: électrodes à baleines conductrices déployables (Rita, Bos-
ton Scientific), à circulation interne (Radionics, Celon) et élec-
trodes à perfusion externes (Berchtold).
Pour l’ablation tumorale, en particulier osseuse, nous
recommandons les aiguilles droites car les électrodes
déployables ne peuvent être bien ouvertes au sein des lésions
osseuses. Nous utilisons un système bipolaire (Celon avec
aiguille à circulation interne, possédant les deux éléctrodes à
son extrémité conductrice). Avec ce générateur, nous traitons
actuellement toutes les lésions tumorales osseuses, notamment
les métastases avec de très bonnes réponses sur la composante
douloureuse [17, 18], les lésions hépatiques en particulier lors-
qu’elles sont volumineuses et également les lésions rénales, sur-
rénaliennes, pulmonaires.
Indications
Les lésions doivent être accessibles par voie percutanée,
atteindre au maximum 5 à 6 cm de plus grand diamètre (ou
plus si on attend seulement un effet antalgique et non plus car-
cinologique), et être à distance d’au moins un, voire deux cen-
timètres d’une structure nerveuse (moelle épinière, nerf péri-
phérique). Les précautions habituelles en terme de crase
sanguine sont prises et la procédure est réalisée sous neurolep-
tanalgésie. Pour raccourcir la durée de la procédure, les tumeurs
supérieures à 3,5 cm sont traitées par une à trois électrodes
(effet multipolaire) . Il en est de même en cas de lésions mul-
tiples (maximum trois lésions à la fois). Il est possible de trai-
ter des lésions ostéocondensantes.
Technique et résultats
Nous réalisons ces interventions sous guidage tomoden-
sitométrique TDM [15, 16]. Après anesthésie sous-cutanée,
une première aiguille de 22 G est poussée au contact de la
tumeur. Elle assure l’anesthésie sur le trajet et permet par tech-
nique de tuteur de guider aisément la pointe de l’aiguille de
radiofréquence au sein de la lésion tumorale. L’application du
courant RF peut commencer avec mise en route du circuit de
refroidissement (80 ml/min). Il est maintenu pendant 8 à 25
minutes en fonction de la taille de la lésion. L’effet antalgique
est immédiat et souvent spectaculaire (le taux de réponse posi-
tive est supérieur à 80 % dans notre série [17, 18]). Les patients
sont soulagés de 4 semaines à 14 mois (2,5 mois en moyenne).
Les lésions du bassin répondent particulièrement bien [17, 18].
Fig. 5.
Patient de 56 ans (cancer du poumon) présentant une métastase
humérale (a) avec fracture pathologique (tête humérale engrénée).
Mise en place de deux aiguilles bipolaires en parallèle au sein de
la lésion ostéolytique, dont l’une en coaxial au travers d’une
aiguille à biopsie (Cook) de 11 G (b). Application d’un courant
RF pendant 15 min. Retrait des aiguilles et injection de ciment
pour consolider la fracture (c et d).
Fig. 6.
Patient de 56 ans (cancer du poumon) présentant une métastase
humérale (a) avec fracture pathologique (tête humérale engrénée).
Mise en place de deux aiguilles bipolaires en parallèle au sein de
la lésion ostéolytique, dont l’une en coaxial au travers d’une
aiguille à biopsie (Cook) de 11 G (b). Application d’un courant
RF pendant 15 min. Retrait des aiguilles et injection de ciment
pour consolider la fracture (c et d).
 6
6
 7
7
1
/
7
100%