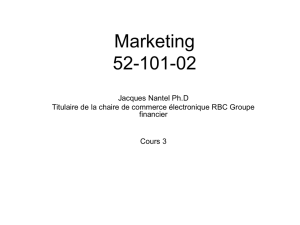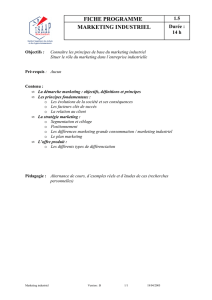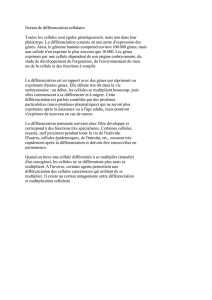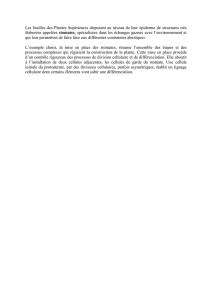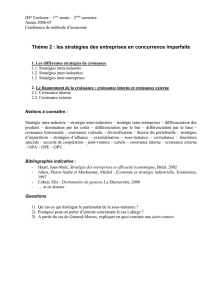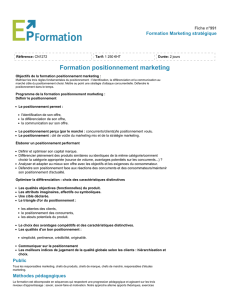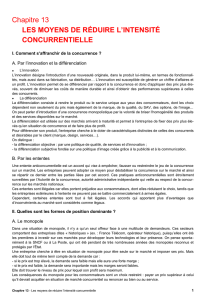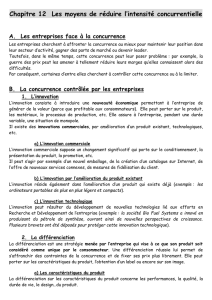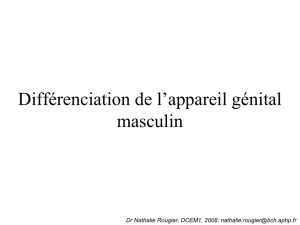Être humain, personne et non-personne

61le clinicien mai 2000
ribune d’éthique
MeMichel T. Giroux
Un patient du Dr Clinicos âgé de 76 ans souffre de
démence vasculaire. Il est veuf, n’a qu’un frère plus
jeune qui le visite à l’occasion et qui a lui-même
une santé fragile. Le frère du patient est son man-
dataire. Le patient réside en centre d’hébergement
et de soins de longue durée depuis trois ans. Son
état de santé s’est graduellement détérioré. Au
début, il reconnaissait les gens du département, il
mangeait et s’habillait avec une aide limitée et il
participait un peu aux activités.
Aujourd’hui, son discours est incohérent, il ne
parle d’ailleurs plus beaucoup, il a besoin de
beaucoup plus de surveillance pour s’alimenter, il
ne choisit plus ses vêtements et ne s’habille plus
seul.
Le frère du patient ne reconnaît absolument
plus en lui le professionnel brillant qu’il a été. Il
a bien du mal a accepter une telle situation. Lors
d’un entretien avec le Dr Clinicos, il lui soumet
l’idée que, dans l’état où il se trouve, le patient
n’est plus une personne et que, pour cette raison,
il faudrait cesser toutes les interventions qui ont
pour effet de le maintenir en vie, et même
«songer à une piqûre qui pourrait régler défini-
tivement les choses», suivant la formulation qu’il
a utilisée.
Quelle devrait être la conduite
du Dr Clinicos?
MeMichel T. Giroux est avocat
et docteur en philosophie.
Il enseigne la philosophie au
Campus Notre-Dame-de-Foy et
la bioéthique à des étudiants de
deuxième cycle en médecine à
l’Université Laval, Québec.
Consultant en bioéthique,
il est conseiller en éthique au
FRSQ et directeur de l’Institut de
consultation et de recherche en
éthique et en droit (ICRED).
Être humain, personne
et non-personne

62 le clinicien mai 2000
La discussion
L’exposé des faits soulève la question de la justesse
et de la pertinence d’une différenciation entre les
êtres humains qui sont des personnes et ceux qui ne
le seraient pas. Il y a déjà plus de 25 ans, des
auteurs ont tenté d’établir une différenciation entre
personne humaine et non-personne humaine.
Selon cette distinction, il existerait deux espèces
d’êtres humains : les personnes et les non-
personnes. En 1979, la Commission de réforme du
droit du Canada a produit un document intitulé Le
caractère sacré de la vie ou la qualité de vie. La dis-
tinction entre personne et non-personne y est dis-
cutée explicitement. De plus, ce document con-
tient de nombreuses références à des auteurs qui
ont élaboré cette distinction, notamment Joseph
Fletcher et Tristan H. Engelhardt.
Suivant la différenciation examinée ici, l’expres-
sion «être humain» représente quiconque appar-
tient à l’espèce humaine alors que «personne
humaine» représente les êtres humains qui sont en
mesure d’utiliser l’ensemble des moyens de l’être
humain. En conséquence de son niveau élevé de
perfection, la personne humaine mériterait qu’on
protège son existence et qu’on lui dispense des
soins exhaustifs. Considérant ensuite que seules les
personnes possèdent des droits, la conduite médi-
cale à l’égard des patients qui sont des non-
personnes humaines pourrait être très différente de
celle à l’égard des personnes humaines. Les non-
personnes humaines seraient, par exemple, le
fœtus, le nouveau-né, le patient atteint de démence
profonde, l’handicapé mental grave ou encore le
patient qui se trouve dans un état végétatif.
Jusqu’à présent, l’impact de la différenciation entre
personne humaine et non-personne humaine semble
avoir été négligeable. Cependant, les fortes préoccu-
pations économiques actuelles et le populaire
impératif de la rentabilité réaniment l’idée de cette
différenciation, quand ce n’est pas son vocabulaire.
L’aspect juridique
Le mot «personne» provient du latin persona qui
désigne d’abord un masque de théâtre, puis un
type de personnage au théâtre. Voici quelques
acceptions actuelles de ce mot :
«1. Être humain, sans distinction de sexe :
Il y avait 15 personnes à table. 2. Individu consi-
déré en lui-même : Le respect va parfois à la fonc-
tion plus qu’à la personne. (...) Personne humaine,
être humain en tant qu’être moral.(...)Dr.
Personne (juridique), tout être capable d’être ti-
tulaire de droits et soumis à des obligations
(personne physique ou morale)».1
En droit, il existe deux types de personnes : la
personne physique, qui est un être humain, et la
personne morale, par exemple une municipalité,
une corporation professionnelle ou un centre hos-
pitalier. Le droit canadien ne fait pas de différence
entre l’être humain et la personne.
L’article 1 de la Charte des droits et libertés de la
personne du Québec (la Charte) énonce que tout
être humain possède la personnalité juridique :
«Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la
sûreté, à l’intégrité et la liberté de sa personne. Il
possède également la personnalité juridique.»
Tribune d’éthique

63le clinicien mai 2000
Tribune d’éthique
L’article 1 du Code civil (C.c.) reconnaît la per-
sonnalité juridique à tout être humain ainsi que la
jouissance des droits civils : «Tout être humain
possède la personnalité juridique; il a la pleine
jouissance des droits civils.»
Suivant l’article 4 C.c., une personne qui ne se
trouve plus capable d’exercer ses droits civils peut
bénéficier d’un régime de protection ou d’assistance :
«Toute personne est apte à exercer pleinement ses
droits civils. Dans certains cas, la loi prévoit un
régime de représentation ou d’assistance».
La personne devenue incapable d’exercer ses
droits civils ne les perd pas, mais un régime de pro-
tection ou d’assistance peut être créé pour son
bénéfice. Dans notre cas, le patient n’a perdu aucun
de ses droits civils en devenant inapte : il n’a jamais
cessé d’être une personne au sens juridique, il pos-
sède toujours la personnalité juridique (le fait d’être
un sujet de droit) et son mandataire est tenu d’agir
dans son seul intérêt.
Enfin, la différenciation entre personne humaine
et non-personne humaine n’est pas conforme à l’ar-
ticle 10 de la Charte puisque la discrimination au
motif du handicap est interdite : «Toute personne a
droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine
égalité, des droits et libertés de la personne, sans
distinction, exclusion ou préférence fondée sur la
race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation
sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue
par la loi, la religion, les convictions politiques, la
langue, l’origine ethnique ou nationale, la condi-
tion sociale, le handicap ou l’utilisation d’un
moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimina-
tion lorsqu’une telle distinction, exclusion ou
préférence a pour effet de détruire ou de compro-
mettre ce droit».
Cette liste de motifs de discrimination est
exhaustive. Une discrimination est interdite si elle
est au moins partiellement fondée sur l’un des
motifs mentionnés.
Jusqu’à présent, l’impact de la
différenciation entre personne humaine et
non-personne humaine semble avoir été
négligeable. Cependant, les fortes
préoccupations économiques actuelles et le
populaire impératif de la rentabilité
réaniment l’idée de cette différenciation,
quand ce n’est pas son vocabulaire.

64 le clinicien mai 2000
Tribune d’éthique
L’aspect éthique
Notre analyse de l’aspect éthique portera entre
autres points sur la justesse de la différenciation
proposée et sur les conséquences qui découlent de
cette différenciation.
La justesse de la différenciation. Le mot
«personne» prend diverses significations suivant
l’aspect de l’être humain qu’on veut faire ressortir.
Les sciences qui étudient un même objet se dis-
tinguent par leur manière de définir cet objet et par
leur méthode d’étude. Ainsi, pour le psycholoque,
la vie psychologique caractérise la personne. Le
biologiste retiendra plutôt qu’il s’agit d’un mam-
mifère primate de la famille des hominiens, seul
représentant de son espèce. Le théologien insistera
sur la présence d’une âme créée par Dieu et des-
tinée à la contemplation éternelle de son créateur.
Le juriste utilisera le mot «personne» pour désigner
le sujet porteur de droits; le mot «personne»
désignera aussi les entités corporatives.
La justesse de la différenciation proposée a pour
objet son exactitude, sa capacité à décrire le réel. La
différenciation entre personne humaine et non-
personne humaine est-elle fondée dans le réel?
La différenciation entre personne et non-
personne fixe le niveau de développement ou de per-
fection à partir duquel on devrait reconnaître l’exis-
tence de la personne. Plus les critères sont élevés et
nombreux, plus il est difficile d’être reconnu comme
une personne. Ces critères se rapportent générale-
ment à la capacité intellectuelle et aux habiletés de
communication. En voici une liste brève : la ratio-
nalité ou l’intelligence dont le niveau requis est à
préciser, la conscience du monde extérieur, la con-
science de soi, la communication, le fait d’agir libre-
ment, la maîtrise de sa conduite. Comment justifier
l’exigence de tel ou tel niveau intellectuel? Par exem-
ple, cet handicapé avec lequel on ne pouvait com-
muniquer il y a 20 ans communique maintenant
avec son entourage grâce à la mise au point de nou-
velles techniques. Selon les critères retenus,
quelqu’un pourrait constater que le patient est une
personne, alors qu’un autre conclurait à l’inverse.
La puissance et l’acte. Du point de vue philo-
sophique, la raison caractérise la personne. La
nature humaine porte ce trait fondamental et dis-
tinctif de la présence d’une intelligence. D’où le
célèbre énoncé de Blaise Pascal qui souligne la
fragilité de l’homme dans son corps, mais sa
grandeur par la pensée : «L’homme n’est qu’un
roseau, le plus faible de la nature, mais c’est un
roseau pensant».2Or, il arrive qu’un accident ou
que la maladie prive quelqu’un temporairement ou
définitivement d’une portion plus ou moins
importante de l’exercice de sa capacité intel-
lectuelle. Cette privation diminue-t-elle l’être con-
cerné au point de lui retirer une partie ou la tota-
lité de sa nature d’être pensant?
Dans son observation des êtres naturels en mou-
vement, la philosophie utilise les concepts de puis-
sance et d’acte. La puissance désigne ce qui est
potentiel ou virtuel. L’acte représente ce qui existe
effectivement. La graine est un arbre en puissance,
alors que l’arbre est un arbre en acte.
L’oreille qui n’entend plus lors d’une infection
recouvre sa capacité d’entendre une fois guérie.
Lorsqu’elle n’entendait plus, l’oreille conservait la
possibilité, la puissance d’entendre. En bonne
santé, l’oreille entend, elle exerce sa fonction;

66 le clinicien mai 2000
Tribune d’éthique
infectée, l’oreille n’entend
pas, mais elle détient en
puissance la capacité d’en-
tendre encore. Ce qui dis-
paraît, c’est l’exercice effectif
d’un sens, non pas sa virtua-
lité intrinsèque et perma-
nente d’exercice.
De même, l’accident ou la
maladie prive une personne
de l’exercice d’une partie ou
de la totalité de son intelli-
gence, qui ne se manifeste
plus en acte. Cette personne
continue de détenir en puis-
sance l’ensemble des capacités
qui se manifesteraient à nou-
veau s’il était possible de
guérir l’organe atteint. Le
maintien de la puissance, du
point de vue de l’exercice des
capacités intellectuelles, a
pour effet que la personne
atteinte dans l’exercice de sa
capacité intellectuelle n’est pas diminuée dans son
niveau d’être ou dans sa dignité.
Les conséquences de la différenciation. Le
raisonnement qui distingue entre personne
humaine et non-personne humaine serait peu utile
s’il n’aboutissait pas à des conséquences significa-
tives. L’enjeu concret est de savoir si l’on peut
adopter une conduite clinique auprès de certains
patients sur la base du constat que ce sont des non-
personnes, donc des êtres qui ne jouissent pas des
droits juridiques et moraux dont disposent les per-
sonnes. Puisque le constat qui est supposé fonder la
différenciation entre personne humaine et non-
personne humaine est erroné en raison des concepts
de puissance et d’acte, la différenciation proposée
devrait ne pas être retenue.
Les limites de la différenciation. La différen-
ciation entre personne humaine et non-personne
humaine présente sans doute l’avantage immédiat et
temporaire de simplifier la réflexion du praticien et
des autres personnes impliquées parce qu’elle est
réductionniste de la nature humaine. Par contre, en
En raison de son incapacité à considérer toutes les dimensions
constitutives de l’être humain, la distinction entre personne
et non-personne n’éclaire pas le praticien dans la mise au
point d’une conduite clinique qui tienne compte de
l’ensemble de l’être du patient.
 6
6
1
/
6
100%