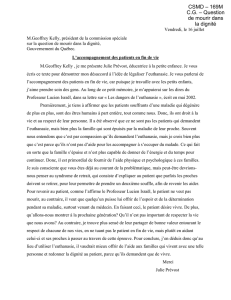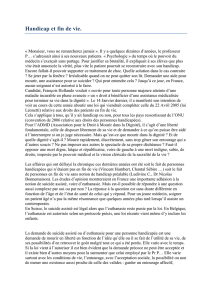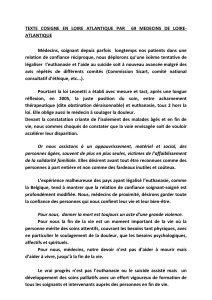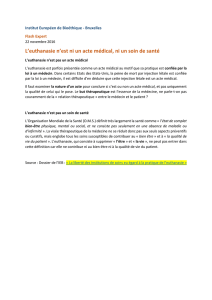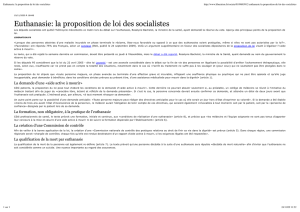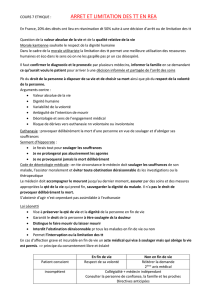Fin de vie. Y a-t-il un droit à mourir ?

Fin de vie. Y a-t-il un droit à mourir ?
●
Th. du Puy-Montbrun*
Tuez-moi, sinon vous êtes un assassin (1)
Frantz Kafka
Si nous avons besoing de sage femme
à nous mettre au monde, nous avons
besoing d’un homme encore plus sage
à nous en sortir (2)
François de Montaigne
L
Aproblématique de la fin de vie, de
ce temps où s’impose que d’exis-
tence il n’y a plus que reliquat, de ces
instants qui annoncent l’inéluctabilité
de la mort figeant corps et pensée en
un présent où douleur et souffrance
nourrissent l’angoisse, où l’image de
soi – pour soi mais aussi pour l’autre
qui voit en miroir se projeter sa propre
mort – met à vif un sentiment d’insup-
portable devant son être qui fait nau-
frage, cette problématique, donc, s’im-
pose comme l’une des plus complexes
questions qui nous soit posée. Non
tant qu’il s’agisse de la mort “en soi”,
concept qu’on peut mobiliser sans
pour autant entraîner l’effroi – on
parle bien de “belle mort” – mais, bien
plutôt, des conditions de cette mort.
S’éteindre dans son sommeil – puisque
mourir il faut – passe encore. Mais
que le chemin qui mène à cette mort
s’impose en tant qu’épreuve infernale
pour soi et pour l’autre, voilà qui inter-
roge : est-ce une obligation que de s’y
soumettre ? Si je ne peux éviter la
mort, ai-je au moins “le droit” d’en
alléger les conditions ? Et si oui, puis-
je solliciter l’aide de l’autre ? En
d’autres termes, peut-on disposer de
sa mort ? Est-ce recevable du point de
vue de l’individu (jusqu’où peut aller
sa liberté ?), de la morale (est-ce bien
que d’interférer ainsi sur son destin ?),
du droit (est-ce juste ?), du politique
(est-ce légitime ?).
La question est double : puis-je, d’une
part, me donner la mort dès lors que
celle-ci paraît inéluctable avec son cor-
tège de souffrance, mais aussi, puis-
je, d’autre part, demander à l’autre
son secours, son aide pour hâter cette
mort ou encore l’autre est-il fondé de
prendre pour moi une telle décision ?
La première interrogation est celle du
suicide, la deuxième celle de l’eutha-
nasie. C’est de ce deuxième volet qu’il
s’agira ici. Au préalable, il importe de
définir ce qu’est l’euthanasie et les
conditions dans lesquelles elle peut
s’exercer. Éthymologiquement, le
mot euthanasie signifie “bonne mort”,
“mort douce”. Il en va autrement de
sa définition moderne que donne M.
Le Gueut-Develay : “
Geste ou omis-
sion du geste qui provoque délibérément
la mort du malade qui souffre de façon
insupportable ou vit une dégradation
insoutenable (3)
.” Cette définition amène
à distinguer deux situations fondamen-
talement opposées : “
L’euthanasie active
[qui] suppose le geste d’un tiers qui
administre à un mourant une substance
létale ou la lui fournit ou encore le tue
par tous moyens, et l’euthanasie passive
[qui] est plutôt définie comme l’arrêt des
traitements de réanimation, ou celui du
traitement de la maladie fatale, à partir
du moment où l’on est convaincu que le
cas est désespéré(4)
.” Mais le distinguo
entre euthanasie active et passive
n’est pas sans ambiguité car, comme
le souligne à juste titre J.Y. Gouffi :
“
il n’est pas possible de dire que celui
qui laisse mourir n’est pas la cause de la
mort, par opposition à celui qui tue (5)
”.
De plus, une telle classification connaît
ses limites puisque, ainsi que l’écrit
A. Hocquard : “
elle repose avant tout sur
des critères juridico-éthiques (6)
” qui
fluctuent selon les pays et les cultures.
Aussi, avec elle, nous reprendrons le
sens qui prévaut actuellement dans
l’opinion – qu’elle définit par “eutha-
nasie volontaire” – et qui s’inscrit dans
le cadre d’une demande ou plus préci-
sément d’une volonté du patient libre-
ment exprimée et répétée. En effet, il
est acquis d’une manière consensuelle
que doit être formellement écarté de
la réflexion le fait de donner la mort de
sa propre initiative et sans le consen-
tement du patient : il s’agit là d’un
assassinat qui doit être traité comme
tel par la justice.
Mais, et il ne faut pas se le cacher si
l’on veut procéder à une analyse sur
le fond, convenons avec J.Y. Goffi “
que
le résultat net d’un acte d’euthanasie est
qu’un être humain est mis à mort (7)
”ce
qui, à l’évidence, implique la morale,
le droit, le politique, le religieux. Notons
ici que le consentement du patient
“
est sans effet, le droit pénal ne justifiant
pas la commission de l’infraction par le
consentement de la victime (8)
”. Meurtre
donc il y a. Comment résoudre cette
problématique ? Pour ce faire, conve-
nons d’analyser en premier lieu ce
dont on dispose avant de s’engager
dans une réflexion sur la possibilité
d’un “droit à mourir” qui fonderait
l’euthanasie volontaire, faisant alors
de la mort un dû que l’État devrait au
malade. C’est dire, en aparté, que
l’euthanasie est, à l’évidence, un pro-
blème politique.
Scien ce et co nscie n ce
Le Courrier de colo-proctologie (IV) - n° 4 - oct.-nov.-déc. 2003
120
* Paris.

Ceux qui condamnent le concept
d’euthanasie volontaire le font au nom
de la transcendance de la vie qui ne
peut être laissée à la disposition de
l’homme. Ils soutiennent le caractère
intrinsèque à la personne de la dignité.
De plus, justifier l’euthanasie impli-
querait qu’il est des circonstances où
la mort serait préférable à la vie. Cela
voudrait dire que la vie en soi n’est
pas toujours un bien, et elle en per-
drait son caractère sacré. Dès lors
bien des dérives seraient possibles
amenant la société à réclamer son
contingent de morts volontaires. Rejeter
l’euthanasie volontaire ne suppose
pas pour autant l’abandon du malade
à la douleur et à l’acharnement théra-
peutique. La douleur est reconnue dans
sa non-finalité. Elle “
distord le langage,
déforme les mots, empoisonne l’esprit
(9)
”. Elle n’est pas salvatrice et il n’est
pas sans intérêt de rappeler la décla-
ration de Pie XII, du 24 février 1957, à
propos de l’analgésie : “
L’acceptation
de la souffrance sans adoucissement ne
représente aucune obligation et ne répond
pas à une norme de perfection (…) On
peut éviter la douleur sans se mettre
aucunement en contradiction avec les
Évangiles (10)
.” Et si pour éviter la
douleur survient la mort, il ne peut,
pour autant, y avoir faute. C’est la
théorie du double effet qui s’origine
dans la pensée de saint Thomas
d’Aquin : une action est moralement
fondée si elle est orientée vers la réa-
lisation d’un bien même si elle doit
avoir des effets secondaires morale-
ment irrecevables – ici, la mort de
l’autre. Mais qui n’a pas la foi ne
manquera pas d’opposer que nous
sommes responsables de la totalité de
nos actes.
On s’appuiera alors sur le code de
Déontologie
(11)
, texte hautement poli-
tique puisque le médecin tire son droit
d’exercer de la loi et d’elle seule
(12)
.
Les articles 37
(13)
et 38
(14)
devraient
permettre de faire face à toutes les
situations. Pour M. Le Gueut-Develay,
ils “
prohibent l’euthanasie active, n’in-
vitent pas à l’acharnement thérapeutique
et insistent sur les soins palliatifs qui
consistent en soins actifs dans une approche
globale de la personne en phase évoluée
ou terminale d’une maladie potentielle-
ment mortelle. La Société française d’ac-
compagnement et de soins palliatifs
(1992) ajoute : les soins palliatifs s’atta-
chent à prendre en compte et à soulager
les douleurs physiques ainsi que la souf-
france psychologique, morale et spiri-
tuelle (15)
”. À leur propos, R. Sebag-
Lanöe écrit : “
En soulageant les
souffrances sans pour autant provoquer
la mort de façon délibérée, les soins pal-
liatifs permettent le déroulement du pro-
cessus naturel de la mort et laissent la
possibilité au malade et à ses proches de
vivre ce mieux de la fin connu depuis
l’Antiquité qui favorise d’ultimes échanges.
Les soins palliatifs ne représentent-ils
pas de ce fait la forme la plus aboutie du
respect de la mort d’un individu ? (16)
”.
Dans son avis n° 63, du 27 janvier
2000, le Comité consultatif national
d’éthique (CCNE) “
manifeste son total
accord
” avec une telle définition et
ajoute : “Leur mise en œuvre résolue
devrait permettre, autant que faire se
peut, à chaque individu de se réappro-
prier sa mort, réconforté par les siens
et par ceux qui l’entourent
(17)
.”
Il n’en demeure pas moins que “
cer-
taines situations peuvent être considé-
rées comme extrêmes, exceptionnelles
(18)
” mettant soignant et patient dans
des conditions “
hors normes
” telles
que la finalité des soins palliatifs ne
puisse être réalisée : “
C’est alors que
se pose la question de l’euthanasie pro-
prement dite (19)
.” C’est, bien entendu,
d’euthanasie volontaire qu’il s’agit, le
CCNE participant au consensus géné-
ral condamne de façon unanime un
acte envisagé ou effectué hors de toute
forme de demande ou de consentement
de la personne ou de ses représentants.
C’est cette euthanasie volontaire pour
laquelle milite la Fédération mondiale
pour le droit de mourir dans la dignité
à laquelle appartient en France l’Asso-
ciation pour le droit de mourir dans la
dignité (ADMD). H. Caillavet, son
président d’honneur, justifie comme
suit l’euthanasie : “
L’euthanasie, un
mot qui ne doit pas faire peur. Imposer
une vie à celui qui veut mourir, n’est-ce
pas porter atteinte à sa dignité ? (…) Il y
a deux façons d’aborder la mort. La maî-
triser ou la subir. En cela, le suicide
conscient est l’acte authentique de la
liberté de l’homme. Pour tous ceux qui
considèrent que la vie ne vaut pas la peine
d’être vécue, que d’un bien elle est deve-
nue une malédiction, nul pouvoir, serait-
il religieux, médical, législatif, moral, ne
saurait se dresser contre leur décision de
mourir, parce qu’ils sont seuls juges de
la qualité de leur vie (20)
.” On retrouve
une même argumentation dans la pro-
position de loi relative au droit de mou-
rir dans la dignité : “
Toutes personnes en
mesure d’apprécier les conséquences de
ses choix et de ses actes est seule juge de
la qualité et de la dignité de sa vie ainsi
que de l’opportunité d’y mettre fin (…)
Elle peut obtenir une aide active à mou-
rir lorsqu’elle estime que l’altération
effective et imminente de cette dignité ou
de cette qualité de vie, la place dans une
situation telle qu’elle ne désire pas pour-
suivre son existence (21)
.” Ainsi, est posée
la question du droit à mourir ou, comme
l’écrit A. Hocquard : “
la mort : un droit
de l’homme (22)
?” et de préciser
qu’“
entre ceux qui affirment qu’il y a
urgence à proclamer un véritable droit à
la mort et ceux qui répètent que l’eutha-
nasie ne peut prétendre à la licéité, car
on pourrait légaliser l’homicide, le
conflit semble irréductible (23)
”.
Se pose ici une question philosophique
d’une grande complexité, celle de
l’autonomie de l’homme et, à travers
elle, celle de l’éternelle opposition entre
le déontologique et le téléologique.
C’est aussi un questionnement psycho-
Scien ce et co nscie n ce
Le Courrier de colo-proctologie (IV) - n° 4 - oct.-nov.-déc. 2003
121

logique sur l’
idem
et l’
ipse
qu’il faut
résoudre : la personne est-elle iden-
tique à elle-même tout au long de sa
vie de telle sorte que le désir de mort
exprimé un jour se verrait pérenniser
tout au long de cette vie dans une
sorte de négation de la temporalité ?
Mais l’histoire de l’individu n’est-elle
justement pas en perpétuelle évolu-
tion, restant toujours à écrire ? Autre
interrogation soulevée par B. Matray :
le droit à la mort ne signifie-t-il pas en
même temps “
la mort du droit (24)
?”
Le droit, en effet, repose sur la rela-
tion interhumaine et non sur sa des-
truction. Accorder le droit à mourir ne
serait-ce pas demander à la société
“
d’institutionnaliser la transgression de
l’interdit, c’est-à-dire organiser une ins-
titutionnalisation de la mise en œuvre de
la pulsion de mort ? (25)
”
Est-il possible de sortir de l’aporie ?
Est-il concevable que, comme le
demande H. Caillavet, de penser pos-
sible “
la dépénalisation sous condition
de l’euthanasie (26)
” ou doit-on, avec
E. Lévinas, faire du visage de l’autre
“
ce qu’on ne peut tuer, (…) ce dont le
sens consiste à dire : tu ne tueras point
(27)
?” Pour essayer d’avancer, nous
rapportons une proposition du CCNE
qui pourrait être une troisième voie,
comme un compromis entre le déon-
tologique et le téléologique – une
casuistique laïque en quelle que sorte.
Il pose, en préalable, dans son avis 63,
du 27 janvier 2000, la valeur fonda-
trice de l’interdit du meurtre et “renonce
à considérer comme un droit dont on
pourrait se prévaloir la possibilité
d’exiger d’un tiers qu’il mette fin à
une vie”. Voilà pour le déontologique.
D’un autre côté, face à des situations
particulières – grande détresse en dehors
de tout espoir thérapeutique, souffrance
insupportable – et au nom de “
la soli-
darité humaine et de la compassion, on
peut se trouver conduit à prendre en
considération le fait que l’être humain
surpasse la règle et que la simple sollici-
tude se révèle parfois comme le dernier
moyen de faire face ensemble à l’inéluc-
table. Cette position peut être qualifiée
d’engagement solidaire
”. Voilà pour le
téléologique.
Le principe incontournable de la trans-
cendance de la vie est posé. Son res-
pect a valeur universelle et s’accorde
avec ce qui fonde l’altérité. Mais au
nom même de cette altérité, et pour ne
pas se mettre en contradiction avec les
principes de bienfaisance et de non-
malfaisance, n’est-il pas licite – éthi-
quement recevable – de s’engager dans
la voie de l’engagement solidaire ?
C’est à chacun d’y réfléchir et ce sera
au
politique
de se prononcer. ■
RÉFÉRENCES
1. Paroles que Frantz Kafka adresse, pendant son
agonie, à son médecin. In : Max Brod (ed). Frantz
Kafka. Cité par Anita Hocquard in : L’euthanasie volon-
taire, Paris : PUF/Perspectives critiques, 1999 ; p. 5.
2. Montaigne. Essais, III, “De la vanité”, cité par
Serge Pottiez, “Peut-on définir la mort ? Réflexions
morales et médico-légales”. In : Mourir en société,
Revue Prévenir 1er semestre 2000 ; 8 : 45.
3. Le Gueut-Develay M. Service de Médecine léga-
le, CHU de Rennes : www.med.uni-rennes1.fr/etud/
medecine_legale/euthanasie.htm.
4. Le Gueut-Develay M. Référence citée.
5. Goffi JY. Euthanasie. In : Canto-Sperber M (ed).
Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale.
Paris : PUF, 2001, p. 595.
6. Hocquard A. L’euthanasie volontaire. Paris :
PUF/Perspectives critiques, 1999, p. 11.
7. Goffi JY. Op. cit., p. 594.
8. M. Le Gueut-Develay. Référence citée.
9. Ruszniewski M. Face à la maladie grave. Paris :
Dunod “Pratiques médicales”, 1995, p. IX.
10. Pie XII. Problèmes religieux et moraux de
l’analgésie. In : P. Verspieren (ed). Biologie, médecine
et éthique : les textes du magister catholique. Paris :
Centurion, 1987, p. 347-64.
11. Décret 95-1000 du 6 septembre 1995 portant
code de déontologie médicale modifiant le décret du
28 juin 1979. Il est signé du Premier Ministre.
12. En France, le consentement du malade ne vaut
pas, à lui seul, autorisation d’intervenir sur son
corps.
13. Article 37 : “En toutes circonstances, le méde-
cin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son
malade, l’assister moralement et éviter toute obsti-
nation déraisonnable dans les investigations ou la
thérapeutique”.
14. Article 38 : “Le médecin doit accompagner le
mourant jusqu’à ses derniers instants, assurer des
soins et mesures appropriées à la qualité d’une vie
qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et
réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de pro-
voquer délibérément la mort”.
15. Le Gueut-Develay M. Référence citée.
16. Sebag-Lanöe R. Au nom de quoi développer les
soins palliatifs ?. In : Mourir en société. Op. cit., p. 52.
17. CCNE : http://www.ccne-ethique.org/francais.
18. Ibid.
19. Ibid.
20. Caillavet H. Le Monde, 24 février 1987.
21. Proposition de loi relative au droit de mourir
dans la dignité, JO Sénat, n° 166, 26 janvier 1999.
22. Hocquard A. Op. cit., p. 41.
23. Ibid, p. 41-42.
24. Matray B. Nouvelles requêtes adressées à la
médecine : les soins de fin de vie et la demande de
mourir. In : Mourir en société, op. cit., p. 127.
25. Ibid., p. 127.
26. Caillavet H. Si la vie nous a été imposée, la mort
nous appartient. Elle, 6 octobre 2003.
27. Emmanuel Lévinas. Éthique et infini. Cité par
Suzanne Rameix. Fondements philosophiques de
l’éthique médicale. Paris : Ellipses, 1997, p. 132.
Scien ce et co nscie n ce
Le Courrier de colo-proctologie (IV) - n° 4 - oct.-nov.-déc. 2003
122
1
/
3
100%