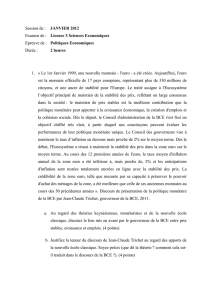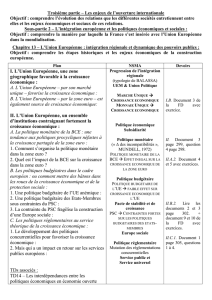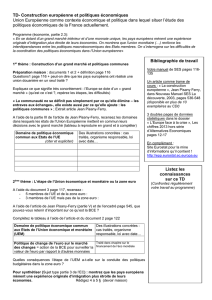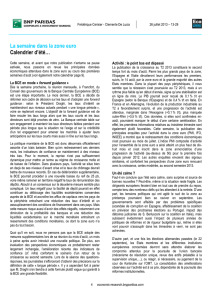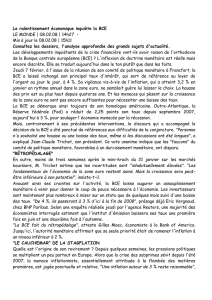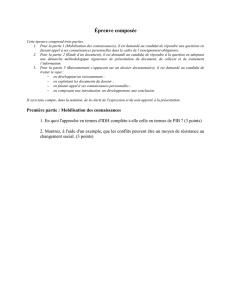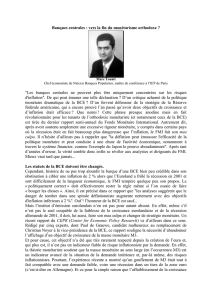La Banque centrale européenne change de tête.

Michel Aglietta
«La BCE fait preuve d'une grande inertie»
propos recueillis par Eric Chol
La Banque centrale européenne change de tête. Pour l'économiste Michel Aglietta, elle doit
aussi changer de politique
Jean-Claude Trichet, 60 ans, succédera officiellement au Néerlandais Wim Duisenberg, 68
ans, le 1er novembre prochain à la tête de la Banque centrale européenne (BCE). Nommé le
16 octobre dernier par le conseil des chefs d'Etat et de gouvernement pour un mandat de
huit ans, celui qui a gouverné pendant dix ans la Banque de France a déjà promis de
préserver l'héritage sur la crédibilité de la monnaie unique. Mais, cinq ans après sa création,
la BCE affiche un bilan mitigé: si l'euro s'est imposé sur la scène internationale, de nombreux
économistes reprochent aux argentiers de Francfort d'appliquer une politique trop restrictive,
dans un contexte de récession. C'est l'avis de Michel Aglietta, professeur d'économie à Paris
X-Nanterre et conseiller scientifique au Cepii. Interview.
La BCE n'a pas semblé très active jusqu'à présent pour stimuler l'économie européenne...
Dites plutôt qu'elle fait preuve d'une grande inertie! Les baisses des taux d'intérêt engagées
par la Réserve fédérale des Etats-Unis ont été deux fois plus importantes que celles
intervenues dans l'Union européenne. En 2001 et 2002, il y a eu des périodes assez longues
au cours desquelles la BCE n'a pas bougé ses taux alors que la dégradation de l'économie,
les difficultés financières et la montée de l'endettement des entreprises montraient
clairement la présence de forces récessionnistes.
«Un degré d'indépendance qui n'existe nulle part ailleurs»
Comment expliquez-vous cette inertie?
Elle vient en grande partie de la doctrine de la BCE, héritée de la tradition monétariste: celle-
ci stipule que la stabilité des prix est le seul objectif à mener. Or cette doctrine, adaptée aux
années 1970 ou 1980, période de forte inflation, se trouve en porte à faux avec le contexte
actuel. En réalité, l'inflation n'est plus un indicateur pertinent aujourd'hui. Elle est à la fois très
basse et très stable, indépendante de l'évolution du crédit et même du cycle économique. En
revanche, d'autres risques sont apparus. Mais la BCE a beaucoup de mal à les reconnaître,
car ils ne s'expriment pas directement par l'inflation.
La Réserve fédérale a-t-elle commis la même erreur d'analyse?
Non, car elle a procédé dès la fin des années 1980 à un changement de doctrine et a mis en
place une stratégie tournée vers la balance des risques dans le cadre d'un ciblage souple de
l'inflation. Ainsi, la Fed étudie les différentes menaces qui pèsent sur le système économique
et réagit par rapport à celle qu'elle a diagnostiquée comme étant la principale. Regardez
comment la Réserve fédérale a participé au sauvetage du fonds spéculatif LTCM en
septembre 1998: elle a inversé sa politique monétaire alors que l'économie, en forte
croissance, poussait à être restrictif. Elle a injecté massivement des liquidités dans les
marchés financiers parce qu'elle avait bien mesuré leur inquiétude. Voilà exactement ce que
la BCE ne fait pas.
Vous voyez d'autres différences entre les deux institutions?
Oui, dans les objectifs, notamment. Le statut de la Fed précise qu'elle doit se préoccuper de
la stabilité économique dans son ensemble. Elle est donc responsable de la croissance et du
plein emploi, pas uniquement du niveau des prix, ce qui l'amène à interpréter largement sa
mission. Il y a une autre différence de taille, que l'on oublie souvent. La BCE peut conduire
sa politique avec un degré d'indépendance qui n'existe nulle part ailleurs, car elle n'a pas de
comptes à rendre dans un processus institutionnel. Le Parlement européen ne joue pas du

tout le même rôle que celui du Congrès américain à l'égard de la Réserve fédérale. En
conséquence, la BCE est seule avec elle-même dans le jugement qu'elle va porter et dans la
conduite de la politique monétaire qu'elle va mener. Elle dépend donc d'autant plus de sa
communication qu'elle n'est pas responsable devant une institution souveraine que serait un
parlement.
La BCE souffre-t-elle d'autres dysfonctionnements?
Oui, dans son processus de décision. Dans des situations financières perturbées, les
autorités monétaires doivent prendre des décisions d'urgence, et éventuellement changer de
cap. Or l'Europe est composée de pays affichant des situations très hétérogènes. D'un côté,
l'Espagne, en croissance; de l'autre, l'Allemagne, au bord de la récession. Naturellement, les
banquiers centraux qui siègent à la BCE ne vont pas à Francfort en tant que représentants
de leur pays, mais ils sont complètement imprégnés de contextes nationaux souvent
contradictoires. Dans ces conditions, la recherche du consensus crée une inertie, la voie
moyenne étant toujours privilégiée. Sans parler de la difficulté de renverser un consensus
une fois que celui-ci a été établi. Or la voie moyenne peut être une erreur dans des
conditions de stress financier. La notion de balance des risques - dont je parlais tout à
l'heure - qui est caractéristique de la Fed, exige que dans certaines situations on ne suive
pas une voie moyenne, mais qu'on regarde là où est le risque prépondérant.
Tous ces handicaps auxquels vous faites allusion n'étaient-ils pas prévisibles dès la création
de la BCE, en 1998?
De nombreux économistes avaient en effet prédit qu'il serait très difficile de gérer une zone
monétaire dans laquelle n'existe ni gouvernement économique ni coopération budgétaire.
Mais tant que l'Union a connu une croissance suffisante, entre 1997 et 2000, les divergences
ont été amorties. Au contraire, dans la stagnation, les politiques de soutien de la demande
par la monnaie et par les budgets sont très insuffisantes pour contrecarrer le repli des
entreprises qui doivent éponger les excès d'endettement passés. L'Union tourne le dos au
keynésianisme alors que, paradoxalement, les Etats-Unis, tout en se disant opposés aux
thèses de Keynes, font preuve de beaucoup plus de pragmatisme...
Pensez vous que l'arrivée de Jean-Claude Trichet à la tête de la BCE préfigure un
changement de cap?
Non, car il est sorti du même moule que son prédécesseur Duisenberg. Il est obsédé,
notamment pour la France, par les questions de compétitivité et d'inflation.
L'inertie que vous dénoncez ne risque-t-elle pas de s'accentuer avec l'élargissement de
l'Union?
C'est bien pour cette raison qu'on ne pourra pas échapper à une révision du processus de
décision, en donnant plus de pouvoir aux membres issus de la BCE dans le conseil de
politique monétaire, qui devrait être plus restreint. On pourrait, comme aux Etats-Unis,
instaurer des votes tournants des gouverneurs nationaux, sauf pour les pays les plus
importants. Il n'est plus possible que des pays de 3 millions d'habitants et un pays de 80
millions comptent pour une voix.
Si l'on revient à la conjoncture, la BCE devrait-elle encore réduire les taux?
Oui. Vu la situation de l'économie, marquée par un sous-emploi général, non seulement de
la main-d'œuvre, mais de toutes les capacités de production, il faudrait que nos taux d'intérêt
réels soient négatifs. Pour cela, il faudrait abaisser les taux nominaux jusqu'à 1%.
Sur le front des changes, l'Union doit aussi faire face à la baisse du dollar...
Il est clair qu'une hausse de l'euro est un désastre dans le contexte actuel de récession. Or
les intérêts, de chaque côté de l'Atlantique, sont aujourd'hui totalement opposés. Les
Américains ont absolument besoin d'une baisse du dollar, et nous d'une baisse de l'euro. Or
que fait la BCE? Elle reste dans une situation d'expectative, de non-interventionnisme: son

discours sur l'euro est teinté de fatalisme. La vérité, c'est que, avec une appréciation de
l'euro, des taux d'intérêt trop élevés et une économie en récession, l'Union ne possède
certainement pas la meilleure combinaison.
Economie européenne : y a-t-il un pilote dans l'avion?
par Corinne Lhaïk
Une banque centrale trop puissante et trop indépendante, des Etats affaiblis, une
coordination déficiente? Cinq experts discutent de la gouvernance de la zone euro
Quand on détient le pouvoir, on suscite les critiques. A l'aune de ce constat, la Banque
centrale européenne (BCE) est clairement en position de domination! La contestation
change d'objet - aujourd'hui, elle vise sa supposée indifférence tantôt face à l'appréciation de
l'euro, tantôt face à la dégradation de la conjoncture - mais le reproche est toujours le même:
la banque serait obsédée par la lutte contre l'inflation et insensible aux vrais problèmes, la
croissance et l'emploi. En réalité, le procès de l'hyperpuissance de Francfort est celui de
l'impuissance des gouvernements à mener une politique économique européenne.
Pour agir sur la conjoncture, les Etats disposent traditionnellement de deux armes: la
politique monétaire et la politique budgétaire. La monnaie et le budget sont, par essence,
deux activités régaliennes. Mais elles peuvent aussi servir d'instruments d'action sur
l'économie. Exemple: en augmentant les taux d'intérêt, la banque centrale d'un pays protège
sa monnaie de l'inflation (activité régalienne), mais cette même décision peut ralentir l'activité
(le crédit, plus coûteux, devient plus rare). Et favoriser l'appréciation de la monnaie face aux
autres devises (les capitaux sont attirés par des taux d'intérêt plus élevés). Même
raisonnement pour le budget: l'Etat doit prélever des impôts pour assurer les dépenses
publiques (rôle régalien), mais, s'il alourdit la ponction fiscale à un moment de déprime, il
aggrave la conjoncture. De plus, les politiques budgétaire et monétaire agissent l'une sur
l'autre, et l'Etat doit trouver le bon policy mix - entendez le bon dosage - entre les deux.
La construction européenne a bouleversé cette architecture classique. En créant la monnaie
unique, les 12 Etats de la zone euro se sont dotés d'une politique monétaire fédérale, menée
de Francfort par la BCE. Une institution indépendante d'un pouvoir politique européen...
quasi inexistant. Les politiques budgétaires, elles, restent de la responsabilité des Etats.
Avec cette restriction de taille: le pacte de stabilité, qui limite les déficits publics à 3% du
produit intérieur brut. Cette organisation asymétrique suscite de nombreuses critiques de la
BCE. Mais elles visent également ce pacte de stabilité dont on dénonce à la fois la rigidité et
l'inefficacité: le 25 novembre 2003, le Conseil des ministres européens des Finances décidait
de dispenser la France et l'Allemagne des sanctions que le dérapage de leurs finances
publiques appelait. La Commission a porté l'affaire devant la Cour de justice européenne, ce
qui fait dire à Jean-Marc Daniel, professeur d'économie à l'ESCP-EAP, que «faute de
gouvernement, l'on risque d'en passer par le gouvernement des juges». Si les cinq experts
sollicités par L'Express constatent, presque unanimes, ce défaut de gouvernance de
l'Europe, tous ne le déplorent pas. Voici leurs critiques et leurs solutions.

Jean-Paul Fitoussi, Président de l'Observatoire français des conjonctures économiques
(OFCE)
«La croissance semble n'intéresser personne»
Longtemps j'ai pensé que l'Europe n'avait ni politique ni gouvernement économiques. Puis je
me suis rendu compte d'une cohérence politique, d'inspiration libérale, fondée sur la stabilité
des prix et des finances publiques et sur la concurrence. Pour les libéraux, ce sont là les
moyens d'atteindre la croissance et l'emploi. Aussi existe-t-il, de fait, un «gouvernement»
européen, qui comporte trois membres: un ministre de l'Activité, c'est le président de la
Banque centrale européenne (BCE), puisqu'en fixant le niveau des taux d'intérêt il
conditionne celui de l'activité économique; un ministre de la Concurrence, c'est le
commissaire européen du même nom; un «secrétaire d'Etat à la Surveillance budgétaire»,
c'est le commissaire chargé des Affaires économiques à Bruxelles. La croissance semble
n'intéresser personne, puisque aucune institution fédérale n'en a la charge.
De ces trois ministres, le plus puissant et le plus indépendant est le président de la BCE.
Celle-ci a le pouvoir de sanctionner les gouvernements si elle estime qu'ils ne conduisent
pas la bonne politique, par exemple s'ils ne réduisent pas assez leurs déficits budgétaires,
mais l'inverse est impossible. Au point que se pose la question du caractère démocratique
des institutions européennes. Normalement, l'indépendance d'un organisme est relative:
créé par le Parlement, il peut être défait par lui. La BCE échappe à cette règle, puisqu'elle ne
rend de comptes à personne et que nul ne peut changer ses statuts, sauf si l'on modifie le
traité de Maastricht. Une fois de plus, l'on bute sur l'absence de gouvernement politique en
Europe et sur ce paradoxe: d'un côté, des politiques fédérales (monétaire et concurrence)
conduites par des institutions sans responsabilité politique; de l'autre, des dirigeants
politiques sans pouvoir fédéral. A force d'avoir rendu l'Europe non démocratique, on risque
de rendre la démocratie allergique à l'Europe. En attendant un gouvernement européen -
autant dire en attendant Godot - il faudrait introduire trois changements. La mission de définir
l'objectif d'inflation de la BCE devrait appartenir au politique, comme c'est le cas au
Royaume-Uni. Faute de gouvernement européen, ce rôle pourrait échoir au Parlement.
Ensuite, les dépenses d'investissement devraient être exclues du calcul du déficit budgétaire
pour donner plus de marges de manœuvre aux gouvernements nationaux. Enfin, le Conseil
européen devrait définir la doctrine de la concurrence au lieu de laisser cette tâche à la
Commission. Trois injections de démocratie, en somme.
Christian de Boissieu, Président délégué du Conseil d'analyse économique (CAE)
«La BCE fait preuve d'un certain pragmatisme»
L'Europe ne souffre pas d'une banque centrale trop forte, mais d'une gouvernance
économique trop faible. Le seul élément qui donnait un peu de contenu à cette gouvernance,
c'était le pacte de stabilité: or son application a été remise en question par les Etats de la
zone euro. Aujourd'hui on a donc une monnaie unique, mais sans coordination économique.
La construction européenne s'est effectuée selon la théorie du vélo: tant qu'on pédale, on
avance. Le problème est que, après avoir fait l'euro et la banque centrale qui va avec, on
s'est arrêté de pédaler, laissant l'intégration politique en panne. Elle se fera, mais cet
accouchement sera difficile et long.
Pour l'heure, je ne suis pas de ceux qui jugent la banque centrale trop puissante: son
indépendance est indispensable à sa crédibilité. Je ne pense pas non plus qu'il soit
nécessaire de modifier son mandat. La BCE a pour objectif principal la stabilité des prix. Le
mot «principal» montre qu'il ne s'agit pas d'une mission exclusive, comme on a trop
tendance à le dire. De plus, la banque centrale sait faire preuve d'un certain pragmatisme,
puisque depuis mai 2003 elle a montré qu'elle était soucieuse du risque non seulement
d'inflation, mais aussi de déflation. Il serait bon qu'elle continue dans cette voie. Pour autant,

cette institution est celle qui a le plus de pouvoir en Europe - n'oublions pas qu'elle prend ses
décisions à la majorité simple. Elle devrait rendre plus de comptes. Par exemple, en publiant
les minutes de son conseil des gouverneurs quelques semaines après la prise de décision,
comme cela se fait aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Une politique monétaire me paraît
d'autant plus efficace qu'elle est partagée et transparente.
Il faut, par ailleurs, améliorer le dialogue entre la banque centrale et les ministres de
l'Economie et des Finances. Depuis la création de l'euro, en 1999, il règne entre eux un
climat de méfiance. Par exemple, à plusieurs reprises, la BCE n'a pas baissé ses taux pour
éviter de donner le sentiment de céder à la pression des politiques qui le lui demandaient!
A l'inverse, ces derniers ont pu être tentés de laisser filer leurs dépenses publiques afin de
compenser une politique monétaire jugée par eux trop rigoureuse. Tout cela n'est pas très
coopératif. Pour y remédier, il faudrait donner un vrai pouvoir à l'Eurogroupe [la réunion
aujourd'hui informelle des 12 ministres des Finances de la zone euro]. C'est une proposition
intéressante du projet de convention de Valéry Giscard l'Estaing, même si on lui a souvent
adressé le reproche de ne pas aller très loin dans la construction d'une gouvernance
économique.
Charles Wyplosz, professeur d'économie à l'Institut universitaire de hautes études
internationales, à Genève
«Il faut réviser le pacte de stabilité»
Que l'Europe n'ait pas de gouvernement économique ne me paraît pas bien grave. Parce
que le coût politique d'un tel gouvernement serait excessif en regard du bénéfice qu'il
apporterait. Pour le réaliser, il faudrait une complète coordination des politiques budgétaires
à laquelle les opinions publiques ne sont pas prêtes; or les vertus d'une telle unification
seraient bien minces tant le budget d'un pays a peu d'incidences sur l'économie de ses
voisins. Toutefois, si les politiques budgétaires doivent rester nationales, il faut
complètement réviser le fonctionnement du pacte de stabilité: celui-ci doit permettre d'éviter
la faillite d'un pays, et non pas brider sa croissance! Certes, le niveau d'endettement français
est inquiétant, mais ce n'est pas pendant les périodes de ralentissement qu'il faut le réduire.
Un pacte intelligent devrait fixer des objectifs de dette (et non de déficits), variables par pays.
Ensuite, chaque Etat créerait une institution nationale, indépendante, qui déterminerait le
déficit permettant d'atteindre ce niveau de dette. En revanche, il était nécessaire d'unifier la
politique monétaire, tant les pays sont dépendants les uns des autres en ce domaine. Et cela
ne fonctionne pas si mal. La BCE n'a guère commis d'erreurs, même si elle aurait pu baisser
un peu ses taux d'intérêt pour freiner l'appréciation de l'euro. Toutefois, cela n'aurait pas
changé grand-chose, car il est difficile, dans un système de change flexible, de contrôler le
niveau relatif des monnaies. Pour améliorer le fonctionnement de la BCE, il faudrait qu'elle
puisse, si nécessaire, être sanctionnée par le Parlement européen; c'est ce dernier qui
devrait déterminer son objectif d'inflation, et non pas elle-même
Gilles Saint-Paul, professeur d'économie à l'université de Toulouse I
«La croissance et l'emploi ne se décrètent pas»
L'indépendance de la Banque centrale européenne n'est pas plus grande que celle de son
homologue américaine, la Réserve fédérale, capable de mener des politiques qui déplaisent
au pouvoir. La pratique des affaires monétaires par la BCE n'est pas particulièrement
restrictive, puisque l'inflation a toujours été supérieure dans la zone euro à la limite maximale
qu'elle s'est fixée, soit 2%, et que les taux d'intérêt sont à peine plus élevés. Sa politique de
change ne me paraît pas davantage condamnable, car, pour l'instant, l'euro n'est pas trop
fort. Certes, l'appréciation excessive d'une monnaie peut détruire une partie du tissu
industriel. Mais nous n'en sommes pas là! De toute façon, la croissance et l'emploi ne se
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%