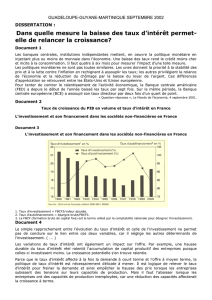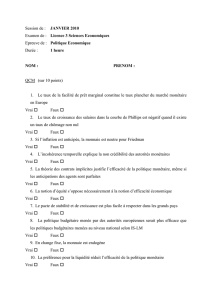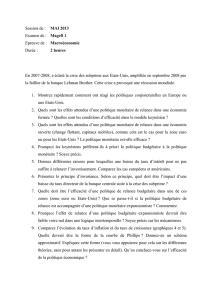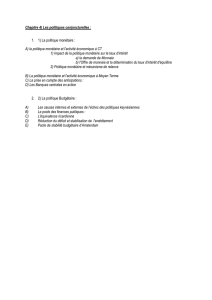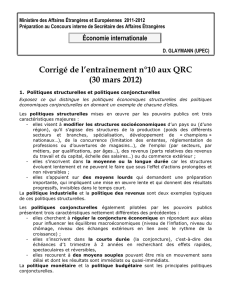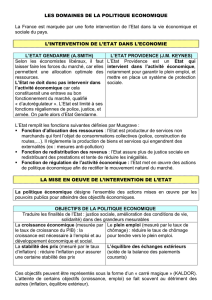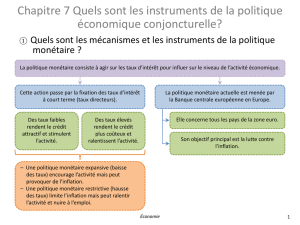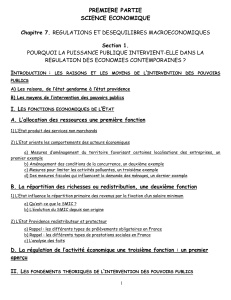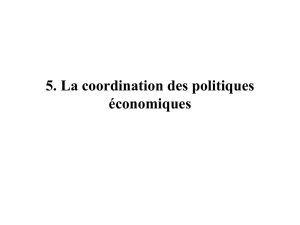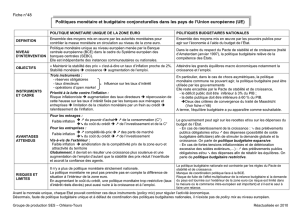Policy mix USA - Eternautes.com

Le policy mix aux États-Unis
L’expression policy mix souvent utilisée par les économistes ou les analystes de marché désigne les
combinaisons de politiques monétaires et budgétaires en vigueur sur un pays ou une zone donnée. Plus
largement, la détermination du policy mix rejoint la volonté de traduire les interdépendances entre les
différents aspects de la politique économique, comme Robert Mundell en avait déjà eu l’intuition en 1960
à propos des politiques de change. Ordinairement rattaché aux théories néokeynésiennes, le choix du bon
policy mix était un passage obligé des politiques économiques dans les années 60. Beaucoup moins
compatible avec les marges de manœuvre économique en Europe dès les années 70, l’idée d’un bon policy
mix est toujours restée un élément du débat aux États-Unis, avec une grille d’analyse plus complexe et
moins directement keynésienne. La politique économique des États-Unis se prête en tout état de cause
particulièrement bien à une explication par son policy mix. Les évolutions du budget américain et des taux
d’intervention de la Federal Reserve Bank (FED) sur ces toutes dernières années relancent ce débat à
propos d’un pays qui tire parti de son poids économique et de la position particulière de sa monnaie sur les
marchés mondiaux. Par contraste, la question du policy mix souligne les difficultés de l’Europe à
déterminer sa propre politique économique et surtout à s’en donner les moyens.
1. LE POLICY MIX COMME MOYEN POUR UN ETAT DE SOUTENIR LA DEMANDE ET
REVENIR AU PLEIN EMPLOI A ETE AU CŒUR DES PRINCIPAUX DEBATS
ECONOMIQUES TANT THEORIQUES QUE PRATIQUES
1.1. Le policy mix, concept à l’origine issu de la théorie keynésienne, trouve jusqu’à aujourd’hui des
applications pratiques, notamment aux États-Unis
Le concept de policy mix est entendu au sens large à savoir l’ensemble des combinaisons possibles entre
politique budgétaire et politique monétaire. Le principe général est que l’utilisation conjointe des
politiques monétaires et budgétaires peut servir différentes stratégies économiques selon la situation
initiale dans laquelle se trouve le pays. La coexistence d’un soutien budgétaire et d’un soutien monétaire
constitue sans doute le cas de politique mixte le plus connu. Il s’agit d’éviter une forme d’effet d’éviction
lié aux variations du taux d’intérêt et ainsi de retrouver les résultats obtenus dans un modèle keynésien
élémentaire. L’effet d’éviction ici en cause consiste en ce qu’une politique budgétaire menée seule
augmente la demande de monnaie alors que l’offre de monnaie est exogène et donc stable : le taux
d’intérêt augmente, ce qui a pour effet de déprimer l’investissement et donc la demande. Keynes
préconisait de résoudre ce décalage entre demande et offre de monnaie par une politique monétaire
d’accompagnement et cette double action de relance de la demande a fait la fortune de l’expression policy
mix. Avec ce double soutien, l’effet obtenu sur le revenu est plus élevé que dans le cas d’une utilisation
isolée de chaque instrument et beaucoup plus limité sur le taux d’intérêt. Il ressort du modèle que l’on peut
toujours augmenter l’efficacité de la politique budgétaire par une politique monétaire complémentaire sans
craindre l’inflation. Cette vue optimiste résulte de l’hypothèse d’élasticité parfaite de l’offre qui permet la
stabilité des prix.
La politique macroéconomique n’a vraiment fait l’objet d’une véritable analyse théorique qu’après la fin
de la seconde guerre mondiale et après la mort de Keynes. Les principes des politiques keynésiennes
furent notamment développés dans la « synthèse néoclassique » de Paul Samuelson, et inspirèrent les
politiques économiques des années 60. Une vision aussi strictement keynésienne a trouvé peu
d’application pratique réussie, et il faut aller assez loin dans l’histoire pour en trouver une illustration.
L’Amérique du début des années 1960 (1961-1965) a combiné soutien budgétaire et soutien monétaire
(relance Kennedy-Johnson). Les résultats furent positifs pendant quatre ans permettant à la fois de
dynamiser la croissance (5 % de croissance entre 62 et 66 contre 2,4 % entre 1953 et 1961) et de retrouver
une situation de quasi-plein emploi (taux de chômage inférieur à 4 % en 1966). La flexibilité de l’offre et
une situation initiale de sous-emploi permirent de ne pas observer de tensions inflationnistes au sein de

cette économie. Cet exemple reste sans doute l’un des seuls cas de relance keynésienne parfaitement
réussie.
Le policy mix peut aussi correspondre à des stratégies croisées, par exemple de relance budgétaire et de
rigueur monétaire, de sorte à en limiter les effets inflationnistes. La coexistence d’une relance budgétaire
et d’un freinage monétaire entraîne une forte hausse des taux d’intérêt et un effet limité sur le revenu. Les
deux instruments cumulent leurs effets pour pousser le taux d’intérêt à la hausse puisque l’offre de
monnaie est réduite par la politique de rigueur monétaire alors que dans le même temps la demande de
monnaie augmente du fait de la politique budgétaire expansionniste.
L’économie américaine du début des années 1980 fournit un assez bon exemple de ce type de politique
mixte. Le soutien budgétaire délibéré lié surtout aux allégements fiscaux a été très important (baisse
continue du solde structurel des administrations publiques de – 0,5 % du PIB en 1981 à – 3,3 % en 1986).
Dans le même temps, à la suite du retournement de 1979 (G5) la politique monétaire a été restrictive (taux
d’intérêt élevé entre 1982 et 1984 : les taux courts oscillent entre 8,5 et 10,5 %, les taux longs entre 11 et
13 %). Au total, l’effet de relance budgétaire l’a emporté sur la rigueur monétaire, d’autant que l’afflux de
capitaux a facilité le financement des déficits. La croissance du PIB de 5,2 % entre 1983 et 1985 a été
entraînée par la demande sous l’effet de la politique budgétaire. Des mécanismes keynésiens ont été
visiblement à l’œuvre au sein de cette économie peu ouverte, dans le cadre d’une politique pourtant
pensée par des économistes de l’offre. La stratégie allemande de 1990-1991 - pour répondre au choc de la
réunification - constitue un autre exemple de ce type de politique mixte.
1.2. Plusieurs phénomènes sont venus contrarier profondément la mise en place de policy mix visant
à soutenir la demande
Tobin (1983) en résumant les grands principes de la politique économique keynésienne souligne la
recherche de cohérence de la politique budgétaire et de la politique monétaire dans la poursuite des
objectifs macroéconomiques, à travers un policy mix approprié mais il reconnaît dans le même temps que
la politique budgétaire et la politique monétaire ne sont pas nécessairement suffisantes pour réaliser à la
fois le plein emploi et la stabilité des prix. Les keynésiens reconnaissent l’utilité d’une troisième catégorie
d’instruments, qui relève de l’action structurelle, et notamment l’ensemble des moyens (persuasion,
négociation, législation, réglementation, fiscalité) par lesquels le gouvernement peut influer sur
l’évolution des prix et des salaires.
Ces principes sont généralement acceptés dans les années soixante et soixante-dix et inspirent plus ou
moins fortement les politiques économiques nationales. Certains pays (Allemagne, notamment) y restent
néanmoins rebelles, en raison à la fois d’un attachement plus grand à la stabilité des prix et d’une plus
grande défiance à l’égard de l’intervention étatique. C’est à partir des années 70 que les principes
keynésiens ont subi l’assaut de la « nouvelle économie classique » et de l’école des anticipations
rationnelles, sur un fond d’échec relatif des politiques de demande, qui ont alors conduit, dans le contexte
du premier choc pétrolier, à la persistance de l’inflation et du chômage.
La nécessité de lutter contre une inflation sans cesse plus forte renforce les thèses classiques et
monétaristes. Pendant les années 80, les banques centrales apparaissent de plus en plus comme les
gardiennes du temple, capables par la rigueur de leurs objectifs quantitatifs d’imposer la désinflation aux
économies industrialisées, après des années de forte inflation. L’attention se porte sur la crédibilité de la
politique monétaire. L’objectif de stabilité durable des prix conduit à protéger la politique monétaire des
choix du gouvernement, en rendant la banque centrale indépendante et en excluant les financements
monétaires des déficits publics. Les économies industrialisées découvrent l’importance des chocs d’offre
(notamment les chocs pétroliers de 1973/1974 et 1979), auxquels les politiques keynésiennes apportent
une réponse très peu satisfaisante. Les gouvernements ont trop usé de la facilité budgétaire, et
l’accumulation des déficits publics a conduit à une montée de la dette publique qui fait peser des doutes

sur la solvabilité des États et ôte toute marge de manœuvre à l’activisme budgétaire. L’attention se porte
davantage sur les distorsions liées au poids élevé de la fiscalité et sur les coûts de transactions suscités par
l’inefficacité de l’État.
Enfin, certains avancent que les capacités d’anticipation des opérateurs économiques annulent les actions
des gouvernements, selon par exemple l’idée que les emprunts d’aujourd’hui sont les impôts de demain
(Barro 1974). Deux phénomènes sont également venus compléter cette panoplie de handicaps, mais
auxquels les États-Unis ont été comparativement moins sensibles que leurs partenaires. La relance
budgétaire souffre le risque d’une éviction par les exportations, d’autant plus que l’ensemble des
producteurs mondiaux répondent plus vite à la demande que les entreprises du seul pays qui pratique la
relance. Ce risque s’est accru avec l’ouverture croissante des économies aux commerce international
depuis les années 60, mais les États-Unis, beaucoup moins ouverts que les autres pays de par la taille de
leur marché, y sont moins sensibles.Enfin, dans un contexte où l’on vise dès lors à éviter toute dévaluation
excessive de sa monnaie, le soutien de la conjoncture par une baisse des taux d’intérêt devient difficile :
les capitaux étant très mobiles entre les pays, l’attractivité de la monnaie nationale diminue
immédiatement et son taux de change aussi. Le statut international du dollar, l’attractivité du marché de
capitaux nord-américain réduit considérablement cet inconvénient.
2. LE POLICY MIX AMERICAIN SE CARACTERISE PAR UN GRAND PRAGMATISME,
FACILITE PAR LA SITUATION PREPONDERANTE DES ETATS-UNIS ET UN CERTAIN
CONSENSUS AUTOUR DE LA PLACE DE L’ECONOMIE
2.1. Le policy mix américain sur ces vingt dernières années
La politique de l’administration Reagan (1981- 1988) a représenté une véritable rupture avec la
période précédente. Elle a consisté :
- en une politique monétaire très résolue à réduire l’inflation à partir de la nomination de Paul Volcker
comme président de la Réserve fédérale en octobre 1979. Cette politique a été notamment marquée par des
taux d’intérêt réel très élevés en début de période (6,2 % sur la période 1980- 1984). Techniquement, la
méthode utilisée s’inspira des travaux de William Poole (1970) qui préconisait en l’occurrence un contrôle
de l’agrégat monétaire. Dans un contexte d’innovations financières multiples, la demande de monnaie se
révéla très difficile à maîtriser, mais permit de justifier la pratique de taux d’intérêt supérieurs à 20 %.
Depuis, le jeu direct sur les taux d’intérêt reste l’instrument privilégié des banques centrales, plutôt que de
viser un objectif de masse monétaire en réalité très difficile à contrôler ;
- en une expansion budgétaire du fait d’un accroissement des dépenses militaires ;
- en une « révolution de l’offre », comprenant notamment une baisse des impôts, et visant à réduire le
poids du gouvernement en éliminant le gaspillage et en réduisant son implication dans l’économie. Pour
les économistes de l’offre (Arthur Laffer), les baisses d’impôt devaient s’autofinancer, de sorte que le
budget reviendrait rapidement à l’équilibre. La politique de l’administration Clinton à partir de 1993 n’a
pas marqué de changement de doctrine en ce qui concerne le rôle de l’État, mais elle a engagé la réduction
du déficit public en arrêtant les baisses d’impôt et en contrôlant les dépenses. L’objectif a été facilité par
l’accélération de la croissance à partir du milieu de la décennie, liée à la hausse de la productivité
tendancielle, elle même déclenchée par un investissement massif dans les nouvelles technologies («
nouvelle économie »). Il a été accompagné par une Réserve fédérale qui a « fait confiance à la croissance
» en dépit de la baisse du chômage en deçà des estimations de l’époque du Nairu, et donc potentiellement
inflationniste. Dans la seconde moitié des années 90, qui s’achève en 2000, les États-Unis semblent avoir
résolu, au moins temporairement, le problème macro-économique consistant à placer l’économie au plein
emploi, dans un contexte de stabilité des prix et de budget équilibré.

2.2. Le policy mix américain actuel est marqué par la combinaison d’une politique budgétaire très
active et d’une politique monétaire de soutien à l’activité
Le début de la présidence de George W. Bush a été marqué par un fort ralentissement de la croisance,
d'abord d'origine interne (du fait notamment d'un excès d'investissement dans les NTIC et de la correction
des cours boursiers) puis mondial, aggravé par les conséquences du 11 septembre. Face à ce
ralentissement, le président a fait voter un premier paquet budgétaire comportant des baisses d’impôts
pour les ménages, puis a proposé à la fin 2002 un deuxième paquet prévoyant notamment la fin de la
double taxation des dividendes. L’année 2002 a également été celle de l'abandon de facto de la politique
du dollar fort, avec une baisse de près de 20 % L’effet conjugué du ralentissement économique et de la
forte impulsion budgétaire explique la dégradation du solde public, d’un excédent de 2,3 % du PIB en
2000 à un déficit de 3,4 % du PIB en 2002 (toutes administrations publiques confondues). Il pourrait
atteindre 4,9 % en 2003 et 5,3 % en 2004.
Depuis l’entrée en récession en mars 2001, pas moins de trois plans de relance ont été votés : l’Economic
Growth and Tax Relief Reconciliation Act en juin 2001 (EGTRRA, 1 350 milliards de dollars de baisses
d’impôts sur 10 ans, visant essentiellement les ménages) ; le Job Creation and Worker Assistance Act en
mars 2002 (tourné vers les entreprises) ; le Jobs and Growth Tax Reconciliation Act fin mai 2003.
Contenant initialement environ 700 milliards de réductions d’impôts sur 10 ans, ce plan après vote par le
Congrès le 24 mai a été réduit de moitié et vise à la fois les ménages (surtout les plus aisés) et les
entreprises. Rompant avec la doctrine Clinton (nécessité d’équilibrer les finances publiques pour soutenir
la croissance à long terme), la doctrine de G. W. Bush est dans la droite ligne de celle des théoriciens de
l’offre (les réductions d’impôts soutiennent la croissance par le biais de la stimulation du travail et de
l’innovation). Durant la même période, la politique monétaire suivit une stratégie convergente de soutien à
l’activité : de 6,5 % début 2001, le taux directeur de la Réserve fédérale fut abaissé jusqu’à 1 % en 2003),
soit un taux d’intérêt réel négatif d’environ – 1 % compte tenu de l’inflation et qui traduit pour le moins
une politique monétaire expansionniste. Cela dit, les effets de la crise de surinvestissement qui a débouché
sur l’éclatement de la bulle Internet sont longs à se résorber et la détente sur l’ensemble des taux du
marché ne se fait concrètement sentir que depuis le début de l’année 2003. Enfin, la dépréciation induite
du dollar vient renforcer l’ajustement du déficit courant et le soutien à l’activité. Le tassement des
rendements effectifs et anticipés des actifs américains consécutif à l’éclatement de la bulle Internet est la
principale cause de la dépréciation du dollar, qui est donc avant tout économique. Les prêteurs ont pris
conscience de l’importance disproportionnée de ces actifs dans leurs portefeuilles. Leur recomposition
s’est traduite par une chute des flux nets entrants d’investissements directs, des achats nets d’actions et par
des entrées nettes de capitaux courts. En tout état de cause le policy mix américain est passé d’un état
plutôt restrictif en 2000 à un état franchement expansionniste en 2003.
Le taux de croissance n’est pas encore tout à fait à la hauteur des efforts consentis. Le mécanisme du
multiplicateur ne s’est que partiellement enclenché. En effet la reprise provient surtout de la
consommation des ménages, mais l’investissement des entreprises n’a recommencé à apporter une
contribution positive à la croissance qu’à partir de la fin 2002, pour prendre réellement son essor en 2003,
s’appuyant sur le retour de la rentabilité : les bénéfices des entreprises de l’indice S&P500 ont augmenté
de 21 % au troisième trimestre 2003 et devraient être équivalents pour le dernier trimestre.
Surtout cette reprise marquée par de forts gains en productivité laisse le taux de chômage américain
relativement élevé (6,4 % en 2003) ce qui pèse sur les revenus et la consommation. Un an après la sortie
de récession (mi-2001 telle qu’enregistrée par le comité NBER), l’économie américaine continuait de
perdre des emplois. Cela dit, la reprise des investissements à la fin 2004 laisse penser que l’investissement
va prendre le relais de la consommation dans le soutien à la demande et incite les prévisionnistes à estimer
que la croissance en 2004 pourrait dépasser 2,7 %, soit le potentiel de long terme de l’économie
américaine. Les prévisions les plus optimistes atteignent même 3,5 %, voire 4 %, d’autant que 50 milliards
de dollars de remises fiscales, soit 0,5 % du PIB sont attendues pour le premier trimestre 2004.

2.3. Des leçons pour l’économie européenne ?
Le policy mix américain, volontairement expansionniste, mêlant effets keynésiens directs (budgets
militaires), accompagnement monétaire (nécessitant toutefois d’être soutenu par un discours offensif dans
la lutte contre l’inflation), politique de l’offre (cadeaux fiscaux, encouragement à la R&D) semble être
parvenu à combler rapidement les effets du choc de la récession consécutive à la bulle Internet.
Contrastant avec ce volontarisme, l’Europe a préféré un stimulus modeste aussi bien sur le plan budgétaire
que monétaire, privilégiant la poursuite de la réduction des déficits et le respect du plafond d’inflation de 2
% fixé par la BCE, et mettant plutôt l’accent sur les réformes nécessaires du côté de l’offre (flexibilisation
du marché du travail, libéralisation des industries de réseau, etc., dans le cadre de la stratégie dite de
Lisbonne). Cette approche a trouvé ses limites dès 2002 avec l’impossibilité manifeste de certains États de
la zone euro (notamment l’Allemagne qui représente 30 % du PIB de la zone) de respecter leurs
engagements budgétaires. Pourtant, à bien des égards, l’Europe se trouve dans une position économique
comparable à celle des États-Unis :
Un taux d’ouverture aux importations limité à 15 % réduit considérablement les risques d’éviction par les
importations ou d’inflation importée. Par ailleurs, la taille du marché européen est beaucoup plus
importante que celle de n’importe lequel de ses membres : la capacité à répondre rapidement à un surcroît
de demande est proportionnellement plus forte à l’échelle européenne qu’à l’échelle d’un seul pays.
L’euro n’a pas encore eu le temps d’acquérir le statut de monnaie de réserve comme le dollar, mais la
nécessité pour les opérateurs financiers de posséder de l’euro rend l’euro moins sensible aux variations de
taux d’intérêt à court terme que les ex-monnaies européennes : actuellement, un bon tiers des échanges
internationaux sont libellés en euros. Enfin, la critique la plus courante serait que ces politiques sont toutes
inflationnistes à des degrés divers, et voient leurs effets annulés par la hausse des salaires et des prix. La
force de l’Europe est justement d’avoir bâti un grand marché très concurrentiel : toute dérive sur les prix
ne peut être que limitée au plus juste. De plus, par la force même des choses, les fameux enchaînements
prix-salaires sont beaucoup moins rigides qu’ils pouvaient l’être il y a vingt ans. Néanmoins, les États-
Unis ont pu bénéficier de leur rigueur passée, notamment sous l’ère Clinton, où profitant de la forte et
durable croissance qui s’était installée, un désendettement public important avait pu être enregistré. Alors
que le poids de la dette publique est passé de 60 % du PIB en 1990 à plus de 70 % en 2001 dans la zone
euro, il a diminué de 62 % à 55 % sur la même période aux États-Unis, ce qui laisse une plus grande
marge de manœuvre budgétaire.
Plus largement, l’adoption d’un policy mix accommodant, voire expansionniste, n’est en rien une garantie
de relance de la croissance. La stratégie américaine a mis du temps à porter ses fruits, et seule l’année
2004 pourra confirmer sa validité, notamment en termes d’investissement industriel et de reprise de
l’emploi. Par ailleurs, le contre-exemple du Japon souligne qu’un policy mix délibérément expansionniste
depuis 1990 n’a pas empêché ce pays de connaître une stagnation de son économie depuis plus de dix ans.
Enfin, le policy mix américain se révèle très composite, car associant des stratégies néokeynésiennes de
soutien de la demande à des politiques de l’offre visant à favoriser les comportements d’entreprise. La
direction d’ensemble est en tout cas claire et affirme le primat de l’économie sur le social, vise la
croissance aujourd’hui, mais aussi de long terme comme l’attestent les nombreux soutiens à la R&D,
plutôt que la réduction des disparités de niveau de vie au travers des transferts de revenu. La mise en place
d’éventuelles réformes d’importance, dans le domaine de la sécurité sociale par exemple, se trouve en
effet reportée à plus long terme, au profit d’une stratégie globale de reconquête de la croissance.
Retour sur le site
1
/
5
100%